Il y a trente ans, en janvier 1991, Philippe Sollers publie La Fête à Venise. Milan Kundera en rend compte dans le Nouvel Observateur.

Le Nouvel Observateur, février 1991.
ZOOM : cliquer sur l’image.

 Il faudra attendre vingt-cinq ans pour qu’une étude approfondie, due à Pascal Torrin, soit consacrée à ce roman. Elle a été publiée dans le numéro 136 de la revue L’Infini sous le titre Tout recommencer, sans cesse [1]. Lors de la publication du roman, Philippe Sollers s’entretenait avec l’écrivain Jean Ristat et définissait ainsi sa stratégie romanesque : « Mes romans procèdent presque toujours de la même manière : il y a de l’invivable et des personnages s’entendent secrètement pour que cela soit vivable, et ils construisent cela. Ce sont donc des récits de construction systématique de situations heureuses dans un monde malheureux et blâmable de l’être. »
Il faudra attendre vingt-cinq ans pour qu’une étude approfondie, due à Pascal Torrin, soit consacrée à ce roman. Elle a été publiée dans le numéro 136 de la revue L’Infini sous le titre Tout recommencer, sans cesse [1]. Lors de la publication du roman, Philippe Sollers s’entretenait avec l’écrivain Jean Ristat et définissait ainsi sa stratégie romanesque : « Mes romans procèdent presque toujours de la même manière : il y a de l’invivable et des personnages s’entendent secrètement pour que cela soit vivable, et ils construisent cela. Ce sont donc des récits de construction systématique de situations heureuses dans un monde malheureux et blâmable de l’être. »
L’entretien comporte deux parties :
 Parler la peinture
Parler la peinture
 Sade et l’école des femmes.
Sade et l’école des femmes.
1991, c’est aussi le moment de la première guerre du Golfe. L’opération Tempête du désert (Desert Storm) a lieu du 17 janvier au 28 février 1991. Nouvel entretien avec Jean Ristat en février : Un devenir mafieux. Face à « la mise en scène de la planète par le directeur de la chaîne américaine CNN » qui crée un véritable phénomène d’hypnose collective (on a fait mieux depuis), Sollers insiste : « Il faut prendre conscience de cette nouvelle prise en main du psychisme humain. » Cet entretien est strictement contemporain de celui donné au Magazine littéraire sous le titre Contre la grande tyrannie. A bon entendeur, salut !
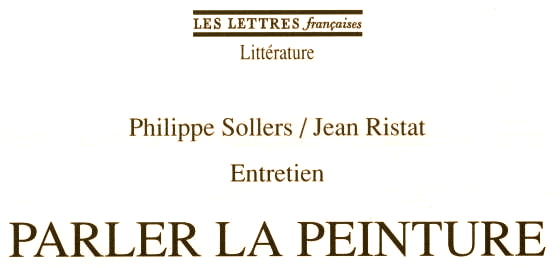
Jean Ristat : La fête à Venise est un roman. Il me semble qu’à partir de ce dernier livre publié on peut relire tous les ouvrages qui l’ont précédé, le Coeur absolu, le Lys d’or, les Folies françaises, Portrait du joueur, Femmes, les Surprises de Fragonard, le tout formant un ensemble cohérent, une entreprise ambitieuse : le roman comme encyclopédie et arche de Noé. Je reprends votre définition.
Le roman comme encyclopédie puisqu’il faut sauver, conserver, stocker, en attendant des jours meilleurs. Nous vivons un temps de barbarie, de régression. La littérature de notre époque, dites-vous, est à peu près nulle et la peinture d’une "laideur et d’une vulgarité qui sautent aux yeux". Bon, je dirais qu’il y a trois personnages dans votre livre : l’écrivain, le peintre, la femme. L’écrivain prend plusieurs figures ou masques : Stendhal par exemple. Le peintre s’appelle Watteau autour duquel se construit la fiction, mais aussi Monet ou Warhol. La jeune femme est "savante" : elle s’occupe d’astrophysique, littérature, peinture, sciences. Parlons de la peinture, pour commencer, je note cette phrase "la peinture dit la vérité". Cela mérite explication comme l’idée que la peinture a un chiffre. Pas seulement au sens du "business" mais aussi comme on dit d’une lettre ou d’un message qu’il est chiffré. Le W de Watteau — ou de Warhol — est une clef à l’aide de laquelle vous lisez, "déchiffrez" la société contemporaine.
Philippe Sollers : Je pars d’un constat : depuis une dizaine d’années, au grand jour, avec une brutalité toute puissante, la peinture est transformée en valeur spéculative et en bourse quasiment parallèle, permanente. Ceci n’a pas toujours été le cas. Sans remonter à l’époque classique où les transactions s’opèrent entre les peintres, les empereurs et l’église (voyez Le Titien), on peut considérer que, toujours, les peintres ont réussi à introduire leur chiffre, quelle que soit la commande, quel que soit le sujet (les Ménines de Velasquez ou la Vénus au miroir par exemple). Comme disait Lacan, en revenant d’Italie, "Toutes ces églises, ah quelle débauche d’obscénités" !
Cette situation de l’oeuvre d’art qui devient un objet susceptible de transactions, susceptible d’entrer dans une rotation par rapport à la plus-value généralisée, prend toute son ampleur au XXe siècle. Ce système, j’ai essayé de le décrire dans la Fête à Venise. Les ventes crépitent sans discontinuer. A la limite, le tableau ne bouge pas. Le prix monte sur place. Voyez ce qui s’est passé avec les Iris de Van Gogh ! Dans cet énorme marché mondial, de plus en plus, prédominent les vols, les falsifications, les opérations de commando, le pillage... Nous ne connaissons encore qu’une toute petite partie de l’iceberg, à la faveur, de temps en temps et presque par hasard, d’une affaire : une vieille dame meurt, sans nourriture et sans soin. On s’aperçoit alors que son Murillo a fait l’objet de tractations très étranges. Ou bien encore, un commissaire de police, une femme charmante au demeurant, doit passer par la mafia japonaise pour récupérer des Corot. On apprend ensuite qu’elle tombe sur une filière dont nous ne saurons rien pour y découvrir le tableau qui a donné son nom à l’Impressionnisme Impressions au soleil levant de C. Monet. Tout cela est un spectacle dont nous n’entrevoyons qu’une toute petite partie.
Je suis parti, pour écrire ce roman, la Fête à Venise, de ce constat. J’estime qu’il est inutile et démissionnaire d’écrire de la littérature qui n’a rien à voir avec la réalité sociale de son époque. Le chiffre de la peinture étonne tout le monde parce que la moindre bricole est achetée dix, quinze, voire cinquante fois plus que son estimation sur le marché. Ce chiffre de la peinture m’intrigue parce que cet emballement veut dire quelque chose : j’emploierai donc pour en parler les termes forts d’usage (valeur d’usage, valeur d’échange). Je pense que, désormais, la valeur d’usage est prohibée partout. Elle est en cours d’interdiction, d’expropriation physique, cela va se porter sur tout le dépôt signifiant, le dépôt de jouissance accumulé au cours des âges. Un tableau réussi ça jouit, mais de quoi ? Comment ? Interdiction d’en parler. C’est là qu’on voit se tisser la tyrannie nouvelle. Un corps qui aurait persisté à avoir l’usage de soi-même est désormais intrinsèquement suspect. Un corps qui voudrait subsister dans la conscience de soi et la gratuité de son existence ne peut être désormais que profondément suspect. De proche en proche, ceci s’entend à travers le fait que les corps sont maintenant artificiellement reproductibles, comme chacun sait. Il n’y a qu’à, pour s’en convaincre, lire les appels incessants d’Antonin Artaud sur ce thème, après la deuxième guerre mondiale.
Une grande partie de ce que j’avance ici a été théorisé dans les Commentaires sur la Société du Spectacle [2] de Guy Debord, paru en 1988. Tout le reste ne me parait être que du bavardage obscurantiste. Les philosophies qu’on essaie de nous revendre à bas prix sont des philosophies non critiques, servant les nouveaux maîtres dans la remise au pas des esclaves à laquelle nous assistons.

Cette image est de Marx, le merveilleux Marx dont on ne dira jamais assez à quel point personne ou presque ne l’a jamais lu, surtout pas les Français, ce Marx dont Althusser réclamait la lecture sans arriver lui même à s’en faire une idée claire. Il faudrait rompre en profondeur avec le stalinisme, ce qui n’a pas été fait. On croit liquider Marx en voyant, s’effondrer le stalinisme : c’est trop commode, il n’en est pas ainsi. Je veux dire par là que nous manquons, y compris à travers la fiction, de cette possibilité ironique et enjouée qui anime les grandes critiques de l’apparence des choses. Pour cette raison de non critique généralisée la peinture se voit aujourd’hui confisquée sans résistance. Le geste créateur est stérilisé à priori, sous l’avalanche d’un art populiste qu’on appelle au gré des modes "moderniste, et post-moderniste, avant-gardiste, et post-gardiste etc".
Tout le monde participe à cette normalisation et personne n’a l’air de s’en préoccuper beaucoup. Il y a donc une complicité qui va des commissaires-priseurs aux peintres eux-mêmes, en passant par les galeries, l’industrie secondaire ou parallèle qui vivote, mais dans quel but ? Dans un but à mon avis de plus en plus analphabétisant. Personne n’est plus capable de savoir comment fonctionne réellement, dans son geste intérieur, la peinture et surtout dans les arts classiques... L’ignorance est de plus en plus propagée et enseignée, si j’ose dire, et il en va de même pour la littérature. L’écrivain qui se dit marginal est lui-même prévu au programme de l’insignifiance des choses et moi, je préférerais que l’écrivain fut encore capable de raisonner. De raisonner évidemment en musique, de raisonner avec la technique — rhétorique qui semble perdue. La seule littérature qui m’intéresse — je ne la vois pas venir et je l’appelle cependant de mes voeux — serait une littérature critique et raisonnante. Raisonnante et résonnante. Dans la Fête à Venise il me semble qu’il est impossible de ne pas sentir que là est l’enjeu passionné.
J. R. : Mais qui lit vraiment aujourd’hui ?
Ph. S. : Je trouve symptomatique que nous soyons dans un moment où il est possible à quiconque se lève un peu tôt et réfléchit d’écrire exactement ce qu’il veut — et que ce soit précisément à ce moment là que tout se passe comme si cela n’était plus possible. On s’aperçoit ensuite que, même si cela est possible, ce ne sera pas lu.
VOIR AUSSI
Et voilà une des raisons par exemple, pour laquelle un écrivain comme Sade peut être publié en Pléiade. Le texte est là, mais personne ne peut s’en saisir. Car, autrement, pourquoi ne pas en lire des extraits au journal télévisé de 20 heures, à la radio pendant la journée ? On pourrait en reproduire de longs passages, puisque c’est un classique, à la une des journaux et par exemple dans le vôtre, les Lettres Françaises, en gros caractères, des passages entiers des 120 journées de Sodome. Eh bien, allez donc vous amuser à faire cela !
Vous verrez que c’est très difficile et même impossible. Par conséquent, il n’y a plus de problème à éditer puisque, comme je le disais tout à l’heure, la société elle-même censure, est elle-même, toute entière, une censure en acte et qu’elle sait en fait que personne ne lira le livre. Et probablement pour longtemps, dans la mesure où une sorte de lésion organique est en train de devenir irréversible. Je ne fais pas du sentiment mais de la clinique.
Il y a lieu de se demander, et je vois la chose se faire tous les jours, si des lecteurs dont c’est la fonction, le métier, la responsabilité, existent encore.
On peut même se demander si les signes typographiques assemblés clairement vont encore produire du sens dans le cerveau.
La question me semble le comble de la réalité et elle n’est que le pendant sur le terrain de la littérature de ce que je dis sur la peinture. A savoir que l’on pourrait remplacer par exemple tous les tableaux dans les musées par des reproductions perfectionnées, allemandes ou japonaises. Personne n’aurait le temps de voir si c’est bien là, devant ses yeux, un original ou une copie. Les gens qui vont dans les musées n’y voient que du feu. On les fait défiler dans le désir du Maître qui a dit qu’il fallait absolument admirer l’art. Quel art ? Que dirait cet art ?
Femme nue étendue, Collection Norton-Simon, Pasadena.

J. R. : Cette remarque me fait penser à ce passage de la Fête à Venise "Nous avons été voir les peintures, le Maître n’arrête pas de nous dire qu’elles sont très précieuses, il va être content. Certains d’entre nous ont même fait l’effort particulier d’acheter un livre que, d’ailleurs, ils ne liront jamais, faute de temps. Ouf, à table. Télévision".
Ph. S. : Pour comprendre un Van Gogh, par exemple, il faut être capable de comprendre le sens du livre qu’Artaud lui a consacré. Vous pouvez vérifier : ce n’est plus jamais le cas si même ce le fût un jour.
J. R. : Vous parlez "d’analyse clinique". J’y entends, malgré tout, un certain désespoir. Sollers-Stendhal dit, en même temps, qu’on le lira au XXIe siècle. Voilà un paradoxe.
Ph. S. : Ce type de propos pourrait me faire apparaître comme revendicatif, plaintif ou mélancolique. Pas du tout. La Fête à Venise est un roman enjoué, ironique, à travers des dialogues drôles où je fais exprès de rentrer dans la tête des spéculateurs ou des maîtres du monde pour mettre en scène leur domination bouffonne.
Par exemple, lorsque j’imagine qu’un propriétaire voudrait acquérir les crânes de Marx, d’Engels, ou pourquoi pas, de Lénine ou de Mao, pour en faire des cendriers.
Le même pourrait vouloir le crâne de Freud et cela n’est pas possible, puisque, comme on sait, Freud a été incinéré et mis dans un vase grec par la princesse Bonaparte. Mettre aujourd’hui dans le roman, le récit, les dialogues, les situations, une ironie constante, une sorte d’enjouement non nihiliste dans le constat de la régression de notre temps, est l’arme qu’il nous faut ; c’était l’arme des lumières qui savaient se servir du roman dans un but éminemment subversif de la société. J’écris des romans en faveur de l’incrédulité. Celle-ci à changé de nature, il ne s’agit plus d’attaquer l’Eglise qui n’a pas de véritable mainmise sur notre situation. Mais en revanche partout où il y aurait Dieu, les saints etc., dans les écrits des philosophes du dix huitième siècle, il faudrait donc écrire tout simplement la marchandise, le marché, et l’argent.
Voilà qui serait scandaleux. Pourquoi personne ne le fait-il ? C’est ce que je demande aux écrivains esclavagistes de notre temps.
J. R. : Parlez-moi donc de Voltaire ? Vous avez consacré un numéro de l’Infini à Voltaire. Faut-il revenir à Voltaire ? Un Voltaire qui écrit "Nous sommes entre les mains des barbares" .
VOIR
Ph. S. : Lorsque j’ai préparé, il y trois ans, le numéro de l’Infini sur Voltaire, il y avait encore autour de moi beaucoup de gens qui étaient passés par la doxa avant-gardiste ou moderniste, dont le fond est toujours nihiliste, à savoir qui ne peuvent écrire que dans la tristesse ou la dépression alambiquée. C’est ce que j’appelle aujourd’hui dans la littérature française — il suffit d’ouvrir les livres dans les librairies — le populisme précieux.
On a vu brusquement l’actualité politique et idéologique de ce numéro de l’Infini au moment de l’affaire Rusdhie. Je passe mon temps à constater avec stupeur que les Français n’ont pratiquement plus de relations avec leur grande tradition romanesque, philosophique ou critique. J’en déduis donc qu’ils sont en cours d’expropriation, avec leur propre concours, par culpabilité réelle ou imaginaire, expropriation de leur corps, de leur mémoire. L’acte surréaliste le plus simple aujourd’hui est de sortir Pascal, Voltaire ou Molière de son tiroir ! Pour tout cela voir Lautréamont, ses Poésies !
On pourrait les dactylographier, et les envoyer aux éditeurs pour publier ensuite leurs lettres de refus. Les grands sentiments viennent de la raison, d’une certaine raison redoublée. Mais Lautréamont lui ne passe pas. Il y a toujours trop d’affects, de romantisme, de vague à l’âme, de dépression ou d’intérêts sordides pour que ce splendide geste de la raison, enfin subversive, de nouveau soit perceptible. Qui a touché à Lautréamont ? Très peu de monde ! Qui sait lire les Poésies ? Qu’on le dise !
J. R. : Vous ne me répondez pas sur "le retour à Voltaire". Je vous cite ! "Si je me sers du XVIIIe siècle c’est juste pour respirer"".
Ph. S. : Je ne "reviens pas" à Voltaire, je ne reviens pas à Stendhal, je ne "reviens" à personne. J’adapte le roman à la possibilité de détourner un nombre considérable d’informations, d’imaginer les informations que l’on nous cache à partir de celles qui nous sont plus ou moins faussement révélées et donc de donner de mon temps l’image de sa faillite.
La Fête à Venise est un roman qui n’est pas, dès le début de sa première phrase, aliéné au spectacle qui réclame ce que la marchandise appelle le roman. La Fête à Venise est un roman fait exactement dans notre situation actuelle, critique. Si l’on me dit souvent que je n’écris pas de vrais romans c’est parce que le narrateur est en situation critique, ce que ne veulent pas les marchands du roman somnambulique, somnifère et asservi. Le narrateur est en situation, la femme avec laquelle il se trouve, l’est aussi. Je vous ferai remarquer qu’ayant écrit six livres où l’on trouve beaucoup de portraits de femmes, autrement dit de modèles féminins, il n’est quasiment jamais question dans la critique de cet aspect de mon travail. Comme si c’était interdit d’en parler !
La réalité me paraît construite comme une fiction instrumentée par la tyrannie nouvelle : je décris la réalité de cette fiction.

Watteau, L’embarquement pour Cythère.
Photo A.G., Le Louvre, 25 janvier 2017. ZOOM : cliquer sur l’image.

Et cela dérange. Le geste est comparable, à mon avis, et j’en fais le catalogue dans ce livre, à la création d’un genre nouveau. Par exemple quand Watteau invente ce qu’on a appelé les Fêtes galantes qui rompent avec toute l’histoire de la peinture jusqu’à lui — la peinture devant être faite, même lorsqu’elle est mythologiquement nue, de sentiments élevés ou de chiffres à découvrir par derrière la peinture. Le geste a été repris, et pas du tout par hasard, par les impressionnistes et en premier lieu, avant eux, par Monet.
J. R. : Pourquoi ce privilège que vous donnez à la peinture ?
Ph. S. : La peinture garantit une certaine expérience physique. Nous n’avons pas d’autre garantie de nos perceptions, de nos sensations et de l’expérience que nous en faisons. C’est pour cela qu’elle est, aujourd’hui, au coeur d’une telle manipulation. Car, avec elle, le corps tout entier, à travers le regard, se montre ou non capable d’entrer indéfiniment dans n’importe quelle représentation plastique et, par conséquent, se montre capable de critiquer le monde des fausses images dans lequel on veut faire vivre l’esclave humain désormais. Quelqu’un qui verrait bien la peinture et qui saurait bien ce qui s’y passe de précis, serait, évidemment un corps imperméable à la propagande quelle quelle soit. Pas seulement celle de l’ancien totalitarisme, nazi ou stalinien, mais celle aussi du libéralisme marchand qui se déploie dans le slogan et la publicité incessante. De la confusion de ces deux systèmes (totalitaires ou libéral) vient probablement l’irréalité dictatoriale dans laquelle nous sommes de plus en plus conviés à vivre.
De même qu’on pourrait dire que deux grands puritains de la planète sont en train de savoir comment se détruire tout en s’entendant, j’ai nommé Bush et Sadam Hussein, le protestantisme et l’islam [3].
La réalité de cette expérience physique est de plus en plus détruite et falsifiée. J’étais à Venise au moment où un ministre socialiste italien avait le projet de faire l’exposition universelle de l’an 2000 dans cette ville.
On la rentabilisait en la détruisant encore un peu plus.
Venise ne s’effondre pas, contrairement à ce qu’on dit toujours, mais le monde, oui ! Venise est l’objet d’un ressentiment qui autrefois appartenait à Rome. "Rome unique objet de mon ressentiment..." J’ai vu des gens faire des prières à la Salute avec des cierges allumés comme si la peste allait bientôt revenir. Spectacle pitoyable et en même temps touchant, étrange, qui met en valeur l’agressivité qui sera toujours en acte contre la réalité voluptueuse.
On ne combattra pas cette pulsion de mort incessante en disant que ce n’est pas bien. Ou encore "quelle connerie la mort" ou, encore plus bête, "quelle connerie la guerre" ! Ce n’est pas une connerie mais une volonté. Un puits de pétrole. On pourrait reprocher à Freud d’avoir mis en symétrie Eros et Thanatos. Thanatos a toujours des milliers de kilomètres d’avance sur Eros, son jumeau potentiel.
La mort est toujours en avance, ne serait-ce que du fait que les familles ne transmettent pas, que je sache, l’éros mais bien seulement le thanatos. Une famille ce sont des tombeaux. Thanatos a son Dieu, c’est pathos. Eros a sa règle, c’est ethos. C’est la raison pour laquelle je me suis permis de mettre en exergue à la Fête à Venise la 39e proposition de l’Ethique de Spinoza "qui a un corps apte au plus grand nombre d’actions, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle".
J. R. : J’insiste sur le rapport de la littérature à la peinture...
Ph. S. : La peinture ne peut pas être détachée de la verbalisation. On voit un tableau dans la mesure où on est capable de le parler. J’essaie, dans ce roman, de parler d’un certain nombre de tableaux. Les tableaux sont des romans, ce roman les parle.
Ils sont dépositaires de la vraie vie, sentie, sensible. Je montre que le langage peut les rejoindre. Je fais exactement le contraire de la société de notre temps qui veut les réduire à l’asphyxie en cachant leur originalité, leur singularité. Les romans indéfinis que sont certains tableaux sont ici des recharges de l’action romanesque, qu’il s’agisse de l’Indifférent, de l’Enseigne de Gersaint, de l’Embarquement pour Cythère, de "la Montage Sainte victoire" ou des séries de Monet...
J. R. : Parlons un peu de l’affaire Watteau dont le dossier est mis en scène dans la Fête à Venise. On a inversé le sens de sa peinture.
Ph. S. : Watteau, léger, instantané, devient au fil du temps, le peintre de la nostalgie, de la mélancolie, quasiment suicidaire, c’est-à-dire le contraire même de ce qu’il est. La Fête à Venise est un roman sur les sources du nihilisme qui ne sont peut-être rien d’autre que cette fracture entre le sentir, le voir et le parler.
Fracture mise en scène à la fin du XVIIIe siècle dans la remise en ordre autoritaire qui suit l’aube de la Révolution française, s’abîmant dans la Terreur qui donne David et Napoléon. David avait déjà servi sous Robespierre pour l’inauguration des Fêtes de l’Etre suprême auxquelles j’ai imaginé que Sade, l’immense Sade, ne pouvait être que farouchement opposé. Pour Sade, pas d’Etre suprême. Il le dénonce dans la fameuse métaphore du Dieu suprême en méchanceté !
La jouissance de l’instant ne veut rien savoir et a la certitude de n’avoir rien à savoir de la mort comme le dit cette inscription du sarcophage épicurien qui se trouve dans le jardin du petit palais de Venise où je mets mon personnage : la mort n’est rien pour nous.
J. R. : Le lien avec les impressionnistes ?
Ph. S. : Après un certain temps, les Impressionnistes, et c’est la raison pour laquelle ils sont l’objet d’une attaque mondiale, attaque financière ou locale...
J. R. : Locale ?
Ph. S. : Essayez de bien voir le Déjeuner sur l’herbe au Musée d’Orsay !
Un critique américain s’est demandé sérieusement pourquoi les séries de Monet ont pu faire tellement d’impression à l’époque alors que cette peinture paraît aujourd’hui dépassée, sage ! Je crois qu’au contraire ce sont des peintures de la plus grande valeur intime.
J’accuse ceux qui pensent que ça n’a pas de valeur de les livrer sans défense à l’acheteur confiscateur. Etrange question de la servilité française qui ouvre sur cette nihilisation française due à une angoisse sur son identité — qui ne peut avoir pour cause qu’une profonde culpabilité. Mon roman essaie d’analyser les origines de cette culpabilité, sans cesse renforcée.
VOIR AUSSI
Cette origine se situe sans doute à la fin du XVIIIe siècle français, pour employer un pléonasme, il n’y a pas d’autre XVIIIe siècle. Tout le monde veut se l’approprier — il trouve, en France même, très peu de défenseurs énergiques.
Je ne parle pas d’une position esthétisante mais d’une compréhension profonde de ce qui s’est passé réellement avec les Lumières.
Les Lumières dont on ne peut absolument pas dire qu’elles sont à l’origine de la Terreur pas plus qu’on ne peut affirmer avec le cardinal archevêque de Paris qu’elles sont à l’origine du nazisme et du stalinisme. Il y a là une curieuse convergence entre le cléricalisme le plus à contre sens et le philosophisme le plus moisi.
VOIR LES EXPOSITIONS
Autre exemple. Pourquoi faut-il que Cézanne soit ce puritain exacerbé qui aurait donné lieu par son mauvais caractère, par son goût de l’abstraction naissance au cubisme et à l’art abstrait. Le cubisme passe encore parce que Picasso connaissait Cézanne. Mais l’art abstrait et Cézanne ? Je ne vois vraiment pas la filiation. Voilà une dogmatique de vidage de l’expérience physique de la peinture qui va dans le sens de sa négation.
J. R. : Vous attachez une grande importance aux propos de Cézanne recueillis par Joachim Gasquet...
Ph. S. : Merveilleux témoignage que celui de Joachim Gasquet ! Il nous montre un Cézanne passionné, frénétique de la sensation instantanée, physique. Voilà ce qui m’intéresse chez les peintres en général.
Ce roman est une vérification, dans mon langage, de ce que la peinture est — la découverte qu’il s’agit de la même substance, cette peinture, pour qu’on en jouisse et qu’on jouisse de la réalité dont elle parle. A titre de jeu, la question que je pose à chacun lorsqu’il est persuadé de l’invivabilité sociale qui lui est désormais imposée est : dans quel tableau choisiriez-vous d’entrer pour y vivre indéfiniment ? Il ne s’agit pas d’apologie du sentiment de la nature — ce n’est pas un livre écologique.
J. R. : Le rôle joué par Andy Warhol dans votre livre ?
Ph. S. : Il est l’artiste qui a eu la plus grande conscience de ce qui était en train d’arriver. Il a joué avec ce phénomène de la mise à plat de la non profondeur des peintures. Si on regarde bien son geste, comme j’essaie de l’analyser dans la Fête à Venise, on se rend compte que tous les éléments de critique de notre société sont réunis.
J. R. : Il y a une phrase d’Andy Warhol que vous citez dans votre livre : "l’art comme business vient après l’art" c’est une proposition ambiguë. On pourrait la retourner contre Warhol lui-même ?
VOIR
Ph. S. : La dénonciation de l’art comme business sur un mode plaintif, de retour en arrière, ne sert à rien. Il faut entendre l’ironie de Warhol comme la forme même de la contestation du marché ou de l’art devenu marché. Grâce à un geste comme celui-là nous pouvons comprendre notre temps. Pas de démission mélancolique : "comme c’était mieux autrefois"... Mon roman ne marche pas à la revendication, au ressentiment, il fonctionne à l’ironie constante.
J. R. On pourrait aussi bien vous reprocher de participer aux phénomènes que vous décrivez ?
Ph. S. : Si je ne participe pas à ces phénomènes, je ne les connais pas. Si je ne les connais pas, je ne peux pas les décrire. C’est pour cela que j’écris un roman réaliste sur notre société. L’acte le plus contraire à celui de l’écrivain marginalisé qui croit que sa plainte, poétique ou romantique, sa revendication humaniste peut être efficace. Elle ne l’est pas dans la mesure où il n’est pas au courant du complot.
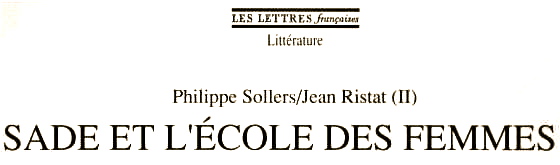
Jean Ristat : Vous écrivez dans la Fête à Venise : "je ne suis pas l’enfant de ce siècle". Plaçons, si vous le voulez bien, la seconde partie de notre entretien, sous le double signe du XVIIIe siècle et des femmes. Nous commencerons par parler des portraits de femme dans votre oeuvre. Vous avez une réputation de misogyne...
Philippe Sollers : Pour des raisons qui sont peut-être les mêmes que celles de cette négation dont je parle de la peinture, il se trouve que pratiquement aucune critique ne remarque que Femmes, Portrait du joueur, le Coeur absolu, les Folies françaises, le Lys d’or ou maintenant la Fête à Venise, comportent systématiquement des portraits de femmes, positifs : mais ce qui revient toujours dans mon cas, par exemple ces temps-ci aux Etats-Unis où Femmes paraît avec un certain retentissement, c’est le mot misogyne. Ce qui est à proprement parler me lire à l’envers. Ces portraits féminins dérangent. Nous sommes loin du pathos à quoi semble vouée éternellement la question féminine (Bovary !), loin de toute idéalisation romantique, bref de toute poétisation inutile. Nous sommes très loin aussi de ce qui s’exhibe en 1928 et 1932 chez les surréalistes à propos de la sexualité. Je voudrais bien qu’on me montre dans les romans du XXe siècle des portraits de femmes, aussi bizarrement nouveaux que ceux que je fais. Sur le plan à la fois de la liberté physique et de la liberté sociale. Beaucoup d’hypocrisie est encore à l’oeuvre et mes livres la mettent en émoi, mais sans qu’elle le dise. Elle s’en rend compte, la dite hypocrisie, que le problème est là. Mais elle parle d’autre chose.
Picasso, 26.11.69.VIII.

J. R. : Le personnage narrateur de la Fête à Venise est dans la vérification permanente de sa sensation à l’oeil nu dans la peinture. Le personnage féminin s’occupe de choses très abstraites : d’astrophysique, de trou noir, de matière noire. Tout les sépare. Mais la distance les définit, les réunit. Ils ont des dialogues.
Ph. S. : J’aime bien donner l’idée, dans mes romans, de personnages qui font l’amour comme ils parlent, et qui parlent comme ils font l’amour. Le Pathos c’est la coupure entre les deux fonctions, le sexe et la parole. L’amour qui ne met pas en scène la comédie de l’amour s’abuse et nous abuse : c’est l’escroquerie incessante du chantage au sentiment, au "merveilleux", à la "fidélité", bref les deux impasses conjuguées de la mystagogie et de la famille. Si la France est si inquiétante pour le monde entier, c’est précisément de poser en plein jour la question du simulacre amoureux. Que les Français l’oublient, ou en aient honte, est une des choses les plus pénibles ou régressives du tunnel éternisé du 19e siècle. Savoir agir, parler et simuler en même temps, voilà la vérité de la jouissance, à quoi s’oppose de toute ses forces la religion noire de "l’authenticité".
J. R. : Votre héroïne est-elle "une femme savante" ?
Ph. S. : Ce qui aurait pu être ironisé au XVIIe siècle sous le nom de femme savante se retrouve, à mes yeux dans une position positive aujourd’hui. Voilà quelque chose qui demande à être repris et qui aurait avorté dans l’histoire : une liberté non précieuse, non ridicule. Quelque chose qui ne soit pas un déguisement du maniérisme — mais qui touche un point central : les femmes et la connaissance, qu’elle soit scientifique ou philosophique. Le thème est constant dans mon travail : j’estime que la philosophie française existe surtout dans la mise en acte de la fiction. Elle n’existe pas en tant que système philosophique. Quand les Français auront réussi à surmonter l’Allemagne en eux, ils s’en apercevront (peut-être trop tard). L’éducation des femmes est un projet fondamental, évident chez Sade qui ne fait que pousser à bout tout le mouvement des lumières. Les femmes doivent être le critère de la philosophie. Nous sommes très loin de la philosophie allemande. La Sophia, est idéalisée comme intermédiaire entre le penseur et les mystères de la nature. A l’opposé, la Sophie française philosophe jusque dans le boudoir. Plus les femmes sont émancipées, plus la philosophie française sous forme de fiction démonstrative et de roman démonstratif (c’est cela la grande tradition de la langue et de son génie) existe dans la pratique.
VOIR AUSSI
Il est paradoxal et terrible de penser que la seule marquise de Merteuil convenable aujourd’hui est une américaine, Glenn Close, au cinéma. La question est : Bovary ou Merteuil ? Camille Claudel ou la Juliette de Sade ? Duras ou Sévigné ? L’effondrement hystérique ou la cruauté dans la grâce ? Essayez d’imaginer une Française capable d’incarner tout de suite Merteuil : laquelle pourrait le faire sans s’angoisser ou sans minouder ?
J. R. : Une parenthèse, si vous voulez bien. Comment inscrivez vous Rétif de la Bretonne dans votre lecture du 18e siècle ?
Ph. S. : Je n’ai pas une grande admiration pour Rétif, qui d’ailleurs détestait Sade. Au contraire dès que j’ouvre un livre de Sade, je suis transporté par l’énergie d’écriture qui va de la première ligne à la dernière, je dirai même indépendamment de ce que ça raconte. Sade m’électrise à chaque instant, c’est l’écrivain la plus rapide du monde et ceux qui le trouvent ennuyeux ou répétitif sont dans la position fatale de Tartufe pris la main dans le sac. Éternellement le génie français montre là sa considérable avance (dans la droite ligne de la plus audacieuse Renaissance, celle de l’Arétin à Venise, par exemple). J’aime, quand je lis, que mon coeur batte plus loin que lui-même, je ris en lisant Sade de toutes les hypocrisies, du guignol social en tant que tel, de son mensonge définitif. La merveille constante de ses romans est de concilier la plus grande ingéniosité avec l’épanouissement irradié de chaque détail. S’il Y a bien un inventeur de situations, c’est lui. Et les dialogues ! Et les comptes ! Et la correspondance ! Allons, Français, encore un effort : Flaubert était une tentative d’éveil un peu lourde, choisissez Sade ! Lisez-le enfin dans son geste et tout ira mieux.
Picasso, 26.11.69.IV.

J. R. : Pour Rétif, dans les ténèbres, dans le siècle de ténèbres qu’il décrit, les lumières peuvent être apportées par la femme... je le cite : "Nous sommes dans le siècle des lumières et pourtant les ténèbres sont le lot des trois quarts de la nation. Il faut les combattre par tous les moyens même par l’amour".
Ph. S, : Oui, mais cela me paraît un tout petit peu empreint de bergerie. Il faut que la femme soit philosophe. Il ne s’agit pas d’amour, mais de connaissance, de déniaisement sexuel. Il s’agit donc d’attirer vers Eros et Ethos contre Pathos et Thanatos dans le déniaisement sexuel poussé... assez loin, le plus loin possible... Il s’agit d’en arriver par exemple, à ce qu’une femme soit détachable de sa mère (un homme aussi, d’ailleurs). C’est, n’est-ce pas, le sujet fondamental de la Flûte enchantée d’un certain Mozart qui se produit à la même époque, comme par hasard... Ce programme a été interrompu par la terreur car on ne comprend pas très bien comme on passe en un demi siècle de l’admirable Juliette de Sade à Madame Bovary, qui n’en finit pas de nous être resservie comme soupe nationale, à croire que notre horloge est définitivement arrêtée à l’heure de Flaubert. Marions vite Cyrano de Bergerac et Madame Bovary, et reprenons l’heure de Sade.
J. R. : Voilà donc une femme savante, non par refoulement sexuel, mais aussi à l’aise avec son corps qu’intéressée par la science. Vous le répétez, à juste titre, c’est un personnage aux antipodes de la propagande spectaculaire. Nous en avons parlé, dans la première partie de notre entretien, en évoquant l’ouvrage de Guy Debord. Mais "les Lumières" aujourd’hui, que feraient-elles ? Dénoncer toujours et encore "l’infâme"... ?
Ph. S. : La cible des "Lumières" ne pourrait plus être la dogmatique religieuse, (il faut toujours garder un oeil ouvert bien sûr, parce que ça traîne... mais enfin, je crois que tout cela est fini... même l’Islam est fini, c’est la convulsion avant la fin...) Nous avons à nous occuper de phénomènes beaucoup plus importants et beaucoup plus secrets qui sont la réduction de toute chose à son échange, à sa vente, y compris celle de la production des corps humains. Pour la première fois est posée la réalité de la procréation en dehors de tout acte sexuel (voir la récente vierge mère anglaise). Je pose la question : Quel est dès à présent le retentissement calculable de cette nouvelle façon de faire de l’humain sur les subjectivités actuelles et futures ? Qu’en pensent ou en auraient pensé Papa et Maman ? Je vous renvoie à la lecture de Femmes où tout cela est envisagé froidement.
J. R. : Vous employez l’expression "livre d’entente"... qu’est-ce que cela veut dire ?
Ph. S. : Ça veut dire que les deux personnages vivent en bonne intelligence, qu’ils s’entendent, que leur façon de concevoir l’existence au jour le jour, ou à la nuit à la nuit, les met dans un non-conflit, dans un non-pathos ; dans un rapport, dans une relation, dans un langage commun qui ne tourne pas au psychologique inutile ou à la guerre des sexes préanalytique ou au n’importe quoi poétique. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas une poésie toute nouvelle de ces rapports.
J. R. : Une poésie ? Je ne peux pas m’empêcher de vous citer avec malice un vers d’Aragon "La femme est l’avenir de l’homme"...
Ph. S. : Je me suis déjà moqué de cette proposition inénarrable dans Femmes. Elle est aujourd’hui le slogan même de la servitude. Pire : on y distingue sans peine une homophobie plus ou moins consciente qui sera désormais un fait religieux global. L’autre soir, je voyais à la T.V. Jean-Jacques Servan-Schreiber entouré de Françoise Giroud, Madeleine Chapsal, Michèle Cotta et Michèle Manceaux. Il semblait bien fatigué ! Son programme se résumait, au grand plaisir de ses accompagnatrices, à cette seule proposition : "l’avenir appartient aux femmes". Il répétait cela sans arrêt, publicité évidente pour la consommation magazinière. Appartient aux femmes ! Appartient aux femmes ! TOFAM ! TOFAM ! TOFAM ! Quelle foi ! Soyons sérieux. Le vieux Lacan, sur la fin, a lâché son fameux "LA femme n’existe pas". Je ne connais pas dix personnes qui ont compris ce qu’il voulait dire. De toutes façons, il n’y a pas deux, mais au moins quatre sexes. Le féminin d’un homme ne sera jamais, évidemment, celui d’une femme. Et le masculin d’une femme jamais tout à fait celui d’un homme. Assez avec "Femme" et "Homme" ! Quel ennui ! Passons du deux au quatre (minimum). Ça change tout.
Picasso, Femme à l’oreiller.
Huile sur toile. 10-07-1969 (195 x 130 cm)

J. R. : Le grand ressort de La Recherche, c’est la jalousie. Pas dans la Fête à Venise...
Ph. S. : Dans la Fête à Venise la jalousie n’intervient pas... Il s’agit de sauver l’instant dans ce qu’il a de plus précaire, la vie qu’on mène dans ce qu’elle a de plus essentielle, de plus animale, de plus sensible. Il y a là comme une description de l’instantané de toute relation, il n’y a plus cette intrigue de la jalousie, ce montage laborieux. Les jeux de la jalousie sont des jeux d’une histoire arrêtée. Ce que je montre, c’est que justement nous pouvons entrer dans une histoire explosée, explosive. Je réfléchis beaucoup sur ce qu’est la rencontre, au sens érotique du mot, de sujets qui n’ont qu’une idée en tête : la clandestinité qui les anime. Il y avait chez Breton une perception de ce choc (Nadja). Son puritanisme n’a pas arrangé les choses. Il est curieux de constater, chez l’autre inventeur de "rencontre", Georges Bataille (Madame Edwarda), la limite inverse qui est celle de l’obscénité. Nadja est "folle". Edwarda aussi. Une femme qui ne serait pas folle tout en étant sexuellement libre : est-ce pensable ? Oui.
J. R. : N’oublions pas Aragon : la Défense de l’infini, ou le Paysan de Paris. Le Con d’Irène, tout de même...
Ph. S. : Bien sûr, Aragon. Mais n’oubliez pas qu’il brûle la Défense de l’Infini pour repartir ensuite dans le mythe fusionnel.
J.R. : Le roman contre la poésie ?
Ph. S. : Le roman s’emparant de la poésie pour critiquer tout ce qui, dans la poésie, est charlatanisme, obscurantisme désormais presque institutionnel. Visant à empêcher les gens de pouvoir dire concrètement leur situation présente. La noyade par le poétique, ou ce que j’ai appelé le populisme précieux, de tout regard actif, de tout regard d’actes, de volonté même, sur la constructibilité des situations humaines, c’est ça qui m’intéresse. Voilà ce que je reproche à la mise en scène que j’appellerai mensongère du poétique. Je reproche au roman d’aliénation et à la poésie qui n’est que l’emphase furtive apportée à cette aliénation, le fait d’éviter la question capitale qui est la constructibilité des situations humaines. Mes romans procèdent presque toujours de la même manière : il y a de l’invivable et des personnages s’entendent secrètement pour que cela soit vivable, et ils construisent cela. Ce sont donc des récits de construction systématique de situations heureuses dans un monde malheureux et blâmable de l’être. C’est très visible par exemple, dans le Coeur Absolu avec la fondation d’une véritable société secrète. Quelles sont les procédures, les techniques sensibles pour vivre le plus librement et le plus heureusement possible ? Voilà les Lumières aujourd’hui... "Cultivons notre jardin" ? Pourquoi pas ? Voltaire, dans sa Correspondance, ne dit d’ailleurs jamais seulement "cultivons notre jardin", mais "cultivons notre jardin, et les lettres" ... L’absurde existentiel n’a pas été découvert au 20e siècle, Voltaire l’a éminemment décrit..."Ce monde est un chaos d’absurdités et d’horreurs, j’en ai les preuves"... A partir de là, deux solutions : ou bien le rabâchage nihiliste, l’oeuvre par exemple, en tous points admirable de ce point de vue, de Samuel Beckett ou de Thomas Bernhard... (le ricanement sur l’invivable...) Ou bien actes de construction des situations : ça vise ni plus ni moins qu’à s’enchanter la vie, le temps qu’on a pour la vivre. C’est un projet d’une grande poésie, d’après moi, sauf que c’est une poésie vérifiable au jour le jour, à la nuit à la nuit, au geste le geste, au dialogue le dialogue, à la proposition la proposition. Sur le mode des Poésies de Lautréamont... Mes romans montrent ce que peut être la vie concrète, quotidienne, au temps enfin réel des Poésies.
J. R. : Il y a malgré tout problème, à mon avis. Faire un constat, c’est important, mais est-ce cela une redéfinition de l’engagement ? Et dans ce cas, ne joue-t-on pas sur les mots ? D’autant que vous dites que plus personne ne lit ? Je veux bien qu’on prenne date, mais pensez-vous qu’il faille pour autant renoncer à transformer le monde, à changer la vie ? L’écrivain témoigne, constate. Est-ce un aveu d’impuissance ? Et la politique alors ? Le rôle de l’intellectuel ? Je crois vous avoir bien entendu, et pardonnez-moi d’insister, mais je ne peux pas m’empêcher d’y voir par moment une certaine façon de renoncer, une nouvelle tour d’ivoire...
Ph. S. : Tant qu’à faire, je vous le dis honnêtement, je préférerais encore une tour d’ivoire à une tour de béton. Mais ce type de vieilles accusations toquardes est là justement pour empêcher de voir ce que j’essaie de mettre en scène, c’est-à-dire une grande mobilité et une traversée sans cesse de toutes les cloisons ; une activité qui non seulement n’arrête pas de mettre en cause l’ordre apparent des choses, de transformer le monde à son profit, au profit d’un éventuel lecteur aussi, pourquoi pas. Il s’agit donc d’une possibilité d’interventions multiples. Pour ces raisons "cultiver notre jardin", n’est pas "la tour d’ivoire". Il faut que ce jardin soit présenté comme universel : c’est l’auteur de Paradis qui vous parle. Transformer le monde ? On voit ça de plus en plus sous forme d’Enfer (demandez aux Kurdes). Changer la vie ? Mais bien sûr ! Et c’est dans mes livres qu’on peut voir comment la vie peut être changée ! Pas en répétant sans cesse changer la vie, changer la vie, changer la vie. Changeons la donc tout de suite, embarquement immédiat. Pauvre Rimbaud ! Ça lui fait une belle jambe de bois d’être commémoré par la stagnation ambiante ! Pauvre Mozart ! Pauvre Marx ! Pauvre qui vous voudrez ! La grande rafle des noms propres est prononcée : la reconstruction publicitaire du passé bat son plein. Vous soyez qu’il y a lieu de prendre, de façon urgente des décisions radicales de dissimulation. Etre sous-estimé, voire même grandement méprisé est désormais une sécurité posthume. Pas de commémoration d’Isidore Ducasse, n’est-ce pas ? Du moins, pas encore. Tout peut arriver. Aucun mort n’est sûr de son avenir. Surtout s’il appartient aux femmes !
Antiope, musée du Louvre, Paris.

J. R. : Vous dites que le monde se transforme sous nos yeux, mais ce monde-là vous dites aussi qu’il est invivable, c’est le monde du business, etc., comment arrêter cela ? La question a-t-elle un sens pour vous ?
Ph. S. : Non, je dis simplement qu’avant de le transformer, malheureusement nous sommes ré-obligés à le réinterpréter correctement. Nous n’en sommes pas capables aujourd’hui dans l’ancienne prédication cléricale. Nous n’avons pas objectivement les moyens de le transformer à partir d’une interprétation qui fait défaut. Donc, voilà le vrai travail auquel les intellectuels devraient se vouer, mais là je les laisse faire. Moi je fais quelque chose, il me semble, de plus ambitieux, qui est de donner la texture, l’intériorité narrée de la texture du monde dans lequel nous sommes. Il faudrait donc, en effet, réinterpréter, mais, hélas, hélas, je ne vois que des interprétations fort fallacieuses sortir de partout, dans le marché et dans une confusion totale.
J. R. : Et la musique ?
VOIR AUSSI
Ph. S. : J’ai parlé plus attentivement de la musique dans le Coeur absolu — Tout se tient, les mots, les sens, les couleurs se répondent — je dirais qu’ils font plus : ils s’excitent mutuellement. Cela est déjà plus proche de nous, de Picasso par exemple. Vous m’interrogez sur la musique dans la Fête à Venise. Où est la polémique dans ce livre si politique ? Je prends parti pour l’Italie.
J. R. : La musique de Monteverdi dont vous êtes un admirateur.
Ph. S. : Écoutez le grand Monteverdi, ces voix qui ne vont nulle part, sans programme, sans rien à marteler, à prouver, sauf leur existence dans l’instant harmonique, déployées et contradictoires, tissées les unes dans les autres. Chaque voix chez Monteverdi est libre et ne va nulle part. C’est aux antipodes du défilé militaire luthérien.
Archives A.G. Les photos en noir et blanc illustraient l’entretien des Lettres françaises.
Première mise en ligne le 15 octobre 2011.



Jean Ristat : Le pacifisme est-il une démission ?
Philippe Sollers : Le pacifisme ? Une mission parfaitement prévue par l’organisation actuelle de ce qu’on appelle la guerre ! Cette guerre ne ressemble à aucune autre dans la mesure où elle est strictement une opération de police contre un tueur surarmé par ses commanditaires qui ont décidé, puisqu’ils voulaient se payer davantage, de le faire revenir à des prétentions moindres. Elle est le symptôme d’un devenir mafieux planétaire. Il n’y a pas une dialectique comme on la pensait autrefois, entre les maîtres et les esclaves, mais, au contraire, un nouveau partage du monde du pouvoir accompli dans le plus grand secret. Je dirai donc que le pacifisme est parfaitement assigné au rôle de diversion qui lui convient. Ce qu’on appelle aujourd’hui une guerre n’est qu’un règlement de comptes mafieux. Pendant ce temps-là, comme on dit dans les films muets, se passent des choses très importantes. Par exemple, la reconversion, qu’on pouvait d’ailleurs prévoir, du récent prix Nobel de la Paix en mafieux typique qui reconsidère l’emploi de sa nomenclatura KGBiste ou militaire, la situation catastrophique des pays dits de l’Est, sur laquelle on informe bien entendu de moins en moins, ou faussement, la disparition qu’on pourrait dire en "trou noir" de la Chine où le régime en profite pour liquider ses dissidents après les avoir déconsidérés — le coup classique ! — Un milliard 200 millions de personnes ont disparu, et le reste à l’avenant, sans parler de la démission toujours plus impressionnante des États devant leur propre devenir interne mafieux... Je renvoie à l’analyse de Guy Debord Commentaires sur la société du spectacle, paru en 1988 aux Editions Gérard Leibovici, que vos lecteurs auront avantage à lire attentivement. Ils y apprendront que toutes les anciennes manifestations de la politique ou du sentiment sont désormais des leurres.
J. R. : Des leurres ?
Ph. S. : Pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans les têtes où ils fonctionnent exactement comme on leur dit de fonctionner. C’est peut-être désespérant mais c’est comme ça, et moi je préfère désespérer pour avertir. Mon propos n’est pas du tout situé au-dessus de la mêlée, mais dans la connaissance et la pratique exactes, autant que je le puis, des dessous de la mêlée apparente...
J. R. : Les dessous de la mêlée, c’est ce que vous appeliez tout à l’heure l’installation d’un système policier au niveau planétaire.
Ph. S. : C’est ce que j’appelle en effet un système policier... terme dont je ne sais pas pourquoi la vieille tradition marxoïde, ouvriériste... se défiait comme de la peste, tout en parlant à chaque instant d’ailleurs de provocation policière... Il était interdit de penser qu’il pût y avoir une conception policière de l’histoire, c’était un crime de lèse-majesté théorique ! Il faut tout simplement prendre la mesure de ce qui arrive.
Pendant presque deux siècles on a considéré qu’il y avait une morale de l’histoire, le bien et le mal, une justice et une injustice... Eh bien, aujourd’hui, un esprit subversif, réellement révolutionnaire, devrait, à mon sens, mettre tout cela en question. On ne peut plus se raccrocher à des vieilleries qui auront servi, d’ailleurs de façon très aléatoire, à des situations différentes, antérieures, totalement dépassées par la situation actuelle : Il serait temps, puisq ue nous sommes désormais revenus avant les Lumières, d’informer, si c’est possible, à moins qu’il ne soit trop tard, le plus d’individus possible sur cette extraordinaire et très importante régression.
J. R. : Je veux bien que le mot "pacifisme" recouvre toutes sortes de vieilleries, toutes sortes de choses différentes mais tout de même, la guerre ou la paix, c’est la question de la mort ou de la vie...
Ph. S. : La guerre n’est pas une connerie, la guerre est la poursuite mafieuse d’intérêts économiques par d’autres moyens et qui donne lieu à des opérations de police... C’est sous ce jour-là qu’il faudrait l’éclairer au lieu d’agiter le bien contre le mal, la vie contre la mort, ou réciproquement. Sinon, on désinforme ce qui pourrait rester d’innocence alors qu’on pourrait instruire, sans illusion... La guerre c’est pas du tout une connerie, mais la poursuite d’une politique qui n’est pas non plus la politique purement économique des émirs, du pétrole, etc. C’est autre chose qui fait partie d’un plan d’ensemble dont nous avons la chance d’être les contemporains.
J. R. : Voulez-vous préciser ?
Ph. S. : C’est la nouvelle définition d’un ordre mondial gelé depuis très longtemps, disons au moins depuis la Première Guerre mondiale ! La remise en question de ce nouvel ordre mondial a été probablement esquissée à Malte. Je vous ferai remarquer que personne n’a rien su de la rencontre entre Bush et Gorbatchev... Nous avons vu et entendu, alors, les journalistes s’interviewer entre eux, parler du mauvais temps qu’il faisait, etc.
Ce qu’il faut comprendre aujourd’hui, c’est moins une opération de police baptisée "guerre", (dont nous ne savons rien ou quasiment rien), que la mise en scène de la planète par le directeur de la chaîne américaine CNN. Ce qu’il faut écouter avec la plus extrême attention, et analyser, au lieu d’aller défiler dans la rue en criant "Vive la paix " ! (ce qui est ennuyeux ... donc la télé l’enregistre, donc ça existe...) ce qu’il faut écouter c’est l’absence d’information ! Les événements se passent dans une fraction de la nuit, et, pendant le jour, on boucle et répète interminablement la même chose ! Ce qu’il faut voir, c’est comment ça fonctionne désormais, comment, par exemple, les gens ont peur à Paris, comme si la guerre se passait chez eux, comme si un SCUD allait tomber sur la place de la Concorde... Il faut prendre conscience de cette nouvelle prise en main du psychisme humain... Au lieu de cela le discours pacifiste fait jouer la mécanique pavlovienne du bien et du mal et des sentiments, forme la plus impropre du raisonnement, comme chacun sait. La démission, c’est d’approuver ou de réprouver quoi que ce soit...
Aujourd’hui, il n’y a rien à approuver, il n’y a rien réprouver, il y a lieu d’analyser l’imposture et la falsification de toutes les données proposées à la réaction humaine, c’est tout.
J. R. : Vous me disiez tout à l’heure : revenons à l’art...
Ph. S. : Revenons aux choses sérieuses, c’est-à-dire à l’interdiction planétaire de l’art. L’art est quand même beaucoup plus sérieux que la technique, instrument de la tyrannie mondiale. J’ai parlé tout à l’heure d’opérations de police ; d’une très grande expérimentation suivie par des milliers de chercheurs très qualifiés en aéronautique, en électronique, en sciences des fluides et des métaux, en communication... Cette technique, elle, occupe un espace gigantesque. Le problème de la science est ainsi reposé comme celui de sa prostitution éventuelle aux maîtres de la technique. Prenons un exemple : le bombardement expérimental de Guernica dont Picasso a fait le tableau que chacun connaît. Ce grand cri qui passe pour être authentique contre la destruction, a toujours été sous-interprété, transformé et falsifié dans son intonation strictement sexuelle. Je dis, en effet, revenons à l’art ! Comment Picasso peindrait-il la situation aujourd’hui ? Cette guerre relève-t-elle d’une mise en scène mythologique, plastique ou pas ? Comment s’y prendrait Picasso en 1991 ? Eh bien , je pense qu’il irait probablement dans le sens de ce que je viens de dire pour montrer qu’il s’agit de faux. Il faudrait donc se poser la question : où est la clé plastique de la guerre du Golfe ? Il est extrêmement compliqué et difficile d’y répondre puisque la plupart des choses ne sont pas sues, pas vues, pas même visibles, pas même visualisables !
CET ENTRETIEN A ÉTÉ RÉALISÉ EN FÉVRIER ET NOUS LUI AVONS GARDÉ SON CARACTÈRE.


Voir en ligne : Site des Lettres françaises
[1] Cf. Tout recommencer, sans cesse en septembre 2016. On notera ce qu’écrit Pascal Torrin (p. 30 de L’Infini) de « l’impressionnant appareil critique mise en place [...] (il suffit d’aller voir le remarquable site Pileface — Sur et autour de Sollers pour en être convaincu). »
[2] sic. Il s’agit des Commentaires sur la société du spectacle (sans majuscules).
[3] L’entretien a lieu au moment de la première guerre du Golfe.




 Version imprimable
Version imprimable







 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


