
Hubert Robert, La violation des caveaux des Rois
dans la Basilique Saint-Denis en octobre 1793.
Huile sur toile, 54 × 64 cm, musée Carnavalet, Paris. ZOOM : cliquer sur l’image.

« Hubert Robert illustre dans ce tableau l’avènement des temps nouveaux qui se concrétise par la destruction des symboles de l’Ancien Régime, le saccage des églises et des châteaux, la dispersion de collections et de bibliothèques. Mais ce vandalisme sinon dicté, du moins encouragé, suscite par contrecoup une prise de conscience, celle du patrimoine, d’une mémoire commune à sauvegarder. Ce concept tout nouveau de patrimoine, inséparable du souci de conservation, est à l’origine de la création des premiers musées. En effet, le jeune peintre Alexandre Lenoir fonde, en 1795, un musée des monuments français, "historique et chronologique, où l’on retrouve tous les âges de la sculpture française". »

En septembre 2017,
l’écrivain italien Roberto Calasso publiait L’innominabile attuale chez Adelphi. Le livre vient d’être traduit en français et édité par Gallimard, en même temps que Grasset publie Tout est accompli, l’essai signé par Yannick Haenel, François Meyronnis et Valentin Retz. Aussi différents soient leur angle d’approche et leur généalogie du monde moderne ou contemporain, une même inquiétude traverse ces deux livres qui se recoupent sur de nombreux points dans l’analyse de ce que le premier appelle la terreur de la société séculière — « On peut se demander, écrit Calasso dans L’innommable actuel, si la société séculière est une société qui arrive à croire à autre chose qu’à elle-même. Ce qu’Homo saecularis n’arrive pas à saisir, c’est le divin. Il ne sait pas le situer. Il ne rentre pas dans l’ordre des choses. De ses choses. [...] Le divin est ce qu’Homo saecularis a effacé avec soin et insistance. Il l’a même supprimé du lexique de ce qui est. » (p. 56-57)
— et les seconds, à la suite de Foucault et de Agamben, le Dispositif (le Gestell pour reprendre cette fois le lexique de Heidegger [1]). Exemple : à l’heure de la domination planétaire de la cybernétique, que veulent aujourd’hui les transhumanistes ? demandent les auteurs de Tout est accompli. Tout simplement supprimer la mort. « Ce qui s’annonce à travers la cybernétique, c’est le règne des spectres. Ces derniers ne seront ni vivants ni morts. Ils n’auront plus de sexe, de genre, d’ancrage. Le Dispositif sera tout en eux, et ils ne seront à leur tour qu’un moment du Dispositif. [...] Rabattre le corps humain au rang de simple cachot induit un déplacement du Dispositif, et c’est ce déplacement qui nous séquestre dans une mauvaise entente du divin. » (p. 326)
Il n’est pas interdit de lire ensemble ces deux livres comme nous y invite d’ailleurs indirectement Haenel dans Homo saecularis, sa dernière chronique de Charlie hebdo.

Charlie hebdo, 7 mai 2019.
ZOOM : cliquer sur l’image.

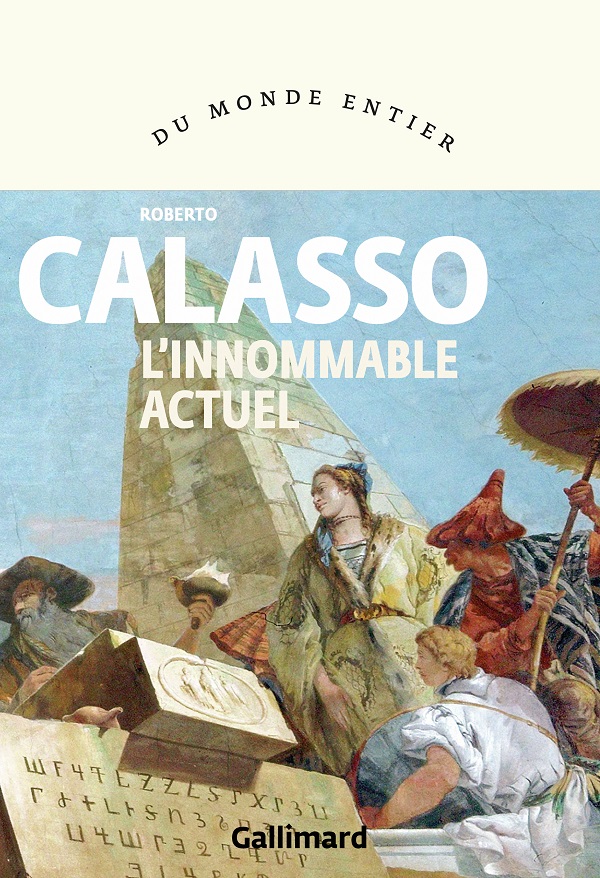
- Tiepolo, Apollon et les continents : l’Asie, 1750-1753.
Roberto Calasso
L’innommable actuel
[L’innominabile attuale]
Trad. de l’italien par Jean-Paul Manganaro
Collection Du monde entier, Gallimard
Parution : 02-05-2019
Touristes, terroristes, sécularistes, hackers, fondamentalistes, transhumanistes, algorithmiciens : ce sont toutes les tribus qui habitent et agitent l’innommable actuel. Un monde fuyant comme il n’était jamais arrivé auparavant, qui semble ignorer son passé, mais qui s’éclaire aussitôt que d’autres années apparaissent, la période comprise entre 1933 et 1945, au cours de laquelle le monde lui-même avait accompli une tentative, partiellement réussie, d’autoanéantissement.
Ce qui vint ensuite était informe, brut et de plus en plus puissant. W.H. Auden intitula L’âge de l’anxiété un petit poème à plusieurs voix situé dans un bar à New York vers la fin de la guerre. Aujourd’hui ces voix résonnent lointainement, comme si elles venaient d’une autre vallée. L’anxiété ne manque pas, mais elle ne prévaut pas. Ce qui prévaut, c’est l’inconsistance, une inconsistance meurtrière. C’est l’âge de l’inconsistance.
Ce livre, le neuvième d’une œuvre en cours d’élaboration, est étroitement relié à sa première partie, La ruine de Kasch (Du monde entier, 1987), où l’on rencontre l’expression « l’innommable actuel », précédée et suivie par deux lignes blanches. À la place de ce blanc il y a maintenant un livre.

 TOURISTES ET TERRORISTES
TOURISTES ET TERRORISTES
 LA SOCIÉTÉ VIENNOISE DU GAZ
LA SOCIÉTÉ VIENNOISE DU GAZ
 APPARITION DES TOURS
APPARITION DES TOURS

La sensation la plus précise et la plus aiguë, pour qui vit en ce moment, est de ne pas savoir, chaque jour, où il est en train de mettre les pieds. Le terrain est friable, les lignes se dédoublent, les tissus s’effilochent, les perspectives vacillent. C’est alors que l’on perçoit avec une plus grande évidence que l’on se trouve dans l’« innommable actuel ».
Durant les années 1933 à 1945, le monde s’est livré à une tentative d’autoanéantissement, en partie réussie. Celui qui vint ensuite était informe, brut et hyperpuissant. Dans le nouveau millénaire, il est sans forme, brut et toujours plus puissant. Aucune de ses composantes n’offrant de prise, il est l’opposé du monde que Hegel entendait étreindre dans l’étau du concept. C’est un monde broyé, y compris pour les hommes de science. Sans style propre, il les utilise tous.
Cet état des choses pourrait presque paraître exaltant. Mais seuls les sectaires s’exaltent, convaincus qu’ils tirent les ficelles des événements. Les autres — les plus nombreux — s’adaptent. Ils suivent la publicité. La fluidité taoïste est la vertu la moins répandue. Et partout ils se heurtent aux angles d’un objet que personne n’est parvenu à voir dans son intégralité. Voilà le monde normal.
Auden intitula L’âge de l’anxiété un petit poème à plusieurs voix situé dans un bar de New York vers la fin de la guerre. Aujourd’hui ces voix résonnent comme si elles venaient de loin, comme si elles venaient d’une autre vallée. L’anxiété ne manque pas, mais elle ne prévaut pas. Ce qui prévaut, c’est l’inconsistance, une inconsistance meurtrière. C’est l’âge de l’inconsistance.
La terreur se fonde sur l’idée que seul le meurtre garantit la signification. Tout le reste apparaît faible, incertain, inadéquat. S’ajoutent à ce fondement les diverses motivations au nom desquelles l’acte est revendiqué. Enfin, se relie également à ce fondement, de façon obscure et impliquant une métaphysique, le sacrifice sanglant. Comme si, d’une époque à l’autre et dans les lieux les plus divers, s’imposait un besoin irrésistible de meurtres, qui peuvent aller jusqu’à paraître gratuits et déraisonnables. Spécularité néfaste des origines et du présent. Un miroir ensorcelé.
Le terrorisme islamique est sacrificiel : dans sa forme parfaite, la victime est l’auteur de l’attentat. Ceux qui sont tués sont le fruit bénéfique du sacrifice de l’auteur de l’attentat. Il fut un temps où le fruit du sacrifice était invisible. La machine rituelle tout entière était conçue pour établir un contact et une circulation entre le visible et l’invisible. À présent, au contraire, le fruit du sacrifice est devenu visible, mesurable, photographiable. Comme les missiles, l’attentat sacrificiel pointe vers le ciel, mais retombe sur la terre. Voilà pourquoi les attentats des assassins-suicidés qui se font exploser prédominent. Quoiqu’il en soit, il est entendu que les auteurs d’attentats finissent par se faire tuer. Faire exploser un quelconque engin télécommandé estompe la nature sacrificielle de l’attentat.
Le premier ennemi du terrorisme islamique est le monde séculier, de préférence sous ses formes communautaires : tourisme, spectacles, bureaux, musées, lieux publics, grands magasins, moyens de transport. Alors non seulement le fruit du sacrifice consistera en de nombreux meurtres, mais il aura une résonance plus vaste. Comme toute pratique sacrificielle, le terrorisme islamique se fonde sur la signification. Et cette signification s’enchaîne à d’autres significations qui toutes convergent vers le même motif : la haine à l’égard de la société séculière.
Au stade ultime de sa formation, le terrorisme islamique coïncide avec la diffusion de la pornographie sur le Net, dans les années Quatre-vingt-dix. Soudain, ils eurent sous les yeux, facilement et constamment disponible, ce qu’ils avaient rêvé depuis toujours et depuis toujours désiré. Et qui dans le même temps démantelait de fond en comble leur système de règles concernant le sexe. Si cette négation était possible, tout devait être possible. Le monde séculier avait infesté leur esprit de quelque chose d’irrésistible qui les attirait et simultanément se raillait d’eux et les discréditait. Sans l’usage des armes — et de surcroît sans reconnaître ou exiger la présence de la signification. Mais eux iraient au-delà. Et, au-delà du sexe, il n’y a que la mort. Une mort scellée par la signification.
Depuis l’époque de Netchaïev, nous savons que la terreur peut suivre d’autres voies. On l’appelait alors terreur nihiliste. On peut aujourd’hui en concevoir une variante : la terreur séculière. Qui doit être comprise comme une pure et simple procédure, par conséquent disponible pour des fondamentalismes de toute sorte, qui lui conféreraient une couleur spécifique en fonction de leurs propres finalités. Voire, pour des individus singuliers, qui peuvent ainsi donner libre cours à leurs obsessions.
La puissance qui meut le terrorisme et le rend obsédant n’est ni religieuse, ni politique, ni économique, ni revendicative. C’est le hasard. Le terrorisme est ce qui rend visible le pouvoir toujours inentamé qui sous-tend le fonctionnement du tout et dont il dévoile le fondement. Il est en même temps une modalité éloquente à travers laquelle se manifeste dans la société l’immense étendue de ce qui l’entoure et l’ignore. Il fallait que la société parvienne à s’éprouver comme autosuffisante et souveraine pour que le hasard se présentât comme son principal antagoniste et persécuteur.
La terreur séculière veut avant tout sortir de la compulsion sacrificielle. Passer à l’assassinat pur. Le résultat de l’opération doit sembler totalement fortuit et se disperser dans des lieux anonymes. C’est alors qu’apparaîtra avec évidence que le hasard est le commanditaire ultime de ces actes. Qu’est-ce qui fait le plus peur : le meurtre signifiant ou le meurtre fortuit ? Réponse : le meurtre fortuit. Parce que le hasard est plus vaste que les significations. Face au meurtre signifiant, l’insignifiant peut se croire protégé par sa propre insignifiance. Mais face au meurtre fortuit, l’insignifiant découvre qu’il est particulièrement exposé, précisément en raison de sa propre insignifiance. À terme, la terreur n’a plus besoin d’un commanditaire collectif. Commanditaire et exécuteur peuvent coïncider. Au même titre qu’un État ou une secte, ce peut être des individus singuliers, des entités désancrées, obéissant à un ordre qu’ils se sont eux-mêmes imposé : tuer.
Le terrorisme signifiant n’est pas la dernière forme du terrorisme, mais l’avant-dernière. La dernière est le terrorisme fortuit, la forme de terrorisme qui correspond le plus au dieu de l’heure.
Rumiyah, « Rome », la revue plurilingue online de l’État islamique qui s’est substituée à Dabiq, indiquait, dès son premier numéro de septembre 2016, la voie du terrorisme fortuit dans un article intitulé « Le sang du kafir, mécréant, est halal, légitime, pour vous, donc versez-le ». Et entrait dans les détails en offrant une première liste de cibles possibles : « L’homme d’affaires qui va au travail en taxi, les jeunes (déjà pubères) qui font du sport dans le parc, le vieil homme qui fait la queue pour acheter un sandwich. Pas seulement : même verser le sang du marchand ambulant kafir qui vend des fleurs aux passants est halal. » Aucune discrimination de classe ou d’âge, hormis le cas du jeune sportif, qui doit être pubère.
La figure de l’assassin-suicidé n’est certes pas une invention récente. Au sein de l’islam, elle naît avec Hasan-i Sabbâh, le « Vieux de la Montagne » dont parle Marco Polo, figure légendaire construite à partir du stratège militaire ismaélien qui, des années durant, avait ourdi ses intrigues depuis la forteresse d’Alamut. Selon les sources de l’époque, il était sévère, austère, cruel et reclus. « On raconte qu’il est resté sans interruption dans sa maison, écrivant et dirigeant des opérations — de même que l’on insiste constamment sur le fait que pendant toutes ces années il ne sortit que deux fois de chez lui, et les deux fois pour monter sur le toit » : c’est ce que rappelle Hodgson, l’historien de la secte le plus digne de foi. Entre-temps les envoyés du Vieux de la Montagne, disséminés dans le royaume des Seldjoukides, que Hasan-i Sabbâh voulait abattre, tuaient des personnages puissants, généralement avec des poignards, avant d’être eux-mêmes tués. Ils étaient fida ’iyyan, « ceux qui se sacrifient » ou bien « assassins », mot qui signifiait consommateurs de haschich, comme l’a définitivement prouvé Paul Pelliot.
Deux siècles plus tard, quand la forteresse d’Alamut n’était plus qu’une ruine, dévastée quelques années plus tôt par les Mongols de Houlagou Khan, et que la secte des Assassins n’était plus qu’un souvenir, quelqu’un raconta à Marco Polo l’histoire du Vieux de la Montagne. Odoric de Pordenone la reprendrait quelques années plus tard, sans variations.
Selon l’un et l’autre, le Vieux de la Montagne « avait fait aménager dans une vallée entre deux montagnes le plus beau et le plus grand jardin du monde ». Et « là se trouvaient les plus beaux jeunes hommes et jeunes filles, qui savaient chanter et jouer de la musique et danser. Et le Vieux leur faisait croire que c’était là le paradis ». Mais il y avait une condition : « N’entraient dans ce jardin que ceux dont il voulait faire des assassins. »
Quand le Vieux décidait d’envoyer quelqu’un en mission, il le droguait pour le plonger dans un demi-sommeil et l’éloignait du jardin. « Et quand le Vieux veut faire tuer telle ou telle personne, il fait ravir le plus vigoureux des jeunes hommes et lui fait tuer la personne qu’il veut qu’on tue. Et les jeunes le font volontiers, pour retourner au paradis… De sorte qu’aucun homme que le Vieux de la Montagne a voulu éliminer ne survit face à lui ; et je vous dis que plusieurs rois lui versent un tribut tant ils le craignent. »
Le Vieux de la Montagne fit connaître à ses hôtes la saveur du paradis. Des siècles plus tard, il suffira d’offrir l’assurance que le paradis est réservé aux martyrs du jihad et qu’il regorge de plaisirs, comme on le lit dans le Coran. Mais il fallait d’abord découvrir le plaisir de la mort.
Tel qu’il apparaît chez Joinville et dans d’autres chroniques du Moyen Âge, le Vieux de la Montagne était une présence fabuleuse et reconnue, comme le prêtre Jean. On supposait que le lecteur le connaissait. Mais plus que tout autre, Nietzsche a vu clair dans cette histoire :
« Lorsque les Croisés se heurtèrent en Orient à l’ordre invincible des Assassins, à cet ordre des esprits libres par excellence, dont les membres de grades inférieurs vivaient dans une obéissance qu’aucun ordre monacal n’avait jamais connue, ils reçurent, on ne sait trop d’où, quelques lumières sur ce symbole, cette devise réservée aux seuls grades supérieurs comme leur secretum : “Rien n’est vrai, tout est permis”… Eh bien, voilà ce qui s’appelle liberté de l’esprit, par là toute foi dans la vérité même était congédiée… Aucun esprit libre européen, chrétien, s’est-il jamais égaré dans cette proposition, dans le labyrinthe de ses conséquences ? »
« Rien n’est vrai, tout est permis » : où Nietzsche avait-il lu cette phrase fatale ? Dans la Geschichte der Assassinen de Hammer-Purgstall, œuvre débordante, aventureuse et précieuse, parue aussitôt après le congrès de Vienne et unanimement désapprouvée par les islamologues successifs :
« Que rien n’est vrai et tout est permis restait le fondement de la doctrine secrète qui n’était cependant communiquée qu’à de très rares personnes et cachée sous le voile de la plus rigoureuse religiosité et dévotion ; en bridant les âmes avec les commandements positifs de l’islam, elle les gardait sous le joug de l’obéissance aveugle, d’autant plus que la soumission terrestre et l’autosacrifice étaient sanctionnés par une récompense et une glorification éternelles. »
En épigraphe au Vieux de la Montagne de Betty Bouthoul, livre à l’origine de l’obsession de Burroughs pour Hasan-i Sabbâh, on lit quelques lignes de Nicolas de Staël qui s’était tué trois ans plus tôt : « Assassinat et suicide, inséparables et si éloignés à première vue…
« Assassinat, ombre portée du suicide, se confondant sans cesse comme deux nuages immatériels et atrocement vivants…
« Tuer en se tuant… »
Le complot naît avec l’histoire. De même, le fantôme d’un centre caché régissant les événements. Les assassins-suicidés ramènent à Ben Laden dans les cavernes de Tora Bora, qui ramène à Hasan-i Sabbâh dans la forteresse d’Alamut. Il est des formes qui ne s’éteignent pas. Elles muent, se chargent et se vident de significations selon les occasions. Mais un mince fil les relie toujours à leurs débuts.
La nature est venue en aide, au moins une fois, à ceux qui veulent imposer partout la charia. Sans même recourir au terrorisme pour ouvrir la voie. En décembre 2004, le tsunami qui s’abattit sur une pointe de Sumatra, dans l’Aceh, dévasta tout, ne laissant debout qu’une mosquée. Il fallait repartir de zéro, situation convoitée par toute utopie. C’est ainsi que prit forme une enclave de la charia, placée sous la surveillance bien visible des Gardiennes de la Vertu : « Elles ont des uniformes vert islam, des fouets de Malacca et des cœurs de pierre. Elles viennent des campagnes et savent comment il faut traiter les gens des villes. En général elles se montrent à Banda Aceh le vendredi, avant la prière. Elles avancent avec un mégaphone et un pick-up, lui aussi de couleur verdâtre, portant l’inscription Wilayatul Hisbah : escadron de la charia. Elles ne sont pas nombreuses, une douzaine, mais elles surgissent d’un peu partout et quand on ne s’y attend pas. » Elles ratissent les cafés, les jardins publics, les rues, les chambres à coucher. Les arrestations et les punitions sont immédiates. Coups de cravache de rotin sur la place publique.
Pour le terrorisme islamique, une église copte ou un grand magasin scandinave sont des cibles tout aussi appropriées. Il suffit que le rejet de l’Occident dans toute son extension, de la chrétienté à la sécularité, se manifeste à travers un organisme bien plus rudimentaire que l’Occident lui-même. La haine doit se concentrer sur un point, si possible là où la vie est le plus dense. Mais ce ressentiment n’est pas nouveau. Il existait déjà il y a cinquante ans. Pour quelle raison ne prend-il ces formes que maintenant ? C’est l’un des nombreux résultats de la désintermédiation, répondrait aussitôt un théoricien du web. Et du fait que le monde tend à devenir instantané et simultané. Qui se tue en tuant est un modèle suprême de désintermédiation.
Juste avant que s’achève le millénaire, dans les pays musulmans, comme presque partout dans le reste du monde, il devint possible d’accéder en quelques secondes à la vision d’un nombre illimité de corps féminins nus accomplissant des actes sexuels. Ce qui constitua un outrage extrême et une attraction irrépressible, plus que dans d’autres pays. Et cela représenta aussi une suggestion puissante pour tout passage à l’acte.
Sayyid Qutb débarqua à New York en novembre 1948, horrifié parce qu’une jeune femme à demi dévêtue avait frappé à la porte de sa cabine en demandant l’hospitalité. C’était un fonctionnaire ministériel du Caire venu en Amérique avec une bourse pour y étudier l’anglais. Il commença par observer l’Amérique en la sillonnant de part en part, avant de s’établir à Greeley, Colorado, qui lui sembla d’abord un lieu paradisiaque. Mais il ne tarda pas à se raviser et prononça une condamnation sans appel de l’American way of life, surtout après avoir participé à certaines fêtes du dimanche soir, quand, les cantines du college étant fermées, les étudiants étrangers fréquentaient des églises où, après l’office, on dînait et, parfois même, on dansait. Les lumières changeaient et Qutb voyait des jambes en mouvement (« nues », précisait-il), des bras qui s’enlaçaient, des seins qui ondoyaient — tandis que résonnait une chanson tirée d’un film d’Esther Williams. Il n’en fallait pas plus.
De retour en Égypte, Qutb devint rapidement une figure politique importante. Parvenu au pouvoir, Nasser le plaça à la tête du Comité éditorial pour la révolution. Mais cela ne dura pas longtemps. Dans l’Égypte de cette époque, comme par la suite en Algérie, seules deux voies s’offraient : soit les militaires soit la charia, prônée ici par les Frères musulmans. Or Qutb les représentait. Dès 1954, il fut emprisonné. Une fois libéré, on lui proposa de diriger la revue des Frères musulmans. Cette fois encore, cela ne dura pas longtemps. Il fut de nouveau arrêté. Comme il était souvent malade, il fut transféré à l’hôpital de la prison où il resta dix ans. Durant cette période il écrivit un commentaire du Coran en huit volumes. Mais son œuvre la plus enflammée est Pierres milliaires, dont le manuscrit sortit progressivement de la prison. Le livre contenait ses instructions pour l’« avant-garde » appelée à conquérir le monde en le soustrayant, au nom de l’islam, à la jahiliyyah, la pernicieuse « ignarité » qui englobe les musulmans réfractaires à la charia et tout le reste des vivants. Il fut le guide de l’action d’un autre Égyptien, al-Zawahiri, et de son compagnon Oussama Ben Laden, ainsi que de celui qui allait devenir l’ayatollah Khamenei.
Qutb fut de nouveau relâché. Il lui aurait été alors permis de s’expatrier. Mais il persista dans son refus. Il fut finalement jugé et condamné à mort. Sadate était l’un des trois juges de ce tribunal. À la lecture de la sentence, Qutb déclara : « J’ai pratiqué le jihad pendant quinze ans et j’ai réussi à gagner le martyre, shahadah. » Il fut pendu à l’aube du 29 août 1966.
Ce n’est pas sans quelques motifs profonds si dans les lieux et sous les formes les plus diverses tant de tribus humaines ont célébré des sacrifices. Et même, sans un enchevêtrement de motifs dont on ne finit jamais de démêler l’écheveau. Certes, le monde séculier n’a jamais accepté de célébrer des sacrifices. Mais c’était là un pan du passé dont il ne savait trop comment se délivrer. Il suffit d’ouvrir Les derniers jours de l’humanité de Karl Kraus, qui reprend en grande partie ce qu’on lisait alors dans les journaux et ce que l’on entendait dans les conversations des gens, pour constater que pendant la Première Guerre mondiale on parlait tout autant de « sacrifices » que d’actions militaires. Mais cela ne fut pas suffisant. Il fallut une autre guerre — et, assortie d’une entreprise démesurée et effroyable de désinfestation, encore une fois pour liquider le sacrifice. Mais cela non plus n’a pas suffi. Après un obscurcissement séculaire pendant lequel il semblait avoir perdu son génie, comme si la prodigieuse floraison qui avait précédé l’eût éreinté, quelque chose à l’intérieur de l’Islam tressaillit de nouveau et, par la bouche de Sayyid Qutb, somma d’opposer de nouvelles « valeurs saines » à la corruption de l’Occident et à l’obnubilation de l’Islam lui-même, qui consistait d’abord dans l’acquiescement progressif aux modes de vie de l’Occident. Ainsi, certains, peu nombreux, commencèrent à se tuer afin d’en tuer beaucoup d’autres, le plus grand nombre possible.
L’héritage du sacrifice devait déboucher sur quelque chose : c’est ce qui s’est produit à travers deux grandes guerres, puis la démesure de la puissance des armes a empêché qu’on aille plus loin. C’est alors que le terrorisme a pris le relais : tueries sporadiques, omniprésentes, chroniques, de plus en plus aléatoires, qui maintiennent en vie le feu sacrificiel. C’est un exact renversement des doctrines védiques. Mais aucun des acteurs ne le sait. Comme des automates, ils œuvrent dans une usine dont l’un des ateliers est céleste et l’autre infernal.
Sacrifice et terrorisme convergent sur un point, le plus délicat : le choix de la victime. Dans le sacrifice, ce sera un exemplaire intègre, immaculé, d’une beauté particulière — ou bien un être quelconque, interchangeable, multipliable. Dans le terrorisme ce peut être qui détient le pouvoir — ou bien quiconque s’est trouvé à un certain moment à un certain endroit.
Ce sont deux voies, divergentes et coexistantes : l’élection et la condamnation. Et deux royaumes : la grâce et le hasard, des puissances irréductibles. De leur façon de se superposer, de se mélanger, de se séparer découlent des conséquences innombrables, les plus subtiles, les plus incisives, qui rayonnent sur tout le reste, et n’ont en commun que l’acte homicide.
Pour comprendre les métamorphoses du sacrifice à l’âge séculier, on doit lui substituer le mot expérimenlalion. Qui ne se résume pas uniquement à ce qui a lieu tous les jours dans les laboratoires — et qui suffirait pourtant à en démontrer l’ampleur. L’expérimentation est ce que la société pratique jour après jour sur elle-même. L’ambivalence du mot apparaît plus clairement encore, si l’on songe que les deux expérimentateurs sociaux suprêmes du XXe siècle ont été Hitler et Staline. L’évocation par ce dernier des « ingénieurs des âmes » ne relevait pas du hasard. En vérité, ils ressemblaient davantage à certains féroces chirurgiens lobotomiseurs, encore une fois au nom de la science.Tous dévastateurs de l’inconnu.
Au cours du XXe siècle s’est cristallisé un processus d’une immense portée qui a investi tout ce que recouvre le nom « religieux ». La société séculière, sans qu’il ait été nécessaire de le proclamer, est devenue l’ultime cadre de référence pour n’importe quelle signification, comme si sa forme correspondait à la physiologie de n’importe quelle communauté et que la signification ne devait être recherchée qu’à l’intérieur de la société elle-même. Celle-ci pouvant prendre les formes politiques et économiques les plus divergentes, capitalistes ou socialistes, démocratiques ou dictatoriales, protectionnistes ou libérales, militaires ou sectaires. Et qu’il fallait, en tout cas, les considérer comme de pures et simples variantes d’une unique entité : la société en soi. C’est comme si l’imagination s’était amputée, après des millénaires, de sa capacité à regarder au-delà de la société à la recherche de quelque chose qui donne une signification à ce qui se produit à l’intérieur de la société. Un pas très audacieux qui implique un formidable allégement psychique. Mais inévitablement de courte durée. Vivre « par-delà bien et mal » est quelque chose qui rencontre une résistance invincible. Produire — ou de toute manière favoriser — cet allégement est une caractéristique décisive de la démocratie. Qui pourtant est incapable de le conserver.
Par rapport à tous les autres régimes, la démocratie n’est pas une pensée spécifique, mais un ensemble de procédures, qui se prétendent capables d’accueillir n’importe quelle pensée, hormis celle qui se propose de renverser la démocratie elle-même. Et c’est là son point le plus vulnérable, comme la démonstration en fut faite en Allemagne en janvier 1933. Ainsi, la société séculière a fait preuve de souplesse et d’ingéniosité dans la réabsorption en elle-même, sous de fausses apparences, de ces mêmes puissances qu’elle venait d’expulser. La théologie a fini par se transformer en politique, tandis que la théologie en tant que telle était reléguée dans les universités.
Or ce processus s’applique à tous les niveaux : sans le frisson du numineux la société séculière se refuse à subsister, tandis que le mot numineux n’est plus accepté que dans le milieu académique. Ne pouvant nommer, selon les règles d’un canon, ce qu’elle adore, la société paraît condamnée à une nouvelle et sournoise superstition : la superstition d’elle-même, la plus difficile à percevoir et à dissoudre. Nous savons désormais que les pires désastres se sont manifestés quand les sociétés séculières ont voulu devenir organiques, une aspiration récurrente de toutes les sociétés qui développent le culte d’elles-mêmes. Toujours avec les meilleures intentions. Toujours pour récupérer une unité perdue et une harmonie supposée. Sur ce point, Marx et Rousseau, mais aussi Hitler et Lénine, mais aussi le productiviste Henri de Saint-Simon ont trouvé un accord fugace. Organique est beau, pour tous. Nul ne se hasarde à dire que l’atomisation tant décriée de la société peut être une forme d’autodéfense contre des maux plus graves. Dans une société atomisée on peut se dissimuler plus facilement. On n’attend pas que la police secrète frappe à la porte à quatre heures du matin.
Tout cela est la conséquence d’une évolution longue et tourmentée jamais interrompue — même si elle s’est parfois dissimulée. S’il fallait établir, de manière indiscutablement arbitraire et pour des exigences purement dramaturgiques, le point de départ de ce processus, aucune image ne serait plus appropriée que celle de Sparte, telle que Jacob Burckhardt l’a montrée, condensant l’essentiel en quelques mots avec son habituelle sobriété : « Sur la terre, la puissance peut avoir une mission supérieure ; sur elle seule, sans doute, sur un monde fortifié par elle, peuvent surgir les civilisations d’un ordre supérieur. Mais la puissance de Sparte ne semble être apparue au monde que pour elle-même, pour sa propre affirmation, et son pathos, son aspiration constante, a été l’asservissement des peuples soumis et l’extension de son empire comme une fin en soi. »
Ils ont lu le livre
L’âge de l’anxiété
par jean-paul gavard-perret
Touristes, terroristes, sécularistes, hackers, fondamentalistes, transhumanistes, algorithmiiens : Calasso rameute les tribus qui hantent un innommable. Peu à peu, il prend corps. Même s’il crée un monde en galère et en fuite qui semble perdre son histoire. Néanmoins, tout semble plus fluide et visible par retour au passé. Ici, dans la période comprise entre 1933 et 1945. L’époque fut déjà tragique puisque s’intruisit à bien des égards une tentative d’anéantissement.
La suite fut plus hybride avec néanmoins bien des craintes plus que rampantes et une peur de l’autre qui prend de plus en plus un aspect planétaire. W.H. Auden intitula cette époque de violence larvée et clivante “L’âge de l’anxiété” dans un dire poétique divinatoire et à plusieurs voix.
Désormais, ces voix reviennent quoique lointaines, comme si elles surgissaient d’une autre “pays” et d’un ordre ancien. Les choses sont désormais de plus en plus compliquées au sein de la mondialisation. Mais avec Calasso, si l’anxiété ne manque pas, elle ne prévaut pas. L’Italien repense notre monde pour mettre en exergue l’inconsistance meurtrière d’un caractère internatioaliste inhumain.
Ce neuvième temps d’une œuvre majeure en cours d’élaboration se retrouve ici relié à sa première partie : “La ruine de Kasch” (1987), où apparaissait déjà la notion « l’innommable actuel », précédée et suivie à l’époque par deux lignes blanches. Ce nouveau tome les remplit en mettant en exergue autant des affirmations solides que des mots d’ordre négatifs. Reste à savoir où trouver la nouvelle inventivité politique et ses débouchés qui devraient réinventer une hospitalité absolue jugée impossible mais aussi que nécessaire toute orientation éthique.
Calasso pose la question de l’autre et de son accueil et son acceptation, alimente ce qui arrive dans cet après — pas si lointain que ça — de la Seconde Guerre mondiale et ses terreurs criminelles. C’est ambitieux dans l’espoir affiché d’une nouvelle alliance. Et ce, même si elle semble improbable dans notre temps post-historique.
L’auteur a le mérite de ne pas proposer des fusions passéistes toujours faciles au moment où les migrations sont à la fois interdites mais d’une certaine manière obligées, loin des limitations des lois étatiques qui referment plus qu’elles n’ “ouvrent”. Une scène internationale est à inventer mais l’on sait la méfiance que cela entraîne.
jean-paul gavard-perret, lelitteraire.com
Roberto Calasso, illuminé rationnel – à propos de L’Innommable actuel
Par Patrick Kéchichian
Avec L’inommable actuel, Roberto Calasso poursuit l’exploration d’un territoire littéraire propre – un territoire d’ombre et de lumière, de vive conscience surtout, qui ne serait pas le sien sans la méthode qui le caractérise, sans le style et la capacité de raisonnement, de déduction, de sa pensée. Procédant souvent par montage de citations, il met en écho notre monde actuel avec la Vienne des années 1933 à 1945.
Dès son titre, L’Innommable actuel, le dernier livre de Roberto Calasso installe dans l’esprit du lecteur une question, une inquiétude : suis-je assez intelligent pour lire ces pages ? Serai-je à leur hauteur ? Certes, il ne faut pas évacuer de la question toute l’ironie, et l’auto-ironie, qu’elle contient… Elle n’en reste pas moins valide, légitime. Peu à peu, lorsqu’on progresse dans le livre, un autre sentiment surgit, une autre question, qui modifie, dans le bon sens, la première : cette intelligence dont je manque, Calasso la déploie, me la tend, me la donne à partager, pas du haut de son orgueil ou appuyé sur une science supposée certaine, mais par sa réflexion obstinée, sa lente progression dans le sujet qu’il s’est choisi. Dès lors, il faut le répéter : la reconnaissance est l’une des grandes vertus que le lecteur met en pratique face à un livre dont il tire un grand, un surprenant bénéfice.
Avant d’en venir à la tentative de description de cet ouvrage, il faut souligner que c’est la totale singularité de la méthode (au sens large) de Roberto Calasso, qui nous frappe, qui sollicite notre attention, pour la désarçonner aussitôt. Et cela vaut évidemment pour tous ses livres, toujours traduits avec grande subtilité par Jean-Paul Manganaro. Je me contente de citer ceux que je garde le mieux en mémoire, en reconnaissante mémoire donc, tous parus chez Gallimard : La littérature et les dieux (2002), K. (sur Kafka, 2005), Le rose Tiepolo (2009) et La Folie Baudelaire (2011). Dans La littérature et les dieux, Calasso rappelait que l’écrivain, c’est d’abord celui qui est « enthousiasmé par le langage ». Et dans son Kafka, il relevait cette phrase de l’écrivain pragois : « Chacun a sa manière de remonter du monde souterrain, moi, je le fais en écrivant. » Cela dessine, esquisse, le territoire littéraire de Roberto Calasso. Territoire d’ombre et de lumière, de vive conscience surtout, qui ne serait pas le sien sans la méthode dont nous parlions, sans le style et la capacité de raisonnement, de déduction, de sa pensée.
Le livre est divisé en deux parties, plus une troisième très brève. A première et courte vue, chacun de ces deux chapitres pourrait former un livre en soi, et le troisième une sorte d’échappée, ou de cristallisation. Mais si cela était, l’intelligence de la vision et l’amplitude réflexive de l’ouvrage tel qu’il nous est livré, s’en trouveraient gravement amoindries. « Touristes et terroristes », tel est le titre de la première partie, « La société viennoise du gaz » celui de la seconde. Deux points formels : chaque partie est divisée en fragments, discrètement séparés par un simple interlignage ; à la fin de ce volume, comme dans tous les ouvrages de Calasso, les « sources », nombreuses, diverses, utilisées dans le livre sont scrupuleusement indiquées, avec simplement la mention de la page, sans appel de note dans le texte renvoyant à ce référencement. Je ne saurais dire en quoi, mais ces choix de présentation me semblent importants, significatifs de la démarche de l’auteur.
Venons-en au contenu.
La première partie, théorique si l’on veut, accumule, selon une logique scrupuleusement divagante, appuyée sur l’analogie et l’association d’idées, des angles de réflexion sur notre actualité, notre vie présente, individuelle et (surtout) collective, et sur ce qui, en elle, est, aujourd’hui, « innommable ». Il y est question de terrorisme, de religion, des processus de sécularisation, de conscience, d’intelligence artificielle, des poussées incontrôlées d’internet et de la funeste loi des algorithmes, de démocratie directe ou indirecte, de l’information et du tourisme, des transhumanistes, etc.
De très nombreux auteurs sont convoqués, des scientifiques, des philosophes, des écrivains. Cela va de Jeremy Bentham à Simone Weil, de Stuart Mill à Robert Walser, de Durkheim à Malebranche, de Leibniz à René Daumal. Calasso ne s’interdit pas l’humour, par exemple lorsqu’il établit un parallèle entre dadaïstes et dataïstes, adeptes de l’information en flux continu. Avec les transhumanistes, ces « humanistes séculiers », les adeptes du Big Data professent que « la conscience est la barrière invisible contre laquelle bute l’information ». « Plus que de penser, il s’agit pour eux de réaliser. Tel est le mirage vers lequel ils tendent, impatients, lugubres et joyeux. »
A la différence de nombre d’intellectuels et d’intervenants médiatiques, Roberto Calasso ne donne pas le fin mot de sa pensée, ne la totalise pas en une synthèse, une idée générale ou une idéologie. Il ne s’agit évidemment pas de dissimuler cette idée, mais de démontrer que l’approche plurielle, selon des angles inédits, sous des éclairages inattendus, est plus féconde, qu’elle nous fait progresser dans cette conscience si souvent mise à mal ou négligée.
Le personnage central de cette réflexion est l’Homo saecularis, qui n’est pas né de la dernière pluie mais s’impose comme le fruit d’un « processus progressif d’évidement, à l’œuvre depuis plusieurs millénaires ». Un « sécularisme humaniste (autrement appelé, en France, laïcité) implique toutes les nuances possibles, de la tiédeur à la bigoterie agressive, que l’on rencontre dans les religions antérieures ». A la fin du chapitre, Calasso cite Walter Benjamin qui, à propos de Kafka, évoquait cette « faculté d’attention » de l’homme, tellement malmenée aujourd’hui. Elle constitue, pour reprendre une expression de Malebranche, « la prière naturelle de l’âme ». Même sécularisées, les « catégories théologiques sont toujours vivantes et à l’œuvre ». Calasso ne pose jamais à l’oiseau de mauvaise augure, heureux de faire entendre son chant funèbre.
Les deux temps du livre – l’actuel d’abord, celui qui l’a préparé ensuite – s’emboîtent, s’articulent.
Le contenu de la deuxième partie est annoncé dès les premières lignes de l’ouvrage. Ce paragraphe souligne le projet, la matière et la visée de l’auteur. Je le cite : « Durant les années 1933 à 1945, le monde s’est livré à une tentative d’autoanéantissement, en partie réussie. Celui qui vint ensuite était informe, brut, hyperpuissant. Dans le nouveau millénaire, il est sans forme, brut et toujours plus puissant. Aucune de ses composantes n’offrant de prise, il est l’opposé du monde que Hegel entendait étreindre dans l’étau du concept. C’est un monde broyé, y compris pour les hommes de science. Sans style propre, il les utilise tous. »
Le titre, « La société viennoise du gaz » est emprunté, à nouveau, à Benjamin. Dans le post-scriptum d’une lettre à Margarete Steffin datée du 7 juin 1939, il écrit : « Karl Kraus est mort trop tôt. Ecoutez-moi bien : la Société viennoise du gaz a cessé toute livraison de gaz aux Juifs. L’utilisation du gaz par la population juive entraînait des pertes pour la Société, parce que les plus forts consommateurs, justement, ne réglaient pas leurs factures. Les Juifs recouraient de préférence au gaz pour se suicider. » Calasso a raison de citer ces phrases sans les commenter. A un certain degré de réalité, les mots seuls peuvent placer celui qui lit ou entend devant le vertige de cette réalité. Cette réalité n’est pas seulement celle d’une histoire passée, révolue.
Les deux temps du livre – l’actuel d’abord, celui qui l’a préparé ensuite – s’emboîtent, s’articulent. Les années d’apprentissage, si j’ose dire, du monde contemporain – lorsque le nazisme monta en puissance, s’installa puis fut vaincu – sont décrites selon une scrupuleuse chronologie. En cette décennie, « c’était comme si le temps avait formé une spirale de plus en plus resserrée, qui s’achevait dans un étranglement. »
A nouveau, Roberto Calasso procède par un montage de citations venues de tous les horizons, tirées pour la plupart de récits, de mémoires ou de journaux intimes, en limitant son propre commentaire à la dimension descriptive. Céline ou Jünger, Klaus Mann, Elie Halévy ou Arthur Koestler donnent leurs impressions. Ce n’est pas toujours la lucidité qui commande, mais une sombre intuition du malheur qui vient, s’installe. Mai 1933, Céline, dans une lettre à Eugène Dabit : « Il y a je ne sais quoi dans l’air d’hystérique et d’urgent […] Il y a une mue – C’est un bateau qui s’éloigne […] Nous allons vers la violence. Elle est tout près. » Plus directement concerné, Goebbels révèle, non pas une face cachée de l’antisémitisme nazi, mais une pensée comme soumise, dans son ignominie même, à une sorte de force supérieure, de fatalité, dont Hitler ne serait que l’exécutant.
Il y a aussi, à un niveau moins hallucinant, presque candide, des passages du Journal de Gide regardant monter le nazisme, avec un calme aveuglement, voyant (en janvier 1941) en Hitler « celui qui se veut grand jardinier de l’Europe… » Quelques années plus tôt (septembre 1937), Robert Brasillach s’en va, conquis, visiter l’Allemagne. « Cent heures chez Hitler », c’est le titre de son reportage pour la Revue universelle. Par exemple, il assiste, fasciné, à une consécration des drapeaux ; Hitler est là, dont le journaliste note « la couleur et la tristesse des yeux ». Et aussitôt, il établit un parallèle entre les gestes du Führer et la consécration chrétienne du pain et de vin : « une sorte de transfusion mystique analogue », dit-il…
Tous les passages cités dans ce chapitre mériteraient d’être mentionnés. Ils dessinent cet « étranglement » dont, pour une part au moins, nous sommes, dans notre monde actuel, les héritiers. Calasso n’est cependant pas un écrivain apocalyptique. Il perçoit, devine et analyse des fragments disparates d’une logique, d’un enchaînement de causes et d’effets. A l’aide de ces éléments, il établit une continuité, trace le profil plus que plausible de notre monde, pris dans son histoire, sa modernité.
Au troisième chapitre, long d’à peine une page, il cite un rêve que Baudelaire avait inscrit sur un feuillet isolé, sans date. Un de ces rêves « qui donnent envie de ne plus jamais dormir ». Une tour se fissure, « tout en haut, une colonne craque et ses deux extrémités se déplacent. Rien n’a encore croulé… » Le rêveur est là, calculant autant qu’il le peut, ce qui menace. Il fait partie de la scène. Conclusion de Calasso : « Quand la “nouvelle” de ce rêve parvint aux “nations”, tout correspondait, à l’exception d’un ajout : les tours étaient deux – et jumelles. » Nous voici, soudain ou à nouveau, renvoyé au très actuel innommable… [2].
Patrick Kéchichian, AOC.
L’innommable actuel
par Cécile Guilbert
Alors que déferlent déjà les services de presse des centaines d’ouvrages de la sacro-sainte « rentrée littéraire » nous rappelant pourquoi Lacan a inventé le terme « poubellication » et Sollers le verbe « poublier » car l’on sait bien que la majorité d’entre eux est programmée d’avance pour la déchetterie, il est impératif de sauver de l’indifférence générale les grands livres récemment parus capables d’agir en contre-poisons aux maraboutages actuels. Sont-ce ceux dont la grande poétesse catholique Cristina Campo n’excluait pas qu’ils soient « inconciliables avec les nouvelles directives » ? À moins qu’il ne faille pointer leur incompatibilité de fond avec le conformisme de l’esprit du temps et le formatage accéléré de ses nouvelles têtes ?
Tout est accompli, de Meyronnis, Retz et Haenel, dont je vous ai parlé la semaine dernière répond à ces critères. De même L’Innommable actuel, de Roberto Calasso, magistral essayiste italien qui se meut dans la même zone d’analyse et de pensée, dans les mêmes formes démonstratives spiralées aussi, insistant sur le tour apocalyptique pris par l’histoire contemporaine de l’humanité. Une nervure d’auto-anéantissement naturellement reliée aux catastrophes du XXe siècle mais selon des formes différentes qui appartiennent précisément à l’informe, au flou, à l’inerte, à l’absence de contraintes produisant ce que l’auteur nomme une « inconsistance meurtrière », passionnante à méditer.
« La sensation la plus précise et la plus aiguë, pour qui vit en ce moment, écrit-il en incipit, est de ne pas savoir, chaque jour, où il est en train de mettre les pieds. Le terrain est friable, les lignes se dédoublent, les tissus s’effilochent, les perspectives vacillent. C’est alors que l’on perçoit avec une plus grande évidence que l’on se trouve dans “l’innommable actuel”. » Caractérisée à la fois par l’instantanéité et la simultanéité permises par la réticulation numérique, mais surtout l’expérimentation incessante que pratique sur elle-même une société planétaire devenue entièrement séculière où « les procédures ont pris le pas sur les rituels », cette « zone qui n’a pas de nom » est aussi reconfigurée par les touristes, terroristes, hackers, fondamentalistes, transhumanistes, algorithmiciens et autres propagateurs d’anxiété qui font d’elle « un laboratoire où des forces opposées tentent de s’arracher réciproquement la direction des expériences ».
Si Calasso voit symboliquement dans l’époque de Bouvard et Pécuchet le moment de cristallisation de cette configuration qui remonte à beaucoup plus loin, sa doctrine en est actée, selon lui, par Émile Durkheim dans Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912). Pour résumer, la société devenue entièrement profane s’arroge tout, ne laisse rien hors de son orbe, « est à ses membres ce qu’un dieu est à ses fidèles », « condamnée à la superstition d’elle-même ». Résultat ? Le contraire du bonheur promis puisque chacun s’éprouve à juste titre livré à la remplaçabilité, à l’angoisse, au ressentiment, à la laideur, à l’insignifiance sur fond d’ennui nommée « normalité », celle-là même dont Houellebecq fait ses tristes choux gras.
Quant à la pensée séculière dominante, identifiée dans « la voie progressiste et humanitaire », Calasso fera grincer des dents en assurant qu’« elle applique des préceptes hérités du christianisme, assouplis et édulcorés. Cette solution tiède et craintive se combine en sens inverse avec le mouvement en cours dans l’Église elle-même qui ne cesse de s’assimiler à une institution d’assistance. Avec pour résultat que les sécularistes parlent avec une componction d’ecclésiastiques et que les ecclésiastiques ont pour ambition de se faire passer pour des professeurs de sociologie ».
Quid alors de ceux qui, sans pour autant appartenir à une confession religieuse, refusent de coaguler dans ce magma désenchanté autant que mortifère mais reconnaissent avoir une expérience du sacré et du divin ? Cachés, réfractaires, contemplatifs et gnostiques, ils existent depuis toujours et traversent toutes les traditions. « Apatrides et extraterritoriaux par vocation », écrit Calasso, ils parlent, écrivent, « réussissent à passer entre les mailles des classes, des corporations, des barrages sociaux ». « Dans l’Inde védique, dit-il encore, on parlait des vanaprastha, de ceux qui vont “dans la forêt”. Quand il n’y a plus de forêt, ils circulent dans les rues de tout un chacun, mais à une certaine lumière dans leurs yeux on saisit qu’ils n’appartiennent pas. »
Cécile Guilbert, La Croix, 26 juin 2019.
« L’Innommable actuel », divin dissolu
Poétique et érudit, le nouvel opus de Roberto Calasso dénonce la désacralisation de notre époque livrée à l’illusion de la réalité virtuelle et du transhumanisme.
par Olivier Lamm
« C’est une tentation générale à laquelle les écrivains devront résister que de décrire l’état mental d’un peuple en faisant passer en contrebande, au milieu d’éléments d’une certaine période, des connaissances postérieures. » Cet extrait de la Lie de la terre, journal de guerre d’Arthur Koestler, a été écrit en 1941, peu avant que l’Allemagne nazie n’attaque l’URSS. Roberto Calasso, romancier-essayiste — il faudrait inventer un mot-valise pour la conjonction totale entre les deux disciplines qu’il est l’un des rares écrivains à avoir réussi à opérer — le cite dans le tissu d’anecdotes, « mots écrits, publiés, dits, rapportés entre le début de janvier 1933 et mai 1945 » qui constitue la deuxième partie, au dessein théorique aussi puissant qu’obscur, de l’Innommable actuel.
Lui-même né en mai 1941, pendant la « période la plus désespérée de l’histoire européenne », l’écrivain, éditeur et traducteur italien conclut ensuite le livre par une exégèse d’un court texte de Baudelaire, non daté, dans lequel le poète raconte l’écroulement d’un édifice immense : à n’en pas douter les tours jumelles du World Trade Center pour Calasso, dont la tentation de se voir, se « sentir » en messie semble plus affirmée que jamais. Faut-il alors lire l’Innommable actuel comme l’ouvrage d’un théoricien prophétique façon Paul Virilio, qui vérifierait à trois décennies d’écart que ce qu’il annonçait s’est finalement réalisé ? Obsessionnel, en tout cas, puisque le titre de cet ouvrage bref, volontiers pamphlétaire, tire son titre d’une page de la Ruine de Kasch, roman essai qui débutait en 1983 le grand cycle littéraire et critique dont l’Innommable actuel constitue le neuvième volume. Et que l’essentiel de la thèse de ce nouveau livre s’y lisait déjà, totalement déployée : « Si le profane, c’est-à-dire le profanateur, dévore ce qui est sacré, sacré et profane se rejoignent dans une mixtion inouïe qui rendra à jamais impossible, désormais, de les discerner. »
Fatuité. Voilà le grand sujet de Calasso, qui le hante depuis son tout premier livre : la dissolution du divin dans des sociétés occidentales devenues ivres de leur « marche en avant », et son remplacement progressif par un « sécularisme humaniste » désacralisé, qui aurait conservé des religions le pire de ce que la croyance a autorisé d’intolérance et de fatuité — « de la tiédeur à la bigoterie agressive ». Arrivé à « l’âge de l’inconsistance », dont les stigmates seraient entre autres Internet et le tourisme de masse, ce sécularisme envelopperait le « monde normal » dans son entier, et nous le rendrait informe au point qu’il nous serait impossible d’en percevoir les contours. Pour nous autodétruire, comme l’Europe entre 1933 et 1945, comme le suggère la deuxième partie du livre ? En tout cas le grand mal perçu comme tel de notre époque, le terrorisme, n’aurait pas pu trouver contexte plus opportun pour se rendre si puissant. Calasso l’évoque dès la deuxième page de l’Innommable actuel : « La puissance qui meut le terrorisme et le rend obsédant n’est ni religieuse, ni politique, ni économique, ni revendicative. C’est le hasard. […] Il fallait que la société parvienne à s’éprouver comme autosuffisante et souveraine pour que le hasard se présentât comme son principal antagoniste et persécuteur. »
Il n’est pas besoin d’avancer très loin dans la lecture de ce livre de Calasso pour percevoir qu’il est apocalyptique. Pour peu qu’on s’acharne à y déchiffrer quelque idéologie, on pourra même y lire une allergie réactionnaire au temps présent. Calasso honnit la réalité virtuelle et le transhumanisme. Mais ces détestations sont presque des détails de la violence que l’Italien décrit, à rebours de l’ambition de l’œuvre — un factum certes politique, mais poétique avant tout. Qui nécessite donc que l’on opère quelques allers et retours vers d’autres ouvrages plus dithyrambiques, consacrés à ses passions, tels la mythologie olympienne (le best-seller les Noces de Cadmos et Harmonie), la pensée védique (l’Ardeur) ou le Mahabharata (Ka) pour comprendre ce qui est en train d’être dissous. La thèse de l’Innommable actuel n’est résumable dans aucun autre système de pensée — classes, déterminisme, capitalisme — que celui de Calasso lui-même, qui élève l’art et la grâce au-dessus de tout. Réputé pour son savoir aussi immense qu’ésotérique, l’Italien est un récipiendaire tardif du panthéon des écrivains « encyclopédistes » dont d’autres membres modernes seraient Julián Rios ou, dans un genre plus remuant, Pacôme Thiellement.
« Inconsistance ». Comme ce dernier, Calasso interprète « infiniment » et brutalement, assemble l’inassemblable, dérape à rebours du sens du temps. Il se fixe ses propres combats. Il voit plus clair, aussi, que bon nombre d’idéologues qui interprètent à l’intérieur des « prescriptions doctrinales » abondant en dépit du bon sens dans le débat public à cause de « l’inconsistance » de ce qui nous entoure. Il est la preuve vivante, et bien vivante, que l’érudition et l’ardeur sont plus que jamais indispensables pour cerner notre monde qui échappe à toute tentative d’être étreint en totalité.
Olivier Lamm, Libération du 31 juillet 2019.

Andrea Mantegna, La Crucifixion, dite Le Calvaire, 1457-1459.
Paris, Musée du Louvre © RMN / Thierry Le Mage. ZOOM : cliquer sur l’image.

Ligne de risque
Ligne de risque a été créé en 1997. La revue était alors animée par Frédéric Badré, Yannick Haenel et François Meyronnis. 27 numéros en 18 ans. Depuis 2015, la revue a fait l’objet d’une nouvelle série. Valentin Retz a remplacé Frédéric Badré (décédé). Le premier numéro de cette nouvelle série portait le titre du roman de Leïb Rochman « A pas aveugles de par le monde » (cf. Ligne de risque n° 1), écrit en 1968 et traduit du yiddish pour la première et unique fois en français en 2012 (chez Denoël, réédité dans la Collection Folio (n° 5679) [3] ; le second numéro, publié en 2017, s’intitulait « Dévoilement du Messie » (cf. Ligne de risque n° 2). De numéro en numéro, de livre en livre, d’essai en essai et de roman en roman, Haenel, Meyronnis et Retz poursuivent leur chemin singulier — vers le Royaume [4]. La critique surmenée en parlent peu, à l’exception notoire des livres de Haenel, souvent salués et même parfois couronnés [5]. Pour la première fois, nos auteurs signent un livre écrit en commun : Tout est accompli. Le titre reprend, bien sûr, les mots de l’évangile de Jean (19/30) : « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit. » Tout est accompli est un livre eschatologique qui relit les derniers siècles, notamment français — ce qu’il est convenu d’appeler les Temps modernes — dans une perspective messianique qui, n’en doutons pas, suscitera autant de résistances que d’interrogations. Une simple présentation n’y suffit pas. J’y reviendrai [6].
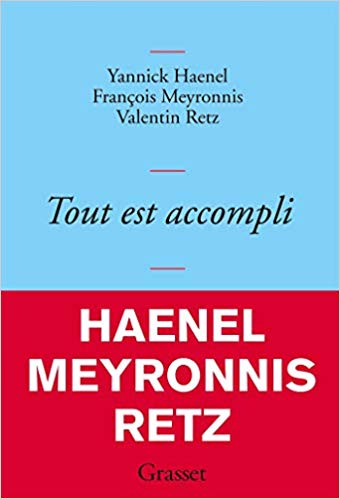 « Dans quelle époque vivons-nous ? Tout indique que nous entrons dans l’âge de la fin : quand l’humanité vit entièrement sous la menace de sa disparition. De toutes parts, on sent croître l’emprise des réseaux numériques, l’intelligence artificielle décide pour nous et les transhumanistes promettent déjà les noces de la biologie et des algorithmes. La terreur nous saisit, de même que l’impossibilité d’agir.
« Dans quelle époque vivons-nous ? Tout indique que nous entrons dans l’âge de la fin : quand l’humanité vit entièrement sous la menace de sa disparition. De toutes parts, on sent croître l’emprise des réseaux numériques, l’intelligence artificielle décide pour nous et les transhumanistes promettent déjà les noces de la biologie et des algorithmes. La terreur nous saisit, de même que l’impossibilité d’agir.
Si ce livre nous fait voir la catastrophe qui vient, il ne nous laisse pas pour autant dans le désespoir. Devant cette nouvelle situation mondiale, il enseigne l’art de n’être ni sourd ni aveugle. Il ouvre une brèche où la plénitude devient accessible, car le sauf n’est pas hors d’atteinte. Et par là, surmonte le nihilisme de notre temps. »
Portant un regard neuf sur les trois derniers siècles qui ont accouché du nôtre, Yannick Haenel, François Meyronnis et Valentin Retz dégagent les forces à l’œuvre dans l’Histoire. Une Histoire qui, sous son aspect strictement profane, laisse entrevoir une trajectoire cachée, une certaine « courbure du temps » qui trouve son origine dans les deux maisons d’Israël, l’Église et la Synagogue.
LIRE : Le ravage, le Royaume pdf
 , entretien des auteurs avec Fabien Ribéry (juillet 2019)
, entretien des auteurs avec Fabien Ribéry (juillet 2019)
Les cinq chapitres
 APPEL DES DERNIERS JOURS
APPEL DES DERNIERS JOURS
 LA STUPEUR DU MONDE (p. 21)
LA STUPEUR DU MONDE (p. 21)
 LE POISON DE DIEU (p. 85)
LE POISON DE DIEU (p. 85)
 LE SACRIFICE D’ISRAËL (p. 217)
LE SACRIFICE D’ISRAËL (p. 217)
 LE ROYAUME (p. 329)
LE ROYAUME (p. 329)
 BIBLIOGRAPHIE (p. 361)
BIBLIOGRAPHIE (p. 361)
Premier chapitre
Dans sa partie principale, l’expulsion du paradis est éternelle : ainsi il est vrai que l’expulsion du paradis est définitive, que la vie en ce monde est inéluctable, mais l’éternité de l’événement (ou plutôt, en termes temporels : la répétition éternelle de l’événement) rend malgré tout possible que non seulement nous puissions continuellement rester au paradis, mais que nous y soyons continuellement en fait, peu importe que nous le sachions ou non ici.Franz Kafka Méditations sur le péché,
la souffrance, l’espoir et le vrai chemin


Dans le numéro 2 de la revue Maintenant parue en juillet 1913, le jeune poète-boxeur Arthur Cravan narre sa rencontre avec celui qui n’était pas encore le « contemporain capital », André Gide. De cette entrevue, on a gardé en mémoire la célèbre phrase : « Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps ? »
Aujourd’hui, il nous incombe de poser cette question à notre tour, afin de savoir dans quelle époque nous vivons. Et la maigre réponse du littérateur : il est « six heures moins un quart », ne peut nous être d’un grand secours.
Il suffit d’ouvrir n’importe quel magazine illustré pour entendre les prophètes officiels de la société assener d’un ton toujours plus péremptoire que l’avènement du numérique est sur le point de changer la définition même de l’être parlant. Avec des roulements de tambour, on nous annonce la fusion de la biologie et des algorithmes, de même que l’apparition d’un homme entièrement remodelé par l’Intelligence Artificielle. Quant à l’économie capitaliste, il est clair que la cybernétique semble en passe de lui donner un nouveau visage.
Devant de telles transformations, les commentateurs les plus crédités, souvent des sociologues, s’en tiennent à un discours lénifiant. S’il y a des problèmes, disent ces belles âmes, nul doute que la science va les pallier. Elles affirment en effet que celle-ci corrigera au fur et à mesure les dégâts qu’elle produit, et qu’ils ne prendront jamais la forme de la ruine. Malgré un état des lieux de plus en plus alarmant, répercuté par ailleurs dans les médias, elles maintiennent à toute force l’hypothèse du progrès. Cette vieille croyance, impossible d’en faire le deuil.
Car si elles admettent que la technique comporte un revers d’ombre, elles ne doutent pas que celui-ci finira par céder devant la toute-puissance de l’ingénierie. Laissons faire les scientifiques, disent-elles. D’autres, plus perfides, ajoutent : laissons faire le marché.
Au XXe siècle, une infime minorité d’esprits lucides a néanmoins pris acte d’un certain tour apocalyptique de l’histoire humaine depuis qu’à l’ère de la technique la guerre a englouti le monde ; et de ce point de vue, même la domination du marché est devenue un moment de cette conflagration planétaire. Quelqu’un comme Günther Anders a pensé explicitement ce qu’il appelle l’« obsolescence de l’homme » en regard de la mise à disposition de toutes choses par la science. Ce faisant, il avait à l’esprit la puissance libérée par l’atome et la menace qu’elle fait peser sur nous depuis 1945. Mais, plus généralement, il pointait la catastrophe voilée inhérente à l’autosuffisance de la technique.
En butte à la menace nucléaire, nous sommes pris dans un compte à rebours. À chaque seconde, les nouvelles capacités de destruction nous placent devant l’imminence de notre effacement en tant qu’espèce. « Nous ne vivons plus dans une époque – disait Anders –, mais dans un délai. » Et, de nos jours, ce délai est comme resserré dans l’instantanéité des connexions numériques, où les flux d’informations circulent à la vitesse de la lumière. Dès lors, le réel devient de plus en plus volatil sous l’effet de l’accélération. Celle-ci est non seulement croissante, mais elle culmine dans une abrasion du temps au profit de la simultanéité des réseaux.
Avant qu’elle ne devienne notre destin, l’écrivain Elias Canetti a pressenti cette déréalisation du monde – « Une idée pénible : au-delà d’un certain point précis du temps, l’histoire n’a plus été réelle. Sans s’en rendre compte, la totalité du genre humain aurait soudain quitté la réalité ».
Tout est accessible, et par là en danger ; mais tout est oblitéré, puisque le temps lui-même fait défaut, et donc avec lui l’accès.
À bon escient, certains penseurs insistent sur ce phénomène d’accélération continuelle. Quarante ans séparent en effet la mise au point du poste de radio à la fin du XIXe siècle et sa diffusion effective ; mais généraliser la connexion à Internet n’a pris que quatre ans. Aux prises avec cette fuite en avant, nos contemporains deviennent des individus sans avenir et sans passé – menés par des gouvernants eux-mêmes privés de toute conduite stratégique. Dans le nouveau monde, qui n’en est déjà plus un, le territoire est supplanté par la trajectoire, et celle-ci par une instantanéité généralisée. Les moyens de la modernité, explique le philosophe Hartmut Rosa, sont retournés contre le projet de la modernité. D’où un élan général vers l’abîme.
Ce constat établit le caractère inepte, et même rétrograde, de toute forme de progressisme. Celui de la gauche, bien sûr ; mais également celui des thuriféraires du marché, sans parler de ceux qui n’ont en vue que les branchements cybernétiques.
Ce qui domine notre planète est en train de se transformer sous nos yeux. Nous sommes les témoins d’un virage. Mais en étant capables d’endurer ce qui nous domine – de l’envisager sans fascination –, on peut se tenir au cœur du risque et, du même coup, rejoindre en nous le sauf. À partir de là, l’événement qui vient vers nous n’est plus seulement une catastrophe.
Ce qui arrive, nous le nommons l’âge de la fin ; par quoi nous n’entendons pas une simple cessation, mais une nouvelle manière, pour l’esprit, de se tenir devant le monde. De nos jours, la fin se montre ; elle devient de moins en moins inapparente. C’est la vraie crise mondiale, qui résulte du retournement sur eux-mêmes des Temps modernes.
Pour comprendre cette époque dépourvue d’assise, mieux vaut ne pas avoir ici-bas de cité permanente, mais être partout « étranger » et « voyageur ». Ce qui suppose d’aborder le « voyage » d’une autre manière que les touristes de masse ou les hommes d’affaires. De l’aborder comme une expérience spirituelle permettant de voir et d’entendre ce que les autres ne discernent pas ; voyager, sous ce rapport, c’est l’art de n’être ni sourd ni aveugle.
Avec l’âge de la fin, nous entrons dans les derniers temps : quand l’humanité ne peut vivre que sous la menace de sa disparition. D’ailleurs, elle n’a plus d’autre soubassement que cette disparition ; et en ceci, on peut soutenir qu’elle séjourne d’ores et déjà dans le royaume des morts.
Cette situation extrême lui donne un rapport entièrement nouveau avec sa propre histoire – de même qu’avec son destin. C’est pourquoi on ne peut restreindre la venue des derniers jours à une mauvaise nouvelle ; car elle est l’occasion d’un retournement messianique.
Nous portons ici attention aux grandes dates de l’histoire profane, surtout celles des trois derniers siècles. Mais sous cette histoire strictement historique, nous entrevoyons des intersignes qui ouvrent à ce qui est plus originaire que le monde, à ce qui le déborde, et que nous appelons dans ce livre le Royaume.
D’une manière paradoxale, l’âge de la fin ressemble à ce que les chrétiens appellent l’Avent : le temps de l’attente joyeuse, où l’on se prépare à recevoir ce qui excède la mesure des jours.
Quant au monde des Temps modernes, il n’est plus qu’un résidu de lui-même entraînant tout ce qui existe dans son effondrement. Cependant, alors que la course vers le néant s’avère la seule logique à l’œuvre, il reste possible à chacun de s’arracher à cette cohérence nihiliste, et de faire le pari de l’impossible. C’est ce que Rimbaud nommerait : choisir la « vie vivante ».
« L’ombre est proportionnelle à la lumière qui est révélée », disait Rabbi Nahman de Braslav. À rebours de toutes les croyances sucrées, le « Royaume » qu’annoncent l’ancienne et la nouvelle alliance d’Israël ne peut donc apparaître qu’en contrepoint d’une désolation générale.
Ce qui est en train de s’évanouir dans un nihilisme intégral n’est rien d’autre que le monde. Alors que le décor de notre vie semble de plus en plus réduit à des écrans, on assiste à un évidement de toute consistance ; mais cette trouée est pour celui qui a le courage de s’y rendre sensible la possibilité d’une libération – l’appel à faire tomber l’écran du monde.
D’une certaine manière, le Messie marche déjà avec nous dans l’aridité du désert ; ce dont témoigne la phrase de l’évangéliste Jean : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. »
Mais quelle est l’assise du mal à notre époque ? La tête du serpent, où est-elle ? Comme l’explique Yuval Noah Harari, la phrase de la Genèse : « Vous serez comme des dieux », est en passe de se réaliser. Les industriels de la Silicon Valley envisagent clairement l’accession de l’homme à la divinité, conçue sur le mode grec. Les humains seront bientôt en mesure de fabriquer du vivant, et de refaçonner le code de la vie : deux attributs réservés à la divinité. On passera par des manipulations génétiques et par le développement de l’Intelligence Artificielle. Le nouveau prométhéisme réalisera les noces de la biologie et du numérique, faisant apparaître l’humanisme des Temps modernes comme un moment périmé. La liberté individuelle ne sera plus, dès lors, qu’une chimère. On glissera ainsi d’Homo sapiens à Homo deus.
En toute logique, la nouvelle civilisation posthumaine décrétera une guerre contre la mort. Pour la nouvelle entité transhumaine, mourir ne sera plus qu’un simple phénomène biochimique à dépasser. Mais, en remodelant la vie, les apôtres de la Silicon Valley ne s’attellent à rien d’autre qu’à rendre la mort vivante.
Avec eux, la civilisation nouvelle imprime carrément un passeport pour l’enfer. Et tout est fait pour masquer cela : pour que personne ne discerne les « signes des temps », alors qu’ils s’accumulent devant nous. Sous le couvert du marché, l’iniquité ne cesse de progresser, et déjà les « faux prophètes » s’élèvent, proposant un avenir biocybernétique. On entre dans un temps de grande détresse ; une détresse – dit l’évangéliste Matthieu – « telle qu’il n’y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu’à nos jours, et qu’il n’y en aura jamais ».
Beaucoup se laissent séduire par les laquais de l’Heure. On élève au pinacle quatre milliardaires proches des transhumanistes, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates et Mark Zuckerberg, qui rêvent de recalibrer l’espèce humaine pour la rendre plus conforme au profit. Bezos s’imagine même en maître du temps, quand il conçoit une horloge électronique capable de donner l’heure exacte pour les dix mille prochaines années, comme si ces dernières devaient appartenir de plein droit au capitalisme cybernétique. Nouveau Millenium consacré au règne immatériel de l’argent.
L’ouverture est sans arrêt maçonnée, et à cet égard l’âge de la fin est aussi celui du Grand Renfermement. Mais, pour celui qui se retourne vers le sauf, tout n’est pas fermé. Même au cœur du nihilisme planétaire, il est toujours possible de trouver le chemin de l’indemne. Comme le dit Rabbi Moshe Loeb : « La voie est en ce monde comme le fil d’une lame ; de ce côté, l’enfer, et de l’autre, l’enfer ; entre les deux : la voie de la vie. »
Le péril le plus extrême s’enroulant avec le sauf, les gestionnaires de la catastrophe ne peuvent faire autrement que d’être à leur insu les certificateurs d’une bonne nouvelle. Ainsi, comme dit le Psalmiste, le côté de la mort loue-t-il l’Éternel malgré lui.
Si l’on prête attention à ce qui nous environne, il est clair que les promesses reçues des prophètes juifs sont en train d’advenir. Seulement, elles adviennent à l’envers.
Cet accomplissement paradoxal des promesses fait d’Israël la vraie mesure du monde, et cela sous ses deux formes : l’Église et la Synagogue. L’histoire du XXe siècle en a porté témoignage de façon spectaculaire ; il est à craindre que celle du XXIe le fasse de manière encore plus terrible.
On peut jeter une bâche sur toutes les idéologies des Temps modernes : elles sont entièrement caduques. Nationalisme, libéralisme, socialisme, ces conceptions s’écroulent sur elles-mêmes, tel un sac de toile sur le vide.
Comme le dit Fernando Pessoa dans Ultimatum : « Faillite des peuples et des destins – faillite totale ! »
La seule chose qui puisse nous soustraire à cette banqueroute, c’est notre rapport avec le langage – notre capacité à entrer dans les paroles et à regarder ce qu’elles montrent.
Quand les paroles sont vraiment « esprit et vie », elles accomplissent. Elles sont moins faites pour être comprises que pour nous rendre disponibles au mystère : pour nous accueillir en lui. Elles nous apprennent à voir de l’intérieur. Une impasse que de les entendre avec les seules oreilles du corps. Car, selon le mot de la poétesse catholique Madeleine Delbrêl, elles sont le « levain initial » – elles nous pétrissent, nous modifient, et nous assimilent à elles.
Toute parole est miraculeuse en ceci qu’elle nous relie au miracle qui précède le monde.
C’est pourquoi l’énoncé de Luc concernant Marie : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur », trouve sa raison d’être dans la dernière phrase du Christ – « Tout est accompli ». (p. 11-19)


Tiepolo, Crucifixion, 1725.
Photo A.G., Église San Martino de Burano, 5 juin 2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Le transhumanisme
Les romans de Michel Houellebecq ne sont pas seulement des extrapolations littéraires produites par un individu isolé. Ils annoncent ce qui vient vers nous. Un autre auteur, Yuval Noah Harari, a entrepris en 2015 de livrer au public « une brève histoire de l’avenir », dont les contours recoupent assez largement les prophéties de l’écrivain français. Là aussi, on a assisté à un triomphe commercial, sur fond d’aveuglement et de somnambulisme. Son essai, Homo deus, se présente comme un chant du cygne à l’aube du IIIe millénaire. Ce dont on prévient les êtres parlants, c’est que l’histoire humaine touche à sa fin, et que le règne d’Homo sapiens se traduira par un retournement fatal dont l’Intelligence Artificielle sera la seule bénéficiaire. Au moment où les êtres humains s’imaginent « acquérir des pouvoirs divins de création et de destruction » ; au moment où ils croient échapper à la misère, à la vieillesse et à la mort, un nouvel ordre du jour les renvoie soudain à leur statut de déchet.
Harari commence par énoncer une position de principe, reçue comme un dogme à la Silicon Valley : il n’y a de problème que technique, et tout problème a une solution technique. La mort, pour les transhumanistes, n’est déjà plus du ressort des prêtres ; elle appartient désormais au domaine de compétence des ingénieurs. Un homme comme Peter Thiel, cofondateur de PayPal, professe qu’un milliardaire comme lui doit vivre éternellement. Qu’un pauvre meure, rien que de très normal ; mais qu’un riche subisse le même destin, quel scandale ! À partir de là, il affirme qu’on ne doit plus « accepter » la mort, ni d’ailleurs la « dénier », mais la « combattre » avec la dernière énergie. Comme le remarque sentencieusement Harari, Thiel est une personne à « prendre très au sérieux », car il est « à la tête d’une fortune privée estimée à 2,2 milliards de dollars ».
La firme Google, de son côté, annonce qu’elle prend les choses en main. Elle veut « résoudre le problème de la mort ». À cet effet, le chef de file des transhumanistes, Ray Kurzweil, est nommé directeur de l’ingénierie. Sa mission : réagencer le corps humain pour augmenter notre durée de vie. C’est lui qui mène la guerre contre la mort – selon Harari, le « projet phare » du XXIe siècle.
Telle est l’entreprise prométhéenne par excellence : celle qui permettra de transformer Homo sapiens en Homo deus. Aussi Harari examine‑t‑il le credo humaniste selon lequel l’univers tourne autour de l’« Homme », source de tout sens et de toute autorité. Mais ce projet n’a de validité que si le petit démiurge parvient à usurper la place de son créateur. Celui‑ci étant défini par la métaphysique comme « éternel », comment la science ne se donnerait‑elle pas comme objectif la poursuite de l’immortalité pour l’être humain ? Comme dit Harari : « Homo sapiens fait tout pour l’oublier, mais c’est un animal. » Or justement c’est cette limite qu’il s’agit de remettre en question. Cet animal, il faut donc le recréer ; ou, du moins, le recalibrer. C’est ainsi qu’on dépassera le vieillissement par la technique, mais ce dépassement expose lui‑même à un danger. En allant jusqu’au bout des idéaux humanistes, on a la surprise de les mettre à bas. Comme le souligne l’auteur d’Homo deus, accomplir le « rêve humaniste est susceptible de provoquer sa désintégration ».
Harari insiste sur ce point : selon les sciences de la vie, l’humain, comme n’importe quel animal, porcs, poulets ou chimpanzés, se résume à des « algorithmes de traitement biochimique des données ». Au XIXe siècle, on pensait cerveau et psychisme humain sur le modèle de la machine à vapeur. Au XXIe, plus personne ne compare la psyché humaine à une soupape qui libérerait de l’énergie. Le parallèle se fait plus volontiers avec un ordinateur, c’est‑à‑dire avec une machine à calculer. Partant de cet axiome, la thèse centrale de l’essayiste consiste à démontrer que nous sommes à la veille d’une révolution, devant laquelle toutes les autres apparaîtront comme de simples vaguelettes à la surface de l’océan. Puisque « les calculs algorithmiques ne sont pas affectés par les matériaux avec lesquels le calculateur est construit », le remplacement des algorithmes biochimiques par des algorithmes électroniques devient inévitable. Autrement dit, ce que le hasard et la sélection naturelle avaient produit laissera place nette aux fabrications du Dispositif, la biologie de Charles Darwin cédant le pas à la cybernétique de Norbert Wiener. En guise de conclusion, Harari nous assène cette prophétie glaçante : « Il n’y a donc aucune raison de penser que les algorithmes organiques peuvent faire des choses que les algorithmes non organiques ne seront jamais capables de reproduire ou de surpasser. Du moment que les calculs sont valables, qu’importe que les algorithmes se manifestent grâce au carbone ou au silicium ? »
Par une légère modification de notre ADN, les transhumanistes ambitionnent de produire des corps dotés de capacités neurologiques augmentées. De tels corps seraient en prise directe avec les réseaux électroniques. On repousserait donc les limites de la vie organique en recourant à une bio‑ingénierie qui récrirait le code génétique. On la repousserait aussi en fusionnant les corps avec des appareils, tels que des capteurs implantés dans nos cerveaux, susceptibles de contrôler nos futures prothèses bioniques. « Après quatre milliards d’années d’errance dans le royaume des composés organiques – affirme calmement Harari –, la vie fera irruption dans l’immensité du champ inorganique. » Autant dire que le passage au silicium risque d’entraîner une errance exponentielle. Ne s’agit‑il pas, sous le couvert d’une extension de la technique, de conduire l’inerte à émettre des informations, avant de se fabriquer lui‑même, et ainsi de rendre la mort vivante ? (p. 289-293)

L’avenir selon Harari
L’une des cibles contemporaines des auteurs de Tout est accompli — essai de Haenel, Meyronnis et Retz dont on attend en vain qu’il soit philosophiquement discuté (ou simplement rendu compte) dans la presse informée — est Yuval Noah Harari, l’auteur de Home deus. François Busnel avait invité Harari dans sa petite librairie en septembre 2017 (voir ici). Yannick Haenel revient sur son dernier best seller dans sa dernière chronique de Charlie Hebdo (19 juin).

Charlie Hebdo, 19 juin 2019.
ZOOM : cliquer sur l’image.

RCJ, Un monde de livres, 25 avril 2019.
Valentin Retz, François Meyronnis et Yannick Haenel, auteur du récent La solitude Caravage, sont les invités de Josyane Savigneau.

François Meyronnis : un regard incisif sur trois siècles d’histoire
Par Josyane Savigneau | L’Arche | 21/01/2020.
Son nouveau livre, qu’il cosigne avec Yannick Haenel et Valentin Retz, dégage les forces à l’œuvre dans l’Histoire. Une Histoire qui laisse entrevoir une trajectoire cachée, une « courbure du temps », et qui trouve son origine dans « les deux maisons d’Israël : l’Église et la Synagogue. »
Tout est accompli (Grasset) est un essai écrit à trois, Yannick Haenel, Valentin Retz, et vous, François Meyronnis. Mais vous parlez d’une seule voix. Pourquoi ce parti pris ?
 C’est une manière d’envoyer par-dessus les moulins l’individualisme qui est aujourd’hui prévalent dans le milieu littéraire. Pour moi, la littérature a à voir avec la singularité, mais pas du tout avec l’individu. Avec cette compétition des egos sur fond de marchandisation. Comme il y a une certaine amitié entre nous, que nous faisons une revue ensemble, Ligne de risque, ça induit un rapprochement, qui fait qu’on peut faire un livre d’une seule voix. Après il y a des ajustements internes, des va-et-vient. Mais très souvent, on a écrit ensemble.
C’est une manière d’envoyer par-dessus les moulins l’individualisme qui est aujourd’hui prévalent dans le milieu littéraire. Pour moi, la littérature a à voir avec la singularité, mais pas du tout avec l’individu. Avec cette compétition des egos sur fond de marchandisation. Comme il y a une certaine amitié entre nous, que nous faisons une revue ensemble, Ligne de risque, ça induit un rapprochement, qui fait qu’on peut faire un livre d’une seule voix. Après il y a des ajustements internes, des va-et-vient. Mais très souvent, on a écrit ensemble.
Pourquoi « tout est accompli » ?
C’est la dernière phrase du Christ sur la croix. Donc c’est la phrase du messie d’Israël. Ce titre signifie que la catastrophe n’est pas devant nous mais a déjà eu lieu. Notre monde est déjà détruit, nous ne sommes pas les premiers à le dire. Certains l’ont dit dès le début du XXe siècle. Par exemple Karl Kraus. Quand il voit surgir la guerre il se transforme en prophète juif. Il se dit que quelque chose a muté. Et son interprétation — qui est aussi celle de Walter Benjamin — est que le langage blasonné des chancelleries était devenu une phraséologie. Quelque chose d’autre était en train de se déployer. Le monde était devenu industriel et avait désormais un tout autre horizon. Et cette distorsion va aboutir à un carnage. La parole habituelle se transforme en babil, en quelque chose de creux. Et des peuples entiers voient leur jeunesse plus que décimée. Kraus va écrire une pièce de théâtre, représentée pour la première fois en 1919, Les Derniers jours de l’humanité. En fait, on est entré en 1914 dans la mondialisation sur fond de guerre, et on n’en est jamais sorti.
L’épigraphe de Tout est accompli est une citation de Kafka extraite de Méditations sur le péché, la souffrance, l’espoir et le vrai chemin, qui commence par « Dans sa partie principale, l’expulsion du paradis est éternelle »…
Kafka a toujours été très important pour moi. Y compris dans mon rapport avec le judaïsme. Sa littérature pouvait faire advenir quelque chose qui ressemble à une Kabbale qui ne serait pas traditionnelle, ne s’autoriserait que d’elle-même. Prendrait certaines voies propres à la mystique juive, mais en la nouant avec la littérature de Flaubert, de Cervantès… Kafka, d’une certaine façon, c’est le mariage de Rabbi Nahman de Braslav et Flaubert. Je ne l’ai pas compris tout de suite, mais c’est ça qui m’a aimanté chez lui. Et avec ce passage que nous avons choisi, se pose la question du paradis. On en est expulsé mais on y est toujours. C’est à chacun de le vérifier dans sa vie.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Ce rapport au judaïsme vous concerne tous les trois ou surtout vous ?
Au départ, surtout moi. Mais j’ai une certaine puissance de conviction.
De quand date votre intérêt pour le judaïsme ?
Ça remonte à très loin.
Avez-vous eu une éducation juive ?
Pas du tout. J’ai eu une éducation catholique. Et d’une certaine manière, plus je me suis intéressé à la mystique juive, plus je me suis rapproché du catholicisme.
Paradoxal ?
Oui, mais c’est comme ça que je suis fait. Assez tôt j’ai commencé à lire Gershom Scholem. Dans les années 1980. J’avais 22-23 ans. Ce qui m’intéressait c’était une mystique du langage. J’ai aussi commencé par Lautréamont. Tel Quel m’a permis d’approfondir ce qu’il y avait dans Lautréamont. Je me suis rendu compte qu’il y avait des gens, dans une certaine tradition, qui avaient cette mystique du langage. C’est à partir de là que j’ai commencé à lire aussi Moshe Idel. Je me suis intéressé à des figures comme Abraham Aboulafia. Ce qui m’a passionné, c’est la coexistence, au XVIIIe siècle, de Voltaire d’un côté et de l’autre du Baal Chem Tov. Ils ont été contemporains. Le Baal Chem Tov est né en 1698 et mort en 1760. Ses disciples, en Pologne, ont une opinion sur les Lumières françaises. Peut-être mon intérêt profond pour le judaïsme vient-il de ce que j’ai trouvé les Lumières françaises extraordinairement sombres. Dans mon enfance, en France, j’ai eu le sentiment d’être en prison. J’ai subi l’école dans un état de colère et de mutisme. J’ai tout refusé. Ma mère est universitaire, donc il était difficile pour elle de négocier avec les professeurs. Ma mère est italienne, donc je suis le fils d’une étrangère. Ça joue. Cette imprégnation française, je l’ai ressentie comme odieuse. À propos des Lumières, j’étais sidéré de voir que ces gens ne comprenaient pas la puissance du crime de leur philosophie. C’est pourquoi le seul auteur de cette période qui m’ait passionné est le marquis de Sade. Très vite, j’ai découvert aussi Joseph de Maistre. Et, de mon point de vue, il y a un lien entre Joseph de Maistre et les disciples du Baal Chem Tov. L’invasion de cette pensée moderne qui est en train de traverser l’Europe, de la mettre sens dessus dessous, avec les répercussions que l’on peut imaginer, en Italie, en Allemagne — le nationalisme allemand est issu du trauma français —, en Russie. Et tout cela n’est pas pensé en France. Alors, à l’Ouest, il y avait les Chouans qui se rebellent contre la Révolution française, et à l’Est il y avait ces gens très discrets, qu’on ne voyait pas, mais qui avaient une pensée, disons frémissante.
Êtes-vous allé en Israël ?
Oui. Une seule fois. Je suis resté à Jérusalem, pour aller voir les disciples de Rabbi Nahman de Braslav (1772-1810), parce que c’est l’un des mystiques juifs qui m’est le plus proche. J’étais en train d’écrire un roman qui a un rapport avec lui et se passe à Jérusalem. Il fallait que je m’imprègne des lieux et rencontre ses disciples. Kafka s’intéressait beaucoup à lui. C’était un maître de Kabbale, mais il a mis en scène sa vie mystique. Il a écrit le Sefer Haganuz (le livre caché) et le Sefer HaNisraf (le livre brûlé). Il n’a montré le premier à personne et a chargé le rabbin Nathan de brûler le manuscrit du second en 1808. Mais ses enseignements ont été propagés.
Et Rabbi Moshe Loeb, cité dans Tout est accompli : « La voie est en ce monde comme le fil d’une lame ; de ce côté l’enfer, et de l’autre l’enfer ; entre les deux la voie de la vie. » ?
Il est entre le Baal Chem Tov et Rabbi Nahman de Braslav, pour les dates. Cette citation de Rabbi Moshe Loeb, je l’ai lue pour la première fois dans un texte de Dominique de Roux, qui avait lu les récits hassidiques de Martin Buber et était tombé en arrêt devant cette réflexion de Rabbi Moshe Loeb. C’est exactement ce que je cherche, la voie intermédiaire. Quand nous désignons, dans Tout est accompli « l’âge de la fin », ce n’est pas une image catastrophiste. Elle est présente, la fin. C’est ce que déjà des penseurs ont pensé à leur manière, dont Heidegger, Kojève, ou, sur un mode un peu moins brillant, Baudrillard.
Qu’est-ce que le Dispositif ?
C’est exactement ce que Heidegger appelle le Gestell.
Selon vous, on peut considérer le monde actuel, celui du Dispositif, comme une erreur d’interprétation…
Les temps modernes, c’est le projet prométhéen de se substituer à Dieu. L’homme serait enfin autonome. C’est le grand projet émancipateur des Lumières, françaises comme allemandes, et c’est un projet que personne ne remet en cause, dont le moment le plus important est la Révolution française, et qui culmine au XIXe siècle. Le Dispositif, ça vient après. Il y a une courbure dans les temps modernes. Les sciences accomplissent le projet et on est au maximum de l’hétéronomie. l’homme prend la place de la cause, il se fabrique lui-même, et à partir de là, il va devenir usinable à merci, interchangeable, évacuable. C’est ce qui est en train de se passer. À travers la cybernétique, il peut y avoir branchements instantanés. Donc, il n’y a même plus de linéarité, on est expulsé du temps, expulsé de l’espace. Dans le monde actuel, celui dans lequel nous vivons, le monde est devenu un moment du virtuel.
Dans Tout est accompli, il est aussi question de Leïb Rochman (1918-1978), auquel vous avez consacré un numéro entier de la revue Ligne de risque.
Son livre Mit Blindè trit iber der erd (À pas aveugles dans la nuit), écrit en 1968, a été traduit pour la première fois dans une langue autre que le yiddish, en français, par Rachel Ertel en 2012 chez Denoël, avec une préface d’Aaron Appelfeld. C’est grâce à cette traduction que je l’ai découvert, par hasard, en librairie. J’étais en train d’écrire Le Messie et je me suis dit que c’était un livre pour moi.
Le Messie , c’est votre prochain livre ?
J’ai commencé à écrire Le Messie avant d’écrire Tout autre, publié chez Gallimard, « L’Infini » en 2012. Cette écriture a induit beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Je ne connaissais alors absolument pas Leïb Rochman. C’est une œuvre majeure du XXe siècle. Un gros livre. Très éprouvant. Je connais peu de “goys” qui l’aient lu jusqu’au bout. Pour les Juifs, c’est différent, ce n’est pas un livre qui les agresse. Tandis que les goyim sont attaqués de manière très violente. Donc il faut se faire juif, d’une certaine manière, pour le lire.
Pourquoi la partie 3 de Tout est accompli s’appelle-t-elle « le sacrifice d’Israël » ?
Pour moi, cette partie est le cœur des choses. Mais ça demande un raisonnement théologique assez soutenu qui est litigieux à peu près pour tout le monde. Il y a la chrétienté, qui se met en place à la conversion de Constantin. Et de mon point de vue, ça s’arrête à la mise à mort de Louis XVI. On peut évidemment le contester, mais pour moi, à partir de là, on entre dans autre chose. La mise à mort de Louis XVI est une orchestration de la mort de Dieu. C’est facile à démontrer, puisque le roi était oint, donc configuré au messie d’Israël. Il y a une continuité entre les rois de Juda, qui sont les ancêtres du messie, et les rois de France, à travers Reims. Et c’est ça qui est brisé par les révolutionnaires avec une mise en scène qui vise à en finir avec cette prégnance théocratique. Et puis il y a la révolution allemande, qui orchestre aussi la mort de Dieu. Dans les deux cas il s’agit d’en finir avec Israël.
Le monde qui naît de la Shoah est pour moi un monde post-hitlérien. Et ça ne passe pas par l’idéologie, au sens où il y aurait un prolongement d’extrême droite. Ça c’est un écran. C’est toute la société qui est fondée là-dessus. La mise en joue atomique d’un côté, l’emprise cybernétique de l’autre. On est entré dans un monde qui a comme soubassement l’extermination et qui aura comme résultat l’extermination. La mise à mort du peuple juif est en quelque sorte une préface à un sacrifice total de l’ensemble de l’humanité.
Au fond le livre de Leïb Rochman parle de cela. C’est un livre kabbalistique sur l’enjeu de l’extermination. Pour lui le monde n’est soutenable que parce qu’il y a la prière des Juifs. Le peuple juif, la shekinah, c’est la présence divine sur terre. Il y a Israël, Amalek, et les soixante-dix nations, qui ont, elles, vocation à être guidées par Israël, et même d’entrer à terme dans l’alliance d’Israël. Les soixante-dix nations ne sont pas rejetées. Mais il y a une compétition entre Israël et Amalek. Lui vise à assujettir les soixante-dix nations, à les conduire vers la destruction. C’est comme une dé-création. C’est tout l’enjeu du livre de Rochman. Ça ne concerne pas seulement les Juifs, ça concerne aussi les soixante-dix nations.
Et le Royaume, dernière partie de Tout est accompli ?
Le Royaume, c’est le contraire du Dispositif. C’est la possibilité d’ouverture. Le fait de faire corps avec Israël. Pour ceux qui sont catholiques, chacun à sa manière, ça passe par l’Évangile. Les catholiques français sont gallicans et républicains. Ce qui les rend inaptes à comprendre que le catholicisme n’est pas autre chose qu’une branche de la sagesse d’Israël. Que les catholiques en soient choqués ou pas c’est la vérité. Un catholique qui connaît un peu sa religion le sait. Ce qui est difficile à penser des deux côtés, c’est qu’il y a un dédoublement d’Israël.
L’effrayant silence métaphysique de l’espace médiatique
par Cécile Guilbert
Voici un livre important, passionnant, engagé, qui concerne toutes les questions ravageuses de notre actualité babillarde alimentant la sourde révolte des peuples : inégalités sociales, précariat généralisé, cynisme oligarchique, pollution atmosphérique, malbouffe, terrorisme, crise identitaire, etc. Mais qui les pense à la fois de plus loin, de plus haut et plus originellement en les articulant à l’histoire scientifique et politique des Temps modernes, à la philosophie, à l’exégèse biblique, à la pensée juive et à la littérature.
C’est un grand livre de métaphysique arc-bouté sur une pensée messianique puisant aux deux maisons d’Israël qui se veut aussi et surtout une parole de Vie, une parole indiquant la voie d’un saut et d’un salut, une issue spirituelle au nihilisme achevé par le croisement de la cybernétique et du marché qui ont complètement renversé l’ancien projet humaniste d’émancipation au profit du « Dispositif », cette infernalité qui, par la mise en réseaux planétaire, en est arrivée à absorber le temps, l’espace, la société, à aplatir le langage comme le réel ainsi que l’espèce humaine réduite à un bétail biologique algorithmé, constamment spolié par ce qu’on appelle aujourd’hui « l’économie de l’attention » et dont le destin « transhumaniste » doit désormais s’achever par les noces de l’intelligence artificielle et des manipulations génétiques qui font tant fantasmer les milliardaires de la Silicon Valley.
Une étonnante digression sur la symbolique du nom de la marque Apple
Écrit d’une langue précise, claire, dans un souci ouvertement pédagogique, ce livre dense qui entend se situer au-delà de la politique jugée caduque et dont le titre reprend l’une des dernières paroles du Christ – « Tout est accompli » – comporte de nombreux développements propres à susciter des conversations passionnées, des débats enflammés et même des polémiques : critique du progressisme tant scientiste qu’économique, analyse des Temps modernes et des Lumières comme résultant d’une formidable « insurrection à l’encontre du christianisme », de la Révolution française comme « gigantesque messe noire assortie d’innombrables et répétés sacrifices humains » digne des imprécations de Joseph de Maistre, de la conquête de l’Algérie par Bugeaud comme répétition de la guerre de Vendée, de la République et de la laïcité comme « sacré de substitution » ; dégagements passionnants sur la Shoah et les Gafa, examens critiques des best-sellers mondiaux de Yuval Noah Harari et Michel Houellebecq, relecture bluffante de Bel-Ami de Maupassant [7], etc.
Il faut évidemment ajouter que si une étonnante digression sur la symbolique du nom de la marque Apple couplée à une autre sur le changement de nom de Google en Alphabet justifieraient presque à elles seules l’achat de ce livre, ce dernier, publié dans une grande maison d’édition – Grasset – n’est pas écrit par n’importe qui puisqu’il rassemble les plumes des trois écrivains animant l’excellente revue Ligne de risque : François Meyronnis, auteur d’une demi-douzaine de romans et d’essais exigeants creusant la question du nihilisme et de la « délivrance » ; Valentin Retz, qui a déjà publié trois fictions hantées par la problématique de l’initiation spirituelle ; et Yannick Haenel qu’on ne présente plus puisqu’il est l’auteur de romans remarqués dont plusieurs ont été couronnés par de grands prix littéraires.
Surdités contemporaines
Et pourtant, vous n’avez nulle part entendu parler de Tout est accompli. Pas un papier dans la presse quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou même un articulet qui en signalerait l’existence. Pas une émission de télé, pas non plus de radio, ni France Inter, ni France Culture ou même Radio Notre-Dame ! Rien. Nichts. Nada. Trou noir complet et total. Tout se passe comme si ce livre n’avait jamais été écrit, imprimé, distribué, mis en vente. Et j’avoue que le silence assourdissant accompagnant l’existence déréalisée de cet ouvrage brûlant qui devrait toucher l’intelligence, le cœur et l’esprit critique des lecteurs m’intéresse tout autant que son contenu.
Assiste-t-on à la démonstration performative de ce qu’il entend prouver sur le terrain de l’inanité générale et en particulier médiatique ? À l’illustration d’une sorte de « samedi saint » éditorial où la promesse du « Royaume » semble anéantie par l’économie spectaculaire qui en figure la ténèbre ? « Chez nous, tout se concentre sur le spirituel, nous sommes devenus pauvres pour devenir riches », écrivait Hölderlin. Puisse cette sentence, qui console des surdités contemporaines, rasséréner un peu les auteurs de Tout est accompli.
Cécile Guilbert, La Croix, le 19/06/2019.

Girolamo da Santa Croce, Résurrection du Christ.
Venise, San Martino Vescovo (Castello). Photo A.G., 11 juin 2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

LIRE AUSSI : TOUT EST ACCOMPLI DIACRITIK pdf

APRÈS L’APOCALYPSE

Faute de trouver un écho ailleurs (?), François Meyronnis et Yannick Haenel ont accordé un entretien à la revue très droitière L’incorrect (n° 22, juillet-août 2019). Vous ne pourrez le lire qu’en vous abonnant ou en achetant le numéro. Mais des extraits ont été mis en ligne au début du mois de septembre qui en donnent un aperçu. Vous pouvez en prendre connaissance ici.
Qu’est-ce que le Dispositif ?

Extraits







"Tout est accompli (cheminement d’une voix qui se réveille)"
Un film de Johanna Pauline Maier (2019). Mis en ligne le 12 mars 2020.
Avec Yannick Haenel, François Meyronnis et Valentin Retz









« Covid, Gafas, transhumanisme » avec Laurent Alexandre et François Meyronnis
Émission du 22/03/2021.
Aude Lancelin reçoit le docteur Laurent Alexandre, chirurgien et essayiste et François Meyronnis, fondateur de « Ligne de Risque », pour affronter leurs visions sur le monde de demain.
Extrait.

![]()
Algorithmes
Aux origines d’une méthode
Les algorithmes prennent une place de plus en plus importante dans nos sociétés contemporaines, ils influent sur nos vies, nos comportements, mais que sont-ils ? Quelle est l’histoire des algorithmes ? Comment s’appliquent-ils, et à quels domaines ?
Avec Claire Mathieu, directrice de recherches au CNRS en informatique.
« On trouve des algorithmes déjà au temps des Babyloniens, au IIIème millénaire avant J.-C., sur des tablettes écrites en cunéiforme qui donnaient par l’exemple des méthodes pour faire certains calculs, des calculs d’opération et des calculs mathématiques assez complexes comme par exemple racine carrée de deux.
C’est le début des algorithmes, une méthode uniquement expliquée par des exemples, elle n’était pas mise en place avec un texte qui explique de façon abstraite la manière de procéder. L’algorithme était là mais il n’était pas encore explicité. Chez les Grecs plus tard, chez Euclide, l’explicitation était là. »


L’intelligence artificielle a-t-elle du coeur ?
Les algorithmes envahissent tous les domaines : marché de l’emploi, Facebook, Google... Sont-ils dangereux ? Vont-ils remplacer l’humain ? Tomberons-nous bientôt amoureux d’une intelligence artificielle ?
Avec Aurélie Jean, Ph.D., docteure en sciences des matériaux et en mécanique numérique, fondatrice et dirigeante de la société In Silico Veritas spécialisée en algorithmique et en modélisation numérique.
Serge Abiteboul, chercheur à Inria, Institut national de recherche en sciences du numérique, et Membre du Collège de l’Arcep, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« L’informatique est une science révolutionnaire qui peut nous permettre de tout faire, créer des machines qui font des choses qu’on ne saurait pas faire, c’est un outil à la mesure de tous les rêves des écrivains de science-fiction, tout devient possible. Mais ce n’est pas parce qu’on a un outil qu’on sait bien s’en servir… Il suffit d’ouvrir le journal pour voir des applications de l’informatique magnifiques, qui aident à soigner des gens, même si certaines sont inquiétantes… Comment va-t-on utiliser dans le futur cet outil merveilleux pour faire une meilleure société et non pas 1984 d’Orwell ? »
Serge Abiteboul


Internet a-t-il réinventé les règles du jeu politique ?
La révolution numérique a bouleversé la façon de faire de la politique. Dans le monde, certains partis populistes ont appris à manipuler les algorithmes, interpréter et se servir de la colère, donnée structurelle de la politique, renforcée par les réseaux sociaux. La politique a-t-elle perdu ?
Avec Giuliano Da Empoli, directeur du think tank Volta à Milan, ancien conseiller politique de Matteo Renzi.
« Il y a aujourd’hui des technologies sophistiquées qui permettent de transformer la colère qui parcourt nos sociétés, trouvant ce qui va exciter le plus possible les émotions, les peurs, non pas de la collectivité mais de chaque personne. Il y a des techniques qui permettent de faire cela et à la fin, d’additionner toutes ces colères pour gagner des élections. C’est ce qui se fait de plus en plus à travers des campagnes politiques qui ont un contenu technologique de plus en plus avancé. »
« L’Italie est la Silicon Valley du populisme ! L’expérience de Beppe Grillo, fondateur du Mouvement 5 étoiles, est extraordinaire : la façade c’est un comédien populaire qui fonde un mouvement basé sur le ras-le-bol. Aujourd’hui c’est le principal parti italien…La vraie histoire de ce mouvement est différente : l’idée n’est pas de Grillo mais celle d’un expert en marketing internet qui comprend au début des années 2000 qu’Internet et les données vont tout changer dans la façon de faire de la politique... »
Giuliano Da Empoli


Serons-nous bientôt jugés par des ordinateurs ?
Quels effets les algorithmes ont-ils sur la justice ? Comment le numérique a-t-il révolutionné notre langage et notre écriture, les liens qui structurent notre société ? Et qu’est-ce que cette nouvelle forme d’intelligence engendre de nouveau d’un point de vue juridique et philosophique ?
Avec Jean Lassègue, philosophe et épistémologue, chargé de recherche CNRS et chercheur associé à l’IHEJ, l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice.
« Se faire aider par des machines c’est un progrès mais ça pose tout de suite de très graves difficultés, parce que la réponse de la machine ne peut pas être liée à l’espace et à la signification de l’espace. En philosophie, c’est quelque chose d’absolument capital, la signification de l’espace est une construction collective. Donc le problème qu’on va avoir c’est comment la justice et le droit en général comme constructions collectives peuvent s’articuler à cet état de la société qui est le nôtre aujourd’hui dans lequel la notion de code est devenue centrale. »
Jean Lassègue


Sur France Culture : Algorithmes. 4 épisodes
Le pire du pire

- Le Monde du 13 mai 2019.
[2] Voici le texte de Baudelaire : Symptômes de ruine
Symptômes de ruine. Bâtiments immenses. Plusieurs, l’un sur l’autre, des appartements, des chambres, des temples, des galeries, des escaliers, des coecums, des belvédères, des lanternes, des fontaines, des statues. — fissures, Lézardes. humidité promenant d’un réservoir situé près du ciel. — Comment avertir les gens, les nations — ? avertissons à l’oreille les plus intelligents.
Tout en haut, une colonne craque et ses deux extrémités se déplacent. Rien n’a encore croulé. Je ne peux plus retrouver l’issue. Je descends, puis je remonte. Une tour-labyrinthe. Je n’ai jamais pu sortir.
J’habite pour toujours un bâtiment qui va crouler, un bâtiment travaillé par une maladie secrète. — Je calcule, en moi-même, pour m’amuser, si une si prodigieuse masse de pierres, de marbres, de statues, de murs, qui vont se choquer réciproquement seront très souillés par cette multitude de cervelles, de chairs humaines et d’ossements concassés. —
Je vois de si terribles choses en rêve, que je voudrais quelquefois ne plus dormir, si j’étais sûr de n’avoir trop de fatigue.
[3] Le livre : A pas aveugles de par le monde fait figure d’exception dans la littérature yiddish, non tant par son sujet — l’anéantissement des Juifs d’Europe — que par sa conception et sa forme. De fait la Shoah n’y est pas directement abordée. Le roman s’ouvre une semaine après la fin de la guerre alors que les deux héros, S et " Je ", ainsi que plusieurs autres personnages, entament une véritable odyssée à travers l’Europe dévastée. Réchappés d’un espace de non-humanité, ils retournent vers l’humanité d’après le déluge. Le roman fonctionne sur une triple temporalité : le présent des protagonistes, leur passé immédiat et, pour certaines des villes traversées comme Amsterdam ou Rome, la résurgence d’un passé plus lointain. Le — les héros — car la focalisation oscille sans cesse de S à "Je" — vogue de lieu en lieu ; partout, pour mille et une raisons, il est retenu et comme happé par l’endroit qui l’accueille. Chaque ville fait naître des romans dans le roman où se croisent des dizaines de personnages — parmi eux ceux qui ont connu "les Plaines", comme l’auteur nomme les lieux d’extermination, et les autres, ceux qui ont été épargnés. Les premiers tentent de vivre, mais demeurent à tour jamais des êtres de souvenir portant partout avec eux leur tragédie personnelle et la tragédie de l’Histoire ; les seconds souhaitent juste oublier. Entre ces deux groupes d’hommes des liens se tissent, des drames anciens ou nouveaux éclatent. Mais si la quête d’Ulysse le ramenait à Ithaque, celle du (des) héros de Rochman les entraînera jusqu’aux monts de Judée, où le "Dénombrement" ou le "Livre des Nombres" pourra enfin commencer. La spécificité et la grande force du livre tiennent au talent avec lequel Leib Rochman mêle les épisodes extrêmement romanesques des récits de vie de cette sorte de tribu d’endeuillés à une méditation plus générale, exempte des contraintes de l’espace et du temps. C’est indéniablement cette capacité à rassembler en un tour cohérent différentes formes d’écriture qui transporte et éblouit le lecteur. Nous évoluons ainsi au côté de l’auteur de descriptions réalistes en évocations lyriques, de monologues intérieurs hallucinés en profondes réflexions sur l’histoire et sur la nature humaine. Une oeuvre majeure sur les thèmes de la quête et du souvenir.
[4] C’est le titre du dernier chapitre de Tout est accompli. Hommage y est rendu à Sollers — qui donna un entretien au titre éponyme dans Ligne de risque. Cf. Le Royaume.
[5] Succès de l’un, faillite des autres ? Meyronnis y fait allusion dans Tout autre : « La possibilité spirituelle de la littérature, souvent à leur insu, beaucoup la récusent. Ils ne se reconnaissent que dans ce qui virevolte comme de la paille autour des apparences. Ainsi ont-ils cru comprendre, au fil du temps, que Haenel marquait des points, à rebours de Meyronnis. Mettant en parallèle le succès de l’un et, selon leurs critères, la faillite de l’autre, ils s’étonnent qu’ils restent amis. Comment rendre compte d’une amitié ? — Nous sommes le masque l’un de l’autre, et pour chacun le geste de le retirer. — Deux duchés adjacents où se déplacent d’étranges peuplades, parfois tumultueuses. [...] ». LIRE ICI.
[6] Pour comprendre d’où proviennent certaines thèses du livre sur le « capitalisme intégré », lire François Meyronnis, Proclamation sur la vraie crise mondiale.
[7] Cf. Tout est accompli, p. 204-205. A.G.





 Version imprimable
Version imprimable





21 Messages
QG. Émission du 22/03/2021.
Aude Lancelin reçoit le docteur Laurent Alexandre, chirurgien et essayiste et François Meyronnis, fondateur de « Ligne de Risque », pour affronter leurs visions sur le monde de demain. VOIR ICI.
la dystopie évoquée par Retz/Haenel/Meyronnis est fort bien décrite dans le roman de Sibylle Berg GRM (Brainfuck), Kiepenheuer & Witsch, 2019. En allemand mais la traduction en français ne saurait tarder. Lecture vivement recommandée !
Entretien avec Valentin Retz, co-auteur de Tout est accompli.
Cela n’aura pas échappé aux lecteurs de Diacritik : le patron de Tesla, SpaceX et Neuralink a récemment émis l’hypothèse que le langage humain pourrait bien devenir obsolète dans les cinq années à venir. Dans le même temps, des robots envahissent le quotidien et tendent à militariser l’espace public. Nous avons souhaité recueillir dans un grand entretien la pensée de Valentin Retz, écrivain et co-animateur de la revue Ligne de risque, pour sereinement discuter de ces symptômes modernes et de tenter de les dissoudre grâce à la littérature. LIREI ICI.
Dans le prolongement des analyses de Tout est accompli, voici la dernière chronique de Yannick Haenel parue dans Charlie Hebdo du 13 mai 2020.
Charlie hebdo, 13 mai 2020.
ZOOM : cliquer sur l’image.
« Nous sommes ces jours-ci comme le peuple hébreu en Égypte, assoiffés de liberté »
FIGAROVOX/ENTRETIEN - Dans une méditation aux accents bibliques, l’écrivain Valentin Retz tente de mettre des mots sur le sentiment de captivité que ressentent les Français confinés, et sur leur ardent désir de revoir enfin le soleil.
Par Paul Sugy
Valentin Retz est écrivain, auteur notamment de Noir parfait (Gallimard, 2015) (voir ici). Avec François Meyronnis et Yannick Haenel, il tient la revue littéraire Ligne de risque. Il a coécrit avec eux Tout est accompli(Grasset, 2019).
FIGAROVOX.- Vous avez publié sur un blog littéraire une méditation sur le désir de liberté des Français confinés, qui évoque l’attente du peuple hébreu à la veille de sa sortie d’Égypte. La réclusion qui nous est imposée nous fera-t-elle apprécier davantage la liberté ?
Valentin RETZ.- Dès le début du confinement, j’ai été saisi par le contraste entre nos sociétés hypermodernes, grisées par leur maîtrise des sciences et des techniques, et le côté archaïque de la pandémie. On aurait dit que le destin nous frappait avec cet air d’ironie qu’il affectionne lorsqu’il entend nous faire toucher notre vide nullité. Je m’explique : alors qu’on ne pense plus ni à Dieu ni à diable, voilà que trois milliards d’êtres humains se voient mis en quarantaine pendant les quarante jours du carême. Autrement dit, aux alentours des Pâques juive et chrétienne. Cela ne rappelle-t-il pas ce que les Hébreux, la veille de la sortie d’Égypte, ont eux-mêmes enduré, alors qu’ils attendaient, reclus dans leurs maisons, que l’ange de la Mort extermine tous les premiers-nés dans le pays du Nil ? Comme nous, ce peuple, que Moïse arracha à un dur esclavage, avait soif de liberté. Or la crise nous impose de réfléchir à la part de servitude que comportent nos vies. Nous aimons nous croire libres, et de plus en plus libres, mais est-ce vraiment le cas ?
Dans ce texte, vous écrivez aussi que la lecture quotidienne des chroniques parues dans la presse est pour vous comme un rayon de soleil en ces temps de brouillard. Comment expliquez-vous ce plaisir ?
Par chance, l’immeuble parisien où je suis confiné comporte une petite cour. La plupart du temps, elle est froide et humide. Mais, environ une heure par jour, le soleil la réchauffe. La presse que j’y lis remplace un peu la sociabilité intellectuelle dont me prive la fermeture des cafés et la mise à l’arrêt de la vie culturelle. J’y joue, par exemple, avec les propositions fiscales de Piketty pour mettre au pas le capitalisme intégré ; ou j’y écoute le mauvais jouir des soi-disant « collapsologues », qui prédisent tous la fin du monde pour la fin de leur vieillesse.
Tenus à bonne distance les uns des autres par les règles sanitaires, nous ne faisons selon vous qu’achever un processus déjà en cours avant la pandémie : celui d’une distanciation croissante, conséquence de la virtualisation des rapports humains ?
En tant qu’écrivain, j’écoute le langage. Or, avec la pandémie, on a vu l’apparition de l’horrible formule : « gestes barrière ». En l’entendant la première fois, j’ai pensé découvrir un nouveau mot composé. Seulement, personne n’a pris la peine d’y adjoindre un tiret : on appose le nom « barrière », comme s’il s’agissait là d’un adjectif. Faut-il penser qu’avec le tiret nous n’aurions pas gardé de distance suffisante les uns avec les autres ?
De même, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que le fléau est apparu après la généralisation du paiement sans contact. Depuis deux ans, telle une supplique au dieu argent, j’entends partout, dans les commerces, ce même refrain morne et figé : « Sans contact ? — Sans contact. » Et sans doute le réel nous a-t-il exaucés ; nous, qui lui demandons sans relâche, à travers le wifi, la 4G, internet, les appareils connectés, les réseaux numériques, de pouvoir nous atteindre sans devoir nous toucher.
Aujourd’hui, nous sommes les témoins d’un infléchissement de la globalisation, comme si le fantasme d’« illimitation » qui la fonde n’était plus en mesure d’imposer son dictat. Pourtant, cela ne signifie pas, me semble-t-il, que nous allons revenir à plus de raison dans nos échanges. Je dirais même que nous entrons dans la version 3.0 du phénomène, celle qui va nous happer à l’intérieur des territoires illimités du Virtuel. Jamais on n’a été autant vissé devant les écrans, que cela soit pour tweeter, télétravailler, subir un enseignement à distance, etc. Et n’en déplaise à ceux qui voudraient voir, dans ce temps retrouvé, une occasion de rouvrir les grandes œuvres littéraires, à l’heure du confinement, ni la lecture ni les longues plages méditatives n’empêcheront la mainmise de la cybernétique sur les cœurs et les têtes.
Dans un monde désormais sans dieu, vouloir lire des signes à travers les incidents de la vie peut sembler suspect, si ce n’est superstitieux. Vous le faites tout de même, pourquoi ?
Suspect ? Je le prends comme un compliment. D’aucuns diront sans doute que je me paie de mots, qu’il faut être concret : gérer, produire, calculer, mettre en œuvre. Autrement dit, que mes éclaircissements sont des chimères, des jeux de lettres sans lendemain. À ceux-là, il faut répondre en cadet de Gascogne et, avec Cyrano, déplorer aujourd’hui qu’on ait si peu de lettres et d’esprit.
Si nous écoutions la Parole plutôt que de remettre notre avenir entre les mains des statistiques et des bilans comptables, si nous prêtions l’oreille à ce que les temps hurlent et réclament, peut-être qu’experts et conseillers seraient en mesure de concevoir des réponses qui ne soient pas les redites des errements que le virus met en lumière. Mais sommes-nous encore capables de voir le monde comme autre chose qu’une réserve de matière et d’énergie, un stock dont on s’empare et qu’on fait rendre ? Percevons-nous encore la grâce d’être né, la vie, la merveille, la gratuité, la poésie ?
Dans un livre que vous avez coécrit avec Yannick Haenel et François Meyronnis, Tout est accompli, vous affirmez l’impossibilité du salut dans une époque nihiliste comme la nôtre. Tous pourtant, guettant à la fenêtre le soleil qui nous nargue et que nous brûlons de revoir, n’attendons-nous pas comme une forme de rédemption après l’épreuve du confinement ?
Le coronavirus, dont le nom articule deux mots latins qui signifient respectivement : « couronne » et « poison », a été nommé ainsi en raison de sa ressemblance avec le soleil, que voilerait une lune noire. En effet, à la lumière du microscope, son enveloppe évoque clairement une couronne de flammèches. Or, dans la Bible, il existe une prophétie selon laquelle, quand « le Soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans ses rayons ». Encore faut-il, comme l’explique le Talmud, « extraire le Soleil de sa couronne », c’est-à-dire se compter pour néant, afin d’inviter le Soleil, qu’est le Messie, à se lever dans les ténèbres de notre existence.
Le vieux substrat biblique, dans lequel s’enracine un pays comme la France, ne cesse de faire retour sur le devant de la scène.
Il y a de l’exotisme, je l’avoue, à voir les choses de cette façon. De fait, on n’a plus l’habitude de lire une crise avec des lunettes spirituelles. Pourtant, depuis un an, le vieux substrat biblique, dans lequel s’enracine un pays comme la France, ne cesse de faire retour sur le devant de la scène. Qu’on pense à l’émotion suscitée par l’incendie de Notre-Dame. Sur ce chapitre, il y avait d’ailleurs récemment une cérémonie intéressante. Puisqu’au milieu des ruines de sa cathédrale, alors que les chrétiens entraient dans le Vendredi Saint, l’archevêque de Paris proposait à la vénération l’un des instruments de torture avec lequel on a raillé le Christ, à savoir la Sainte Couronne d’épines.
Remarquable jeu d’ombres, c’est le moins qu’on puisse dire. Comme si, du virus à la couronne, c’était toujours le même obstacle. Comme s’il fallait, à chaque génération, extraire le Soleil de sa couronne pour être en mesure de traverser notre néant et, par là, d’édifier une civilisation fondée sur la justice, et non sur la domination, qui n’est, dans le fond, qu’un nihilisme.
FIGAROVOX
Extraire le soleil de sa couronne, à propos d’une pandémie, par Valentin Retz, écrivain
Par chance, l’immeuble parisien où je suis confiné depuis un mois comporte une petite cour. Certes, elle est bien sombre, et la plupart du temps froide et humide. Mais, environ une heure par jour, le soleil s’y invite et la réchauffe. De temps à autre, j’y descends donc boire un café ; et c’est toujours un moment suspendu, loin de tout fil d’actualité. Les applaudissements du soir n’y retentissent plus du tout ou alors pas encore, et l’on n’entend aucune des formules qui se sont répandues récemment, telles qu’ « impacter », « geste barrière » ou « distanciation sociale ». Soit dit en passant, lorsque j’ai entendu la première fois l’expression : « geste barrière », j’ai pensé découvrir un nouveau mot composé. Mais, non, personne n’a pris la peine d’y adjoindre un tiret : on y appose simplement le nom « barrière », comme s’il s’agissait là d’un adjectif. Faut-il penser qu’avec le tiret nous n’aurions pas gardé de distance suffisante les uns avec les autres ?
Dans le même ordre d’idées férocement inutiles, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que la crise qui nous emporte intervient après la généralisation du paiement sans contact. Depuis deux ans, en France, mais aussi dans le monde, telle une supplique au dieu argent, j’entends partout dans les commerces ce même balai morne et figé : « Sans contact ? — Sans contact. » Et sans doute le réel nous a-t-il exaucés ; nous, qui lui demandons sans relâche, à travers le wifi, la 4G, internet, les appareils connectés, les réseaux numériques, de pouvoir nous atteindre sans devoir nous toucher.
Cela doit d’ailleurs nous renseigner sur notre réaction collective à la pandémie, ou plutôt sur l’orientation que celle-ci nous fait prendre. Puisque, si nous sommes les témoins d’un véritable infléchissement de l’idéologie néolibérale et de la globalisation, si le principe d’ « illimitation » qui en est le fondement ne semble plus être en mesure d’imposer son dictat, cela ne signifie pas, me semble-t-il, que nous allons revenir à plus de raison dans nos échanges. Certes, les partisans du souverainisme et du rapatriement des productions stratégiques pourront toujours se référer au moment que nous vivons pour asseoir leur discours ; et les détracteurs de l’émancipation illimitée des mœurs, du genre, du corps, etc., pourront même avancer que l’évidence qui s’impose aux sociétés doit forcément valoir pour les personnes. L’illimité semblant enfin devoir buter contre sa propre limite — le maximum de puissance rejoignant logiquement le maximum de faiblesse.
LIRE SUR LE BLOG DE FABIEN RIBERY
tout à la joie de faire à son tour le mariole et d’y aller de son tweet le ministre LREM de la Santé a fait une annonce étrange à propos du Covid-19 : il a déclaré que "la prise d’anticoagulants pourrait aggraver l’infection", sic. On s’étonne d’avoir à rappeler que la prise d’anticoagulants, à laquelle des millions de bipèdes (par ailleurs bien portants) sont astreints n’a rien d’une décision facultative ! Pour le reste ce à quoi il fait allusion est au plus un éventuel risque accru -mais seulement, en cas d’atteinte- pour les personnes qui prennent des anticoagulants. C’est là, le genre de chose dont on informe discrètement les praticiens que les personnes contaminées iront... de toute façon consulter. Mais de là, à mettre en circulation ce genre d’information publiquement : on voudrait, créer de l’anxiété, que l’on ne s’y prendrait pas autrement
Et si, avec et derrière la psychose entretenue médiatiquement, numériquement, jour après jour, heure après heure, minute après minute, par le mystérieux covid-19, se cachait un nouveau Vidocq, prêt à tous les coup pour assurer notre "sûreté", me souffle Etienne Klein, l’auteur des Anagrammes renversantes, ou le sens caché du monde ? Ce serait encore trop simple, car, en fait, à travers l’appel à "la guerre", à "l’unité du peuple", à "la mobilisation générale" ou à "l’Union sacrée" (les mots d’ordre varient selon les pays et les régimes), nulle identité cernable : ce qui se met en place de manière impersonnelle et spectaculaire, c’est une nouvelle phase du contrôle des consciences et des corps à l’âge de la cybernétique. Voilà la dernière illustration de la puissance du Dispositif analysée par Yannick Haenel, l’un des trois auteurs de Tout est accompli.
Charlei Hebdo, 11 mars 2020.
ZOOM : cliquer sur l’image.
Et maintenant profitez du confinement auquel on prétend vous contraindre pour regarder, calmement, les vidéos proposées dans le commentaire ci-dessous.
Les trois auteurs de "Tout est accompli" expliquent leur livre devant la caméra de Johanna Pauline Mayer. Ce très beau film est disponible sur la chaîne Youtube de la revue Ligne de risque :
https://www.youtube.com/channel/UCYrR-kS3RwJt6j9GmtRMYLQ
Voir en ligne : Revue Ligne de risque (site officiel)
Empirer dans la caverne. Illustration d’une des thèses fondamentales de Tout est accompli à l’âge de la cybernétique. Vous qui êtes accrocs de cet écran qui vous permet de suivre votre site préféré, Pileface, lisez quand même (et zappez le reste).
Charlie hebdo du 20-11-19.
ZOOM : cliquer sur l’image.
Avec Félix Tréguer, co-fondateur de la Quadrature du net, chercheur associé au CNRS, pour "L’utopie déchue. Une contre histoire d’internet XVe-XXIe siècle" (Fayard, 2019).
Alors qu’internet devait permettre l’émergence d’une société plus libre et plus démocratique, c’est, dit-il, tout l’inverse qui s’est produit. Chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS, membre fondateur de l’association La Quadrature du Net, qui défend les libertés numériques en France, Félix Tréguer déplore la chute de l’utopie émancipatrice et révolutionnaire que représentait l’Internet des origines.
Il nous en parle dans L’utopie déchue (Fayard, 2019), une contre-histoire qui, dans la lignée de Michel Foucault, revient sur la question des libertés et montre que celle-ci dépasse le cadre de l’informatique et du web. Il montre ainsi que, de l’invention de l’imprimerie au XVème siècle aux usages actuels de la technologie, les gouvernements ont toujours su s’approprier les communications pour contrôler les individus. ECOUTER ICI.
Faute de trouver un écho ailleurs (?), François Meyronnis et Yannick Haenel ont accordé un entretien à la revue très droitière L’incorrect (n° 22, juillet-août 2019). Vous ne pourrez le lire qu’en vous abonnant ou en achetant le numéro. Mais des extraits ont été mis en ligne au début du mois de septembre qui en donnent un aperçu. Vous pouvez en prendre connaissance ici.
Quelles différences faites-vous entre le reste et le résidu ?
L’une des choses qui caractérisent les Temps modernes, c’est le refus de l’idée de sacrifice. Dans cette perspective, le sacrifice est tout juste bon à remiser dans une pièce du musée de l’Homme. Le problème, c’est que si l’on postule que tout est profane, la réciproque s’applique aussitôt : tout est sacré. Ce qui signifie que tout est en proie — tout doit être détruit. Nous sommes là au cœur de la courbure des Temps moderne. La civilisation occidentale prétendait en finir avec le sacrifice, et celui-ci a fait retour sur nous avec une violence inimaginable.
Cette violence aujourd’hui prend trois formes. L’emprise de la cybernétique, la mise en joue atomique et la destruction environnementale, indissociable du Marché global.
Dans notre livre, nous proposons une nouvelle doctrine du sacrifice. Celle de René Girard nous semble non seulement réductrice, mais fausse dans son principe. Pour lui, le sacrifice relève exclusivement de l’anthropologie. Il le pense en rapport avec ce qu’il appelle la violence mimétique. Le sacrifice permettant simplement de passer de la violence de chacun contre chacun à celle de tous contre un seul.
Pour nous, la messe catholique — donc aussi la Passion et la Résurrection du Christ — n’est pas du tout une sortie du sacrifice comme le croit abusivement Girard, mais son accomplissement.
Un sacrifice opère le partage entre « reste » et « résidu ». Il s’agit à chaque fois de rapprocher ce qui est à disposition, le monde qui nous entoure, de ce qui est indisponible. Dès lors, le « reste » correspond à ce qui est rapproché, et rendu vivant par ce rapprochement ; et le « résidu », à la part qui demeure éloignée de ce qui rend vivant. Celui qui accomplit entièrement le sacrifice, et qui rassemble en lui tous ses moments — il est à la fois sacrificateur, sacrifiant, destinataire et offrande —, c’est le Messie d’Israël, en tant qu’il est la parole incarnée. À travers lui, la parole se fait sacrifice ; et le sacrifice, parole. Voilà le sens de la formule de Paul dans l’Épître aux Hébreux : « Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as façonné un corps. » Bref, la parole s’est incarnée pour qu’il y ait accomplissement du sacrifice, et que celui-ci soit le salut du monde. En somme, le reste qu’il s’agit toujours d’extraire du monde n’est rien d’autre que la part qui a été mise en réserve dans la victoire du Messie d’Israël. Et cette part, c’est l’amour.
Quand il est accepté par les hommes, le sacrifice retire au monde ce qui l’enfermerait en lui-même.
L’intégralité de l’entretien.
Tout est accompli, du trio Yannick Haenel, François Meyronnis et Valentin Retz, est un livre qu’il faut prendre le temps de lire très attentivement.
Parce que la réflexion y est de grande ampleur – le diagnostic du ravage de la planète Terre et de ses habitants par la fureur de la volonté de puissance aboutissant à la prison algorithmique -, inactuelle – une analyse sans concession de la Révolution française dans son délire criminel (assassiner le Dieu chrétien) -, scandaleuse pour beaucoup (le salut par le Christ).
Pensant la littérature comme voie de délivrance et éveil, les fondateurs de la revue Ligne de risque vont aujourd’hui plus loin, proposant la traversée du désert social par le feu de la parole chrétienne.
Tout est accompli est donc un livre messianique.
LIRE SUR LE BLOG DE FABIEN RIBERY
La recension de Charles Jaigu : « Trois chevaliers de l’Apocalypse ».
La recension de Cécile Guilbert. LIRE ICI.
L’une des cibles contemporaines des auteurs de Tout est accompli — essai de Haenel, Meyronnis et Retz dont on attend en vain qu’il soit philosophiquement discuté (ou simplement rendu compte) dans la presse informée — est Yuval Noah Harari, l’auteur de Home deus. François Busnel avait invité Harari dans sa petite librairie en septembre 2017 (voir ici). Yannick Haenel revient sur son dernier best seller dans sa dernière chronique de Charlie Hebdo.
Charlie Hebdo, 19 juin 2019.
ZOOM : cliquer sur l’image.
La recension de Stéphane Guégan.
Dans le monde d’aujourd’hui, « où les lignes se dédoublent, les tissus s’effilochent, les perspectives vacillent », écrit Roberto Calasso, il n’est plus d’arrière et de front, l’ultra-violence sectaire, comme les réseaux complices de l’internet, frappe partout et à tout moment, qu’il s’agisse de cibles explicables ou de victimes dont l’anonymat et la mort aléatoire donnent sens à l’acte qui les désigne soudain à l’attention publique. Dans un monde où tout devient instantané et simultané, précise Calasso, le terrorisme islamique partage donc plus d’un trait avec « la société séculière » dont il veut précipiter la fin. On le vérifie à chacun de ses livres, au pessimisme croissant, les raisonnements binaires, banalement progressistes, ne sauraient apaiser l’inquiétude que lui inspire notre époque de déliaison. La sur-connexion en est à la fois la fable et le levier : « On peut se demander si la société séculière est une société qui croit en quelque chose qui ne soit pas elle-même. » Dieu n’est pas mort, il a changé d’apparence : « Les conflits de la société n’ont plus pour objet quelque chose qui serait en dehors et au-delà, mais la société elle-même. Or, celle-ci est tout d’abord une vaste surface expérimentale, un laboratoire où des forces opposées tentent de s’arracher réciproquement la direction des expériences. » Ce grand baudelairien de Calasso n’a pas de mal à crucifier le « sécularisme », aussi sectaire que ceux qui le combattent, le tourisme, cette religion de l’insignifiant propre à l’âge du zapping, et l’obscénité d’un multiculturalisme destructeur des différences qu’il est supposé transmettre : « La convergence des cultures vers l’unité se vérifie dans le tourisme et dans la pornographie. Ce sont des mondes parallèles régis par des règles similaires. » L’Innommable actuel demande à Baudelaire le dernier mot. Il est emprunté aux brouillons du poète. L’une de ces notes se présente comme la transcription d’un cauchemar piranésien. Baudelaire se dit avoir été assailli par la vision étouffante d’une sorte de gratte-ciel qui s’effondre sur ses occupants. Or, conclut Calasso, le rêve de Baudelaire s’est réalisé au-delà de lui-même, car les tours étaient deux – et jumelles.
Stéphane Guégan, Moderne
Voilà une sorte de version érudite d’un Sérotonine macabre. Le dernier livre de Roberto Calasso se présente comme un essai sur les rapports de l’homme à la terreur, vus à travers le prisme des années 1933-1945. Il aborde, tour à tour, les thèmes du Big Data, du terrorisme, du tourisme de masse ou de la pornographie, en vue de mieux cerner ce « monde fuyant » et instable qui semble vouloir ignorer son passé. Le style de ce grand éditeur toscan, fondateur des éditions Adelphi, peut paraître abscons. Il se situe entre la poésie et l’essai philosophique. Comme dans La Folie Baudelaire, son magnifique ouvrage sur l’impact du poète sur l’art et la littérature, l’auteur s’appuie sur un enchevêtrement de citations et de rapprochements pour déchiffrer ces périodes de profonde instabilité où le monde semble basculer vers une tentative d’auto-anéantissement comme celle, « en partie réussie », des années 1933-1945, où « les perspectives vacillent ».
Pierre de Gasquet, Les échos.
Yannick Haenel, François Meyronnis & Valentin Retz : « Comme Nietzsche, nous pesons nos mots, du premier au dernier, sur les balances les plus fines »
Yannick Haenel, François Meyronnis et Valentin Retz
Zoom : cliquez sur l’image.
La sortie de ce fabuleux livre à trois mains et trois têtes intervient dans un moment précis de ce que l’on nomme actualité. Le toit de Notre Dame de Paris est parti en flammes. Un rapport mondial annonce tout de go que la vie d’un million d’espèces animales et végétales tient à un micro fil temporel. L’extrême droite va selon toute vraisemblance imposer sa sale patte sur les urnes dans les prochains jours. La question est sur toutes les lèvres : sommes-nous les contemporains de la fin du monde ?
Un samedi, je suis devant la télévision et une caméra filme la devanture du restaurant la Coupole sur le boulevard du Montparnasse. Deux-cent CRS forment un barrage devant ce qui avait été la cantine du président actuel juste après son sacre. Une sorte de cordon bleu finalement. De l’autre côté du boulevard, des chaises fusent devant Le Select, quartier général de Meyronnis, un des auteurs de Tout est accompli. Avec ses complices Haenel et Retz, il anime la revue Ligne de risque. Toutes les chaînes d’information diffusent cette unique image si nette d’un capitalisme ouvertement armé et qui s’arc-boute devant un restaurant symbole. Pour le pouvoir, il ne doit absolument pas avoir le même destin que le Fouquet’s. Je sens que quelque chose me fait signe dans ce face à face entre les deux établissements et en éteignant l’écran en un sursaut je suis déjà en train de faire l’expérience du texte que je vais lire.
Quelques jours plus tard, il impose sa forme énigmatique. On reconnaît le style des auteurs et on devine leurs passages personnels. Leur si fertile champ de pensée avait déjà donné il y a dix ans Prélude à la délivrance écrit par Haenel et Meyronnis et Poker avec Philippe Sollers en 2005. Deux livres de très haute volée, se tenant au cœur de grandes œuvres romanesques respectives. Dans Tout est accompli les trois noms se cachent judicieusement derrière leur propos. Mais la couleur est annoncée : « Nous sommes comme Nietzsche : nous pesons nos mots, du premier au dernier, sur les balances les plus fines. » Dès les premières pages, la pertinence et l’acuité de cette triple pensée agissent en un éclat et il est vite bien clair qu’il ne sera pas question de la crise du premier quart de siècle et qu’on ne lira pas un énième essai-choc sur la déchéance de la civilisation. Parce que la fin de ce que nous connaissons et de ce que nous sommes a déjà eu lieu. « Il n’y a plus de monde. Ce qu’on appelle couramment « mondialisation » est en réalité une « immondialisation ».
Nous avons échoué dans nos descriptions des situations et nos traités n’ont plus pouvoir de loi. Les discours comme les cris sur les réseaux sociaux sont vidés de leur substance. Tout tombe sous la simplicité du diagnostic qui frappe l’esprit comme une cymbale : « En vérité, notre temps n’a plus la capacité de traverser les phénomènes, et de se hausser à la hauteur d’une pensée métaphysique. Son eschatologie est devenue entièrement profane : à la mesure de la mesquinerie de ses calculs. Si l’on anticipe à ce point la catastrophe, c’est au fond parce qu’elle a déjà eu lieu. On redoute la « Grande chose » qui s’avancerait vers nous depuis le futur, alors qu’en réalité celle-ci nous précède, étant plus proche de nous-mêmes que notre veine jugulaire. Au vrai, sans le savoir, nous sommes déjà de l’autre côté du seuil. »
C’est exactement cela, nous avons sauté à pieds joints dans la boue du rien et nous pataugeons juste après la fin de tout. Oui, mais alors tous les étages de la pensée contemporaine s’en trouvent secoués. Il n’y aurait plus rien à attendre de la politique ? À apprendre des nouveautés du calendrier culturel ou social ? À espérer du discours des grands hommes sur leurs places ? Walou. Seul subsiste le dernier homme nietzschéen, ce rebut multiplié : « A part quelques vedettes (qui elles-mêmes de sont rien), quelques patrons (qui eux-mêmes ne sont rien), quelques présidents de quelques pays (qui eux-mêmes ne sont rien) – à part ces faux premiers interchangeables -, il n’existe que des derniers. »
Comme tout livre important, il trouve des illustrations implacables dans l’actualité. Voilà que la sénatrice américaine Kamala Harris, qui lorgne vers une candidature en 2020 ose se prononcer pour la fin de Facebook dans la foulée des critiques de Chris Hughes, le cofondateur du site qui expliquait ses craintes dans le New York Times il y a peu. Pour lui, cette entreprise est devenue trop grande et elle a trop de pouvoirs. Pour elle : « Nous devrions sérieusement réfléchir à faire appliquer la loi antitrusts. » Résultat ? Des articles prenant la défense de Facebook en feu d’artifice stratosphérique, un journaliste économique de CNN, Richard Quest, invoquant même directement le 1er amendement depuis le panier originel de Wall Street : oui il y a peut-être un souci mais beaucoup d’argent est en jeu et après tout « We have the right to be wrong ! (Nous avons le droit d’avoir tord !) » . Exactement dans le même temps Mark Zuckerberg est reçu par le président de la République comme un chef d’état. Il ne se passe décidément plus rien au niveau des mots et des figures.
Nos Temps Modernes présentent pour les auteurs une certaine courbure et il posent sur la table un nouveau concept : le Dispositif. Une présentification, une évolution du Spectacle de Guy Debord qui se trouve à la fois ainsi justifié et précisé, planétaire et moderne, tout à fait dans la lumière du jour. Le Dispositif se tient fièrement dans « le règne de la cybernétique. » Il siège dans ce moment de la réticulation reine et du réseau : « il est la capacité, à tout moment, d’agencer êtres et choses. Mais sous réserve de se fixer à lui-même des fins par sa propre puissance de calcul. » Une entité autonome délirante, un « point d’interférence de tous les programmes » qui réalise « l’absolu de la servitude » et qui a pour projet le transhumanisme. Surtout, surtout, il est inattaquable. « Quand prévaut le Dispositif, l’agencement des réseaux produit à la fois la réalité et celui qui la vit. Or il s’agit toujours d’une existence enchaînée ; et qui ressemble à l’étiolement du zombi, quand bien même on l’énergiserait à l’aide de substances. Dans le réglage des agencements, toutes les négativités sont absorbées. Vanité de déclarer la guerre au Dispositif, de prendre les armes contre lui, de le défier frontalement. Car il ne se réduit à aucune position : il efface toutes les frontières, empruntant à loisir les masques de l’ennemi. »
Il s’avèrerait bien peu malin de penser pouvoir régler son compte au Dispositif en frontal ou même de tenter de l’encercler. « L’émeute organisée de l’anarchiste, tout comme la terreur de l’islamiste, fait partie de la gestion courante du système. Aucun cocktail Molotov ne causera le moindre tort à la prééminence du Dispositif. Si l’on brûle une agence bancaire, cela ne change rien à la tutelle du Marché global ; à la rigueur, ce peut être l’occasion de donner un tour de vis. » Ce tour de vis a lieu maintenant, il vibre et vous rive au concret du béton de la société. Les CRS devant la Coupole ? Un peu d’huile politique dans l’immense rouage du géant financier qu’est le monde. Les rets de son ordre seront toujours plus grands, plus renforcés par la contestation. Avez-vous vu la proéminence délirante à la fois matérielle et symbolique de la casquette du nouveau préfet de Paris ?
Quelles alliances nouer dans le chaos ? François Meyronnis documentait dans le livre autobiographique Tout autre (Gallimard – L’Infini 2012) un rendez-vous manqué entre les têtes du Comité Invisible et certaines figures de l’avant-garde littéraire. Il y était question d’un ratage sur les lignes de front. Celles d’un Coupat et de ses invisibles se nourrissant du souffre de la violence quand celle formée par l’axe Haenel-Meyronnis brulait du feu de la littérature. La parole, les mots, le sens, le style sont au cœur de la vraie guerre face au gros capitalisme intégré qui mange tout et recrache ses sentences acides comme celle du milliardaire Warren Buffet, cité dans le livre : « La lutte des classes existe, nous l’avons gagnée. »
Dès lors, où situer le trou dans le monde aplati du Dispositif ? Il vient d’en haut, peut-être. Surgissant d’une verticalité transcendantale inattendue, occultée depuis la Révolution, cette « messe noire » meurtrière. « Tout est accompli » est la dernière parole du Christ et l’ouvrage, surtout dans sa dernière partie, est bel et bien ouvert du côté de la Bible et des textes rabbiniques, comme un rayon de lumière ouvre l’espace d’une scène picturale. Les références et citations forment une exégèse joyeuse et pratique, écho fou d’un événement de parole qui a toujours lieu dans l’instant. Une vraie musique même, jouée en combinaison avec les saillies de Sade, Heidegger, Lautréamont, Walter Benjamin et qui dévoile l’étendue du fabuleux stock d’études et de vie des auteurs. Par petites touches, elle pique aussi salutairement les penseurs actuels. René Girard et sa visée basse toujours prête à en revenir au plombant « tout est social ». La star mondiale des ventes de livres Yuval Noah Harari, coupable lanceur d’alerte anesthésié dans une gangue qui n’entoure aucune véritable pensée et où s’absentent conscience et raison. Michel Houellebecq enfin, qui « amène ses lecteurs vers une immense déchetterie, afin qu’ils prennent dans la file la place qui leur est dévolue. Il le fait dans une prose mesquine et utilitaire, et cela parce que le ressentiment envers l’existence s’étend chez lui jusqu’au souci de gâter la forme. »
On laisse aussi au lecteur le plaisir de découvrir une interprétation brillamment improvisée d’un rêve que René Descartes a fait dans la nuit du 10 au 11 novembre 1619. On l’espère même sortir de la lecture de Tout est accompli avec la certitude qu’on vient de lui présenter des dieux.
Arnaud Jamin, Diacritik, 22 mai 2019.
Un retournement messianique
En 1997, Yannick Haenel, François Meyronnis et feu Frédéric Badré, écrivains trentenaires, créent la revue Ligne de risque. Valentin Retz les rejoint peu après. Le projet sonne comme un réveil : pour dépasser le nihilisme, il s’agit de penser le néant – « la part maudite », dirait Georges Bataille, l’un des inspirateurs de ce courant, et plus encore la figure incandescente du Maldoror de Lautréamont – pour de nouveaux commencements. L’entreprise est ouverte et libre. Elle est d’abord esthétique (la littérature, « la parole », a seule l’intuition du salut). Elle devient mystique, théorisant un « retournement messianique » puisé à la kabbale et à l’Évangile, à la Synagogue et à l’Église. C’est l’objet de ce livre en forme de conversion postapocalyptique.
Nous vivons « l’âge de la fin », avec l’extermination de l’espèce humaine comme unique projet d’avenir. Déjà, « le Dispositif » que crée la mise en réseau numérique du monde « contrôle à partir du virtuel tout ce qui existe ». Échec des Lumières, liquidation de l’histoire. Toute pensée de l’avenir ne peut s’imaginer qu’à partir du déjà fini : « tout est accompli » sont, selon l’Évangile de Jean, les dernières paroles du Christ avant sa mort sur la croix. Parcourant à grands pas (et avec de fortes analyses de détail) « la courbure des Temps modernes », de la Révolution française à la Silicon Valley, les trois auteurs prophétisent l’avènement du Royaume. Si « le désert croît », comme disait Nietzsche, il faut justement, tel le stylite du christianisme juif, « aller vers le désert », « faire le saut ardent vers l’intérieur » pour toucher en soi la présence divine. Une voie… étroite.
Philosophie magazine