des mondes qui ne sont pas dans le monde... »
George STEINER
Après Babel, A.Michel, 1978,p.207.
 Les enfers intérieurs de Sophie
Les enfers intérieurs de Sophie
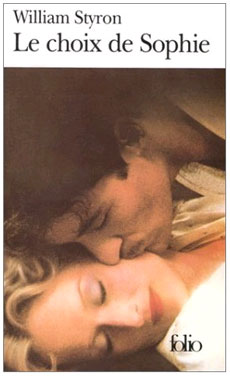 En 1981 parut chez Gallimard la traduction française de Sophie’s Choice de William Styron [1] un de ces « monuments » de la fiction américaine que furent « le génie déroutant » de William Faulkner, F. Scott Fitzgeral et Tom Wolfe, surnommé « dandy de la Troisième Avenue » .
En 1981 parut chez Gallimard la traduction française de Sophie’s Choice de William Styron [1] un de ces « monuments » de la fiction américaine que furent « le génie déroutant » de William Faulkner, F. Scott Fitzgeral et Tom Wolfe, surnommé « dandy de la Troisième Avenue » .
William STYRON (1925-2006)
Il est de toute évidence qu’on ne peut réduire la littérature américaine du XXe siècle à ces écrivains-là (La production fictionnelle aux Etats-Unis est, en fait, tellement abondante qu’on ne peut l’enfermer dans un catalogue. Nous aimons citer un groupe d’écrivains à succès doués d’un imaginaire lexical et vocal hors du commun : W. Gaddis, R. Coover, W. Gass, S. Elkin et J.McElroy, tous appartenant à cette partie de la littérature américaine contemporaine que l’on désigne souvent sous le nom de « métafiction »), ni non plus prétendre que Styron n’est qu’un écrivain documentariste. Sa bibliographie [2] compte plusieurs ouvrages où les thèmes abordés (la solitude, le racisme, l’esclavage, l’intolérance, la mort) sont de grand intérêt social et humain.
Styron dépeint, en fait, la vie quotidienne et ordinaire avec une habilité et une progression descriptive vraiment captivantes.
Dans cette perspective Le Choix de Sophie, excellente traduction de Maurice Rambaud à laquelle on renvoie, a aussi les caractéristiques du document sociologique, et c’est la raison pour laquelle bon nombre de lecteurs européens y sont attachés. Et d’autant plus volontiers que le livre ne prétend pas à une relecture de l’holocauste juif. Car ce n’est pas tant l’histoire (déjà mille fois racontée mais il faut la raconter encore et toujours, car l’oubli est prompt) de l’horreur et des exactions nazies qui fait le succès du roman, que la recherche d’une humanité plus vraie et plus profonde, dans le complexe tissu de connexions qu’est le vécu.
W. Styron utilise un langage transparent, réaliste, susceptible de produire un effet de vérité. Il prend les distances des thèmes idéologiques mais il démontre, en même temps, une grande capacité d’introspection quand il présente ses héros problématiques aux prises avec le monde environnant.
L’écrivain, quand il se replie sur son « Je », ne donne pas de soi seulement « cette image souffrante et confuse », propre au romantisme de la première génération. Comme soutient Philippe Sollers, il n’y a pas « du langage un peu secret, comme alchimique », ni non plus un auteur, « qui ne saurait quoi dire, qui ne saurait s’exprimer, mais qui impliquerait ce secret. Non, non et non » [3]. Car, pour l’auteur de Les voyageurs du temps, langage et conscience sont intimement liés et sont inséparables pour que le narrateur raconte le monde, les mondes et fabrique des histoires. Ce faisant, continue Sollers, le livre-produit n’est plus un témoignage qui reste enfermé à l’intérieur d’une catégorie, mais une réalité qui traverse le temps, les temps, échappant à toute classification. Il devient « immémorial ».
L’un des mérites de cet écrivain du Sud américain est qu’il nous fait comprendre que comprendre n’est pas une vertu sans faille, et que les êtres sont souvent imprévisibles, vagues, fantasmatiques et illuminés.
Tel est Stingo, jeune sudiste de 22 ans, qui arrive de Virginie à Brooklyn dans le but de faire carrière comme homme de lettres. Il incarne bien ce nouveau type de sudiste américain qui tout en restant attaché à sa formation première et à la culture de l’espace, signe visible de la réussite sociale, entreprend consciemment un voyage contre-courant, aussi exaltant que riche en contradictions, dans la dimension tout à fait nouvelle pour lui du monde adulte.

- Merryl Streep dans Le choix de Sophie
- Film de Alan J PAJKULA, 1982.
La performance de Merryl Streep lui vaudra l’Oscar de la meilleure actrice, en 1983
Et la rencontre avec Sophie, femme polonaise de 30 ans, catholique, rescapée de l’enfer d’Auschwitz, arrivée en Amérique pour retrouver sa paix, marquera à jamais sa quête identitaire. Ce sera l’occasion pour le narrateur-Stingo de reconstituer le véritable film de la vie de la femme, et, grâce à elle, de repenser, non sans inquiétude, son amour de jeunesse pour Miriam Bookbinder, sa relation avec Maria Hunt , « jeune fille d’une beauté vraiment radieuse »(87), ainsi que ses échecs sentimentaux, Stingo étant « naïf en matière d’amour » (561), notamment l’expérience catastrophique avec Lesli Lapidus, jeune fille juive en analyse, qui déversa sur lui une foule d’interrogations sur son aspect physique et sur ses manières d’approche.
A travers ses héros c’est la conscience sudiste de Styron qui se manifeste par tous ses instincts. L’identification d’un homme innocent à une terre qui resiste au temps, l’attachement à la trace première, l’unique qui soit encore à même de s’opposer à la malediction et à la fatalité.
C’est là un des thèmes majeurs du roman de Styron, particulièrement frappant dans les descriptions des paysages minutieusement observés. D’ailleurs, Styron est fasciné par tout ce qu’on lui offre au regard. Séduit par les innovations technologiques, le développement des villes, des industries, de la laïcisation, Stingo, le seul héros « positif » du roman, décide de se séparer du Sud vaincu. Il abandonne le mythe de l’idéal agraire du Vieux Sud pour poursuivre l’aventure, pour rompre les liens avec le temps-tyran, le passé inacceptable, avec une vision trop traditionnaliste de l’existence. Stingo expérimente son jeune âge et, grâce à Sophie, il acquiert son identité et son autonomie. Il connaît la jouissance charnelle et « l’extase » . Il vit selon sa conscience.
Sophie ou les fantasmes du passé
Une reconstruction qui procède par des flash-back désordonnés, des tranches temporelles rétrogrades entraînant la femme à une revisitation angoissante des moments les plus saisissants de son existence malheureuse et force le lecteur à des lectures parallèles, à une sorte de gymnastique intellectuelle et érotique, au milieu de scènes « osées » éparpillées dans le texte. La force du roman n’étant que dans la figure de Sophie, il nous semble plus intéressant de concentrer notre attention sur cette complexe figure féminine, sur ses comportements de mère et de femme encore jolie, sur les souvenirs de son enfance apparemment heureuse, puis de l’âge adulte, emmagasinés dans son esprit et revisités toutes les fois qu’elle se rend compte qu’elle a terriblement besoin de sortir du labyrinthe qu’est la vie. Des retours en arrière qui s’avèrent nécessaires pour que son récit soit plus crédible et son « moi » moins précaire.
Femme aimée, femme aimante, mère de deux enfants (Eve et Jan) forcée à choisir lequel des deux faire survivre, fragile et résolue selon les lieux et les circonstances, Sophie Zawistowska fait tout pour ne pas se laisser dévorer des fantasmes du passé, mais, à la fin, elle succombe sous le poids insupportable des remords.
L’action du roman est construite sur trois axes : 1. l’Amérique, destination privilégiée de l’immigration juive après 1945, une Amérique triomphante et distraite, héritière d’un climat de tensions et de contrastes d’un passé historique récent (la guerre de Sécession opéra, de facto, une division de l’Amérique entre qui voulaient une société plus industrialisée mais égalitaire et ceux qui, attachés aux traditions rurales, pensaient à une communauté plus intimement liée au territoire, plus identitaire) ; 2. la ville de Brooklyn, immense, verdoyante et belle ; 3. la pension « d’un rose uniforme » (67) de Yetta Zimmerman, » femme trapue et exubérante » (68), le « Palais rose » où Stingo voit pour la première fois Sophie, en train de pleurer, mais extrêmement belle, « aux cheveux de lin » (97), évanescente dans sa robe de soie légère, « le timbre de sa voix fragile et doux, l’accent polonais...un corps pourvu aux bons endroits des rotondités, courbes, lignes et symétries adéquates » (106). Bref, derrière la banalité de la rencontre, lui apparaît une femme « d’une sensualité merveilleusement désinvolte » (101), qui a encore l’envie de rêver.
Tout cela s’enracine également dans un contexte historique précis : celui de la naissance d’une nouvelle époque après les « temps de détresse » dont parlait le poète F. Hölderlin. Et le drame de Sophie incarne bien la volonté de mettre fin à la représentation d’un moment horrible et térrifiant de l’histoire et de la condition humaines et, à la fois, apprendre à vivre une autre vie plus « folle » , plus vibrante et plus poètique. Non plus un voyage au bout de la nuit, mais une déambulation plus sûre, sans se faire traverser des fausses idées. Mais, ce n’est qu’une illusion, car l’enfer est en elle dès qu’elle a subi le choix.
Nombreux sont les démons qui hantent la malheureuse Sophie. A commencer, son père, professeur universitaire distant et rigide, animé par l’esprit de l’utopie et coauteur d’un projet criminel antisémite qui passe sous le nom de Solution Finale. Sophie apprend l’antisémitisme extrême de son père à l’âge adulte quand, sténodactylographe, elle pouvait lire le texte complet de Le Problème juif de la Pologne. « Son style avait un charme inné » (440) et la présence « fumeuse et nénaçante » (440) du mot « extermination » , la jette dans la consternation et l’effroi. Dès lors elle commence à éprouver de la répugnance envers son père, « une présence tyrannique et étouffante » (432).
Un seul être le comprend : son beau-fils, Kasik, universitaire lui-aussi, qui accepte, sans véritable conviction, de partager les idées du prof Bieganski qui le tenait comme Sophie « sous coupe » (445) de protection. Kasik accepte de distribuer le pamphlet du prof dans les salles de l’université de Cracovie. Mais ce n’est qu’un fiasco. Est-ce qu’il a pour Sophie, sa femme, une attirance sincère ? Elle l’ignore. Ce que Sophie apprend c’est que Casimir n’a pas le courage de ses idées et qu’elle a fait un mariage médiocre. Et quand les deux universitaires seront justiciés, la souffrance de Sophie est d’une nature toute particulière. Celle-ci porte en elle la marque de la dégradation et de l’humiliation la plus lourde, de sa culpabilité morale face au martyre collectif de son peuple polonais auquel elle-même, en tant que copiste-dactilographe, avait donné sa contribution. « Elle se sentait trop étrangère à eux pour en être profondément affectée » (455).
Celui qui inculque davantage dans son esprit un sentiment de culpabilité jusqu’au suicide, c’est Rudolf Franz Höss, le commandant du camp d’Auschwitz,
Voir aussi
« ce robot implacable et docile »(274) avec qui Sophie a un rapport de voisinage à cause de son travail de secrétaire. Elle reste dix jours dans la cave de Höss, animée d’une seule idée, revoir son enfant Jan. Elle se montre correcte, confiante et disponible pour pouvoir trouver en lui l’humanité. Rien à faire.
A Auschwitz comme à Treblinka, à Birkenau comme à Ravensbruck, il n’y a que des monstres, ou des monstruosités. Rudolf HÖss orgueilleux d’appartenir au grand Golem qui fit les beaux jours, montre à tous instants un regard d’une cruauté et d’une froideur désarmantes.

- Shoah par Benoît Monneret
- Crédit illustration : benoit.monneret@gmail.com
En présence de Sophie il ne se laisse pas adoucir, pas même quand il est forcé de fermer les fenêtres pour éviter de respirer les odeurs puantes des carcasses de juifs gazées dans les fours du prochain camp de Birkenau. Ce qui le fait vibrer et qui délie sa chaleur, c’est des migraines qui l’épuisent, les seules qui échappent au contrôle de l’idéologie et qui le rendent plus vulnérable, voire plus pathétique.
Figure démoniaque par excellence est, bien sûr, Nathan Landau, amant odieux, capable de manifester, à la fois, une tendresse jusqu’à l’excès et une agressivité inouïe et folle. Figure contradictoire, sûrement tourmentée, mais géniale, aimant l’art, la littérature (il adore Faulkner mais il se permet de considérer la littérature sudiste médiocre, en train de disparaître) et la bonne musique classique, les voyages et la mode (il aime s’habiller avec élégance), voilà comment Nathan se présente à Sophie alors qu’elle sort du cours d’anglais à Brooklyn College, souffrante d’une très grave anémie contractée pendant les vingt mois de sa permanence au camp d’Auschwitz.
Une connaissance fugace qui va bientôt devenir une passion amoureuse folle et totalisante, un rapport fait de reconnaissance, de gratitude et de crainte. Une liaison intense qui va connaître des hauts et des bas mais toujours conflictuelle. « Nathan est d’une intelligence sans limites, peut-être un génie » (760), dit de lui, son frère Larry. Le médecin exprime toute son admiration pour la générosité et le sens de l’amitié de son frère, même s’il connaît très bien la pathologie de ses comportements souvent censurables.
D’humeur instable, Nathan alterne un langage excessif, décidemment offensif et menaçant (il appelle « Petit Blanc » son ami Stingo en guise de dégoût et de mépris) à une conduite plus réglée d’homme « charmeur, généreux, et stimulant » (746), au point qu’il arrive de demander pardon de ses insultes vulgaires et « de ses sarcasmes sectaires et autres incongruités délirantes » (141).
C’est justement ce mélange de bizarrerie et de transport qui exerce en Sophie, seule et affligée, une fascination particulière. Paradoxalement Nathan, ce champion de l’excès et de l’intolérance, lui transmet plus d’occasions d’attache. Et les ruptures même les plus turbulentes ne sont jamais définitives. Bien plus elles vont nourrir leur passion sentimentale qui deviendra dévorante et exclusive.
La vérité est que Sophie a trop absorbé, « emmagasiné toute la sauvagerie de Nathan, ses menaces, ses sarcasmes, ses imprécations » (614), ses malédictions. Elle a terriblement besoin de croire en une figure masculine. Au fond, elle se sent « incomplète » (261) et son sentiment d’incomplétude la rend une femme fragile et vulnérable. Elle ne veut pas renoncer à son « Prince charmant » (285) qui lui a sauvé la vie physique et avec qui elle a signé un pacte de sang qu’elle veut absolument respecter.
Sophie n’aime pas la solitude et les pleurs de détresse qui ont suivi ses brusques abandons la disent longue sur sa forme de dépendance (réciproque !). Ni, en fait, les mauvais traitements physiques (des coups de pied sur tout son corps qui lui causent des fractures assez douloureuses aux vertèbres) auxquels elle est soumise alors que Nathan est en proie à ses terribles « tempêtes » , ni la vilaine accusation de « respirer le bon air pur de Pologne tandis qu’à Auschwitz des multitudes entières mouraient lentement asphyxiées par le gaz » (381), ne réussiront à persuader Sophie que Nathan est un type à qui l’on ne peut accorder aucune confiance.
Elle accepte toute sorte d’ironie, Nathan l’appelle la « comtesse de Cracovie » (604) et supporte toutes formes de vexations, même l’accusation d’être infidèle. Mais elle ne veut pas se démissionner de son emploi à mi-temps dans le cabinet du Dr. Hyman Blackstock, chiropracteur. C’est la seule fois qu’elle s’oppose résolument à la volonté despotique de Nathan.
La vérité est que Sophie et Nathan se ressemblent beaucoup. Ils aspirent tous les deux à être des êtres humains, normaux. Ils tendent, avec le même élan, à une identité plus définie et essaient d’échapper à leur tragique passé et à la mémoire de soi.
Et alors, il ne reste qu’aux Stingo/Styron de s’interroger sur la société contemporaine atteinte d’une incurable maladie de l’âme : le manque de valeurs et d’espoirs. Sophie et Nathan, eux, ont été dévorés par les négativités, nous, lecteurs, avons absolument besoin de croire que derrière les malheurs plus ou moins généralisées se trouve la Force pour contraster le Mal.
Prof. Raphaël FRANGIONE
Illustrations : Pileface
 Il publie ses Mémoires, Le Lièvre de Patagonie
Il publie ses Mémoires, Le Lièvre de Patagonie
Les cent vies de Claude Lanzmann
par Philippe Sollers
Que penser d’un intellectuel célèbre qui commence l’énorme roman de ses Mémoires par les mots suivants : « La guillotine plus généralement la peine capitale et les différents modes d’administration de la mort - aura été la grande affaire de ma vie » ? Qu’il est, d’emblée, dans le sujet même. Qu’il a compris que la mort est un scandale, et la vraie vie aussi. Que les bourreaux, à travers le temps, se ressemblent tous, de même que les victimes. Il a 5 ou 6 ans, Lanzmann, quand la guillotine lui apparaît dans un film. Il n’en dort plus. Il ne dormira pas, non plus, au moment de la guerre d’Algérie, quand une exécution aura lieu à l’aube. La Terreur, c’est ça : « Une même lignée de bureaucrates bouchers servant sans faillir les maîtres de l’heure, ne laissant aucune chance aux inculpés, refusant de les entendre, les insultant, ordonnant les débats vers une sentence rendue avant même leur ouverture. » L’abolition de la peine de mort et de la guillotine, en France, est récente, mais partout l’horreur continue : aux Etats-Unis, en Chine, en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Lanzmann, parce qu’il est un grand vivant, est hanté par toutes ces scènes, ces derniers regards, ces derniers instants. « J’aime la vie à la folie , dit-il, cent vies ne me lasseraient pas. » Il s’oblige à regarder des vidéos d’égorgements islamiques : Dieu se récite au couteau et détache des têtes. Lanzmann est révulsé mais voudra voir plus loin, là où on ne voit plus rien, et, un jour, après douze ans de tribulations extravagantes, ce sera « Shoah », ce chef-d’oeuvre au-delà des images.
Qui a su, qui a senti, qui a compris ? Goya, sans doute, et Lanzmann a des pages de grande inspiration sur le « Tres de Mayo » et un dessin prophétique « Duel à coups de bâton ». Mais enfin, lui-même a bel et bien eu cent vies, et il les a toujours puisqu’il sait les dire.

Un livre où il y a une bonne dizaine de livres, tous éclatants de précision, de détails parlants, de portraits inoubliables. C’est Lanzmann, avec ironie et distance, parlant de sa mère explosive et embarrassante, de son père silencieux dans la Résistance. C’est Lanzmann à 18 ans, au lycée Blaise-Pascal, à Clermont-Ferrand, transportant des armes avec l’aide du Parti communiste. Il y a là une charmante Hélène de son âge, et ils s’embrassent à n’en plus finir dans les rues pour échapper à la Gestapo (les armes sont dans la valise). C’est Lanzmann toujours plus ou moins réfractaire et clandestin dans le maquis. La narration saute d’une époque à l’autre, revient, repart, art extrême du montage, avec mémoire visuelle instantanée. C’est Lanzmann à Berlin et en Israël, faisant du planeur et apprenant à piloter. C’est Lanzmann philosophe avec ses amis d’alors, notamment Deleuze qui sera le peu glorieux amant de sa soeur, Evelyne, avant que celle-ci soit séduite par Sartre, et finisse de façon tragique. Tragédies, suicides, mais aussi comédies. C’est Lanzmann étudiant déguisé en curé pour de fausses quêtes, petit voleur de livres au quartier Latin. C’est Lanzmann au bordel et, plus tard, journaliste à « France-Soir ». Des drames, sans doute, mais aussi beau coup de générosité et de liberté. C’est Lanzmann dans l’aventure des « Temps modernes », et ce portrait de Sartre : « Formidable machine à penser, bielles et pistons fabuleusement huilés, montant en puissance jusqu’à plein régime. » « Les ennemis de Sartre se sont gaussés de sa laideur, de son strabisme, l’ont caricaturé en crapaud, en gnome, en créature immonde et maléfique... Je lui trouvais, moi, de la beauté, un charme puissant, j’aimais l’énergie extrême de sa démarche, son courage physique et par-dessus tout cette voix d’acier trempé, incarnation d’une intelligence sans réplique. » Et puis, bien entendu, Beauvoir, la cohabitation avec elle, l’amour, puis l’amitié et, toujours, l’admiration. Sartre et Beauvoir : « Ils m’ont aidé à penser, je leur donnais à penser. » Les voyages épuisants avec Beauvoir, les mauvaises humeurs de Sartre, leurs angoisses, néantisantes chez lui, hurlantes et pleurantes chez elle : la vie.

- Philippe Sollers, rédacteur en chef d’un jour
- vérifiant l’accroche photo "Lanzmann à lièvre ouvert". Libération des écrivains du 19 mars 2009,
Une vie d’aventurier un peu fou, si l’on y pense, comme le prouve sa rocambolesque et drolatique aventure en Corée du Nord avec une infirmière sans cesse surveillée par la police totalitaire. Il est dedans il est dehors. Quand on lui demande, à New York, après la projection de « Pourquoi Israël », si sa patrie est Israël ou la France, il a cette réponse qui le résume : « Ma patrie, c’est mon film. »
Et c’est le voyage vers le soleil noir de « Shoah », le film le plus antispectaculaire qu’on n’ait jamais conçu et réalisé. Dès le début, Lanzmann sait qu’il n’utilisera pas les images d’archives ni les récits des survivants. Il ne fait pas un film sur la survie mais sur la mort elle-même, celle dont personne ne revient, celle des chambres à gaz. Il va donc retrouver les rares rescapés des Sonderkommandos (commandos spéciaux) qui officiaient dans l’enfer lui-même. On connaît leurs noms : l’extraordinaire Filip Müller, ou encore, séquence centrale, Abraham Bomba, le coiffeur de Treblinka. Et voici les cercles infernaux : Birkenau, Belzec, Sobibor, Treblinka, Maïdanek Non pas un film sur l’horrible routine concentrationnaire, mais sur la mécanique de l’extermination. Pour cela, il faut retrouver aussi les tueurs nazis, les identifier, les pister, et surtout les faire parler avec caméra dissimulée et ruses diverses. Douze ans de cavales et de recherches, donc, avec des moments de désespoir lorsque l’argent manque et qu’il comprend que personne ne réalise vraiment ce à quoi il veut aboutir. Il est aux Etats-Unis pour trouver un financement, et la question qu’on lui pose est : « What is your message ? » Pas le moindre message d’espoir, de consolation, de rédemption ? Non. Du coup, précise Lanzmann, « il n’y a pas un dollar américain dans le budget de « Shoah » ». Voilà la grande démonstration : les humains, pour fuir la mort, ont besoin d’images, ils veulent vivre dans des images et dans des faux films, ils font tout pour ne pas savoir l’extrême (3 000 personnes étouffées ensemble, hommes, femmes, enfants). « Shoah » (comme « Sobibor », autre chef-d’oeuvre) montre bel et bien l’impensable et l’irrespirable. On commémore pour éviter la mort, on vit sa petite vie de devoir de mémoire, on institue l’oubli, on ne veut pas que le mal existe en soi et pour soi. Révélatrices sont les réactions de fuite ou d’effroi religieux que Lanzmann rencontre (le rabbin Sirat, le cardinal Lustiger...). Non, le mal n’est pas « banal », il est absolu, et c’est pourquoi l’oeuvre et la grande vie de Lanzmann sont des événements métaphysiques.
Voir aussi
Il a imposé au tourbillon du spectacle sa technique obstinée de questionneur. « A Birkenau, rappelle-t-il, les lièvres se glissaient sous les barbelés pendant qu’avait lieu l’épouvantable massacre. » Longtemps après, en Patagonie, Lanzmann voit soudain un lièvre dans les phares de sa voiture. Il a 70 ans, mais il écrit que, comme à 20 ans, tout son être s’est mis à bondir d’une « joie sauvage ». Son livre, d’un bout à l’autre, dit cette joie.
_
Philippe Sollers
Le Nouvel Observateur N° 2313, jeudi 5 mars 2009
 Le Lièvre de Patagonie,
Le Lièvre de Patagonie,
par Claude Lanzmann, Gallimard, 560 p.
Claude Lanzmann
Né le 27 novembre 1925 à Bois-Colombes, Claude Lanzmann entre dans la Résistance et combat en Auvergne pendant la guerre. Il rencontre Sartre et Beauvoir en 1952. Il devient leur ami et entre aux « Temps modernes », dont il est le directeur. Il est l’auteur de plusieurs films dont « Pourquoi Israël » (1972), « Shoah » (1985), « Tsahal » (1994).
[1] La revue DELTA lui a consacré un numéro annuel spécial (n°23, Université Paul Valéry de Montpellier). Une étude aussi vaste que sévère sur l’oeuvre, les sujets traités et sur ses références littéraires.
[2] En 1951 Styron publie son premier roman « Un lit de ténèbres » , l’histoire d’une jeune fille morte en des circonstances sordides. En 1953 il publie » La marche de nuit sur l’absurdité de la vie militaire et « La proie des flammes » en 1960, mais ce sont « Les confessions de Nat Turner » en 1967, histoire violente et perverse d’une révolte d’un groupe d’esclaves noirs sous la conduite de Nat Turner, qui lui donne une renommée internazionale. En 1979 paraît « Le choix de Sophie » , la narration du martyre de Sophie et l’évocation de l’holocauste nazi, deux veines, autobiographique et historique, qui fusionnent en une touchante parabole sur la présence du Mal et sur l’intolérance au plus haut degré. Après une période de silence à cause de sa dépression, Styron raconte ses obsessions suicidaires dans « Face aux ténèbres-Chronique d’une folie » paru en 1900, un petit livre terrible et magnifique à la fois. En 1993 il publie « Un matin de Virginie » , où encore une fois Styron proclame sa fidélité à la défence de la dignité humaine, le refus de la violence et du racisme. William Styron meurt en 2006 à l’âge de 81 ans.
[3] Magazine Littéraire , n°171, entretien avec Ph. Sollers.



 -
- 
 Version imprimable
Version imprimable Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


