« Ainsi, dans une certaine mesure,
la fonction de représentation engage
la vie même de celui qui l’assume. »
Georges Bataille
(Marcelin Pleynet, Le système de Matisse)


Après 1914, 1918. C’est à Nice que Matisse peint "Le violoniste à la fenêtre" au printemps 1918, après "La leçon de piano" (1916) et "La leçon de musique" (1917). Alors que ne cesse le fracas des armes de « l’imbécillité infernale » de cet « abattoir international en folie » (Céline), Matisse impose sa peinture et sa musique (c’est ici la même chose). Qui est ce violoniste qui joue en nous tournant le dos ? La fenêtre est fermée, l’horizon n’est pas entièrement dégagé, mais ce n’est plus la porte-fenêtre noire de Collioure de 1914. Je ne me lasse pas de ce tableau qui est reproduit sur la couverture du "Henri Matisse" de Marcelin Pleynet (folio).
A chaque visite d’une exposition à Beaubourg, je fais un petit détour par le 5ème étage pour aller le contempler en silence (j’allais dire me "recueillir").
Sur la Toile, je découvre que, devant ce tableau, une élève de 3ème (Arine) s’est laissée aller à cette belle — et à peine croyable — rêverie (elle imagine que la scène se passe à Paris) :
« C’est l’histoire d’un violoniste parisien, qui passe ses journées sur son balcon pour y jouer du violon. Il ne s’en lasse jamais et continue à jouer le matin, le soir et parfois même une partie de la nuit. Sa mélodie est assez fluide comme si elle sortait directement du violon lui-même.
Le violoniste y joue surtout pour lui même, mais aussi pour les passants. Qu’ils soient grands, petits, affairés ou touristes. Tous s’arrêtent pour l’écouter jouer.
Tant que le violoniste joue, le temps sur Paris est ensoleillé, les oiseaux chantent et tout le monde est content. Mais, dès qu’il s’arrête de jouer, il commence à pleuvoir sur Paris, il y a de l’orage et les gens se bousculent et la vie devient chaotique.
Mais un jour une des cordes de son violon se déchire. Catastrophe ! Peut-on le réparer ? Quelqu’un d’autre va t-il jouer à sa place ? La ville de Paris va t-elle être condamnée à jamais d’une ambiance maussade avec un temps constamment pluvieux ?
La mauvaise humeur va t-elle y régner à jamais ? Que va t-il se passer ? »
Oui, que va-t-il se passer ? Pour Matisse, en tout cas, pas de corde cassée : la musique ne manquera jamais à son désir.
Le 3 novembre dernier, peu de monde au musée d’art moderne, j’ai tout le loisir de photographier le tableau. (note du 4 décembre 2014)
Henri Matisse La musique à l’oeuvre
18 janvier 2014. Au menu des Greniers de la mémoire, une promenade dans les archives sonores d’Henri Matisse. La musique est l’un des thèmes iconographiques récurrents de son œuvre, mais elle tient aussi lieu de métaphore quand le peintre s’exprime sur la couleur, ses thèmes, variations, harmonies…

► Henri Matisse
— Couleurs de ce temps, prod. Georges Charbonnier (1950)
— Entretien avec Henri Matisse, prod. Robert Sadoul (1951)
— Henri Matisse : "Rôle et modalités de la couleur" (1945) (In Henri Matisse, Ecrits et propos sur l’art, Hermann 2004)
— Henri Matisse dans son atelier évoque la peinture et le dessin (archives Gaumont Pathé 1945)
► Pierre Boulez, Matériau et invention musicale (1980)
► Pierre Schneider, Il y a cent ans Henri Matisse (1993)
► Marcelin Pleynet, Il y a cent ans Henri Matisse (1993)



Fin 2006 Marcelin Pleynet publiait « Cézanne marginal ». A cette occasion il s’entretenait avec Alain Veinstein et revenait sur la maladie, la chance (« toujours présente quelle que soit la monstruosité dans laquelle on se trouve »), bref le savoir-vivre. Mais aussi sur Rimbaud, Guy Debord, ses chroniques régulières de L’Infini (Situation).
Méditation sur la société du spectacle, la croyance au progrès, à la science, et l’art. « Cézanne marginal ».
Marcelin Pleynet et la peinture

Marcelin Pleynet a également publié en mars dernier un petit livre comprenant deux CD : La peinture contemporaine en question, reprenant une conférence faite en 1979 au CAPC de Bordeaux.
Dans sa préface intitulée « Situation : la plaque tournante des années 70 de Tel Quel à L’Infini », il revient longuement sur le contexte culturel, idéologique et politique, qui a permis la publication, après mai 68, d’un nombre assez impressionnant de livres dont on peut dire qu’ils ont fait date : L’Ecriture et l’expérience des limites (repris de Logiques, 1971), Lois (1972), H (1973), Sur le matérialisme (1974), le "feuilleton" de Paradis (de 1974 à 1981) de Sollers, L’anti-Oedipe (1972) de Deleuze, les deux volumes du Nietzsche de Heidegger (traduits par Klossowski en 1972), La dissémination de Derrida (1972, publiée en quatre livraisons auparavant dans Tel Quel), Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse de Lacan (1973), Stanze de Pleynet lui-même (1973), une "remarquable traduction" du Système totalitaire de Hannah Arendt, etc. Guy Debord, de son côté, après avoir dissous L’internationale situationniste en 1972, réalise son film La Société du spectacle.
Et puis, il y a l’effet de choc produit en 1974 par la publication de L’archipel du Goulag de Soljenitsyne...
Beaucoup de revues voient également le jour : Peintures, cahiers théoriques, Documents sur, etc.
On mesure mal dans l’air raréfié d’aujourd’hui l’effervescence de ces années-là et les radicales remises en question qui eurent lieu !
Parallèlement à son activité principale de poète, Marcelin Pleynet voyage, donne des conférences aux Etats-Unis et s’affirme très vite (en fait dès le milieu des années 60) comme un "critique" =- terme qu’il n’aimerait pas, préférant se qualifier de « pseudo-critique » — dont l’acuité, à nul autre semblable, ne lui fait pas que des amis notamment chez les marchands d’art. De nombreux essais en témoignent : Art et littérature (1977), Situation de l’art moderne : Paris-New-York (1978, en collaboration avec William Rubin, directeur du MOMA de New-York), Transculture (1979), Giotto (1985), Les Etats-Unis de la peinture (1986), Les modernes et la tradition (1990).
« Les Modernes et la Tradition »
.

Dans ce livre qui comporte dix textes deux sont consacrés à Matisse : Matisse et Picasso : état d’urgence — Matisse aujourd’hui, le grand atelier, suivi d’un Appendice : la chapelle du Rosaire.
Philippe Dagen, dans Le Monde du 18.05.90, expose ce qu’il appelle :
Les généalogies de Pleynet
Depuis son Enseignement de la peinture, paru il y a vingt ans, Marcelin Pleynet accomplit une tâche aussi nécessaire que singulière. Historien et analyste de la peinture moderne, il est celui qui, inlassablement, contre les engouements, contre les vogues, cultive l’intimité de Matisse et de Picasso. Il y a là, dit-il, dans leurs tableaux, leurs dessins, non seulement l’essentiel de notre temps mais une leçon de maintien et de morale. Il faut non point les imiter mais les connaître à fond, afin d’être, autant que possible, " à leur hauteur ".
Dans les Modernes et la Tradition, il a réuni des essais récents consacrés à ses deux " patrons ", à leurs pères putatifs, Courbet, Cézanne, Monet et à l’un de leurs enfants, Pollock. La métaphore de parenté n’est pas simple commodité : Pleynet se plaît en effet à l’étude des généalogies, qu’elles soient esthétiques — que prit Picasso à Cézanne ? Pollock à Picasso ? — ou familiales — comment Alberto Giacometti régla-t-il ses comptes avec son père, néo-impressionniste estimable ? De filiation en adoption, il recompose savamment réseaux et systèmes de références, rapports entre peintres, de peintres à écrivains, de vivants à morts, de modernes à anciens.
C’est qu’il faut rappeler que Courbet se réclamait de l’"art des musées", que Proust voyait en Picasso un maître non moins admirable que Carpaccio et Vermeer et que Pollock eut pour iniateur Benton, qui lui donna à étudier le Tintoret et Greco.
A l’histoire ordinaire du vingtième siècle, qui serait faite de ruptures, révoltes et amnésies obligatoires, vulgate dont s’autorisent l’ignorance et le simplisme de tant de " contemporanéistes " actuels, Pleynet substitue une histoire infiniment plus précise et complexe, celle d’une modernité fondée sur la manipulation constante d’un savoir et d’un présent, de l’actuel et de la tradition en somme, laquelle tradition n’a de valeur que pour celui qui la brusque et la métamorphose, cherchant encore de la beauté, de la poésie, de l’intelligence dans son temps, suivant son temps. " Celui-là serait le peintre, le vrai peintre, qui saurait nous faire voir et comprendre combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottes vernies ", écrivait Baudelaire, que cite Pleynet à propos de Proust, de manière à montrer combien l’esthétique du " peintre de la vie moderne " détermine la conception de la Recherche.
Elle ne détermine pas moins l’exécution des Demoiselles d’Avignon, qui ne naissent pas d’une combinatoire de lignes et d’emprunts, mais du désir de produire un " effet de vérité ", sinon une " toute nouvelle forme d’allégorie ".
Ainsi oeuvre Pleynet, ennemi juré, quoique courtois, des formalismes, analyste préoccupé du sens des oeuvres et de leur genèse tout à la fois plastique, érotique, morale, historique et biographique.
Il pourrait parfaitement reprendre à son compte la profession de foi de Courbet de 1855 :
" J’ai étudié en dehors de tout esprit de système et sans parti pris l’art des anciens et l’art des modernes, je n’ai pas plus voulu imiter les uns que copier les autres. Ma pensée n’a pas été davantage d’arriver au but oiseux de l’art pour l’art. Non ! J’ai voulu tout simplement puiser dans l’entière connaissance de la tradition le sentiment raisonné et indépendant de ma propre individualité.
A ces essais s’ajoutent de nombreux petits livres. La liste en serait trop longue à énumérer ici [1]...
Le premier livre important date de 1971 : Pleynet publie alors dans la collection Tel Quel un recueil d’essais sous le titre de L’enseignement de la peinture. Parmi ceux-ci, un long essai écrit d’avril 1970 à mai 1971 : Le système de Matisse (sous-titre : "(programmation)") qui sera réédité en 1977 dans la collection "Points".
Philippe Sollers en rend compte dans « La quinzaine littéraire » (1er-15 avril 1972).
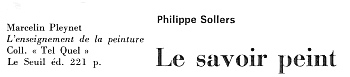
Le livre que vient de publier Marcelin Pleynet, l’Enseignement de la peinture, est sans aucun doute le premier livre théorique tentant de définir la production picturale dans son histoire et sa spécificité à l’intérieur du matérialisme historique. D’où son importance qui risque, bien entendu, étant donné la dictature de l’idéologie bourgeoise idéaliste et métaphysique sur tout ce qui concerne « l’art », d’être sèchement censurée. Nous vivons en effet aujourd’hui, en France, trois ans « après Mai », une phase particulièrement instructive de blocage et et d’hégémonie idéologique bourgeoise et révisionniste. La toile de fond de cette hégémonie, on la voit clairement : union sacrée sur nos « grands peintres modernes », nos grands vieux peintres modernes (Picasso, Matisse), avec arabesques d’anniversaires, célébrations en tous sens, meetings, souvenirs, rétrospectives, apothéoses de musée, etc. Pompidou et Aragon, amateurs éclairés, mènent le cirque. Et la peinture, la question posée par la peinture redevient invisible dans une propagande fétichiste du confort sur murs.
Or la peinture, comme la littérature moderne en Occident, témoigne d’une remarquable cohérence productive si l’on se donne les moyens de la déchiffrer. C’est précisément ce que fait Pleynet en articulant pour la première fois entre eux tous les mouvements d’avant-garde de la percée « peinture » en Occident (cubisme, futurisme, surréalisme, Mondrian, Kandinski, Malevitch, Klee, Matisse, l’avant-garde américaine, l’avant-garde française actuelle). Montrant très bien ce qui « progresse » à l’intérieur de ces différents mouvements (moins et plus différents que ne tend à le faire croire l’idéologie de marché de la peinture), c’est d’abord l’insistance d’une répétition, l’extension d’un écart décisivement produit par Cézanne (comme, s’agissant d’écriture, par Lautréamont) à la fin du XIXe siècle. Écart que l’investissement bancaire, à vrai dire délirant, de la bourgeoisie essaie vainement de combler. Comme si la classe bourgeoise essayait de boucher à coups de centaines de millions ce qui vient dénoncer visiblement — forme et fond — sa domination visible.
L’aventure de la peinture moderne s’explique d’abord par le bouleversement de plus en plus accéléré de la révolution économique et industrielle du passage du capitalisme à l’impérialisme. Bouleversement qui trouve, au niveau idéologique, ses effets conséquents précis. Effets non pas mécaniques (comme l’ont cru les idéologies totalitaires de la « décadence » de l’art) mais profondément dialectiques, dégageant une nouvelle pratique de l’espace et non pas seulement de sa représentation. A travers « l’ébranlement ininterrompu de tout le système social » (Marx) déclenché par la bourgeoisie impérialiste, à travers les contradictions de plus en plus aiguës entre révolutions prolétariennes et impérialisme, l’expérience discontinue, précipitée, de la peinture occidentale nous donne comme le « tableau » d’une immense mutation de base des systèmes représentatifs. Pleynet analyse comment le rapport-décalage entre arts et sciences constitue le ressort de cette mutation. C’est ce rapport-décalage entre une pratique de plus en plus ferme, assurée d’elle-même et une idéologie (empiriste ou mystique) qui vient, par défaut de théorie, la recouvrir et la livrer à son académisation rapide, qui forme le fond du « drame » de la peinture moderne. Drame dont on ne saurait s’évader en prononçant une sortie arbitraire des problèmes formels et la réduction à une « pure » question de « contenu » (c’est ici l’échec du « réalisme socialiste ». Prêché en son temps par Aragon, on voit à quoi il mène en se renversant : au retour massif de l’idéologie religieuse de l’art sur le terrain même d’une question non scientifiquement posée). Drame qui, pour se jouer dans quelques individualités « privilégiées » des superstructures individuées, vite transformées, le plus souvent à titre posthume, en fétiches, n’en reflète pas moins une crise de l’ ensemble des pratiques idéologiques sous-tendues par la lutte des classes. Les bouleversements sociaux viennent en effet se représenter, en système capitaliste-impérialiste, sous formes de « névroses géniales » en quelques têtes, dès lors achetées à prix d’or. Cette genèse du « génie peintre » ne peut trouver son explication ni dans une théorie idéaliste de l’Histoire ; ni dans des analyses formalistes ou positives. C’est encore une fois le marxisme, mais aussi la psychanalyse, qui doivent en proposer la lecture rationnelle. L’Enseignement de la peinture traverse le fourmillement groupusculaire des « avant-gardes » picturales en éclairant leurs bases sociales et inconscientes. En mettant en scène l’expérience d’une pratique spécifique à l’intersection de la science de l’histoire et de la science de l’inconscient, Pleynet découvre donc que « l’art » est le lieu pratique d’analyse où se joue la possibilité de critiquer la métaphysique d’une science mystique comme d’une mystique scientifique. Marx : « Tous les mystères qui poussent la théorie au mysticisme trouvent leur juste solution rationnelle dans la pratique humaine et dans l’intelligence de cette pratique ».
Dans les pratiques humaines. La « peinture » est l’une d’elles, enjeu d’une lutte stratégique particulièrement âpre et confuse. Solidement tenue en mains par le Capital, et pour cause. Répressivement dominée par le déplacement-sublimation de la religion esthétique. Pleynet, lui, va y regarder d’un peu près. En détails. Sans dogmes. Sans les émois extatiques de la « critique d’art » subjectiviste. Sans livre de messe ni programme volontariste. En marxiste et en freudien.
Le nouveau de la peinture moderne, au-delà des « nouveautés » lancées sans cesse par le marché de la peinture, tient dans quelques principes fondamentalement brouillés et cachés par le murmure esthétisant fétichiste. C’est d’abord la « sortie du tableau ». Problème qui n’est pas celui de ses dimensions mais de sa division interne, dialectique, transformant complètement la conception hiérarchisée surface/fond, indice du passage à une pratique sans précédent de l’espace. Amorcée par Cézanne, déviée par le Cubisme, radicalisée par Mondrian, Matisse, Rothko, méconnue par le surréalisme, reprise aujourd’hui, ici même, par quelques peintres, cette enquête de base, « hors-cadre », qui peut commencer maintenant à trouver sa théorie juste , devient bien, comme l’écrit Pleynet, une « force productive dans l’ordre d’une connaissance spécifique ». A l’opposé de toute idéologie de surface du « modernisme » (le plus souvent technocratique), cette « force de travail », cette « profondeur multiple d’une vision décentrée », échappe à la théologie de l’art comme à toute illusion métaphysique (oscillant entre primat du contenu ou primat de la forme). C’est l’apparition patiente, obstinée, coupée de ruptures et de sauts parfois tragiques au niveau individuel, d’un corps anonyme nouveau. Le bras détaché de Pollock, l’oeil exorbité de Rothko, le dessin à vif dans la couleur de Matisse... sortie du miroir de la peinture, dissolution du vieux corps peint en miroir qui donne lieu aux bavardages sur « la mort de l’art ». Interventions d’un nouveau corps qui, sortant de l’unité additionnelle du « tableau » découvrent peu à peu le continent peinture , avec ses multiplications, ses différences, ses tracés de pulsion et d’effacements, ses deux membres longtemps refoulés par le mode de perception (métaphysique) de l’unité : le geste, la couleur. Il faut lire attentivement la splendide analyse que Pleynet fait du Système de Matisse : ce qui lie la pulsion sexuelle à une irruption historique propre, à travers l’inceste et la sublimation des pulsions. Comment le fait de « dessiner directement dans la couleur » suppose tout un étagement à la fois des pulsions et des références culturelles. A travers le dépeçage de la figure et la multiplicité des plans, à travers l’expérience recommencée de Matisse pour délivrer l’inscription coupée de sa mère dans la contradiction des couleurs, Pleynet, loin des effets de surface de l’esthétisme ou des mots d’ordre contemporains, nous enseigne réellement la force possible de la transformation matérielle de la peinture. Comment cette pratique donne accès à ce que Matisse appelait empiriquement « les principes essentiels qui ont formé le langage humain », c’est-à-dire en même temps à l’expérience de l’inconscient et à celle du développement concret de l’histoire. Grand livre coloré de la naissance du geste de la peinture trouvant sa solution rationnelle et la conscience de cette solution.
Matisse incontournable ? Un nouvel essai — Henri Matisse — verra le jour en 1988 avant d’être réédité en édition Folio en 1990 [2]. La question du sujet en peinture, à tous les sens du terme, y est traitée hors de toute approche "anecdotique ou historiciste" [3].
Le 25 février 1993, Pleynet, retraçant le parcours du peintre, reprend certains de ses thèmes dans un article du Monde — Matisse : Le pur plaisir d’inventer. Cet article figure désormais dans Comme la poésie la peinture (Editions du Sandre/Editions Marciana, novembre 2010) sous le titre L’invitation au voyage. C’était déjà, en 1988, le titre du premier chapitre de Henri Matisse [4].
Matisse, L’invitation au voyage [5]
par Marcelin Pleynet
« Réunir le passé avec l’avenir de la tradition plastique ». Cette simple et ambitieuse profession de foi impose aujourd’hui l’oeuvre de Matisse comme la plus prestigieuse réalisation de l’art français du XXe siècle.

- Matisse dessinant dans son appartement à Nice avec une de ses modèles habillée en odalisque en 1927-1928.
- Photographies de Matisse
Internationalement reconnu comme un des événements fondateurs de l’art moderne, l’oeuvre de Matisse établit une mesure à laquelle l’art de son temps se trouve inévitablement confronté. Nous savons désormais que non seulement l’histoire de l’art de notre époque ne s’écrira pas sans lui, mais qu’elle s’écrira d’abord à partir de lui, à partir de celui qui s’oppose à une tradition morte au nom d’une tradition vivante et dont l’oeuvre se confond, en effet, avec l’avenir de la tradition plastique.
Dans le message qu’il adresse à sa ville natale, Le Cateau-Cambrésis, à l’occasion de l’inauguration du musée qui lui est consacré, Matisse ne laisse subsister aucun doute sur le sentiment immédiat et « constant de l’importance de sa détermination ».
Si, après des études de droit, il aborde tardivement sa carrière picturale à l’âge de vingt et un ans, on ne peut pas douter qu’il ne le fasse immédiatement en toute connaissance de cause. Il précisera lui-même : « J’ai foncé tête baissée dans le travail avec le principe que j’avais entendu toute ma jeune vie, énoncé par ces mots : "Dépêche-toi." »
Incontestablement, l’oeuvre de Matisse témoigne d’un mouvement de détermination et d’urgence qui n’abandonne rien des acquis du passé que le peintre ne cesse de déplacer et de précipiter en avant, « poussé, nous dit-il, par une force que je considère comme étrangère à ma vie d’homme normal ».
Sortant d’un milieu qui n’avait aucune raison de l’y pousser, sa découverte de la peinture l’entraîne à Paris, sans que pour autant il renie les principes familiaux. Sa vocation est un appel à l’oeuvre, une invitation, un voyage au cours duquel l’action de la mémoire rassemble la pensée.
En 1930, au retour d’un voyage à Tahiti, il confie à André Tériade :
« On reprend son chemin avec plus de certitudes quand la préoccupation de la partie antérieure du voyage, n’ayant pas été détruite par la quantité d’impressions reçues du monde nouveau dans lequel on s’est plongé, reprend possession du cerveau. »
Mais n’est-ce pas de la même façon qu’en 1954 il évoque ses premières visites, en 1890, au Musée Lécuyer à Saint-Quentin, comme la partie la plus antérieure, la plus initiale de sa carrière ?
« On y voyait, écrit-il, une centaine d’esquisses exécutées par Quentin de La Tour au pastel avant de faire ses grands portraits d’apparat. Touché par ces aimables visages, j’ai constaté ensuite que chacun d’eux était bien personnel. J’étais surpris, en sortant du musée, de la variété de sourire particulier à chacun des masques [...] ils m’impressionnaient au point d’en avoir les muscles du rire fatigués [c’est moi qui souligne]. »
C’est ainsi que, l’année même de sa mort, Matisse nous informe que c’est Quentin de La Tour, ce merveilleux peintre du XVIII siècle, que nous avons abandonné en effigie sur les billets de 50 francs, qui, traversant toute sa carrière, rassemble encore en sa pensée, avec ces aimables visages, l’invitation à l’oeuvre comme proximité, forme d’un élargissement de la sensibilité et de l’intelligence où l’homme s’accorde à lui-même le luxe d’une existence réconciliée.
Luxe, calme et volupté (1904)

« Matisse a choisi comme titre du tableau qui restera le plus représentatif de son séjour à Saint-Tropez un vers de L’invitation au voyage où Baudelaire associe explicitement « ordre et beauté » à « Luxe, calme et volupté » (titre du tableau de Matisse, pour qui, en conséquence, et on ne peut plus explicitement, plus déclarativement, "beauté" rime avec "volupté". » M. Pleynet, Henri Matisse.
Initialement placées sous le patronage des premières oeuvres d’art que le peintre ait peut-être jamais vues, les pastels de Quentin de La Tour, dont les frères Goncourt diront « C’est mieux que l’art, c’est de la vie », la carrière et la peinture de Matisse connaissent effectivement, entre 1904 et 1906, une très décisive précipitation, au sens chimique du terme.
Avec sa première grande composition comportant plusieurs nus féminins, Luxe, calme et volupté, de 1904, avec les toiles qui figurent dans la « cage aux fauves » du Salon d’automne de 1905, notamment le portrait de Mme Matisse dit la Femme au chapeau et, définitivement, fin 1905, début 1906, avec le Bonheur de vivre, Matisse réalise déjà ce qui va constituer, pour l’essentiel, la singularité de son oeuvre.
Il ne manquera d’ailleurs pas, par la suite, de prendre de multiples précautions et d’insister pour qu’aucun malentendu ne subsiste quant à ce qui, dès ce moment, ordonne son art.
Le bonheur de vivre (1905-1906)

« Dans "Luxe, calme et volupté", le mélange optique tend à dissoudre les formes dans la lumière qui les baigne et les irradie ; impossible de suivre, de saisir le parcours sinueux des corps. Alors que de ce point de vue, Le bonheur de vivre se présente comme une véritable anthologie : femme nue allongée de dos, femme nue allongée de face, femme nue debout les bras levés, femme nue renversé dans les bras d’un homme, ronde de femmes (la danse au centre du tableau). » M. Pleynet, Henri Matisse.
A partir de 1906, c’est quasi systématiquement que l’oeuvre de Matisse développe un certain nombre de thèmes récurrents, tous plus ou moins directement inspirés du programme éthique et esthétique qu’imposent Luxe, calme et volupté et le Bonheur de vivre. Il suffit pour s’en convaincre d’évoquer les titres qui, de la période des ateliers parisiens à la période niçoise, ponctuent le parcours de l’artiste, entre autres : le Luxe (1907 - deux versions [6]), la Musique (1907 [7]), Harmonie en rouge (1908 [8]), la Danse (1909-1910 — deux versions [9]), Nature morte à la danse (1909), la Musique (1910 [10]), l’Atelier rouge (1911 [11]), Capucines " à la Danse " (1912 — deux versions [12]), Porte-fenêtre à Collioure (1914), Femmes à la rivière (projet de 1909, commencé en 1913 et terminé en 1916 [13]), la Leçon de piano (1916 [14]), la Leçon de musique (1917 [15]), le Violoniste (1918), etc.

Le violoniste, 1918. Fusain sur toile.
Musée Matisse, Le Cateau. Photo A.G., 4 janvier 2018. Zoom : cliquez l’image.

De ces toiles, dont la plupart sont directement constituées par une sorte de zoom avant sur un détail du Bonheur de vivre, de ce fabuleux parcours, et de la force créatrice qui l’impose, il faut aussi retenir qu’ils sont le fait d’un homme encore jeune, mais qui n’est plus un jeune homme ; ils sont le fait d’un homme dans sa maturité à qui s’imposent brusquement et avec enthousiasme la jouissance et la maîtrise de son art.
Il n’est pas besoin de chercher d’autre justification aux oeuvres que Matisse réalise à partir de 1906 : seule la certitude qu’a le peintre de se trouver, comme il l’écrit lui-même, « dans sa vraie voie » justifie la peinture d’être, dans l’invention de la peinture, un bonheur de vivre. Ici, l’expérience picturale est d’abord une expérience existentielle. Expérience intime qui entraîne Matisse à constater que
« les tableaux appellent des beaux bleus, des beaux rouges, des beaux jaunes, des matières qui remuent le fond sensuel des hommes [c’est moi qui souligne] ».
La liberté et l’audace, pour tout dire la vérité des inventions formelles et chromatiques qui feront écrire à Apollinaire que Matisse est « le fauve des Fauves », ne manqueront pas, par ailleurs, de troubler la misère ambiante et de scandaliser les esprits timorés, jusqu’à entraîner la foule à brûler en effigie le Nu bleu, souvenir de Biskra (1906) lors de sa présentation dans le cadre de l’exposition itinérante de l’Armory Show à Chicago en 1913 [16].

- La vue de Notre-Dame (1914)
Mais aujourd’hui encore, pour des raisons voisines bien qu’inverses, si cet assaut, cette libre association sur les formes traditionnelles de la peinture, ne provoque plus aussi violemment le puritanisme contemporain, on ne s’emploie pas moins à dissocier les quinze premières années de la carrière du peintre, la période plus particulièrement parisienne, de la période niçoise.
Des oeuvres comme le Nu bleu, souvenir de Biskra (1907), l’Atelier rouge (1911), Femmes à la rivière (1913-1916), le Portrait de Mademoiselle Landsberg (1914 [17]), la Vue de Notre-Dame de Paris (1914), la Porte-fenêtre à Collioure (1914 [18]), la Leçon de piano (1916) sont encore présentées comme « abstraction et expérimentation » (dans le catalogue de la Rétrospective du Musée d’art moderne de New-York, 1992) qui les verse au compte d’on ne sait quelles intentions formalistes et avant-gardistes, quand, comme l’ensemble de l’oeuvre, elles témoignent, d’abord et essentiellement, de ce que Matisse ne cesse de revendiquer : le luxe, le pur plaisir d’invention que, dans l’enthousiasme de sa désormais toujours nouvelle liberté d’expression, l’artiste s’accorde à lui-même.
En 1913, et justement à une journaliste d’outre-Atlantique qui s’étonne qu’une oeuvre aussi « anormale » (sic) eût pour auteur un homme en apparence aussi « ordinaire et sain » (sic), Matisse se voit dans l’obligation de préciser :
« Oh ! dites bien aux Américains que je suis un homme normal, que je suis un père et un mari dévoué, que j’ai trois enfants, que je vais au théâtre, pratique l’équitation, que j’ai une maison confortable, un beau jardin, que j’adore les fleurs, etc., exactement comme tout le monde. »
Faut-il aujourd’hui encore insister sur ce point ? Matisse, il est vrai, l’aura fait jusqu’à la fin de sa vie, puisqu’en 1952 il déclare :
« Du Bonheur de vivre — j’avais trente-cinq ans — à ces papiers découpés — j’en ai quatre-vingt-deux — je suis resté le même : non comme l’entendent mes amis qui veulent à toute force me complimenter sur ma mine, mais parce que tout ce temps j’ai cherché les mêmes choses que j’ai peut-être réalisées avec des moyens différents. »
Le Bonheur de vivre, ce fut d’abord, et continûment pour Matisse, le bonheur de peindre, le bonheur d’inventer la peinture, le bonheur de réconcilier librement le langage pictural avec lui-même et, par voie de conséquence, de réconcilier l’homme avec son langage.
A partir de 1916, Matisse séjourne de plus en plus souvent à Nice, jusqu’à ce qu’il y installe définitivement son atelier en 1921.
Si les séjours à Nice sont d’abord déterminés par le « grand émerveillement » du peintre pour le Sud et pour sa lumière, ils participent aussi de ces voyages (en Corse en 1898, au Maroc en 1911, à Tahiti en 1930) qui ponctuent sa carrière et sont comme autant de ressourcements pour lui-même et pour son art.
L’installation à Nice a pourtant ceci de particulier : elle se situe à la fin de la première guerre mondiale, à un moment où, en pleine maîtrise de ses moyens, Matisse, conscient de la démoralisation et du nihilisme de la société d’après-guerre, sait pouvoir réaffirmer plus déclarativement les valeurs qui sont les siennes. N’est-ce pas d’abord dans cette perspective qu’il choisira l’occasion d’un de ses premiers séjours à Nice pour rencontrer Renoir ? Rencontre à laquelle il ne cessera d’accorder la plus grande importance en ces mêmes années où Marcel Proust, de son côté, écrit :
« Les gens de goût disent aujourd’hui que Renoir est un grand peintre du XVIIIe siècle. »
C’est déclarativement qu’en ces années le Matisse qui n’a pas oublié Quentin de La Tour rencontre le Renoir qui n’a cessé de se réclamer de Watteau. Dès son séjour à Nice, Matisse s’emploie à réaffirmer ce qu’est pour lui une tradition vivante et dynamique en mettant en évidence tout ce que l’esprit de sa peinture doit à l’art mouvant et libre du XVIII siècle français. Il est très étonnant qu’un certain nombre d’historiens aient cru pouvoir placer sous la rubrique du « retour à l’ordre » des oeuvres comme Antoinette au chapeau à plumes, debout torse nu de 1919, l’admirable Odalisque à la culotte rouge de 1921
Odalisque à la culotte rouge (1921)

« Il n’est rien de plus beau que cette nudité que tout exalte et d’abord ce qui l’habille, ce superbe pantalon mauresque rouge qui gonfle démesurément le bassin et les cuisses d’un corps dont l’élégante nudité du buste s’affine et s’allonge des bras levés et repliés derrière la tête. Le tableau est ainsi tout entier constitué par une subtile rivalité dans le désir qui se fixe sur la présence découverte de ce buste de femme et la dilatation rouge de la culotte qui couvre les cuisses et le bassin, et dont les motifs clairs semblent répondre, en contrepoint, à ceux des tentures et paravents qui ferment le haut du tableau. La nudité, pleine et modelée du ventre et des seins nus, que dégagent les bras levés, participe dans sa pâleur d’un jeu érotique où elle cède la place à l’euphorie d’une jouissance qui se trouve seule célébrée dans sa dilatation chromatique. Si la culotte, coupée du corps par une ceinture d’un bleu vif et froid, exalte en rouge le jeu qu’elle cache et découvre, n’est-ce pas parce que, dans la jouissance qu’il procure, ce jeu est le sol même (d’un rouge vif) de la scène ? Ainsi, en euphorie et dilatation, à partir d’un corps nu de femme, l’espace n’est pas celui du modèle, mais celui du désir, qui s’exalte en l’environnant. » M. Pleynet, Henri Matisse (p.187)
et pourquoi pas la Nature morte avec un volume des " Pensées " de Pascal de 1924 ? Ne devrait-on pas, au contraire, penser que la chair découverte et magnifiée des modèles tels que Nu au peigne espagnol assis près de la fenêtre (1919), la Méditation, après le bain (1920), et les jeux de dames qui, malicieusement, accompagnent et commentent les couples d’odalisques comme Deux odalisques dont l’une dévêtue, avec fond ornemental et damier (1928), ou le Repos des modèles, fond ornemental et damier (1928), font plutôt " désordre " pour les conventions aujourd’hui encore dominantes ?
Seulement voilà, Matisse est non seulement aussi vivant entre 1919 et 1930 qu’entre 1907 et 1916, mais il l’est peut-être alors beaucoup trop librement pour la tartufferie qui s’emploie à considérer les admirables réalisations de la période niçoise comme un « retour à l’ordre ».
De cette société, qui se fait alors plus ou moins complice de la toujours évitable ascension du fascisme, le Matisse de la période niçoise pourrait déjà dire ce qu’en 1940 il écrit à son fils Pierre :
« Si tout le monde faisait son métier comme Picasso et moi faisons le nôtre, ça ne serait pas arrivé » (sic).
Pour lui, comme avant lui pour Cézanne, la peinture « fait vérité en peinture ».
En 1930, au retour de son voyage à Tahiti, il pourra déclarer :
« Quand l’homme est formé, organisé, avec un cerveau ordonné, il ne fait plus de confusions et il sait davantage d’où lui viennent son euphorie et sa dilatation. »
La période niçoise réconcilie définitivement Matisse avec l’histoire de son art. Comme il le dit lui-même, il y prend « conseil de sa jeunesse » et de la dynamique des formes qui réalisent heureusement ses sensations. La mesure et l’intelligence de son oeuvre sont d’abord mesure et intelligence de l’euphorie qu’il éprouve à pratiquer librement la « dilatation » du langage qui est le sien. Faut-il rappeler que « dilater » consiste à augmenter le volume d’un corps en élevant sa température.
Toutes les inventions de Matisse, et, d’abord, l’extraordinaire organisation spatiale que déploie son oeuvre, sont littéralement liées à l’augmentation, à la chaleur, à la dilatation des données de l’expérience plastique. Littéralement, cette ampleur des données de l’expérience plastique se manifeste par le passage de la toute petite farandole au centre du Bonheur de vivre (1907) à la monumentale décoration (trois exemplaires) de la Danse (3,40 m 12,76 m) de 1931-1932, par l’ensemble des grands papiers découpés, et plus encore par l’extraordinaire réalisation de la chapelle du Rosaire à Vence.
La Chapelle du Rosaire (1950)

A gauche : l’arbre de vie, vitrail — A droite : saint Dominique, céramique

La Chapelle du Rosaire. Maquette définitive.
Musée Matisse, Le Cateau. Photo A.G., 4 janvier 2018. Zoom : cliquez l’image.

« Matisse écrit en décembre 1948 à André Rouveyre : " On dit que c’est par amitié pour une dominicaine qui m’a soigné que je fais cette chapelle. Tout est à Freud aujourd’hui." (Faut-il souligner ?) » M. Pleynet, La chapelle du Rosaire dans Les modernes et la tradition (1990).
« Cette chapelle est pour moi l’aboutissement de toute une vie de travail, et la floraison d’un effort énorme sincère et difficile. [...] De cette expression du sentiment humain les erreurs qu’elle peut contenir tomberont d’elles-mêmes, mais il restera une partie vivante qui pourra réunir le passé à l’avenir de la tradition plastique. » Henri Matisse, 1951.
Libre de lui-même dans le bonheur de peindre, d’inventer la peinture et de s’inventer dans la peinture, l’art de Matisse témoigne désormais, contre tous les nihilismes de son siècle, de la souveraine liberté de la pensée réconciliée avec les formes de la vérité (ces formes qui sont aussi celles des odalisques) qui, de toutes parts, lui font signe. Pour Matisse, la liberté de la pensée est sans limite pour qui sait « donner à une surface très limitée l’idée d’immensité ». « C’est ce que j’ai fait, ajoute-t-il, avec la chapelle de Vence. »
C’est ce que d’une autre façon il entend lorsqu’il déclare vouloir « réunir le passé avec l’avenir de la tradition. »
Marcelin Pleynet, Le Monde du 25.02.93.
Voir en ligne : Le site officiel de Marcelin Pleynet
La femme au chapeau
« Ce qui m’a toujours frappé, et me frappe aujourd’hui encore dans ce tableau, c’est la façon dont les couleurs se disposent à côté les unes des autres, voire se superposent en transparence, sans se mélanger, mais réalisant la juste tonalité chromatique de l’ensemble ; et, par ailleurs, le caractère d’aboutissement du tableau constitué de ses apparents effets d’inachèvement. Je ne connais pas une autre peinture qui traite de cette même façon la facture brossée des couleurs à l’huile. »
M. Pleynet, Henri Matisse, 1988.

- La femme au chapeau (1905)
En 1971, M. Pleynet analysait ainsi le tableau :
" La figure n’est plus utilisée dans l’espace comme excentricité jouant plus ou moins contradictoirement par rapport à un centre spatial, elle est un des éléments, entre autres, de l’espace qu’elle constitue, qui se constitue aussi en elle, et auquel elle sacrifie sa vraisemblance (reconstituée) : " Je ne peins pas une femme, je fais un tableau. "
Aussi, rien, semble-t-il, dans la Femme au chapeau, qui renvoie à Mme Matisse, à une femme réelle. Dans ce portrait, pas un des espaces ou champs colorés, si vaste ou si petit soit-il, qui ne se trouve sur le même plan. Toute la peinture est comme la reconstruction logique, dans l’ordre de l’artifice, d’une figure dépecée. Ceci pour chaque unité de référence figurative, ou élément de couleur, qu’il s’agisse de ceux qui "constituent" (la femme 6- visage ou buste), de ceux qui "constituent" (le chapeau), de ceux qui "constituent" dans ce rectangle (le tableau). La tache verte qui touche (la joue) gauche du puzzle (de la figure), n’est ni plus ni moins solide que la figure, ni plus ni moins "réelle" - elle paraît être bien en avant de la figure (du visage), mais dès qu’on s’arrête à ce dernier on s’aperçoit que ce qui le constitue est également pris dans une multiplicité de possibilités de plans. Le nez, la bouche, les sourcils, les yeux, les joues, le front, l’oreille (le rouge, le jaune, le vert, l’orange, le brun...) sont, les uns par rapport aux autres, comme appartenant à autant d’espaces différents, et créent une figure toute en surface et en trous, comme si le visage avait été hâtivement écorché et la peau étalée, aplatie sur la toile. Mais encore une fois, ce qui est valable ici au niveau du détail l’est aussi au niveau de l’ensemble. A gauche, le rouge (des cheveux) dispute le premier plan à la tache verte à droite (la tache qui touche la joue gauche du modèle). La construction complexe (le chapeau) qui remplit en grande partie le tiers supérieur de la toile a, sinon plus, au moins autant d’importance que tout le reste de la figure. Cette construction ne se réfère d’ailleurs à un chapeau que dans la mesure où elle se situe juste au-dessus du visage de Mme Matisse (quoique sur un tout autre plan pictural). Isole-t-on cette construction, on obtient une sorte de nature morte ou encore quelque motif décoratif de papier peint ou de draperie, démesurément grossi et amené au premier plan (motif tel qu’on en voit dans certaines toiles de Cézanne, comme par exemple dans le coin en haut à droite de la Nature morte au rideau à fleurs et aux fruits, 1900-1906).[...]
Avec ce portrait de Mme Matisse, "la femme au chapeau", la structure formelle, telle qu’elle se trouve répondre de la problématique de la peinture moderne, est en adéquation parfaite avec la force ("cette force inconnue...") travaillant subjectivement la pensée moderne, avec les pulsions destructives (fauves) qui commandent cette force (conflit oedipien > pulsions "sadiques" > agression du corps maternel) et avec la biographie du peintre (portrait de sa femme modiste).[...]
Lorsque Matisse peint et expose (ex-pose) la Femme au chapeau, nous sommes en 1905 et je dirai que nous sommes à peine, voire pas encore, au début du XXe siècle, nous sommes à la fin du XIXe siècle ; l’archaïque morale bourgeoise règne en maîtresse absolue sur une société où une femme qui se peint le visage ne saurait être une honnête femme - et ce dans le milieu même d’où Matisse est issu. [...]
La femme peinte (le vocabulaire commun emploie toujours cette expression pour désigner la prostituée), c’est la prostituée, le femme qui cherche les hommes, la mauvaise femme, la mauvaise mère. Ce que le chroniqueur, l’imbécile de service, ressent immédiatement : il y a quelque chose de "sauvage" de "FAUVE" dans le traitement que Matisse fait subir à son modèle.
Ce point de vue apparemment marginal se trouve tout à fait justement recentré dans le champ du système de la peinture de Matisse, si on le rapproche de ce que rapporte Sarah Stein, à savoir que, pour ce portrait de la Femme au chapeau, Mme Matisse posait vêtue d’une robe noire et coiffée d’un chapeau noir, le seul élément coloré étant le ruban qu’elle portait au cou. Matisse a donc réellement peint, coloré, de " ces couleurs qui éveillent le fond sensuel des hommes ", sa femme. Ou, plus exactement, prenant sa femme comme modèle, il a peint non pas sa femme, mais sa mauvaise femme , la mère qui se donne au père, la mauvaise mère, la prostituée. Et l’on comprend comment il peut alors écrire : " Si j’en rencontrais de pareilles dans la rue, je me sauverais épouvanté ." »
Marcelin Pleynet, Système de Matisse
dans L’enseignement de la peinture, 1971, p.62-63 et suivantes.
[2] Henri Matisse . Voici ce qu’en disait Philippe Dagen dans Le Monde en 1988 :

« Composer la biographie d’un peintre n’est pas commode, ne serait-ce que parce l’oeuvre peint se dérobe à l’évocation. La recommencer est plus périlleux encore : la répétition menace, une comparaison peut être mortelle. Ainsi fallait-il de l’audace pour revenir sur Matisse moins de deux ans après la somme de Pierre Schneider. Il n’en est que plus remarquable que l’ouvrage que publie Marcelin Pleynet parvienne à révolutionner analyses et interprétations. Son propos est moins de raconter en détail la vie du peintre que de réexaminer de fond en comble le "cas" Matisse. Le biographe suit l’ordre chronologique, mais se laisse volontiers déborder par l’essayiste qui va à l’essentiel et se sert des faits, des oeuvres et des propos de l’artiste comme d’autant d’arguments en faveur de sa thèse.
Car Pleynet a une thèse, une thèse claire, forte et juste. Il se refuse à ne voir en Matisse que le bon grand-père à lorgnons dorés de l’abstraction. Qui lui donnerait tort ? Portraitiste, peintre et sculpteur du nu, Matisse s’est constamment efforcé de transcrire ce qu’il appelait son " sentiment intime ". Il a célébré les formes et les couleurs des femmes et des fleurs en véritable héritier du dix-huitième siècle français, celui de Quentin de La Tour et du grand Fragonard. Au fil de sa démonstration, Pleynet remet en cause bien des lieux communs, rappelle le profond attachement de Matisse à l’art dit " ancien " et réhabilite la période dite " facile " du peintre de Nice. Son Matisse ne peut que choquer les bien-pensants du progrès en art. Aux autres, qu’il aide à se dégager des conformismes du modernisme officiel, il donne une belle leçon de liberté de pensée.[...] »
[3] Le sujet en peinture et la signification du tableau c’est aussi le titre d’un essai de Signac (1935) cité par Pleynet (cf. Henri Matisse, Folio, p.100).
[4] Ajout du 13-12-2010.
[5] Le choix des reproductions des oeuvres de Matisse ainsi que des "légendes", extraites de « Marcelin Pleynet, Henri Matisse » (folio, 1990), a été effectué par moi. A.G.
[6]

- Luxe I (1907)
[9]

- La danse I (1909)

- La danse II (1910)
« Le blanc de la toile apparaissant ça et là en semi-transparence sur la ligne qui définit le corps des femmes de La Danse I, donne à ce tableau, d’une facture brossée relativement visible, une dimension de sensibilité et d’intimité, de proximité, qui ne se trouve plus dans les aplats et l’interprétation des figures comme signes iconiques, de La Danse II. Pourtant, ici encore, de l’une à l’autre des deux versions, et de façon encore plus manifeste, s’impose la présence d’une troisième dimension, d’un espace (implicite et qui n’est pas sans évoquer celui qu’encerclent les bras des danseuses dans chacun des tableaux), espace que Matisse est, bien entendu, le seul à pouvoir occuper. Espace que l’on peut aussi reconnaître, dans le cadre de ses oeuvres, comme littéralement constitué de données objectivement mesurables et en expansion. La "ronde" du Bonheur de vivre occupe, au centre du tableau, un peu plus de 30 cm de large, sur un peu moins de 30 cm de haut [...]. Les versions I et II de La Danse (de New York et de Léningrad) mesurent, à quelques millimètres près, 260 x 390 cm. Enfin les deux versions de La Danse de 1931-1932, ont respectivement entre 12, 67m et 14, 45m de long et entre 3,40m et 4m de haut. Comme on le voit, entre 1905 et 1932, il y a expansion de la surface littéralement occupée par le motif de la danse, et entre chacune des versions de La Danse [...], Matisse expose le double, le multiple, complexe et libre mouvement qui détermine la création de son oeuvre. »
M. Pleynet, Henri Matisse, p.132-133.
[10]

- La musique ( 1910)
[11]

- L’atelier rouge (1911)
« Dans mon atelier le sol est rouge sang de boeuf comme dans les carrelages provençaux ; le mur est rouge ; c’est comme si le sang s’était infiltré pour tout teindre ; les meubles sont rouges entourés d’un fil d’or mat. Ce rouge est comme une nuit chaude à l’intérieur de laquelle, venant de la fenêtre à gauche, une intense lumière fait naître ou plutôt ressusciter les autres objets. Il y a sur la commode plusieurs pots dont l’un est rempli de pinceaux devant une frise que l’on dirait en marbre noir et or comme le manteau d’une cheminée, qui passe derrière l’horloge dont on voit l’écran mais pas les aiguilles. Il y a la toile rayée du transatlantique à demi replié près d’une de mes assiettes blanches et bleues sur la table à droite. Il y a une jarre qui vient aussi des bords de la Méditerranée. On dit que c’est mon atelier de Clamart, mais j’ai tout fait pour y reconstituer la lumière d’ailleurs. Il y a deux de mes sculptures sur des selles de modelage et la table à gauche plus près, une troisième autour de laquelle une liane de capucine venue d’une fiasque vert sombre à long col tourne amoureusement. Que tu es belle, Marguerite, ma fille ! tes dents sont un troupeau de brebis tondues qui remontent du bain. Il y a sur la même table un grand verre transparent, un des plats que j’ai décorés d’une femme comme si c’était elle qui offrait toute la nourriture, qui la produisait, à demi dressée sur un socle noir, près d’une boîte de crayons dont deux sont déjà sortis. Il y a les tableaux encadrés ou non qui sèchent en attendant l’approbation finale : trois femmes au bord de la mer, je l’ai appelé le Luxe , un satyre épiant une nymphe dans la forêt, un pot de cyclamen sur une table ronde, un marin accoudé, deux grands nus, un brin de paysage, une petite aquarelle sans doute dans son passepartout. Il y les oeuvres passées, toile retournée, montrant leurs chassis, et les cadres prévus pour des tableaux futurs. C’est là que je m’efforce de vivre et d’inventer, au milieu du tintamarre et de la menace, un monde de volupté calme. Je me suis toujours méfié des maîtres, mais je les ai passionnément interrogés, et l’on trouvera leurs leçons dans toutes mes audaces. »
[12]

- Capucines "à la danse" (1912)
[13]

- Femmes à la rivière (1913-1916)
[14]

- La leçon de piano (1916)
« La leçon de piano bénéficie de toute la virtuosité technique et formelle, et des virtuosités créatrices de l’artiste, portées à un degré d’élaboration comparable, en effet, à celui d’une écriture musicale. Au demeurant, si l’on considère les lignes de force de la composition, on ne peut manquer de remarquer qu’elles suivent, comme l’enfant (le plus jeune fils de Matisse, Pierre) qui se trouve au piano, formellement, les données du métronome que Matisse a fait figurer au premier plan à droite de sa toile. Les trois diagonales du métronome se projettent en se renversant sur le visage de l’enfant (marquant de haut en bas le renversement que l’artiste souligne en écrivant de droite à gauche la marque du piano LEYELP, PLEYEL) et ordonnent les deux tiers gauches de l’ensemble de la peinture dans un rectangle qu’une diagonale (qui divise la toile de haut en bas) partage en deux triangles renversés qui, reproduisant à l’échelle du tableau, l’un la forme du métronome, l’autre la forme inverse projetée sur le visage de l’enfant, ordonnent une composition où la partie vaut pour le tout. Comme le métronome commande la disposition du clavier sur lequel s’exerce, il commande la règle de composition picturale, ordonnée comme un clavier. Il n’est certainement pas dans toute l’oeuvre du peintre une autre toile qui déclare aussi explicitement, et atteint avec une telle évidence, la volonté et l’ambition artistiques de "mesure" qui sont celles de Matisse. »
[15]

- La leçon de musique (1917)
[16] Souvenir de Briska :
Souvenir de Briska (1906)

« De toutes les oeuvres les plus radicalement provocantes de la vaste manifestation des expressions modernes de l’avant-garde que fut, en 1913, l’exposition de l’Armory Show, n’est-ce pas la seule toile de Matisse qui scandalisera à tel point la pruderie anglo-saxonne qu’elle fut brûlée en effigie dans les rues de Chicago ? Nous n’en sommes pas, bien entendu, alors aux formes de répression qui, en Allemagne, quelques vingt ans plus tard, aboutiront aux grands autodafés et aux expositions d’art dégénéré, mais n’est-ce pas la même attitude d’une société et de son " horreur de vivre ", qui commande un même acte collectif (limité à un seul exemple aux Etats-Unis et plus tard systématisé en Allemagne) ? Cette aventure témoigne en tout cas, autant que possible, de l’évidente expression de vérité que porte l’oeuvre de Matisse et de la façon dont cette oeuvre s’inscrit dans la sombre et médiocre histoire de son siècle. » M. Pleynet, Henri Matisse.
[17]

- Portrait de Mademoiselle Landsberg (1914)
[18]

- Porte-fenêtre à Collioure (1914)
« C’est la guerre. C’est encore cette question de santé qui m’oblige à rester à l’arrière. Je ne suis pas dans les tranchées, mais quand même. Les camarades sont moins seuls. J’aurais envie de rester toute la journée à attendre les communiqués, mais je ne peux pas. Que tu es belle mais terrible, Hélène, fauteuse de trouble, par qui tant d’amis ont péri ! ton cou est une forteresse d’ivoire. Sans nouvelles de ma famille, angoissé à cause de l’attente continuelle dans laquelle on vit, du peu qu’on sait, du fait que l’on nous cache évidemment beaucoup, incapable de m’absorber souvent dans une oeuvre de longue haleine, je vais faire du paysage pour retrouver un peu de calme.
Voici par exemple une porte qui donne sur des ténèbres. Elle est assez semblable à celle de mes années d’enfer dans l’étude de maître Derieu, avoué à Saint-Quentin, avec sa plaque de cuivre qui disparaissait dans l’ombre quand on l’ouvrait sur une seconde porte à panneau vitré mais que l’obscurité habituelle rendait opaque. Ici je n’ai ouvert qu’une seule porte et je suis incapable d’ouvrir l’autre. Il faut que les mobilisés le fassent pour moi tandis que je prépare leur retour. Je me suis toujours méfié des discours politiques et je n’ai que trop souffert de leurs effets ; on trouvera cette hantise dans mes silences. »




 Version imprimable
Version imprimable











 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



3 Messages
" Matisse dans le coin de son appartement à Nice avec un de ses modèles habillés à la mode odalisque en 1927-1928."
Le traducteur de Google ne sombre pas encore dans le politiquement correct.
.
Une édition augmentée du livre de Marcelin Pleynet, Cézanne marginal (2006), paraîtra au printemps 2010 dans la collection « Folio ».
ce site est genial !je suis en option art et j’ai tout trouvé pour mon exposé !