
- Ph. Lançon au sortir de la remise du prix Femina 2018
© Manon Botticelli
« Le journaliste Philippe Lançon, rescapé de l’attentat de Charlie Hebdo, a livré le récit de sa reconstruction dans "Le lambeau". Ce roman a été couronné, ce 5 novembre peu avant 13 heures, par le prix Femina. L’auteur est venu à cette occasion, première apparition publique, devant des journalistes, depuis les attentats de 2015. Nous y étions. Et avons pu l’interroger. » Récit sur france info.
Philippe Lançon : « Mon père est mort le jour où je recevais les épreuves du livre (...) c’est à lui que je pense. »
Crédit Média : Bernard Lehut.

SOMMAIRE
 Philippe Lançon, Le lambeau
Philippe Lançon, Le lambeau

 Sollers parle du livre de Lançon et de... Shakespeare
Sollers parle du livre de Lançon et de... Shakespeare
 Philippe Lançon, miraculé de « Charlie Hebdo », raconte ce qu’il a vécu... Extraits
Philippe Lançon, miraculé de « Charlie Hebdo », raconte ce qu’il a vécu... Extraits

 Après « Charlie », le journal du deuil
Après « Charlie », le journal du deuil
 Philippe Lançon : « Désormais, Je est un autre »
Philippe Lançon : « Désormais, Je est un autre »
 Entretien avec Philippe Lançon
Entretien avec Philippe Lançon
ANNEXES
 Philippe Lançon, Sollers, lame à l’oeil
Philippe Lançon, Sollers, lame à l’oeil
 Philippe Lançon, « Je suis Charlie » : « Ce slogan a vite cessé de me convaincre »
Philippe Lançon, « Je suis Charlie » : « Ce slogan a vite cessé de me convaincre »
 Philippe Lançon, Tintoret, la sensation de Venise
Philippe Lançon, Tintoret, la sensation de Venise

Première mise en ligne le 12 avril 2018.

Philippe Lançon
Le lambeau
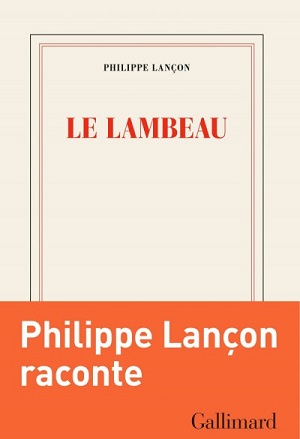 Collection Blanche, Gallimard
Collection Blanche, Gallimard
Parution : 12-04-2018
Lambeau, subst. masc.
1. Morceau d’étoffe, de papier, de matière souple, déchiré ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie.
2. Par analogie : morceau de chair ou de peau arrachée volontairement ou accidentellement. Lambeau sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le mordit à la joue, déchira un lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire (Borel, Champavert, 1833, p. 55).
3. Chirurgie : segment de parties molles conservées lors de l’amputation d’un membre pour recouvrir les parties osseuses et obtenir une cicatrice souple. Il ne restait plus après l’amputation qu’à rabattre le lambeau de chair sur la plaie, ainsi qu’une épaulette à plat (Zola, Débâcle, 1892, p. 338).
(Définitions extraites du Trésor de la Langue Française).
LIRE : « Charlie » : Lançon, penser les plaies
Sollers parle du livre
Le 29 mars 2018, invité sur RCJ par Josyane Savigneau, Sollers parle du livre de Philippe Lançon et de son émotion en lisant l’article de celui-ci sur Centre paru dans Charlie Hebdo [1].

L’antidote contre l’horreur : la féérie de Shakespeare.
« If music be the food of love, play on... »

Philippe Lançon, miraculé de « Charlie Hebdo », raconte ce qu’il a vécu depuis l’attentat
LE MONDE DES LIVRES | 11.04.2018 à 14h52

Le 20 janvier 2015, devant le siège de « Charlie Hebdo ».
CYRIL MARCILHACY/ITEM. Zoom : cliquez l’image.

Le chroniqueur Philippe Lançon, grièvement blessé au visage lors de l’attaque de l’hebdomadaire satirique « Charlie Hebdo » le 7 janvier 2015, publie Le Lambeau. « Le Monde des livres » dévoile en exclusivité cinq extraits de cet ouvrage magistral, brûlant journal de deuil.
« La nuit des rois », page 12. La veille, au théâtre
« Je suis devenu critique par hasard, je le suis resté par habitude et peut-être par insouciance. La critique m’a permis de penser – ou d’essayer de penser – ce que je voyais, et de lui donner une forme éphémère en l’écrivant. (…)
La critique me permet-elle de lutter contre l’oubli ? Bien sûr que non. J’ai vu bien des spectacles et lu bien des livres dont je ne me souviens pas, même après leur avoir consacré un article, sans doute parce qu’ils n’éveillaient aucune image, aucune émotion véritable. Pire : il m’arrive souvent d’oublier que j’ai écrit dessus. Quand par hasard l’un de ces articles fantômes remonte à la surface, je suis toujours un peu effrayé, comme s’il avait été écrit par un autre qui porterait mon nom, un usurpateur. Je me demande alors si je n’ai pas écrit pour oublier le plus vite possible ce que j’avais vu ou lu, comme ces gens qui tiennent leur journal pour débarrasser quotidiennement leur mémoire de ce qu’ils ont vécu. Je me le demandais, du moins, jusqu’au 7 janvier 2015.
Pendant la représentation, j’ai sorti mon carnet. Le dernier mot que j’ai noté ce soir-là, dans le noir et de travers, est de Shakespeare : “Rien de ce qui est n’est.” Le suivant est en espagnol, en lettres beaucoup plus grosses et tout aussi incertaines. Il a été écrit trois jours plus tard dans un autre type d’obscurité, à l’hôpital. Il est adressé à Gabriela, mon amie chilienne, la femme dont j’étais amoureux : “Hable con el medico. Un año para recuperar. ¡ Paciencia !” [“J’ai parlé au médecin. Un an pour récupérer. Patience !”] Un an pour récupérer ? Rien de ce qu’on vous dit n’est, quand vous entrez dans le monde où ce qui est ne peut plus être vraiment dit. »
« Tapis volant », pages 27-28. Ce matin-là
« Je suis toujours agacé par les écrivains qui disent écrire chaque phrase comme si c’était la dernière de leur vie. C’est accorder trop d’importance à l’œuvre, ou trop peu à la vie. Ce que j’ignorais, c’est que l’attentat allait me faire vivre chaque minute comme si c’était la dernière ligne : oublier le moins possible devient essentiel quand on devient brutalement étranger à ce qu’on a vécu, quand on se sent fuir de partout. J’en suis donc venu à penser à peu près la même chose que ceux qui m’agaçaient, même si c’est pour des raisons et dans des circonstances différentes : il faudrait noter les plus petits détails de ce qu’on vit, la moindre des choses moindres, comme si on allait mourir dans la minute qui suit ou changer de planète – la suivante n’étant pas plus hospitalière que celle qu’on a quittée. Ce serait utile pour le voyage, et comme un souvenir pour les survivants ; plus utile encore pour les revenants, ceux qui, n’étant pas plus morts que les autres, sont allés suffisamment loin ailleurs pour n’être plus tout à fait de retour ici, dans le monde où chacun continue de vaquer à ses occupations comme si la répétition des jours et des gestes avait un sens linéaire, établi, comme si ce théâtre était une mission. Les revenants liraient leurs notes, regarderaient vivre les autres, frotteraient leurs souvenirs et leurs vies. Ils compareraient le tout dans l’étincelle produite et, en s’y réchauffant, ils se rappelleraient peut-être qu’un jour ils ont vécu. (…)
Ce ne serait pas exactement Les Choses de la vie, ce film de Claude Sautet où le héros revoit les moments importants de son existence tandis que dans un accident il va la perdre. Non, il ne s’agirait pas de noter les choses essentielles, les grandes étapes, cela c’est une perspective d’homme vivant et bien portant. Il n’y aurait d’abord que les toutes petites choses, celles des dernières minutes, les toutes petites cendres de la dernière cigarette du condamné, celui qui ne sait pas encore que la sentence est prononcée et que le bourreau est en route, avec armes et bagages dans le coffre d’une voiture volée. Evidemment, je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas pris ces notes sur les heures qui ont précédé l’apparition des tueurs, puisque c’était une matinée comme les autres, mais j’ai l’impression que quelqu’un l’a fait pour moi, un farceur qui s’est fait la malle et que j’essaie, en écrivant, de coincer. »
Page 48
« Quand je suis arrivé, la conférence avait commencé. J’ai voulu prendre un exemplaire de l’édition du jour, mais il n’y en avait plus, et je me suis de nouveau énervé. Je suis rentré en râlant dans la salle où tout le monde était assis. Une place m’attendait au fond, entre Bernard Maris et Honoré. Je me rappelle avoir plus ou moins dit : “C’est quand même incroyable qu’il n’y ait pas assez d’exemplaires du journal pour chacun de nous le jour où il est publié et où nous devons en parler.” Charb a eu un sourire ironique et bienveillant qui signifiait : “Tiens, Lançon fait son caca nerveux !” Honoré, avec sa gentillesse habituelle, a sorti de son sac l’un de ses deux exemplaires et me l’a donné. Nous étions une bande de copains plus ou moins proches dans un petit journal désormais fauché, presque mort. Nous le savions, mais nous étions libres. Nous étions là pour nous amuser, nous engueuler, ne pas prendre au sérieux un monde désespérant. J’ai eu honte de ma réaction et j’ai regardé la “une”. Luz, en retard ce matin-là, l’avait dessinée. On voyait Houellebecq en demi-clochard blafard et allumé, clope à la main, nez d’ivrogne et bonnet étoilé sur la tête, genre lendemain de fête trop et mal arrosée. Au-dessus, cette inscription : “Les prédictions du mage Houellebecq”. Au-dessous, les prédictions : “En 2015, je perds mes dents… En 2022, je fais ramadan !” Il avait tout prévu, vraiment, sauf l’attentat.”
« La conférence », page 50. Juste avant l’attaque
« Pourquoi étais-je toujours en retard à la conférence, moi qui ne le suis presque jamais ? Il y avait une sorte de brioche devant Cabu. Wolinski dessinait sur son carnet tout en regardant d’un air amusé tel ou tel intervenant. En général, il dessinait plutôt une femme, plutôt nue, aux rondeurs plutôt minces, et il lui faisait dire quelque chose de drôle, d’inattendu, d’absurde, qui lui avait été inspiré par ce que venait de dire quelqu’un qui, drôle, l’était moins. (…)
J’insiste, lecteur : ce matin-là comme les autres, l’humour, l’apostrophe et une forme théâtrale d’indignation étaient les juges et les éclaireurs, les bons et les mauvais génies, dans une tradition bien française qui valait ce qu’elle valait, mais dont la suite allait montrer que l’essentiel du monde lui était étranger. J’avais mis du temps à me débarrasser de mon esprit de sérieux pour l’accepter, et je n’y étais d’ailleurs pas tout à fait parvenu. Je n’avais pas été programmé pour le comprendre, et puis, comme la plupart des journalistes, j’étais un bourgeois. Autour de cette table, il y avait des artistes et des militants, mais il y avait peu de journalistes et encore moins de bourgeois. Bernard Maris était sans doute resté à Charlie, ces dernières années, pour la même raison que moi : parce qu’il s’y sentait libre et insouciant. Raconter n’importe quoi sur tel écrivain ou tel événement était sans importance, du moment que ça conduisait à quelque chose qui le métamorphosait : une idée, une blague ou un dessin. Les mots couraient comme des chiens affamés d’une bouche et d’un corps à l’autre. Dans le meilleur des cas, ils trouvaient une proie. Dans le pire, ils se perdaient et on les oubliait entre un gobelet vide et un papier plus ou moins gras. Les gens que leur compétence obsède écrivent des articles rigoureux, certes, mais ils finissent par manquer d’imagination. Ici, on disait ou l’on criait beaucoup de choses vagues, fausses, banales, idiotes, spontanées, on les disait comme on se dérouille le corps, mais, quand la sauce prenait, l’imagination suivait. Elle avait assez de mauvais goût pour ne nous épargner aucune de ses conséquences. »
« L’attentat », pages 77-78. Le temps haché par les balles
« Mais déjà la suite était là. J’entendais de mieux en mieux le bruit sec des balles une par une et, après m’être recroquevillé, ne voyant plus rien ni personne, coincé comme au fond d’un caisson, je me suis agenouillé puis allongé doucement, presque avec soin, comme pour une répétition, en pensant que je ne devais pas, en plus du reste – mais quel reste ? – me faire mal en tombant. C’est sans doute dans ce mouvement par palier vers le sol que j’ai été touché, à trois reprises au moins, légèrement à distance, directement ou par balles perdues. Je n’ai rien senti et n’en ai pas pris conscience. Je me croyais indemne. Non, pas indemne. L’idée de blessure n’avait pas encore fait son chemin jusqu’à moi. J’étais maintenant à terre, sur le ventre, les yeux pas encore fermés, quand j’ai entendu le bruit des balles sortir tout à fait de la farce, de l’enfance, du dessin, et se rapprocher du caisson ou du rêve dans lequel je me trouvais. Il n’y avait pas de rafales. Celui qui avançait vers le fond de la pièce et vers moi tirait une balle et disait : “Allah akbar !” Il tirait une autre balle et répétait : “Allah akbar !” Il tirait encore une autre balle et répétait encore : “Allah akbar !” Avec ces mots, l’impression de vivre une farce est une dernière fois revenue pour se superposer à celle de vivre cette chose qui m’avait fait voir et revoir Franck [Brinsolaro, le garde du corps de Charb] dégainer quelques secondes plus tôt, quelques secondes mais déjà beaucoup plus, car le temps était haché par chaque pas, chaque balle, chaque “Allah akbar !”, la seconde suivante chassant la précédente et la renvoyant dans un lointain passé et même très au-delà, dans un monde qui n’existait plus. (…)
Il y a eu encore des balles, des secondes, des “Allah akbar !” Tout était à la fois brumeux, précis et détaché. Mon corps était allongé dans l’étroit passage entre la table de conférence et le mur du fond ; ma tête, tournée vers la gauche. J’ai ouvert un œil et vu apparaître, sous la table, de l’autre côté, près du corps de Bernard, deux jambes noires et un bout de fusil qui flottaient plus qu’ils n’avançaient. J’ai fermé les yeux, puis je les ai de nouveau ouverts, comme un enfant qui croit que nul ne le verra s’il fait le mort ; car je faisais le mort. »
« Entre les morts », pages 84-86. Celui d’avant et moi-même
« J’étais couché sur le ventre, la tête tournée vers la gauche, c’est donc l’œil gauche que j’ai ouvert en premier. J’ai vu une main gauche ensanglantée sortant de la manche de mon caban, et il m’a fallu une seconde pour comprendre que cette main était la mienne, une nouvelle main, taillée sur le dos et découvrant sa blessure entre deux articulations dites métacarpo-phalangiennes, celles de l’index et du majeur. Ce sont des mots que j’ai appris ensuite, parce qu’il m’a fallu apprendre à nommer les parties du corps blessées, les soins qu’on leur apportait et les phénomènes secondaires qui s’y développaient. Les nommer, c’était les apprivoiser et pouvoir vivre un peu mieux, ou un peu moins mal, avec ce qu’ils désignaient. L’hôpital est un lieu où chacun, en paroles comme en actes, a pour mission d’être précis.
La voix de celui que j’étais encore m’a dit : “Tiens, nous sommes touchés à la main. Pourtant, nous ne sentons rien.” Nous étions deux, lui et moi, lui sous moi plus exactement, moi lévitant par-dessus, lui s’adressant à moi par-dessous en disant nous. L’œil est passé sur la main et il a vu au-delà, à un mètre, le corps d’un homme allongé sur le ventre dont j’ai reconnu la veste à carreaux et qui ne bougeait pas. Il est remonté jusqu’au crâne et il a vu entre ses cheveux la cervelle de cet homme, de ce collègue, de cet ami, qui sortait un peu du crâne. Bernard est mort, m’a dit celui que j’étais, et j’ai répondu, oui, il est mort, et nous nous sommes unis sur lui, sur le point de sortie de cette cervelle que j’aurais voulu remettre à l’intérieur du crâne et dont je n’arrivais plus à me détacher, car c’est par elle, à ce moment-là, que j’ai enfin senti, compris, que quelque chose d’irréversible avait eu lieu.
Combien de temps ai-je regardé la cervelle de Bernard ? Assez longtemps pour qu’elle devienne une partie de moi-même. J’ai dû faire un effort pour m’en détourner et tourner la tête vers l’autre côté, vers mon autre bras. Ce fut très lent. Je ne crois pas que nous étions d’accord, celui d’avant et moi-même, sur la nécessité et la nature de ce mouvement. Il y avait débat. Celui d’avant ne voulait pas découvrir les conséquences de ce qui avait eu lieu, il était assez sage pour deviner que les mauvaises nouvelles peuvent attendre lorsque les bonnes ne viennent pas les tempérer, mais il était bien obligé de suivre celui qui les vivait, il n’avait pas la main, il s’éteignait peu à peu sans le savoir dans la conscience nouvelle qui, comme d’un sommeil confondu avec l’existence, émergeait.
J’ai tourné la tête très lentement, de nouveau comme si le tueur était là : comme un enfant qui continue de faire le mort après le départ des méchants qui le cherchent et qui ne peut s’empêcher de regarder à travers ses doigts ce que, s’il était mort comme il feint de l’être, il ne pourrait voir : les morts autour de lui, après l’attaque.
J’ai vu devant moi les jambes d’un homme qui ne bougeait pas et que j’ai cru mort, lui aussi, alors qu’il ne l’était pas : c’était Fabrice [Nicolino, journaliste]. Comme moi jusque-là, il faisait sans doute le mort ou il attendait le coup de grâce, ou il flottait dans cet espace qui n’était pas encore tout à fait un univers de douleur. Ma tête a continué de tourner et elle s’est posée doucement sur la joue gauche. J’ai vu que la manche du caban de mon autre bras, le droit, était déchirée, puis j’ai vu l’avant-bras fendu du coude au poignet. « Comme par un poignard », a dit celui qui n’était pas tout à fait mort, et il a vu un poignard à la Rambo, long, dentelé, bien aiguisé. (…) J’ai tourné la langue dans ma bouche et j’ai senti des morceaux de dents qui flottaient un peu partout. Après quelques secondes de panique, celui qui n’était pas tout à fait mort a pensé, « Tu as la bouche pleine d’osselets », et il a revu toute son enfance à travers les parties d’osselets, jouées dans des chambres ou dans des tas de poussière. Puis les dents ont remplacé les osselets, chacune avait son histoire liée depuis vingt-cinq ans à mon dentiste, nous avions vieilli ensemble et, ai-je pensé, il avait fait tout ce boulot pour rien. La panique est revenue et j’ai préféré tout oublier, les osselets, les dents, le dentiste, parce que je n’étais pas assez vivant pour retomber tout à fait en enfance ou dans ma jeunesse, dans la vie qu’on mord à pleines dents, expression qui prenait un sens comique au moment où je perdais les unes en ayant failli perdre l’autre, pas assez vivant ni assez mort pour affronter ce qui m’attendait. »
Autre extrait.
L’art de la fugue
p. 389-392.

Nous échangions depuis quelque temps des disques avec Hossein, et, une fois installé sous la couverture chauffante, je l’ai vu s’approcher et me montrer un CD d’un pianiste américain, Richard Buhlig : c’était L’’Art de la fugue, que j’écoutais de plus en plus souvent dans la chambre et dans une version de la pianiste chinoise Zhu Xiao-Mei. Hossein m’a dit : « J’ai pensé que vous ne la connaissiez peut-être pas cette interprétation », et il avait raison. Puis il m’a expliqué ce qu’il allait faire en m’indiquant une sorte de râpe perfectionnée, le dermatome. Grâce à elle, il allait prélever une fine tranche d’épiderme sur la cuisse droite, pas plus épaisse que la plus fine des tranches de mortadelle, juste à côté de celle qui avait été prélevée pour la grande greffe :« Comme ça, m’a-t-il dit, on laisse l’autre cuisse intacte. » L’idée que certaines parties de mon corps puissent échapper aux cicatrices me paraissait maintenant presque incongrue, et j’ai eu un bref moment de soulagement. Une partie de la tranche de peau serait ensuite plaquée et cousue sur la zone de greffe, sous la lèvre. C’était une greffe dite de peau mince. Il en existe en profondeur, mais cela, c’était pour plus tard, quand celle-ci aurait échoué. Les explications étaient données, L’opération pouvait commencer.
Hossein a installé le CD dans un lecteur. Tandis qu’on désinfectait et anesthésiait la cuisse droite, les premières notes, si lentes, du premier contrepoint sont passées entre les bonnets des infirmières pour entrer une à une, comme les gouttes d’un début de pluie, dans l’oreille. Ré, la, fa, ré, do dièse, ré, mi, fa, fa, sol, fa, mi, ré. C’était une musique d’hiver, c’était l’hiver, ma vie était en hiver. Le son du vieil enregistrement se déposait sur la salle et sur mon corps. J’ai senti les piqûres et me suis concentré sur la musique de cet homme, Bach, dont j’avais chaque jour un peu plus l’impression qu’il m’avait sauvé la vie. Comme chez Kafka, la puissance rejoignait la modestie, mais ce n’était pas la culpabilité qui l’animait : c’était la confiance en un dieu qui donnait à ce caractère coléreux le génie et la paix. Hossein a approché le dermatome de la cuisse, j’ai fermé les yeux et cherché à entrer dans la fugue qui développait maintenant ses différentes lignes en obtenant ce miracle : plus c’était complexe, plus ça me simplifiait. J’ai senti une légère brûlure. Le paysage se dégageait. Les contrepoints se succédaient et Hossein s’est mis à travailler sur le visage qu’il avait anesthésié. L’anesthésie locale, sur le visage, est un paradoxe encore plus affirmé qu’ailleurs. Je sentais violemment tout ce dont je ne souffrais pas encore. La peau qu’on plaque et qu’on tire, la lèvre qu’on étire, le mouvement des tissus et pour finir l’aiguille plantée et replantée par Hossein pour effectuer la suture. Comme la sensation ne correspondait à aucune douleur, la perception de mon visage était une fois de plus désorientée. L’imagination prenait le relais des nerfs endormis, comme pour tirer les conclusions les plus folles d’une phrase inachevée. Le moindre geste ressemblait à la secousse d’un glissement de terrain, mais sans morts ni blessés, juste avec le tremblement et la panique. Je me suis alors reconcentré sur la fugue. Je cherchais à entrer dedans, à devenir cette fugue, pour échapper aux variations de mon imagination. Pas question de m’agiter ou de me plaindre en présence de Bach ni, d’ailleurs, en celle d’Hossein. Au contraire, maintenant que le second semblait me déchirer la lèvre pour l’amener vers la droite jusqu’au-delà du bloc, comme on tire l’oreille d’un garnement, je devais mettre des sensations aussi aveugles qu’intenses au service de l’écoute du premier, et c’est ce que je fis tandis que, faute d’anesthésie suffisante, la douleur pointait le bout du nez : j’ai fait signe à Hossein et une nouvelle piqûre l’a éloignée. Je suis reparti dans la fugue et je n’en suis sorti que pour remonter.
Une fois dans la chambre, je l’ai réécoutée. Pendant que j’étais au bloc, Gabriela m’avait de nouveau écrit. Son mail était si violent que je n’ai pas répondu. J’étais fatigué. J’en ai parlé à mon frère, qui m’a proposé de lui écrire pour lui rappeler que je n’avais pas été victime d’un « petit. accident de voiture », puisqu’elle semblait l’avoir oublié. Je lui ai répondu de n’en rien faire, que c’était sans importance et qu’elle s’était déjà probablement calmée. Elle était seule, déstabilisée, étouffée par la culpabilité : sur qui d’autre que moi aurait-elle pu décharger sa peine et sa colère ? Qu’elle le fasse au moment même où je remontais d’un bloc ne pouvait que m’éloigner de ce bloc, du moins pour quelques instants, et Gabriela et son mail et l’idée d’y répondre ont disparu tandis que Bach refaisait le vide, puis le plein. Sur ma peau, les pansements ne tenaient plus. Hossein m’avait conseillé, au moment où le brancardier m’emportait, de la dégraisser avec du benjoin.J’ai demandé à mon frère d’en trouver et je me suis endormi, jusqu’à ce que me réveille l’une de ces toux pénibles et récurrentes, dues à la trach’. Deux infirmières sont entrées et ont fini par expulser deux bouchons. J’étais en sueur, liquidé, une fois encore j ’ai remis L’Art de la fugue.
Après « Charlie », le journal du deuil
Par Jean Birnbaum
Philippe Lançon, miraculé de l’attentat contre « Charlie Hebdo », raconte dans « Le Lambeau » ce qu’il a vécu depuis janvier 2015. Magistral.
Au matin du 7 janvier 2015, peu de temps avant de se trouver collé au sol, la tête dans une mare de sang, Philippe Lançon était assis chez lui. Il écrivait un e-mail à Claire Devarrieux, qui dirige le service « Livres » au quotidien Libération. Dans ce message, le critique littéraire raillait les « bavardages » de ses confrères à propos de Michel Houellebecq, dont le nouveau roman, Soumission, sortait le jour même, et avec lequel il avait rendez-vous à la fin de la semaine. « Cela laisse du champ, samedi, pour un entretien que j’espère plus raisonnable et précis », se félicitait-il. Trois ans ont passé et Lançon y revient aujourd’hui sans grande fierté : « Ces phrases anodines, plutôt méprisantes et non dépourvues d’autosatisfaction, je les ai écrites comme si la vie allait continuer (…). Ce sont les derniers mots d’un journaliste ordinaire et d’un inconscient », note-t-il dans Le Lambeau, livre magistral, brûlant journal de deuil.
Vérité physiologique
Brûlant ? Magistral ? Nous écrivons ces mots et déjà la honte rôde. Ce texte revenu d’entre les morts, allons-nous le traiter depuis l’autre rive, dans les termes et selon les usages du journaliste ordinaire, cet inconscient dont la vie, elle, a continué ? Cela s’annonçait possible, puisque, en apparence, rien n’avait changé : nous avons vu Teresa Cremisi, l’éditrice de Philippe Lançon, qui nous a remis les épreuves du Lambeau ; nous avons appelé Pascale Richard, son attachée de presse chez Gallimard, pour lui dire notre souhait de publier les bonnes feuilles ; nous avons collectivement décidé d’en faire la « une » et fixé une date de parution. Tout s’est passé comme si l’auteur appartenait encore à notre monde ordinaire, celui des vivants rivés à leur fausse sécurité, à leur sotte insouciance. Et pourtant, à mesure que nous avancions dans le livre, il devenait clair que la frivolité n’avait aucune place : les ponts étaient coupés.
pas tout à fait mort » devra cohabiter
avec « celui qui allait devoir survivre »
Le Lambeau décrit cette béance. Sous la plume de Lançon, la rupture avec le vieux monde n’est ni une pensée ni un slogan. Elle s’impose d’emblée comme une vérité physiologique, surgie en deçà du langage, essaim de sensations à même la chair. C’est le corps, cet autre moi en moi, qui est au poste de commande et trace les nouvelles lignes de front. Il y a quelques secondes encore, le chroniqueur Philippe Lançon blaguait avec ses camarades dans les locaux sinistres d’un journal appauvri, Charlie Hebdo. Le voilà maintenant allongé au milieu des morts amis, la gueule cassée et la conscience séparée : désormais, « celui qui n’était pas tout à fait mort » devra cohabiter avec « celui qui allait devoir survivre ».
Commence alors le récit de ce face-à-face qui met en ruine la vie d’avant – habitudes, rêves, amours, idées. Parce que le seul parti encore ouvert, pour Lançon, est celui de l’absolue sincérité, ce face-à-face avec lui-même sera tout sauf une partie de cache-cache. Il ne s’agit pas de minauder, mais de faire front. Avec les moyens du bord, c’est-à-dire avec les armes de la critique, cet exercice de lecture qui est également, quand il se respecte, un art du tranchant.
Si bien qu’entre le Lançon vivant et le Lançon revenant, le lien est assuré par les livres élus, les textes sauveurs, ceux qui volent à la rescousse parce qu’on les a choisis. Là encore, cela n’a rien d’abstrait. Tout juste défiguré par les frères Kouachi, et alors qu’il découvre autour de lui les cadavres de ses compagnons, celui qui devra survivre se cramponne aux livres tant chéris, il y a peu, par celui qui n’est pas vraiment mort : « J’ai tendu un bras vers mon sac à dos, qui traînait par terre à quelques centimètres, et je l’ai collé contre moi comme une petite vieille dame inquiète. Dedans, il y avait mes papiers et mes livres, il y avait donc ma vie à cet instant. »
La grand-mère de Proust
Quatre cents pages et de multiples opérations plus loin, la reconstruction de son visage coïncidera avec la construction d’une bibliothèque dans l’appartement qu’il avait quitté au matin du 7 janvier : « La nouvelle bibliothèque donnait une seconde vie aux milliers de livres que vingt ans de foutoir avaient dévorés et dont j’avais oublié l’existence. Ils réapparaissaient comme des vieux amis au coin d’une rue, sans m’effaroucher. Ils étaient silencieux, patients. Ce que j’avais vécu ne pouvait que nourrir les vies qu’ils m’offraient. » Entre-temps, chaque instant où se débat la vie, la vie survivante, aura été traversé grâce à la poésie de Baudelaire, aux lettres de Kafka ou aux romans de Proust.
Avant de descendre au bloc opératoire, le revenant aime lire les passages de La Recherche où le narrateur raconte la mort de sa grand-mère. Suspendu à ces lignes, Philippe Lançon renoue avec ses souvenirs de jeunesse et rend hommage à ses propres aïeules, notamment à sa mamie Marguerite, cet autre visage effacé, qui dut subir de nombreuses opérations maxillo-faciales après un accident de voiture, en 1940. On ne peut pas lire ces pages, comme toutes celles que Lançon consacre à son frère, aux policiers ou aux infirmières qui veillent sur lui, sans être envahi par des sursauts de vérité. La littérature coïncide avec un cri. Roland Barthes l’affirmait dans un texte consacré, on y revient toujours, à la mort de la grand-mère chez Proust : ici, les enjeux autobiographiques font du narrateur « le lieu d’une réflexion souveraine sur le monde, l’amour, l’art, le temps, la mort ».
De la même manière, Philippe Lançon hisse chaque évocation intime au niveau d’une méditation universelle sur notre temps, nos existences, nos aveuglements : sa renaissance exige une nouvelle pratique d’écriture ; sa plume nous en met plein la gueule ; son visage défait exhibe tout ce que nous ne voulons pas regarder en face ; sa lucidité est une fidélité à l’enfant qu’il fut ; ses souvenirs d’enfance ressemblent déjà à nos souvenirs de guerre.
Le Monde des livres, 11 avril 2018.
Philippe Lançon après "Charlie Hebdo" :
"Mon corps entier s’est réfugié dans ma mâchoire"
Par Jérôme Garcin
Publié le 11 avril 2018 à 13h14
EXCLUSIF. Gravement blessé, le 7 janvier 2015, le journaliste-écrivain Philippe Lançon raconte, dans un livre capital, comment sa vie a basculé. Rencontre chez lui, à Paris.
Il venait de voir au théâtre « la Nuit des rois » et de signer, dans « Libé », un article sur « Soumission », de Michel Houellebecq. Il s’apprêtait, une fois encore, à partir enseigner la littérature française aux étudiants américains de Princeton. Il entretenait une liaison avec Gabriela, une femme chilienne et mariée qui vivait à New York. Philippe Lançon avait 51 ans et la vie devant lui lorsque, le 7 janvier 2015, rue Nicolas-Appert, les frères Kouachi ont assassiné « Charlie Hebdo », « ce petit journal qui ne faisait de mal à personne ». Douze victimes, dont neuf membres de la rédaction.

Dans la rue de l’ancien siège du journal, une fresque murale en hommage à
Bernard Maris, Georges Wolinski, Tignous, Charb et Cabu, victimes de la tuerie.
(Chistophe Archambault/AFP). Zoom : cliquez l’image.

Philippe Lançon, qui assistait à la conférence du journal, tombe lui aussi sous les balles, qui lui arrachent la mâchoire. Pendant la fusillade, écrit-il, « je faisais le mort ». Quand il ouvre un œil après le carnage, il voit ses amis morts se tenir « presque par la main », la cervelle sortie du crâne de Bernard Maris et, sur l’écran de son téléphone portable, le reflet de son propre visage défiguré, comme « par une main de peintre enfantin ».
Le pompier qui va le transporter prononce le verdict sans appel : « Blessure de guerre ». Cette scène d’apocalypse, Philippe Lançon la raconte et donc la revit, seconde après seconde, dans un livre magnifique et insoutenable, une manière d’oratorio de l’horreur. Il sait en effet que, pour rejoindre la rive des vivants, il doit aujourd’hui exercer sa mémoire et décrire au plus près, sans tricher, tout ce qui lui est arrivé.
Non seulement l’enfer de l’attentat, mais aussi l’enfer de la reconstruction. Car, entre janvier et novembre 2015, pas moins de dix-sept opérations ont été nécessaires, à la Pitié-Salpêtrière, pour que Philippe Lançon, gueule cassée de la grande guerre moderne soignée ensuite aux Invalides, puisse à nouveau parler, manger, boire, recouvrer le plein usage de son corps et le bas de son visage : « Ma mâchoire inférieure ayant disparu, on avait greffé à la place mon péroné droit, accompagné d’une veine et d’un bout de peau de jambe qui, sous le nom de palette, me tenait lieu de menton. »
Livre de la réparation et de la résilience, autoportrait chirurgical, « le Lambeau » est aussi un défi à la littérature : comment en être sans en faire ? Porté par les pages de Proust et de Kafka, rythmé par les « Variations Goldberg » jouées par Glenn Gould, augmenté par les statues bouddhistes aux cents bras du Musée Guimet, Philippe Lançon réussit pourtant l’impossible : il fait de son calvaire un traité de sagesse et de sa tragédie, une œuvre d’art.

Dans les locaux de « Charlie » en 2006.
De gauche à droite : Catherine Meurisse, Jul, Cabu, Tignous, Charb, Honoré (derrière) et Riss.
(Joël Saget/AFP). Zoom : cliquez l’image.

Cet appartement où vous viviez depuis vingt-cinq ans et me recevez aujourd’hui, vous y êtes retourné pour la première fois, en coup de vent, escorté par des policiers, le 19 avril 2015. Vous écrivez que vous n’en aviez aucune envie, que vous aviez peur et vous ajoutez : « J’ai senti que si je revenais bientôt vivre ici, ce serait bref, car je commencerais par me jeter par la fenêtre. » A quel moment avez-vous pu enfin vous réinstaller chez vous ?
Pardon pour le pléonasme, mais j’ai commencé à pouvoir y revivre en y revivant. Ça a été progressif. J’ai commencé à y faire de brèves incursions une fois que, en septembre 2015, l’appartement a été remis à neuf et que les bibliothèques en bois finissaient d’être construites. Je quittais ma chambre des Invalides pour venir ici, en général le week-end. J’étais rassuré par la présence de voisins bienveillants et troublé de marcher dans un quartier dont j’avais l’impression qu’il avait presque totalement changé, alors qu’il avait seulement un peu changé.
Il faut comprendre que tout ce que je vivais relevait pour moi de la fiction. Je me promenais, tel un acteur, dans un décor plaqué sur le quartier où j’avais vécu. Et c’est en réapprenant les gestes du rôle que je croyais jouer que, petit à petit, je suis revenu à la vie. A partir de la mi-octobre, je me suis réinstallé complètement chez moi. Je me suis repris en main, j’ai réappris à vivre seul, sans gardes du corps ni aides-soignants. Cela faisait partie de ma rééducation.
A la Salpêtrière, vous notez : « Je ne souffrais pas, j’étais la souffrance. Vivre à l’intérieur de la souffrance, ne plus être déterminé que par elle, ce n’est pas souffrir ; c’est autre chose, une modification complète de l’être. » Trois ans après, vivez-vous toujours à l’intérieur de la souffrance ?
Oui, la souffrance est toujours là, mais je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Quand on vit avec les sensations qui sont les miennes, et qui évoluent dans le bon sens, on s’habitue à ces sensations. Je ne suis même plus capable de définir des sensations dites normales. Qu’est-ce qui différencie la souffrance de l’incommodité ? Je ne sais pas, je ne sais plus.
La seule chose que je sache, c’est que les moments d’angoisse, d’inquiétude, de fatigue se reportent aussitôt sur la mâchoire. Même si la plupart de ses nerfs n’existent plus, elle est devenue mon centre nerveux. Mon corps entier, autrefois aguerri par le sport, s’est désormais réfugié dans ma mâchoire.
Vous écrivez avoir renoncé à retrouver votre visage d’avant vos 50 ans, êtes-vous parvenu à vous accommoder du nouveau ?
Oui, je m’en accommode très bien. Au moment où j’étais le plus défiguré, j’avais d’autres soucis, j’étais tout à ma réparation. Ensuite, j’ai acquis une vision technique de mon visage qui est due au fait que je dois faire chaque jour une heure d’exercices devant un miroir. J’ai donc un regard de soignant sur mon propre visage. Je ne me vois plus. Je ne me regarde pas comme la sorcière de Blanche-Neige pour me demander si je suis le plus beau ou le plus laid, mais pour savoir si je fais correctement mes exercices, si j’arrive à bien remonter la lèvre, si j’articule les syllabes comme il le faut. Et quand je tombe sur des photos de moi avant, je vois bien que ce n’est plus moi. Je vois un étranger. Désormais, Je est vraiment un autre.
De votre chirurgienne, Chloé, vous dites : « Elle a pris une importance démesurée dans ma vie. » Est-ce encore le cas ?
C’est toujours ma chirurgienne référente. Un peu moins actuellement car les opérations en cours sont surtout de l’implantologie, mais elle sait qu’elle va devoir encore intervenir et elle sait qu’elle figure en sauveuse dans mon livre.
"Ecrire fut la seule manière de regrouper mes forces"
C’est une question terrible, mais je la pose au critique littéraire : pensez-vous qu’il faille vivre une tragédie pour écrire un grand livre ?
Je ne sais pas ce que vaut mon livre, je sais seulement que j’ai fait du mieux et le plus précisément possible. Ecrire et lire ont toujours été ma vie. Or ma vie a été totalement bouleversée par un attentat, dont j’ai eu la chance de réchapper. Après, même si j’étais à l’hôpital comme Jonas dans sa baleine, écrire et lire restaient ma vie. Et écrire sur ce que j’avais vécu était, une fois sorti du cycle chirurgical le plus intense, la seule manière de regrouper toutes mes forces.
Vous auriez pu vous contenter de réunir vos chroniques post-attentat de « Charlie Hebdo »...
Oui, tous les éditeurs me les ont demandées dès 2015, mais j’ai refusé. Elles étaient trop proches du drame. Il me fallait un projet plus distancé, et beaucoup plus intime : c’est ce livre, que j’ai écrit deux ans après, alors que j’avais le sentiment d’exister à nouveau, et où je m’interroge sur la mémoire que j’ai de l’attentat. Dans un premier temps, c’était en 2016, à New York, je faisais fausse route : j’étais dans la littérature. C’était trop dur à raconter, et je n’arrivais pas à être simple. J’ai découvert alors que le talent qu’on a pour écrire peut devenir son pire ennemi. J’abusais des figures de style, des métaphores, des périphrases, des moulures, de tout ce qui m’évitait de regarder les choses en face.
Maintenant, pour répondre à votre question, il suffit de citer tous les chefs-d’œuvre conçus par des écrivains dans la vie desquels il ne s’est presque rien passé. Le meilleur exemple, c’est Proust et sa « Recherche ». Et le meilleur contre-exemple, le Primo Levi de « Si c’est un homme »...
Comment avez-vous pu écrire les soixante pages de la scène de l’attentat ?
Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que je l’ai revécue telle que je l’avais vécue, en me dédoublant. Il y avait réellement une partie de moi qui était détachée de moi et qui voyait la scène qui avait lieu au moment même où je la vivais. Il y avait l’homme qui tombe et l’homme qui regarde l’homme qui tombe. L’homme qui ouvre un œil pour voir les jambes du tueur s’approcher et l’homme qui voit l’homme ouvrir un œil pour voir les jambes du tueur s’approcher.
Tout le travail de l’écriture consiste à exercer sa mémoire sans cacher pour autant les flottements de la mémoire. Il y a en effet des choses que je ne sais pas : un des moments pour moi les plus saisissants, qui s’est déroulé un an et demi après l’attentat, c’est quand je suis allé voir les rapports que les policiers ont rédigés sur la scène du crime. En lisant la description objective de cette scène, avec la mention par exemple de mon bonnet près du corps de Bernard Maris, j’ai cru que j’allais avoir un arrêt cardiaque.
"Cet attentat a transformé ma vie en destin"
Un jour, alors qu’elle est à vos côtés à la Salpêtrière, votre amie Gabriela s’emporte contre vous : « Tu te prends pour un roi ! Tu te complais dans ta douleur et ta notoriété. » Un peu plus tard, dans l’ambulance qui vous conduit aux Invalides, vous avez l’impression d’être « un pharaon qu’on met dans son tombeau ». Les Invalides, où vous recevez vos visiteurs « en châtelain, en vieux noble ». Et, page 438, vous écrivez : « On s’habitue vite aux mesures qui nous rendent exceptionnels. On finirait par croire qu’on les mérite. La vanité adoucit l’incommodité [...] et j’étais orgueilleux. » L’orgueil a-t-il participé de votre reconstruction ?
Quand j’étais beaucoup plus jeune, j’ai lu passionnément les « Vies parallèles des hommes illustres » de Plutarque et plus les vies des Romains que celles des Grecs. Ces Romains, qui étaient souvent corrompus et que les actes immoraux conduiraient aujourd’hui dans un cul de basse fosse, avaient pour la plupart l’orgueil de leur destin. Or cet attentat a transformé ma vie en destin. Il faut être alors à la hauteur de ce destin. Car ça n’engage pas que soi-même. Ça engage tous ceux qui vous aident, les soignants, les amis, les policiers protecteurs.
Pour tous comme pour moi, il était capital que je m’en sorte par le haut. Et là, le stoïcisme n’est pas un mot vain. Lorsque je suis arrivé, pour ma rééducation, aux Invalides, il fallait que je devienne celui que je devais être, c’est-à-dire le meilleur possible, très bienveillant, beaucoup plus à l’écoute que je ne le suis ordinairement, et jamais dans la plainte.
On peut aussi lire « le Lambeau » comme une ode à la littérature, avec l’omniprésence de Proust (la « Recherche »), de Thomas Mann (« la Montagne magique ») et de Kafka (« Lettres à Milena »), à la musique, surtout celle de Bach dont vous tenez qu’elle soulage comme la morphine, et aux tableaux, dont ceux de Velasquez, que, vous échappant des Invalides, vous allez voir au Grand-Palais. Jamais on n’a mieux senti combien les écrivains et les artistes pouvaient être, aux pires moments, ces « alliés substantiels » dont parlait René Char.
Ils étaient en effet des agents dormants que l’événement a réveillés. Bach et Kafka m’ont été essentiels : ils rendent modestes par rapport à l’expérience subie. Bach nous dit : quoi qu’il t’arrive, n’oublie pas qu’il y a quelque chose de plus grand. Pour Bach, c’est Dieu, et moi, je ne suis pas croyant, mais ça n’est pas la question. La question, c’est qu’on est dépassé par ce qui nous arrive et ce qu’on peut faire. Bach nous convainc d’accepter. Kafka aussi, mais d’une autre manière, par un excès de culpabilité.
Dans la chambre d’hôpital, le compositeur chrétien et l’écrivain juif m’ont aidé, le premier en me disant : « Accueille ce que tu souffres, vis-le le mieux possible, sans te détourner de la beauté », et le second en me répétant, avec le sourire qu’on voit sur sa photo : « Ne crois pas que tu vas sortir de l’enfer, et ne te plains pas, tu méritais peut-être pire que ça. »
"Une partie de moi a disparu avec les morts de ’Charlie’"
Avez-vous jamais éprouvé le sentiment de culpabilité du rescapé ?
J’ai pu me sentir coupable de mes cicatrices qui ne cicatrisaient pas ou d’être en dessous de l’homme que je voulais être, mais jamais je n’ai éprouvé la culpabilité du survivant. C’est un luxe qui est refusé aux grands blessés. Les morts de « Charlie » m’accompagnent, ils ne m’ont jamais quitté. Une partie de moi-même a disparu pour toujours avec eux. Ils donnent aujourd’hui la clé musicale et le ton pacifique de mon livre, qui se situe entre la vie et la mort, la souffrance et la joie.
Vous ne cachez rien, dans votre livre, de vos histoires d’amour, parfois compliquées, était-ce pour montrer, sans jeu de mots, votre vrai visage ?
Un attentat ne change pas seulement la vie d’un homme qui en a été victime, elle change aussi celle de son entourage. Cela aurait été indigne de ne pas tout dire de moi, de mes proches, de mes amours. Ma première femme, Marilyn, dont je suis divorcé mais avec qui j’étais resté très lié, a aussi été une victime. Elle est arrivée très vite à l’hôpital et les instants que nous avons passés ensemble ont été aussi importants pour elle que pour moi. Elle a eu les gestes et les silences qu’il fallait. Et en m’aidant, elle s’aidait.
En mars, vous avez consacré un grand article dans « Libération » à l’exposition Tintoret du Musée du Luxembourg [voir plus bas]. Comment et pourquoi, après une telle épreuve, redevient-on journaliste ?
La critique culturelle est mon métier. Fût-il galvaudé, il le reste, et j’y tiens. Du point de vue administratif, je suis toujours en arrêt de travail, mais je dois beaucoup aux journaux qui se sont très bien comportés avec moi, à qui je dois de continuer à parler d’art et de livres. Je ne serais pas capable d’enquêter sur un crime antisémite ou sur le quotidien dans les banlieues, mais une exposition sur Le Tintoret, oui, je sais faire.
Dans votre livre, vous avez des mots très durs pour les entretiens avec les écrivains et les artistes, qui alimentent ce que vous appelez le « dégoûtant bruit publicitaire ». Pourquoi acceptez-vous alors de vous y plier ?
Il y en aura très peu, deux ou trois, pas plus, dont le nôtre. Et aucune télé. Vous savez, j’écoute beaucoup de vieux entretiens, diffusés la nuit sur France-Culture, avec des créateurs. Je remarque que, autrefois, leur parole était rare. Et forte, parce que rare. Lorsqu’ils la prenaient, ce n’était pas pour se justifier ni donner quoi que ce soit à l’air du temps. Aujourd’hui, le contexte a changé et cette parole s’est diluée et la publicité a pris le dessus. L’auteur délivre désormais ses bonnes intentions : « J’ai voulu faire ceci ou cela », dans ce qui ressemble de plus en plus à un cabinet psychologique. Je crois que mon livre parle beaucoup mieux pour moi que tout ce que je pourrais en dire.
Propos recueillis par Jérôme Garcin, L’OBS du 11 avril 2018.
Philippe Lançon est né à Vanves en 1963. Journaliste culturel à « Libération », chroniqueur à « Charlie Hebdo », il est l’auteur, sous le pseudonyme de Gabriel Lindero, de « Je ne sais pas écrire et je suis un innocent » (2004), et, sous son nom, de « les îles » (2011) et « l’Elan » (2013).
ANNEXES
SOLLERS, LAME A L’OEIL
« Je suis Charlie » : « Ce slogan a vite cessé de me convaincre »
Par Philippe Lançon, Journaliste à « Libération » et à « Charlie Hebdo »
— 5 janvier 2018 à 20:46
Je suis Charlie, puisque j’y publie chaque semaine et puisque je suis une victime de l’attentat du 7 Janvier ; mais ce slogan, que j’ai découvert en badge sur les poitrines de mes soignants, a vite cessé de me convaincre. Au départ au départ, comme chantait Alex Beaupain, c’était une triste et belle histoire. « Je suis Charlie » était un cri humaniste, d’effroi et de mélancolie. Il me signifiait que je vivais dans un pays où des millions d’individus, quels qu’ils soient et quoi qu’ils pensent, se levaient spontanément pour dire qu’ils ne voulaient pas habiter un monde où l’on massacre des dessinateurs dont le métier est de faire rire, ni d’ailleurs qui que ce soit. « Je suis Charlie », c’était alors : « Je ne lis pas forcément Charlie, je n’aime pas forcément Charlie, mais je refuse qu’on tue ceux qui le font. » Il regroupait ceux qui lisaient Charlie, peu nombreux, ceux qui ne le lisaient pas, très nombreux, ceux qui avaient grandi avec les dessins de Cabu et de Wolinski, assez nombreux, ceux qui avaient quitté Charlie à un moment ou à un autre de son histoire, assez nombreux aussi, et même beaucoup de ceux qui ne l’aimaient pas. On se levait pour un principe, pour la vie, pour un principe de vie.
Très vite, l’individualisme publicitaire du slogan s’est dilué dans les diverses et inévitables traductions politiques dont il fut l’objet. Je préfère le mot traduction au mot récupération : celui-ci induit un dégoût de la politique et un sentiment de pureté assez peu recommandables de la part de ceux qui l’emploient. Au lieu d’une réflexion profonde sur les bases d’un contrat social renouvelé, moins normatif et plus pragmatique, l’idéologie s’est installée. « Je suis Charlie » est devenu l’étiquette magique qu’on faisait valser au gré de ses intérêts, de ses combats et de ses préjugés ; en clair, une injonction. Cette injonction, qui dégradait comme toujours l’élan initial, variait selon les utilisateurs du slogan. Elle visait à regrouper autant qu’à exclure, à regrouper en excluant : c’est le propre de l’idéologie. Qui dit injonction, dit réaction : « Je suis Charlie », en se fermant, a aussitôt provoqué des « Je ne suis pas Charlie », des « Je suis ceci » ou des « Je suis cela » contre Charlie, tout aussi clos. Dès qu’un slogan apparaît comme l’arme d’un pouvoir, tous ceux qui se sentent à tort ou à raison désignés par ce slogan, par ce pouvoir, ont un plaisir nerveux à s’y opposer.
Résister à l’ordre et au consensus est souvent un point d’orgueil, mais aussi une manière d’exister. Je n’ai jamais attendu de qui que ce soit qu’il me dise : « Je suis Charlie. » Les journaux où je travaille — Libération, Charlie — sont précisément fondés sur des bases qui s’opposent, selon moi, aux injonctions. « Je suis Charlie » continue donc simplement de signifier pour moi : je veux me sentir libre d’écrire et de lire ce qui me chante, et que les autres bénéficient de cette liberté.
Philippe Lançon Journaliste à « Libération » et à « Charlie Hebdo ».
Libération du 5 janvier 2018.
Philippe Lançon, Tintoret, la sensation de Venise pdf


Tintoret, La Crucifixion (détail). Venise, San Rocco.
Photo A.G., juin 2016. Zoom : cliquez l’image.

[1] Voir plus bas.




 Version imprimable
Version imprimable





 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



15 Messages
La reprise
Philippe Lançon
On ne fête pas le 7 janvier, du moins à Charlie. On ne le célèbre pas davantage. Les anniversaires où l’on compte de nouveau les morts, avec un chiffre qui ne bouge plus et des souvenirs saignants, sont plus difficiles que ceux où l’on compte simplement les années qui passent, même si au bout du compte et dans tous les cas, comme disait l’autre, un peu de terre sur la tête et en voilà pour jamais. Il y a huit ans, les frères K. ont avancé l’échéance de plusieurs d’entre nous. Sans doute trouvaient-ils que certains avaient trop dépassé l’âge de la retraite et que d’autres, comme moi, méritaient au contraire une retraite anticipée. Le résultat est qu’ils n’ont pas fait de détail. Les djihadistes sont, entre autres choses, de vieux réactionnaires : les femmes au foyer, les hommes en mission, les inutiles et les ennemis au tombeau.
Je suis redescendu au bloc trois jours avant la date fatidique. Motif : une intervention sur la bouche et les brides cicatricielles qui tirent tout vers le bas. J’y avais renoncé à deux reprises, par fatigue avant tout. Je ne compte plus le nombre de mes opérations et je n’ai pas envie de me remettre à les compter. Huit ans déjà ! Depuis huit ans, ma chirurgienne reste la même. Quand la confiance règne, le patient reste attaché au soignant. Il vit avec lui non seulement une vie parallèle, mais un temps particulier. Comme deux amants qui se retrouveraient quelques fois par an, dans une chambre d’hôtel, selon un protocole établi. Ni confession ni épanchement, simplement : action. La relation reprend là où, la fois précédente, elle avait cessé. Comme une remontée de bloc où, au réveil, on reprendrait sa phrase exactement là où on l’a laissée quand l’anesthésique, soufflant sur la chandelle, vous a endormi. Le reste de la vie ne franchit pas la porte, ou si peu. Mais le motif de ces rencontres n’est ni l’amour, ni le sexe, ni le goût du mystère et du secret : c’est la reconstruction et la guérison.
Dans le sas, je me suis changé en admirant de nouveau les chaussettes de bloc, d’un rouge tomate. L’interne m’a demandé : « Est-ce que vous voulez écouter de la musique pour vous endormir ? » Après avoir dit non, j’ai finalement dit oui, et j’ai demandé Scènes d’enfants de Schumann. L’infirmière ne trouvait pas. J’ai ajouté : « Kinderszenen en allemand ». « Kinderszenen ! J’ai trouvé. » Les premiers accords ont aéré la salle. On m’avait mis le masque à oxygène. J’étais bien sous la couverture chauffante. « Oh ! C’est beau », a dit l’infirmière. J’ai senti le froid passer dans la veine, la tête tourner, et puis, comme d’habitude, plus rien. L’opération a duré deux heures.
Je n’ai vu ma chirurgienne qu’en salle de réveil. Elle avait de petites lunettes rondes. Je devais sortir le jour même. Elle m’a dit en souriant : « On vous garde cette nuit, parce qu’on est allé loin. Pour vous surveiller. D’accord ? » Il fallait prévenir la famille, l’ami qui devait venir me chercher. J’avais envie de rejoindre le sommeil, j’ai dû faire un effort. Plus tard, j’ai retrouvé le service où j’avais passé tant de mois, dans une chambre que j’avais habitée, face à l’ascenseur menant au bloc local. Dans la nuit, en demi-sommeil, j’ai revécu malgré moi toute la scène de l’attentat, seconde par seconde, sensation par sensation, avec une effroyable précision ; et quelque chose en moi n’a cessé d’insister, comme on appuie avec la langue sur une dent malade pour aviver la douleur. Depuis, ça tire.
Charlie hebdo, Mis en ligne le 18 janvier 2023 . Paru dans l’édition 1591 du 18 janvier.
Philippe Lançon tient régulièrement une chronique dans Libération et dans Charlie hebdo. Cela mérite le détour. Voici sa dernière chronique de Charlie.
Cratère et croc blancs
Philippe Lançon
Mis en ligne le 3 août 2022
Paru dans l’édition 1567 du 3 août
Fool, Opération.
ZOOM : cliquer sur l’image.
Depuis deux mois, j’ai un petit cratère blanc au fond de la bouche. Pendant un mois, il m’a fait souffrir quand je parlais et mangeais. La douleur a disparu ; le cratère, non. Il est creusé dans la grotte de chair molle, recouvert d’une légère couche de fibrine. Chaque jour, je le nettoie avant de me coucher, comme le Petit Prince ramone son volcan avant de quitter sa planète. Le Petit Prince part pour les aventures qu’on sait. Je rejoins le pays des rêves. Il me conduit assez loin, me ramène souvent à l’hôpital. Au réveil, le cratère est toujours là.
Personne n’est capable d’expliquer sa présence. Il s’agit peut-être d’une morsure. Si c’est le cas, je ne l’ai pas sentie. Peut-être me suis-je mordu la nuit, pendant un cauchemar. Une bouche refaite a une géographie mouvante. L’absence ou la repousse anarchique des nerfs perturbe les mouvements. Administrativement, sept ans et demi après l’attentat, je suis enfin considéré comme « consolidé ». J’ai dit au médecin de la Sécurité sociale, qui hésitait : « Consolidé, je ne le serai jamais tout à fait. Des problèmes avec cette bouche, ces implants, ces nerfs, j’en aurai toujours. Je ne serai consolidé que le jour de ma mort. Mais on est arrivé, je crois, à la seule normalité possible dans cette situation anormale. » Il a signé.
La douleur du cratère a cessé au moment où je lisais une nouvelle, La Fin de l’histoire, publiée en 1911 par Jack London. On est dans le Yukon, dans le nord du Canada, un endroit extrême et invivable que London connaît bien. C’est le mois de mars ; il gèle. Dans une cabane, des hommes jouent au whist, quand entre un bonhomme de neige : « Le nouveau tenta vainement de faire fonctionner ses mâchoires et ses joues prises par la glace. […] La peau de ses pommettes était noire d’avoir gelé à plusieurs reprises. Du nez au menton, ce n’était qu’un bloc de glace percé d’un trou unique qui lui permettait de respirer. Il s’en était également servi pour cracher son jus de chique, qui avait gelé en dégoulinant, formant une stalactite ambrée, aussi pointue qu’une barbe à la Van Dyke. » Van Dyke, c’est Van Dyck, le peintre flamand. Regardez ses portraits de Charles Ier, roi d’Angleterre : vous verrez la stalactite, sans avoir à supporter le froid.
L’homme, Tom Daw, a marché pendant trois jours pour retrouver l’un de ceux qui jouent au whist, Linday. Linday est un excellent médecin, chirurgien, qui, pour des raisons qu’on saura plus tard, a abandonné une brillante et lucrative carrière pour s’enterrer ici, au bout du monde. Sa réputation l’a suivi. Si Tom Daw vient le chercher, c’est parce que l’un de ses amis, un prodigieux cinglé, en jouant d’un peu trop près avec une panthère prise au piège, a été en partie déchiqueté par elle. Linday refuse d’abord de le suivre : trop loin, trop dur, trop con, et, par-dessus tout, inutile. L’homme à la panthère sera mort quand ils arriveront. Mais Tom Daw insiste, ne doutant de rien. Le blessé, dit-il, est une force de la nature, et « sa femme est avec lui, et elle a pas une larme, rien, elle l’aide juste à vivre le temps que vous arriverez ». Linday le suit en le maudissant.
À LIRE AUSSI : L’ère du (co)vide
Débute un voyage épique jusqu’au campement où l’homme, Rex Strang, est inconscient, mais en effet vivant. Quant à la femme, Linday la reconnaît aussitôt : c’est son ex-épouse, celle qui l’a quitté jadis pour suivre cet aventurier fou. Il refuse d’abord de le soigner, puis il a une idée : il fera l’impossible pour le consolider, autrement dit, pour le remettre dans l’état où il était avant la panthère, mais, ensuite, elle devra quitter le ressuscité pour revenir avec lui, Linday : « Il courra, sautera, se baignera dans les torrents, montera sur le dos des ours, se battra contre les panthères, fera absolument tout ce que lui suggérera son imagination de crétin. En plus, je te préviens, il fascinera autant les femmes que dans le temps. Ça va te plaire, ça ? Tu vas être contente ? » Elle répond : « Continue, continue. Rends-lui son intégrité. Fais de lui ce qu’il était avant. »
London raconte la lutte médicale, obsessionnelle, que Linday mène contre la fièvre, les os brisés, les infections multiples : c’est un médecin d’exception. Il effectue des greffes assez délirantes, mais toute fiction est elle-même une greffe où la réalité se mêle à l’imagination pour rétablir ce grand malade qu’est le lecteur, sans qu’il retrouve son état initial. Que fait Linday avec son ex-femme, une fois l’homme qu’elle aime consolidé ? Je ne vous le dirai pas.
Toutes les chroniques de Philippe Lançon dans Charlie
Toutes les chroniques de Philippe Lançon dans Libé
Il est écrivain et critique littéraire. Son roman, « Le lambeau », immense succès de librairie, distingué par le prix Fémina et un prix Renaudot spécial, sort aujourd’hui en édition de poche. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir ce récit de la reconstruction. Philippe Lançon est l’invité d’Augustin Trapenard.
Son livre "Le lambeau" a été l’un des évènements littéraires marquants de l’année 2018. Il revient sur l’attaque de Charlie Hebdo et ses conséquences immédiates. Un récit de reconstruction... On parle de bêtise, de Peter Handke, de Blaise Cendrars et de jazz avec Philippe Lançon, invité de Boomerang.
Extraits de l’émission
"L’injonction de donner notre avis sur tout et tout de suite a toujours existé mais elle s’est finalement développée techniquement aujourd’hui. (…) Pour y résister, nous pouvons essayer de se ménager de moments de silence, de distance."
"Pendant cette longue période hospitalière, les livres ont été des amis, des éclaireurs."
"Le Lambeau m’a permis de faire le point à travers un récit. (...) Mais ce n’est pas un endroit où l’on a des réponses, seulement un lieu où l’on raconte des histoires"
"L’écriture est toujours un voyage"
"Une voix c’est quelque chose qui porte une présence et un physique. C’est aussi pour ça que la radio est merveilleuse. Elle permet de voir sans voir."
"A l’hôpital, j’étais comme un nourrisson qui n’avait guère d’amour que pour lui-même. Il a fallu écrire pour retrouver la possibilité de l’amour, pour le restituer à ceux qui me l’avait donné"
Carte blanche
Pour sa carte blanche, Philippe Lançon a écrit un texte inédit.
Programmation musicale
Johnny HARTMAN / John COLTRANE - My one and my only love
Jean-Louis AUBERT - Où je vis
Grièvement blessé au visage dans l’attentat contre Charlie Hebdo, Philippe Lançon a chroniqué sa lente reconstruction dans « Le Lambeau ». Interviewé par Sylvain Bourmeau, il déploie son parcours où se sont cristallisés un amateurisme revendiqué et une écriture qui ne se résoud pas à choisir entre information et littérature. ENTRETIEN.
Dominique Noguez : « Il serait bon d’accorder le prix Goncourt à des récits autobiographiques »
Tribune
Dominique Noguez
L’écrivain regrette, dans une tribune au « Monde », que les académiciens Goncourt n’aient pas couronné « Le Lambeau », de Philippe Lançon, au motif que ce livre n’est pas un roman. Or, l’histoire du prix montre que cela n’a jamais été une obligation.
Tribune. Du Lambeau, de Philippe Lançon (Gallimard, 512 pages, 21 euros), les Goncourt n’ont pas voulu. « C’est un très bon livre, peut-être l’un des plus beaux de l’année, a déclaré Bernard Pivot, président du jury, mais ça ne correspond pas à ce qu’attend le Goncourt, c’est-à-dire couronner un roman d’imagination. » Dans le mensuel Service littéraire de décembre 2018, Pierre Assouline, membre du même jury, est plus incisif encore : en donnant le prix à un ouvrage qui n’est pas un « roman », on induirait le public en erreur et on ignorerait « une réalité incontournable » depuis la création dru prix.
Que dit en réalité le testament d’Edmond de Goncourt, puisque c’est manifestement à lui que nos amis font allusion ? « Ce prix sera donné au meilleur roman, au meilleur recueil de nouvelles, au meilleur volume d’impressions, au meilleur volume d’imagination en prose, et exclusivement en prose, publié dans l’année. » Et, plus loin : « Mon vœu suprême (…), c’est que ce prix soit donné à la jeunesse, à l’originalité du talent, aux tentatives nouvelles et hardies de la pensée et de la forme. » On voit bien qu’il ne donne pas l’exclusivité au roman. Précisant même : « Le roman, dans des conditions d’égalité, aura toujours la préférence », ce qui prouve que, dans son esprit, d’autres genres en prose peuvent concourir.
Une part d’imagination dans la non-fiction
Dans la réalité, d’ailleurs, les académiciens Goncourt n’ont pas toujours montré cette inflexible préférence pour le « roman d’imagination ». Le Feu, d’Henri Barbusse, couronné en 1916, n’était-il pas un témoignage ? L’Amant, de Marguerite Duras, en 1984, n’était-il pas, à 99 %, une autobiographie ? Et qu’avait de romanesque Les Ombres errantes, le beau livre de Pascal Quignard, primé en 2002 ? Certains critiquèrent, mais d’autres louèrent Edmonde Charles-Roux d’avoir couvert ce choix de son autorité de présidente. Edmonde avait compris que les choses avaient changé depuis la mort d’Edmond. En 1896, le paysage littéraire français ne comprenait guère de récits autobiographiques, dans la ligne de ce que furent exemplairement Les Confessions de Rousseau.
Et pourtant, première remarque, beaucoup plus que pour leurs romans Germinie Lacerteux ou Madame Gervaisais, Edmond de Goncourt et son frère survivent pour leur journal, œuvre de témoignage autobiographique s’il en est. Et puis, deuxième remarque, a fini par s’imposer aujourd’hui l’évidence qu’il y a nécessairement une part d’imagination dans la non-fiction même.
Philippe Lançon l’a fait valoir, avant même d’être sur les listes du Femina et du Renaudot (et de ne l’être pas sur celle du Goncourt), lorsqu’il a reçu en septembre 2018 un prix au nom bizarre, Roman News : « Je n’ai pas imaginé ce que j’ai vécu du 7 janvier au 13 novembre 2015. Je n’ai rien imaginé de ce que je raconte. Mais j’ai imaginé comment l’écrire et le composer. » Il rejoignait ainsi la célèbre analyse de Michel Leiris dans « De la littérature considérée comme une tauromachie » (1946) qui sert désormais de préface à son Age d’homme.
La sorte de livre que défend Leiris est, certes, « la négation d’un roman », en ce que sa « règle fondamentale » est de « dire toute la vérité et rien que la vérité ». Mais il n’en doit pas moins être « bien rédigé et architecturé », et « d’une forme capable d’être fascinante pour autrui » – travail de mise en forme et de « composition » qui suppose indéniablement chez son auteur, même si le mot n’est pas employé par Leiris, de l’imagination.
Des livres sans nom de genre
Peu importe le mot, d’ailleurs. Il est temps que les jurys des principaux prix prennent acte de l’existence d’une branche de plus en plus florissante de l’arbre littéraire. Il ne s’agit pas seulement de faire une place – elle est déjà faite – à cette variété de fictions à forte teneur en autobiographie qu’on a un moment cru bon d’appeler « autofictions ».
Il s’agit tout bonnement d’accueillir de plein droit des « récits » ou des livres sans nom de genre du type de Si le grain ne meurt de Gide (1926), Nadja d’André Breton (1928) ou Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir (1958), qui sont de la non-fiction. Est-il besoin de souligner qu’aucun de ces trois récits n’était indigne du roman qui l’emporta au prix Goncourt l’année où il fut écrit (Le Supplice de Phèdre d’Henri Deberly en 1926, Un homme se penche sur son passé de Maurice Constantin-Weyer en 1928 et Saint-Germain ou la Négociation de Francis Walder en 1958).
Pour ce qui est du Goncourt, une tentation serait de créer un énième prix Goncourt-bis, comme ces prix Goncourt de la nouvelle ou de la biographie institués depuis quelques décennies. Non, la bonne idée serait d’accorder à des récits autobiographiques le prix principal et le plus connu, comme l’a fait cette année le prix Femina en choisissant Le Lambeau, de Philippe Lançon. Pierre Assouline écrit que ce serait ouvrir « la boîte de Pandore » – drôle d’idée, tout de même, de comparer les livres à des fléaux ! Ce serait seulement reconnaître l’unité de la littérature et l’égalité des chefs-d’œuvre, quelle que soit la dose d’imagination qu’ils comportent.
Dominique Noguez est membre du jury du prix Décembre.
Dominique Noguez (Ecrivain), Le Monde du 26 décembre 2018.
Avec le Lambeau, livre impossible et magnifique, Philippe Lançon a marqué, comme nul autre, l’année 2018. Celui qui se définit comme "un foutu bavard" la raconte ici : Une part de moi flotte je ne sais où... pdf
Le prix Femina a été attribué au livre Le Lambeau de Philippe Lançon (Gallimard), lundi 5 novembre. A partir du moment où les jurées avaient placé cet ouvrage, sans aucun doute le texte le plus remarqué et célébré de l’année, dans leur dernière sélection, et sachant que le calendrier fait cette année du Femina le premier des grands prix littéraires attribués (deux jours avant le Renaudot, qui le comptait aussi parmi ses finalistes), il semblait peu probable que Le Lambeau ne soit pas le lauréat.
C’est un grand texte qui se voit ainsi couronné. Un livre magistral, revenu d’entre les morts. Publié au printemps, un peu plus de trois ans après l’attentat de Charlie Hebdo, où Philippe Lançon a été défiguré, la mâchoire emportée par une balle, Le Lambeau raconte comment « celui qui n’était pas tout à fait mort » doit cohabiter avec « celui qui allait devoir survivre ».
Pierre Guyotat a reçu un prix Femina spécial pour l’ensemble de son œuvre. Le Monde.
Entre deux selfies en bikini, que fait "le Lambeau" de Lançon sur Instagram ?
Quelques photos du "Lambeau" de Philippe Lançon postées sur Instagram (DR)
Zoom : cliquez sur l’image.
Quand on sait de quoi parle ce livre, ça peut choquer.
Par Elisabeth Philippe
Entre deux selfies, la couverture crème apparaît dans le petit carré réglementaire, avec sa ribambelle d’émojis et de hashtags : #sundaymood, #teatime, #Ilovebooks, #livreaddict... Sur certains clichés, le livre se trouve artistiquement mis en scène, sur une pelouse vert tendre ou au bord d’une piscine, entouré d’un mug et d’une jolie bougie parfumée, caressé par des ongles manucurés ou des pétales de fleurs séchées, et même tatoué d’un baiser au rouge à lèvres.
A l’instar des photos de son chat ou de ses plus belles poses de yoga, exhiber ses lectures fait partie des figures imposées d’Instagram. Sauf qu’ici, il ne s’agit pas de n’importe quel livre, mais de celui de Philippe Lançon, « le Lambeau », récit puissant et sidérant dans lequel le journaliste rescapé de l’attentat du 7 janvier 2015 contre « Charlie Hebdo » raconte sa lente reconstruction. Dès sa parution, des critiques se sont demandé si ce texte, fruit de l’expérience unique d’un survivant, pouvait être soumis au même traitement que le tout venant littéraire. Voici, par exemple, ce qu’écrivait Jean Birnbaum dans « le Monde des Livres », en avril, à la sortie du livre :
En dépit de son statut d’« intouchable », « le Lambeau » s’est inséré dans le cours « ordinaire » de la vie médiatique jusqu’à s’imposer comme l’un des phénomènes littéraires de l’année. Des voix déplorent d’ailleurs aujourd’hui son absence dans la première sélection du Goncourt, alors qu’il figure dans celle du Renaudot. De toute façon, le récit de Philippe Lançon n’a pas eu besoin d’un bandeau rouge pour devenir un succès public. Il a déjà été réimprimé douze fois et vendu à plus de 100.000 exemplaires.
L’engouement des lecteurs ne fait aucun doute. Et la présence du « Lambeau » sur Instagram le donne à voir, au sens propre. 471 publications comportent le mot-dièse #lelambeau, 405 #philippelançon. S’ils ne sont pas particulièrement impressionnants, ces chiffres étonnent malgré tout, s’agissant d’un livre de cet acabit, loin des bestsellers industriels qui constituent le gros de la bibliothèque virtuelle et visuelle de « Bookstagram ».
De prime abord, il semble y avoir quelque chose d’indécent à voir le témoignage d’un homme défiguré par des tirs de kalachnikov ainsi noyé dans le grand bain d’exhibition narcissique qu’est Instagram ; à constater que l’on peut poster une photo du livre de Philippe Lançon comme l’on poste celle de son petit déjeuner #healthy ou de son essayage de bikini #summerbody.
Transformé en cliché, le récit devient lieu commun
Dans « Sur la photographie » publié en 1999 et donc bien avant l’avènement d’Instagram, Jean Baudrillard écrivait :
Ici, c’est la force du livre de Lançon qui semble disparaître, sa singularité diluée dans la répétition des images. Transformé en cliché, le récit devient lieu commun. Au-delà, le fait d’avoir lu le livre ou plutôt de le faire savoir paraît compter davantage que le livre lui-même. Poster une photo du « Lambeau » sur Instagram revient à proclamer : « Regardez, je l’ai lu ! » Mais pourquoi cette nécessité de partager une expérience de lecture, a priori éprouvante, sur un réseau social où la légèreté confine souvent à l’insignifiance ?
La réception d’un texte comme « le Lambeau », introspectif, violent, profond, peut-elle vraiment être la même que celle de n’importe quel autre livre ? Revient alors en mémoire la distinction entre divertissement et recueillement établie par Walter Benjamin dans « l’Oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » :
Et c’est sans doute le phénomène à l’oeuvre sur Instagram. En exposant le livre de Philippe Lançon sur le réseau, la « masse » fait entrer le livre en elle, se l’approprie. Mais moins par distraction, pour reprendre le terme de Benjamin, que par besoin d’expiation, de catharsis collective.
Le petit carré Instagram devient une sorte d’ex-voto incongru et dérisoire, et « le Lambeau » un fétiche, un talisman, à la fois pour se souvenir et pour conjurer le sort. Derrière les images, il y a les mots de Lançon. Et ce sont eux qui resteront, eux que l’on relira comme lui-même a relu avant chaque opération la scène de la mort de la grand-mère dans « la Recherche du temps perdu ».
Elisabeth Philippe, L’OBS du 12 septembre 2018.
La mort de la grand-mère dans la recherche du temps perdu
France Culture, Répliques, 1er septembre 2018.
Avec Philippe Lançon et Antoine Compagnon.
La littérature aide-t-elle à vivre et à revivre ?
Le 7 janvier 2015 à 11h25, deux hommes encagoulés ont fait irruption dans les locaux de Charlie Hebdo et la vie de Philippe Lançon a basculé. Dans le Lambeau, le livre sur sa terrible blessure et sa lente reconstruction, Lançon, parlant de la vie à l’hôpital, écrit : " Quand les portes des chambres s’ouvraient, pendant que je faisais mes premières longueurs dans le couloir, j’avais découvert sans surprise que la plupart des patients cloués dans leur lit et aussi moribonds soient ils, regardaient la télé, le son poussé à fond, comme pour réveiller un sourd, sinon le mort qu’ils risquaient d’être à brève échéance, et particulièrement la dernière et la plus efficace des machines à décerveler par l’actualité : BFM."
Le blessé de guerre en temps de paix qu’est Lançon refuse de juger les autres malades. Il les comprend. Mais pour pour ne pas ajouter aux images qui l’occupaient, ce tableau collectif de l’enfer, les informations et divertissements en boucle, il prend ne décision radicale : dans sa chambre, ni TV ni radio. A la place la musique c’est à dire Bach, et les livres. Dans les livres A la recherche du temps perdu et dans la Recherche : un épisode qu’il lit et relit à chaque fois qu’il doit descendre au bloc pour refaire son visage dévasté, la mort de la grand mère rencontrée dans le Côté de Guermantes. C’est de ce passage bouleversant que nous allons parler et une question me brûle Philippe Lançon : "Comment se fait-il que vous ayez choisi cette agonie, décrite avec un réalisme effrayant, pour accompagner vos tribulations chirurgicales ? Cela vous préparait-il au pire ? Etait ce un moyen de résister à la complaisance, de ne pas pleurer sur vous-même ou trouviez vous une sorte de réconfort dans ce moment si rare de tendresse proustienne ?"
C’est une expérience étrange qu’un lecteur, professionnel ou non, peut être amené à vivre. Il est entouré de livres, des bons, de moins bons, mais aussi de très bons. Et soudain, l’existence d’un seul livre, pas nécessairement paru avec une étiquette le désignant comme appartenant à l’ « espace littéraire », a pour effet que les autres livres, y compris les meilleurs, non pas lui tombent des mains, mais pâlissent, s’éloignent, s’effacent peu à peu. « Hors sujet », comme noterait un prof dans les marges d’une dissertation ratée. Resterait, bien sûr, vu l’état du monde d’aujourd’hui, de nos civilisations, de l’humaine tragi-comédie, à préciser ce qu’on entendrait par là. Et, a contrario, ce que serait un livre qui serait, lui, en plein dans le sujet, je veux dire en totale prise avec le réel, ce réel que Lacan définissait comme ce qui résiste, ce qui fait mal, Bataille comme l’impossible, ou Badiou comme ce qui finissait toujours par s’offrir comme une épreuve du corps. Or il est un livre à propos duquel il n’est probablement pas besoin d’avoir recours aux savantes définitions que je viens de rappeler pour reconnaître à l’évidence qu’il se situe, ce livre-là, au cœur même du réel, de sa brûlante actualité. Je parle du récit autobiographique de Philippe Lançon, le Lambeau. Philippe Lançon, faut-il le rappeler, est ce journaliste et écrivain qui a été gravement blessé lors de la tuerie perpétrée dans les locaux de Charlie Hebdo par deux terroristes islamistes.
Une abjection de la pensée
Il m’est arrivé de souvent citer cette phrase d’Isidore Ducasse : « Dans la nouvelle science, chaque chose vient à son tour, telles est son excellence ». Oserais-je soutenir ici, aujourd’hui, sans crainte de proférer une insanité, que l’assassinat des amis de Philippe Lançon et la balle qui a fait de lui pendant un temps un mort-vivant relèveraient de quelque « excellence » puisqu’ayant abouti, sinon comme le prophétisait Mallarmé pour toute littérature au Livre total, mais pour le moins à un très grand livre ? Un livre de 500 pages dont paradoxalement le noyau radio-actif est un événement qui n’a duré que quelques minutes et auquel le lecteur, (Lançon le prend souvent à témoin), a peu de chance de trouver un sens, quelque recours qu’il ait aux constructions métaphysiques les plus solides, les philosophies les plus savantes, les concepts les plus sophistiqués. Quelle utilisation faire de ce riche bagage intellectuel quand nous est donné d’assister au spectacle d’êtres humains exécutés avec calme par des ombres, par des fantômes sans visage, dont Philippe Lançon, baignant dans son sang et celui de ses amis morts, ne voit que les jambes gainées de noir et le bout d’une arme, celle dont la balle vient de lui ravager le bas du visage ? Quelle utilisation faire, dans l’état de sidération et d’effroi où nous plonge le vision d’une telle scène, de cette notion du Mal, auquel, en désespoir de cause, je serais prêt pour ma part à me raccrocher, ou de celle du démoniaque, ou de celle du néant. Lançon est le premier à les réfuter, jugeant qu’il avait mis, notamment la dernière, trop à contribution dans ses articles, après une consommation excessive de poésies. On comprend que la lecture de l’entretien d’un intellectuel français « complaisant à la violence », voire « fasciné » par elle, alors que lui est dans une chambre d’hôpital où les chirurgiens reconstituent son corps et aident à la résurrection du « demi-mort » qu’il est, lui ait inspiré ces lignes : « Il y avait une abjection de la pensée, lorsqu’elle croyait donner sens immédiat à l’événement auquel elle était soumise ».
Le mage Houellebecq
Le matin du 7 janvier 2015, Philippe Lançon, après avoir visionné la veille, en rentrant du théâtre, un entretien donné par Michel Houellebecq à France 2 à propos de son roman Soumission, et avant de rejoindre, indécis, ou Libération ou Charlie Hebdo (il optera pour le second), exécute en écoutant la radio quelques pompes sur un vieux tapis acheté à Bagdad. L’invité de France Inter est à nouveau Michel Houellebecq. Sait-il l’auteur de Soumission, peut-il savoir, Philippe Lançon, qu’à ce moment les tueurs de Daëch sont en train de préparer leurs armes et d’exécuter le plan que Houellebecq, d’une « voix faussement endormie » imagine dans son livre de politique-fiction, jugeant qu’il n’était « pas forcément très crédible », mais ajoutant quand même, en pouffant, précise Lançon, qu’il pouvait y avoir « bien pire que l’Islam modéré » qu’il évoquait ? Pouvait-il prévoir, l’auteur du Lambeau, qu’arrivant deux heures plus tard, dans les locaux de Charlie, il allait une fois de plus se trouver sous le signe de Houellebecq, les journalistes de Charlie étant, à quelques minutes de l’arrivée des deux tueurs en noir, en pleine discussion sur Soumission, tous manifestant leur hostilité au livre, à l’exception de l’économiste Bernard Marris, aussitôt soutenu par Philippe Lançon. Sur la table était posé le magazine frais paru, avec en couverture la caricature de Houellebecq-le-sans-dents. Le réel, quelques instants plus tard allait tragiquement trancher le débat et rendre, hélas, bien inadéquate la railleuse inscription de Luz placée au-dessus de son dessin : « Les prédictions du mage Houellebecq ». Et que penser aujourd’hui des critiques littéraires et écrivains qui se sont gaussés ou indignés des prédictions du demi-clochard alcolo croqué par Luz avec lequel Philippe Lançon n’en avait d’ailleurs fini, puisque transporté à l’hôpital de la Salpétrière, avant l’intervention chirurgicale qui devait durer entre six et huit heures (deux ans plus tard, en août 2017, il en sera à sa dix-septième opération !), sa chirurgienne, l’admirable Chloë-aux-doigts-de-fée, appelée d’urgence pour l’opérer, était alors à la cafeteria de l’hôpital en compagnie d’une amie qui venait de lui offrir… Soumission.
Des pétards
En tout lecteur, en tout spectateur, il y a un inévitable voyeur. Comment nier que le lecteur de le Lambeau ne soit pas impatient d’en arriver au plus vite à la tragique scène de la tuerie, d’en savoir enfin, par la voix du témoin rescapé, comment il l’a vécue et ce qu’il s’y est réellement passé. Il faudra qu’il s’arme de patience, ledit lecteur. À chaque fois que Philippe Lançon est au bord de la décrire l’attentat, il oblique, fait un détour, tel détail de son récit rameute en lui des souvenirs de son enfance, de son adolescence, d’amours anciennes, de voyages, en Irak comme journaliste, en Inde, en Somalie où déjà il a été témoin de scènes d’horreur… Le récit attendu de la matinée du 17 janvier 2017 est sans cesse retardé. Et puis, page 70, nous y voilà ! Titre du chapitre : l’Attentat. Philippe Lançon vient d’arriver dans les locaux de Charlie où il trouve Cabu, Marris, Charb, Wolinski, Tignous…en plein débat. Il entend des « petits bruits secs », comme des « pétards ». Une farce, pense-t-il, avant de comprendre que par « l’irruption de la violence nue », c’était la mort qui s’annonçait.
La cervelle et l’anémone
Jamais les images des plus sanglantes des combats de la Première Guerre mondiale ne m’ont laissé l’impression d’horreur glacée des quelques minutes vécues par Philippe Lançon, telles qu’il en fait le récit. Pas Verdun, pas une guerre : une exécution. Pas un champ de bataille plein de bruit et de fureur : l’espace étroit d’un modeste bureau (la revue connaît une mauvaise passe). Pas de cris, de hurlements, pas de bruits de rafales, seulement les claquements secs de balles tirées une à une, tirs ponctués d’un « Allah Akbar ! » Philippe Lançon se recroqueville sous le bureau, ferme les yeux, comme enfant il jouait à la guerre, il les rouvre, devine qu’il est touché, aux bras et aux mains, n’éprouve aucune douleur (il restera conscient jusqu’à son évacuation vers l’hôpital). C’est en saisissant son portable pour téléphoner à sa mère qu’il découvre, dans le reflet de l’écran, que la moitié de son visage n’existe plus : « un trou, un cratère de chair détruite ». Les tueurs on disparu. Tout est silence. La vision qui s’offre aux yeux du blessé est irréelle, il la décrit avec une sobriété et une précision impressionnantes. « Les morts se tenaient presque par la main. Le pied de l’un touchait le ventre de l’autre, dont les doigts effleuraient le visage du troisième qui penchait vers la hanche du quatrième… ». En critique d’art averti, il voit ses compagnons comme les figures d’une danse macabre, voire formant une « version inédite et noire de la Danse de Matisse ». Le corps de son ami Wolinski « était légèrement adossé à un mur. Son visage était apaisé, un peu triste, les yeux clos, j’ai pensé qu’il était un oiseau splendide, une sorte d’aigle infiniment civilisé… ». Lançon reconnaît le corps de l’homme mort allongé près de lui, Bernard Marris. La cervelle lui sort du crâne. Elle reviendra de façon obsédante dans ses rêves, la cervelle de son ami. Dans une page admirable, il évoque comment cette masse spongieuse se confond avec l’image d’une anémone de mer vue dans une rivière où il s’était baigné, lors d’un de ses voyages à Cuba.
La tuerie : le plan court d’un film de deux minutes. Son prolongement pour Philippe Lançon ? Les longs plans séquences de ses séjours à l’hôpital. Deux ans pour lui reconstruire le visage, lui réapprendre à parler et à se nourrir. Avec quel humour il raconte les pittoresques bricolages, rafistolages dont son corps a été l’objet ! Un péroné qu’on lui enlève pour le greffer sur ce qui lui reste de mâchoire, des bouts d’artères, de veines, de peaux du cou, du mollet, prélevés pour les greffer ailleurs… Une des interventions dure une douzaine d’heures. Et voici qu’à son issue, il s’imagine avec consternation des poils de jambes lui poussant dans la bouche, en même temps qu’il apprend que son menton et sa lèvre sont modelés avec de la chair de cheval et de porc. Pour supporter son devenir-monstre avant son retour à l’humain : les lectures et la musique, Proust, Kafka, Bach. La présence attentive, calme, discrète des policiers à ses côtés, le jour comme la nuit, lui sont précieux. « Ils me reliaient au monde dont ils me protégeaient ». Quant à ses chirurgiens et ses soignants, leurs « gestes remplaçaient les larmes, le bavardage, la compassion inutile, la pitié dangereuse ». Qui a jusqu’alors échappé aux longs séjours en hôpital découvrira, notamment dans le récit que fait Lançon de ses longs mois passés dans l’hôpital des Invalides, un monde en marge de notre monde, un monde secret de souffrances physiques, de misère morale, dont il n’a pas idée.
Le 13 novembre 2015, profitant d’un répit dans les soins, Philippe Lançon retrouve à New York son amie Gabriela avec qui il se promène en direction de Broadway. Il fait doux, ils sont joyeux. Tout « respire la puissance et la paix ». Son portable sonne, un ami lui apprend la tuerie au Bataclan. « J’ai senti que tout recommençait », note Lançon.
Au moment où j’écris ces lignes, j’apprends la énième prise d’otages dans un supermarché par le énième possédé d’Allah. Les énièmes morts, l’héroïsme d’un gendarme. Pour la énième fois, je lis dans une certaine presse et entend dans la bouche de politiques les mêmes commentaires qui avaient suscité l’indignation de Lançon. Pas d’entracte dans le spectacle de l’ « abjection ».
Transporté d’urgence à l’hôpital, ce 7 janvier 2015, Philippe Lançon, devant les corps de ses amis assassinés qu’il abandonne, a ce mot : « Je ne voulais pas que les morts s’endorment ». Plutôt qu’à une veille à laquelle, via son livre, il les maintiendrait, ou à un réveil auquel il les contraindrait, n’est-ce pas, à cette joyeuse bande d’anars violemment athées qu’ils étaient, à une manière de résurrection qu’il les convierait ?
Jacques Henric, 13/05/2018.
Notre camarade Philippe Chauché, lecteur intransigeant, me signale sa recension du livre de Lançon. A LIRE ICI.
Petit écho chirurgical
Charlie Hebdo 1353, 27 juin 2018.
ZOOM : cliquer l’image
Gravement blessé lors de la tuerie de "Charlie Hebdo" le 7 janvier 2015, le journaliste raconte, à travers son livre "Le lambeau", son long combat pour se reconstruire.
Philippe Lançon, journaliste et écrivain, le 20 février 2013 à Paris.
© Getty / Bertrand Rindoff Petroff. Zoom : cliquez l’image.
Ce jour-là, Philippe Lançon aurait pu ne pas être présent à la conférence de rédaction de Charlie. Il devait écrire pour Libération un article sur La Nuit des rois, pièce vue la veille aux Quartiers d’Ivry. Sur son vélo, il hésite encore. Libé ou Charlie ? Rue Nicolas-Appert ou rue Béranger ? Sur les Grands Boulevards, il opte pour Charlie.
Dans Le lambeau aux Editions Gallimard, le journaliste raconte le dur et long parcours médical : des mois et des mois d’hospitalisation à la Pitié-Salpêtrière, puis à l’hôpital des Invalides, en tout dix-sept interventions chirurgicales, dénombre-t-il à la mi-août 2017, qui vont le mener à la cicatrisation de ses blessures, et à la patiente reconstruction du tiers inférieur de son visage, pulvérisé par un projectile. Philippe Lançon s’engage aussi dans un cheminement intérieur qu’il nous raconte dans son livre sans tricher.
Choix musical : Habanera d’Emmanuel Chabrier par Alexandre Tharaud
Musiques :
Variation Goldberg n°21 de Jean-Sébastien Bach, par Glenn Gould
Ay mariposa par Pedro Luis Ferrer
Générique : Veridis Quo des Daft Punk
France Inter, L’heure bleue, lundi 25 juin 2018 par Laure Adler.
Survivant de l’attentat de Charlie Hebdo, le journaliste Philippe Lançon raconte dans son ouvrage Le Lambeau le matin du 7 janvier 2015 et les mois passés à l’hôpital.
L’invité des Matins de France Culture
La chronique de Philippe Lançon dans Charlie Hebdo du 11 avril, la veille de la sortie de son livre Le lambeau en librairie.
Charlie Hebdo, 11 avril 2018.
Zoom : cliquez l’image.