« Ouvrons Tchouang-tseu qui, avec Lao-tseu et Li-tseu, est le plus grand penseur de la Chine antique. Quoique né apparemment autour de 300 avant notre ère, il s’approche sans nulle déperdition d’énergie et de vérité de nous, "debout, comme dit Rimbaud, dans la rage et les ennuis." »
Philippe Sollers, Illuminations, 2003.
Zhuangzi et Laozi.
Zoom : cliquez sur l’image.

Comment traverser l’époque avec philosophie ? « Pour le taoïsme, la seule chose qui ne change pas, c’est le changement »

Par Ursula Gauthier
L’OBS. Publié le 27 juillet 2021 à 07h00
Le taoïsme a connu en Occident une grande vogue populaire à partir de la fin des années 1960, entrant en résonance avec l’émergence du souci de la santé, de l’écologie, d’une critique de la modernité et d’un mysticisme de type New Age. Le texte fondateur, le « Daodejing » ou « Livre de la Voie et de la Vertu », également appelé du nom de son auteur « Laozi » (Lao-Tseu), est devenu une sorte de livre de chevet. Mais pour trouver des leçons de vie dans notre époque troublée, mieux vaut se tourner vers un autre maître du Dao (Tao) : Zhuangzi (Tchouang-Tseu). Explications d’Anne Cheng, titulaire de la chaire d’histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France.


Le New Age a popularisé le texte fondateur du taoïsme, le « Daodejing » ou « Livre de la Voie et de la Vertu », de Laozi. Pensez-vous que l’on puisse aujourd’hui se tourner vers cette sagesse chinoise antique pour trouver des réponses au désarroi suscité par l’épreuve de la pandémie ?
Je pense que la réception enthousiaste du « Laozi » par le grand public en Occident tient beaucoup du malentendu. Ce texte a été interprété de bien des façons au cours de l’histoire. Mais la lecture que nous en faisons est vraiment très peu fidèle. J’étudie les textes dans le contexte historique et culturel de leur apparition. Je pense que la notion de wuwei, ou « non-agir », notion centrale du « Laozi », a été assez mal comprise chez nous. Il ne s’agit pas d’un « laisser-faire », d’un « lâcher prise », voire d’une attitude « cool » opposée à l’autoritarisme. Le wuwei du « Laozi », c’est presque le contraire, c’est la puissance pure : c’est le mode d’action du Dao, qui est tel que l’action n’est pas visible, que seuls les effets le sont. C’est pourquoi Han Fei, le grand penseur du totalitarisme étatique, s’est fendu d’un commentaire sur le « Laozi » : cette puissance pure, c’est exactement ce qu’il vise pour le souverain. C’est aussi la raison pour laquelle le grand sinologue britannique Arthur Waley a choisi de traduire le titre « Daodejing » par « The Way and its Power » : « la Voie et sa Puissance ». Je rappelle toujours que le mot de en chinois, que nous traduisons par « vertu », se réfère non à l’idée de morale ou d’éthique, mais à celle de la racine latine virtus, c’est-à-dire la puissance mâle.
Ce texte qu’en Occident on trouve « planant », qui a été mis à la mode par le mouvement New Age, je vous le dis tout net : il me met mal à l’aise. Il est extraordinairement désincarné : il ne comporte aucune référence, pas un seul nom propre, de personne ni de lieu ; on ne peut le situer ni dans le temps ni dans l’espace. Cette œuvre, qui porte sur le Dao, dit explicitement que tout sens de l’humanité est étranger au Dao. Il dit dans un passage (« Laozi », 5) que pour le Dao comme pour le Sage, l’humanité, ce n’est rien d’autre que « des chiens de paille » [qu’on brûle dans les offrandes, NDLR].
Le Dao est inhumain ?
Il est a-humain, et le « Laozi » le revendique. Je trouve assez stupéfiant que les gens s’extasient devant cela. Avec un mode d’expression non discursif, peu habituel pour nous, ce texte essaie de dire quelque chose de a-humain. C’est le sens de la toute première phrase : « Le Dao dont on peut parler n’est pas le Dao constant (ou éternel) ». C’est un effort pour dire quelque chose d’indicible. On peut comprendre que les mystiques s’en soient emparés, eux qui essaient également de dire quelque chose d’indicible sur le rapport au divin. Sauf que le Dao n’est pas une divinité, ce n’est rien d’autre que le processus naturel des choses, comme l’a bien montré le grand spécialiste du taoïsme Jean Levi. Tout cela devient terrifiant quand on comprend que le gouvernement humain est calqué exactement sur cette marche du Dao. Imaginez une puissance pure qui avance sans aucune espèce de considération pour l’humain : c’est l’essence du totalitarisme antique.
Cette pensée du totalitarisme a-t-elle servi au cours de l’histoire impériale chinoise ?
Les empereurs chinois ont été nourris de cette idée. Ils sont « Fils du Ciel » (Tianzi) et n’ont de compte à rendre qu’au Ciel (Tian), pas à plus bas qu’eux. Le Ciel, c’est le Dao en fait. Certes, le Ciel prend des significations différentes selon les courants de pensée. Pour les conseillers confucéens de l’empereur, il est une sorte d’instance régulatrice : un allié, un alibi, qu’ils utilisent pour border le pouvoir illimité de l’empereur. Mais avec avec le Ciel de Laozi, ou Han Fei, on obtient une structure pyramidale dans laquelle la circulation du pouvoir se fait dans un seul sens, de haut en bas. Plus encore, en dehors de cette structure de pouvoir, il n’y a aucun autre espace, nulle part où la contestation soit possible. C’est la totalité du monde qui est régie par cette puissance pure.
Attention, je ne parle pas ici du taoïsme en général, qui comprend de multiples tendances et filiations, mais de ce livre, le « Daodejing », pris dans le contexte de son apparition. C’est un texte fondamentalement politique et très vite, sous l’empire Han, il a été considéré comme un manuel politique. Un ou deux siècles plus tard, le « Laozi » a été résumé par ce paradoxe central : pour contrer la puissance, il faut choisir la faiblesse. Ce paradoxe est au cœur des arts martiaux, le judo, le karaté, etc. : on feint la faiblesse et on utilise la force de l’adversaire contre lui-même.
Que savons-nous de Laozi ?
Il faut mettre de côté une fois pour toutes l’idée d’un auteur qui s’appellerait Laozi. Ce nom, qui veut dire simplement « le vieux maître » (ou « le vieil enfant »), peut désigner n’importe qui. C’est un texte anonyme en réalité. Et ces formules très brèves, de forme régulière, avec des effets de rime, faciles à mémoriser, constituent probablement un texte sectaire à l’origine. J’en choque plus d’un quand je dis cela, mais le « Daodejing » fait penser à ces mantras, ces recettes que l’on se récite dans les sectes religieuses. Le texte apparaît pour la première fois au IVe siècle avant l’ère chrétienne. Dans les IIIe et IIe siècles, on le trouve sous forme de manuscrits dans des tombes, comme l’exemplaire célèbre trouvé dans la tombe de Mawangdui (fouillée en 1974). Manifestement, les aristocrates de l’époque pré-impériale pensaient que c’était un texte important pour le voyage dans l’au-delà, et en tout cas qu’il fallait l’avoir dans sa bibliothèque funéraire.
Dans cette pensée totalisante dénuée de souci de l’humain, est-ce qu’on trouve tout de même des réponses aux questions de nos contemporains ?
Très peu. Il y a bien une question à laquelle le « Laozi » essaie sans cesse de répondre, et qui pourrait être d’une certaine utilité de nos jours, c’est de savoir comment un petit pays coincé entre d’énormes puissances peut survivre. Toute la réflexion sur le « non-agir » tend à répondre à cela. La réponse du « Laozi », c’est que quand on veut résister à quelque chose d’énormément plus fort et plus puissant que vous, il ne faut pas agir mais laisser agir. C’est parfaitement futile d’essayer de rendre coup pour coup à un adversaire beaucoup plus fort.
Pas d’action, car elle suscitera une réaction ?
Oui. Mais pas d’action ne signifie par pour autant de rester les bras croisés. Il faut au contraire beaucoup d’effort et d’énergie, mais investis sur la très longue durée. Le Dao est éternel. Il faut se mettre à cette échelle de temps, en tablant non sur la force brute mais sur sa propre petitesse, sa faiblesse.
Le « tianxia », ou comment la Chine s’est faite monde
N’est-ce pas cette idée qui a inspiré la politique extérieure de la Chine pendant très longtemps et favorisé les trente années de boum économique, avec la formule « cacher sa brillance et attendre son heure » ?
Oui, c’est du « Laozi » ! Ainsi que la guérilla théorisée par Mao : il faut être en très petit nombre face à des armées professionnelles bien entraînées, frapper quand l’autre ne s’y attend pas, disparaître, réapparaître… Les protestataires de Hongkong ont utilisé eux aussi ces tactiques. Leur mot d’ordre « Be water », « Etre eau », est directement issu du « Laozi ». L’eau, c’est l’illustration par excellence du Dao. Un élément incolore, inodore, qui coule au plus bas, personne n’y fait attention, et pourtant il est capable d’user les roches les plus dures. A la longue évidemment, à la très longue. Le mouvement prodémocratie de Hongkong a été terrassé, mais pas définitivement. S’il continue à se calquer sur le modèle de l’eau, il pourra continuer la lutte.
Et si aujourd’hui, dans le contexte de la pandémie, on voulait s’inspirer du « wuwei », cette philosophie du non-agir, peut-on se dire par exemple : on ne fait rien, on ne se fait pas vacciner, on attend ?
Non, car le wuwei suppose d’être toujours en amont des choses. C’est d’ailleurs la grande obsession de nombreux textes chinois antiques. On la trouve aussi dans le « Yijing », le « Livre des Mutations ». C’est ce qui explique l’importance de la divination en Chine, qui ne consiste pas tant à essayer de prévoir l’avenir, que de le prévenir, de faire en sorte que certaines choses indésirables ne se produisent pas. Ceux que les textes antiques appellent les Sages, les Shengren, sont capables de faire cela : ils sont tellement en amont des choses qu’ils peuvent faire en sorte que les pandémies, ou autres, ne se produisent pas.
Une des questions que nous nous posons aujourd’hui, c’est s’il faut tenter de retrouver le monde d’avant, ou accepter de le voir changer radicalement. Est-ce que ce genre de question fait sens pour la pensée chinoise antique ?
Non, car cette pensée de l’amont dont je viens de parler va de pair avec la pensée du changement. Beaucoup de textes anciens disent que la seule chose qui ne change pas, c’est le changement. Nous sommes déjà entièrement pris dans le flux du changement permanent. Ce serait futile de vouloir revenir en arrière…
Le « Zhuangzi »
Il n’y a donc pas grand-chose dans le « Laozi », d’un point de vue purement textuel, dont nous pourrions nous inspirer en ces temps difficiles. Quid des autres penseurs du taoïsme ? Est-ce que l’autre œuvre capitale sur le Dao, le « Zhuangzi », donne aussi dans la pensée totalisante ?
Pas du tout, et dans l’histoire de la pensée chinoise, il faut absolument les distinguer. Certes, ils parlent tous deux du Dao, mais pas dans le même sens. Le « Zhuangzi » est une pensée de la longue vie. Le « non-agir » revêt pour lui un sens différent : celui de « non-engagement ». Moins nous sommes engagés dans l’action, c’est-à-dire dans la vaine poursuite du pouvoir, de la richesse, de la renommée… et mieux nous nous portons.
Pour une longue vie, pas de stress, en somme ?
Tout à fait. Mieux vaut vivre caché, et éviter toute cette agitation mortifère. Ce refus de l’engagement est un des sujets du « Zhuangzi » – un texte lui aussi très composite, qui a été considérablement remanié dans les premiers siècles de notre ère… Parmi les différentes voix qui le composent, on trouve en effet cette idée à contrepied des Confucéens, qui sont de bons petits soldats, toujours prêts à s’engager au service d’un prince, à se démener pour améliorer le monde. Zhuangzi, lui, dit : « Non, pas pour moi. »
C’est un esprit philosophique ?
Oui, il préfère prendre le temps de contempler la beauté du monde. Rien à voir avec l’esprit du « Laozi ». Et on le voit dans le fait que le « Zhuangzi » s’est prêté à la greffe du bouddhisme zen, alors que ça ne marche pas du tout sur le « Laozi ». Fait intéressant : le bouddhisme, né en Inde, s’est introduit en Chine dès les premiers siècles de l’ère chrétienne et a eu tôt fait d’attirer l’attention d’élites lettrées familières du « Zhuangzi » et, partant, promptes à interpréter les thèses bouddhiques en termes empruntés à ce texte, notamment celles qui concernent la méditation (en chinois « chan », en japonais « zen »). Je pense que l’on peut également relier l’esprit du « Zhuangzi » à un phénomène récent : beaucoup de gens ont découvert à la faveur de la pandémie et du confinement qu’ils n’avaient pas envie de continuer dans la voie de l’ambition personnelle et du stress perpétuel. Ça a été une sorte de révélation existentielle, un basculement de mentalité : nous avons dû changer de rythme, passer moins de temps en compagnie, dîner moins au restaurant… Certains – pas tous – ont découvert que, finalement, c’est plutôt mieux. Qu’au fond, on n’a pas besoin d’avoir une grosse bagnole, de faire du tourisme ou d’aller en discothèque…
Cela va dans le sens de Zhuangzi ?
Oui. Le « Zhuangzi » [dont la rédaction s’étale entre le IVe et le IIe siècles avant l’ère chrétienne, NDLR] est un texte qui tire un peu à hue et à dia. On y distingue en général trois « couches » : un corps de chapitres dits « internes », dont on considère qu’ils reflètent davantage la voix de « Maître Zhuang ». Puis des chapitres « externes » et, enfin, des chapitres « mélangés ». Le thème de la longue vie, présent dans les chapitres internes, n’est pas donné comme un but en soi : c’est le résultat d’une posture de vie, qui consiste à dire que le Dao fait bien les choses, qu’on n’a pas besoin de se démener pour changer la face du monde. Et que le mieux, c’est de préserver son capital de « souffle vital » (qi) pour vivre le plus longtemps possible.
Et en meilleure santé, avec l’esprit clair ?
Oui, c’est cela, la bonne vie. Dans cette perspective, le stress est évidemment à exclure, le fait d’être constamment dans l’action, de chercher absolument à réaliser tel objectif, etc. Dans le « Zhuangzi », il y a des vignettes célèbres qui illustrent ce propos. Par exemple, au chapitre 17 : Zhuangzi, qui est au bord de la rivière en train de pêcher, est approché par les émissaires d’un roi qui veulent absolument l’enrôler au service de la royauté. Il ne les regarde même pas. Il répond sans se retourner : « Fichez-moi la paix, moi je préfère être comme la tortue qui traîne sa queue dans la gadoue. » C’est tout à fait Zhuangzi, cette posture anti-confucéenne par excellence. Les héros des Confucéens sont des figures comme Yu le Grand, qui domptent les fleuves, se dévouent au bien public et triment jour et nuit… Zhuangzi pense que l’humanité n’a pas besoin de gouvernement. Pour Jean Levi, Zhuangzi est un penseur anarchiste.
Il y a donc chez Zhuangzi des leçons de vie à méditer.
Bien sûr. Et ça va plus loin que le désir de vivre le plus longtemps possible. Il y a aussi des considérations étonnantes sur le langage. La tradition grecque nous a engagés sur la voie du logos, du discours et de la pensée. Or Zhuangzi fait une distinction très nette entre cet effort de pensée que l’on pourrait appeler discursive et une véritable pensée des choses, c’est-à-dire le fait de se sentir en accord avec le déroulement des choses. Le non-engagement selon Zhuangzi va très loin, car même le fait de nommer les choses pour les distinguer (le noir et le blanc, le grand et le petit, le dedans et le dehors, etc.) représente déjà une atteinte à la vie. Car, pour lui, distinguer les choses implique aussi de distinguer le moi du non-moi, le sujet de l’objet, etc. Toutes choses qu’il considère comme nuisibles à la connaissance véritable − laquelle deviendra plus tard, dans le contexte du bouddhisme chan/zen, l’illumination.
C’est donc bien une pensée qui peut aider dans les épreuves ?
Oui. Il y a par exemple au chapitre 18 cette vignette de Zhuangzi, qui vient de perdre sa femme. Un ami passe, le trouve assis par terre, en train de taper sur un pot en chantant à tue-tête. L’ami est très choqué. Et Zhuangzi dit : « Ce n’est pas que je ne suis pas triste, mais à partir de cet être qu’était ma femme, je suis remonté petit à petit vers l’origine. Et cette origine est la même pour tous, nous venons tous de la terre, nous sommes des agrégats de terre, c’est normal que nous y retournions. » On voit là la pensée du changement permanent.
Et face une grande épreuve collective ? Aborde-t-il ce type de cas ?
Oui, mais toujours sur un mode distancié, ironique. Zhuangzi est en plein dans cette idée qu’il faut toujours se situer en amont. L’idée d’être détaché, de ne pas être engagé dans le feu de l’action, ne consiste pas à se mettre simplement à l’écart, mais à réussir à se mettre en amont. Et aussi à se défaire de ses rêves de puissance, de gloire, de richesse… Pour lui, ce sont vraiment ces rêves qui dérèglent le monde. Il les traite par l’humour. C’est une lecture très drôle, le « Zhuangzi ». Il était anti-confucianiste, et je pense qu’aujourd’hui il serait anti-capitaliste.
Tchouang-tseu, le penseur chinois qui savait l’art de déstabiliser
Le Dao de Zhuangzi est-il identique à celui de Laozi ?
Non. Pour tous deux, le Dao est la marche naturelle des choses. Mais Zhuangzi ne le traduit pas en termes politiques. Le Dao, c’est aussi la pensée du changement, et, par conséquent, dans cette marche naturelle des choses, il peut y avoir également des catastrophes, des malheurs, des inondations, des invasions de sauterelles, etc. Mais cela fait partie du cycle naturel des choses. Cela se produit aujourd’hui, certes, mais cela va changer.
Demain est un autre jour ?
Oui, et il apportera autre chose. C’est déstabilisant pour l’esprit occidental avancé, fondé sur des certitudes, sur ce positivisme scientifique qui nous fait croire que tout est prévisible, rationalisable.
Il faut apprendre à vivre dans l’incertitude permanente ?
Ce n’est même pas de l’incertitude, c’est le cours naturel des choses. Surtout que beaucoup des catastrophes que nous vivons sont d’origine humaine. Nous nous tirons des balles dans le pied sans cesse. Par exemple, à force de bétonner la planète, forcément on provoque des inondations. L’idée de Zhuangzi, c’est qu’il faut intervenir le moins possible, le moins possible laisser sa marque.
Ce n’est donc pas une pensée du progrès ?
Non, il n’y a pas de notion de progrès, mais la marche naturelle des choses, qui est pour Zhuangzi une évidence.
Pour lui, la question de la dépression, la déprime, ne se poserait donc pas ?
La déprime, au fond, c’est une frustration intense : je m’imaginais telle chose, je m’étais fait tout un film, mais ça ne se passe pas comme je le souhaite, je n’arriverai jamais à obtenir ce que je veux, etc. Si on vit à la Zhuangzi, on évite cela. Il peut y avoir de la tristesse, mais pas de déprime.
Est-ce une chose importante pour Zhuangzi de vivre proche des autres ?
Si on veut vivre à la manière zhuangzienne, il faut plutôt mener une vie d’ermite. Le sage taoïste, c’est quelqu’un qui est tout seul dans sa montagne.
Il est seul, isolé physiquement ? Ou il peut être avec sa femme, ou avec des amis ?
Le mieux, pour éviter les soucis, c’est de vivre seul. On ne peut s’en prendre qu’à soi-même, il n’y a pas de dispute. Je pense donc que ce sont les avantages d’une vie zhuangzienne qu’un certain nombre de personnes viennent de découvrir à la faveur de la pandémie.
Chez Zhuangzi, il n’y a pas de notion de fin du monde ?
L’apocalypse ne fait pas partie de cette pensée. Notons qu’il existe des mouvements apocalyptiques dans ce qu’on appelle les religions taoïstes, des mouvements millénaristes. Mais ils s’inspirent du « Laozi », chez qui on trouve l’idée que la puissance extrême ne peut que décliner. Il existe donc une possibilité de bascule de la puissance présente. Zhuangzi ne s’intéresse pas à cela.
Comment faut-il comprendre cette parabole si poétique de Zhuangzi rêvant qu’il est un papillon et qui, au réveil, se demande s’il n’est pas un papillon rêvant qu’il est Zhuangzi ?
 Cet épisode figure au chapitre 2, qui traite de la « non-distinction ». En réalité, l’esprit humain passe son temps à distinguer le blanc du noir, etc. On voit cette opposition dans tous les livres pour enfants, dès le premier âge, c’est quelque chose que nous inculquons aux petits dès qu’ils sortent du ventre de leur mère. Et c’est explicitement critiqué sur tous les tons dans le « Zhuangzi ». La distinction entre le rêve et la réalité fait partie de cette réflexion. Qu’est ce qui nous dit, quand nous nous réveillons, que nous ne sommes pas en train de nous réveiller dans le rêve d’un autre ? Nous croyons passer du rêve à l’état de veille, mais qu’est-ce qui nous dit que nous ne sommes pas passés dans un rêve plus grand qui englobe le précédent ?
Cet épisode figure au chapitre 2, qui traite de la « non-distinction ». En réalité, l’esprit humain passe son temps à distinguer le blanc du noir, etc. On voit cette opposition dans tous les livres pour enfants, dès le premier âge, c’est quelque chose que nous inculquons aux petits dès qu’ils sortent du ventre de leur mère. Et c’est explicitement critiqué sur tous les tons dans le « Zhuangzi ». La distinction entre le rêve et la réalité fait partie de cette réflexion. Qu’est ce qui nous dit, quand nous nous réveillons, que nous ne sommes pas en train de nous réveiller dans le rêve d’un autre ? Nous croyons passer du rêve à l’état de veille, mais qu’est-ce qui nous dit que nous ne sommes pas passés dans un rêve plus grand qui englobe le précédent ?
Toute identité s’évanouit alors, et le langage devient très compliqué. Faut-il cesser de parler ?
Ou alors il faut inventer une autre forme d’expression. Et c’est ce que font les artistes, ils s’expriment autrement que par les mots. Ce que la poésie du « Zhuangzi » exprime, c’est l’humain intégré dans un tout. L’humain est une des modalités de la vie sous toutes ses formes. Et la mort, qui fait partie du cycle vital, est d’une certaine façon aussi une forme de vie.
Peut-on donc dire que cette philosophie du passé peut nous éclairer et nous aider dans les temps présents ?
Je vais vous donner une réponse très personnelle : quand mon mari est mort d’un cancer il y a plusieurs années, après s’être battu pendant deux ans et avoir terriblement souffert, je me suis aperçue que tout ce que je savais des philosophies du monde ne m’aidait pas du tout à surmonter la difficulté à vivre la souffrance de l’être aimé. Aucune philosophie que je connaissais – et pourtant, j’en connais quelques-unes – ne m’était d’aucun secours. Après sa mort, je me suis retrouvée dans une solitude insupportable. Zhuangzi et sa leçon de l’accord avec les choses comme elles sont, c’était un peu trop poétique pour proposer une solution radicale. Confucius n’aidait pas. Laozi encore moins. Eh bien, la seule chose qui m’a aidée, ça a été de comprendre en profondeur, et pas seulement théoriquement, la leçon bouddhique de l’impermanence des choses et des êtres. Quand vous lisez cela, vous vous dites : c’est beau, c’est profond. Mais quand vous êtes attaquée dans votre intégrité vitale, vous comprenez qu’avec l’impermanence des êtres et des choses, les bouddhistes ont vraiment compris quelque chose. Le moi, c’est juste un agrégat de phénomènes qui ne demandent qu’à se disperser, à se recombiner autrement, etc. L’idée d’un moi permanent est une illusion. D’où l’idée bouddhique que tout est illusion. Et une personne avec qui on s’imagine vivre, oui, peut disparaître du jour au lendemain. Dans le « Zhuangzi », vous avez aussi cette idée. Mais Zhuangzi dit que la vie vaut la peine d’être vécue. Les bouddhistes, eux, ont bien compris que le désir est quelque chose qui emprisonne, qui rend captif et dépendant.
Zhuangzi, c’est plus joyeux tout de même.
Oui, je le pense. C’est intéressant de voir comment les penseurs chinois ont appréhendé la leçon bouddhique. Cela s’est passé sous les Song [960-1279, NDLR], avec ce qu’on a appelé la « renaissance confucéenne ». Certains auteurs le disent explicitement : tout de même, nous, les Chinois, nous avons cet attachement à la nature, aux montagnes, aux rivières, au shanshui [« paysage » en chinois, littéralement « montagnes et eaux », NDLR]. Que tout cela disparaisse dans une espèce d’illusion généralisée, c’est un peu difficile à accepter. Et donc il y a eu à cette époque une « réinjection » de ziran, de « nature », pour tempérer l’excès de bouddhisme… N’empêche que la Chine a bien assimilé la leçon pendant presque un millénaire. Pas étonnant de voir aujourd’hui le bouddhisme revenir au triple galop.
Propos recueillis par Ursula Gauthier.
Anne Cheng, titulaire de la chaire d’histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France, s’intéresse à l’histoire des idées en Chine et dans les cultures voisines. Parmi ses nombreuses publications dans ce domaine figurent notamment une traduction des « Entretiens de Confucius » et une « Histoire de la pensée chinoise », toutes deux parues aux éditions du Seuil. « La Chine pense-t-elle ? » est une question qu’elle ne cesse de se poser au fil de ses autres publications. La plus récente, « Penser en Chine », est parue en « Folio-Essais » aux éditions Gallimard en 2021. Elle codirige la collection bilingue « Bibliothèque chinoise » aux Belles Lettres.

Ursula Gauthier, L’OBS du 27 juillet 2021
LIRE AUSSI :
Anne Cheng : « En Chine, les intellectuels ne peuvent s’en prendre à l’hégémonie de l’État-Parti »


L’évidence chinoise
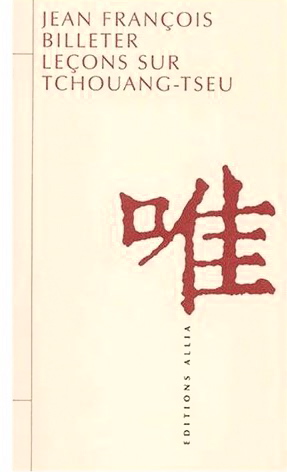
C’est un petit livre, mais on ne s’en lasse pas, on en a pour longtemps à méditer sa fraîcheur, son incongruité, sa justesse. Qui est Tchouang-tseu ? Ce philosophe chinois mort en 300 avant notre ère, cet illuminé taoïste sacralisé par des tonnes de commentaires plus ou moins obscurs, ou bien tout simplement quelqu’un qui nous parle aujourd’hui au plus près de notre expérience la plus commune ?
Jean-François Billeter n’y va pas par quatre chemins : la traduction, rien que la traduction, faisant émerger ce qu’il appelle « l’infiniment proche » ou le « presque immédiat ». Là, ici, tout de suite. Mon corps fonctionne et je ne m’en aperçois pas. Mes gestes me précèdent et me suivent sans que j’y fasse attention. Je me crois une machine, alors que je suis une réserve d’énergie et de forces. Je me laisse réduire, détourner, approprier, classer, user, et le premier coupable n’est autre que moi-même. Je travaille à ma servitude, je pose des questions, j’attends des réponses, au lieu d’éprouver mon autonomie radicale, mon indépendance sans consolation ni soumission.
Tchouang-tseu penseur dangereux pour toutes les habitudes et tous les pouvoirs ? Mais oui, et c’est peut-être un Occidental d’aujourd’hui, mieux qu’un Chinois, qui peut en tirer le meilleur parti, loin de tout exotisme orientaliste ou d’un charlatanisme ésotérique. Un éveil aux choses mêmes, à leur fonctionnement, à leur art.


La Chine en direct

Le Monde du 19.03.04.
Archives A.G. ZOOM : cliquer sur l’image.

Récemment, dans ses Leçons sur Tchouang-tseu, Jean-François Billeter se donnait comme horizon « de remettre l’histoire des idées chinoises sous tension, de la remagnétiser. Il pourrait en résulter avec le temps un changement de perspective considérable ».
Et voici un premier résultat d’années de méditation, de traductions, de compréhension intime : Etudes sur Tchouang-tseu, livre admirable et incontournable, comme si la pensée chinoise fondamentale se mettait à vivre là, directement, sous nos yeux. On croyait la connaître, mais non, des tonnes de commentaires nous la cachaient en l’alourdissant, en la recouvrant d’obscurités et de clichés conformistes et intéressés. Tchouang-tseu ? La simplicité, la clarté, la subversion même. Un philosophe ? Sans doute, mais pas au sens où nous l’entendons. « Les interrogations de Tchouang-tseu, dit Billeter, communiquent avec les nôtres sur des points essentiels. » Une méthode nouvelle pour s’approcher de lui ? Oui, « partir du texte, le retraduire et voir où il mène. » Et voilà le grand art : montrer, en français, que ces dialogues, ces mises en scène nous parlent de notre vie la plus quotidienne, de notre liberté en acte, de notre soumission humaine, trop humaine, à la domination de tous les pouvoirs.
Dès le début (IIe siècle avant notre ère), « le Tchouang-tseu » est fragmenté, interprété, vite mis en perspective par ce que Billeter appelle « l’idéologie impériale », laquelle, selon lui, se perpétue dans son aveuglement jusqu’à nous. Un libre discours ne contient aucune justification du pouvoir quel qu’il soit ? Il faut donc le canaliser, le rendre religieux ou métaphysique, idéaliser son auteur, le simplifier, le transformer en conservateur éthéré (pour l’aristocratie lettrée) ou en relativiste sceptique, mystique, subjectiviste réactionnaire (pour les marxistes). Mais le problème n’est pas là. « Dans sa vision des choses, écrit Billeter, le social est en soi un mal inévitable, nécessairement régi par le mimétisme et par le conflit. Tchouang-tseu est pessimiste, mais il n’est pas cynique. Il n’enseigne pas que le prince a le droit, ou même le devoir, d’utiliser à ses propres fins la logique du pouvoir, comme l’ont fait les penseurs « légistes ». En dépit d’un préjugé tenace qu’on nourrit en Chine depuis le début de l’ère impériale, Tchouang-tseu n’enseigne pas non plus l’indifférence à l’égard de ce mal. Il l’étudie au contraire de près parce qu’il estime possible de le défaire ponctuellement, d’abord en soi-même et parfois chez d’autres. C’est tout ce que peut faire l’homme, selon lui. C’est à la fois peu de choses et très considérable. »


LIRE SUR PILEFACE (sélection — par ordre de publication) :
 Sollers et la trame des mutations : Passion fixe
Sollers et la trame des mutations : Passion fixe
 Qui est Tchouang-tseu ?
Qui est Tchouang-tseu ?
 Tout tient dans ce mot, dao...
Tout tient dans ce mot, dao...
 CD - Déroulement du Dao
CD - Déroulement du Dao
 L’Art de la guerre
L’Art de la guerre
 Le papillon de Zhuangzi
Le papillon de Zhuangzi
 Analyse taoïste de « l’Ecole du Mystère » de Sollers
Analyse taoïste de « l’Ecole du Mystère » de Sollers
 Jean-Michel Lou, L’autre lieu, De la Chine en littérature
Jean-Michel Lou, L’autre lieu, De la Chine en littérature




 Version imprimable
Version imprimable


 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


