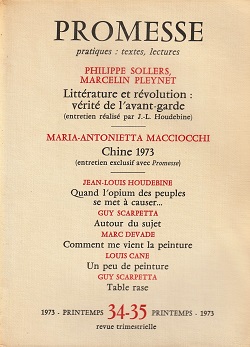 |
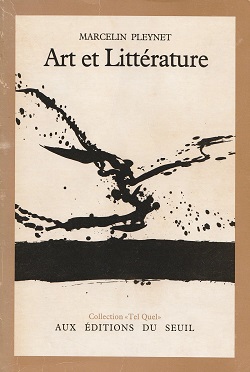 |
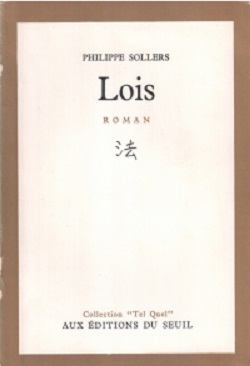 |
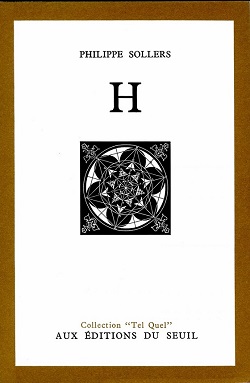 |
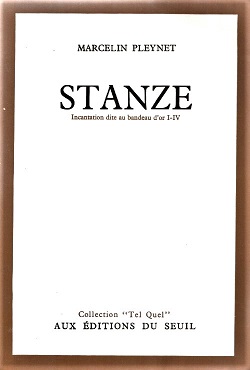

Cet entretien a été réalisé par Jean-Louis Houdebine [1] à Paris, le 24 février 1973. Publié dans la revue Promesse n° 34-35 (avril 1973) [2] sous le titre : « Littérature et révolution : vérité de l’avant-garde », il n’a jamais été repris dans les volumes d’essais de Philippe Sollers, il n’a été réédité que dans Art et littérature de Marcelin Pleynet en 1977. Il faisait suite à « Dès Tambours », une longue étude que Pleynet avait consacrée au roman de Sollers Lois. Il était accompagné de cette note :
Cet entretien reste évidemment marqué par les illusions qui étaient encore les nôtres à l’époque quant à la révolution chinoise. On le lira en tenant compte de notre position actuelle (1977) insistant sur l’expérience de l’écrit insubordonné en tout sens. (M. P., Ph. S., J.-L. H.) (je souligne. A.G.)
J’avais cité un court extrait de cet entretien dans Sollers, Lu Xun, même combat quand Jean-Michel Lou avait publié Corps d’enfance corps chinois, le premier essai entièrement consacré au rapport de Sollers avec la Chine et la pensée chinoise. Pourquoi le republier dans son intégralité aujourd’hui ?
Philippe Forest dans son dernier essai — Rien n’est dit. Moderne après tout — écrit : « L’époque voudrait nous convaincre que la modernité, c’est fini. Qu’il faut en revenir aux canons, et au bon vieux récit, celui qui plaît, celui qui enchante le public. Comme si rien ne s’était passé, précisément, avec ces avant-gardes dont on ne peut pourtant contester qu’elles ont animé le XXe siècle. » Eh bien, voilà : si ce constat est vrai (et il est vrai), cela me semble mériter qu’on y regarde de plus près. « Non pas pour ressusciter les avant-gardes d’autrefois » écrit encore Forest dans un article récent Moderne ? Absolument ! « La chose n’est ni possible ni souhaitable. Il faudrait, d’abord, que renaisse la croyance en l’idée révolutionnaire. Et on sait bien que l’expérimentation pour l’expérimentation, lorsqu’elle se fossilise, tourne à l’académisme le plus creux et le plus affligeant. Comme le notait Guy Debord, le mieux que l’on puisse attendre d’une avant-garde, c’est qu’elle ait fait son temps ».
Chaque mot doit ici être pesé... et interrogé. La notion d’avant-garde, au XXe siècle, du surréalisme ou des avant-gardes soviétiques (années 20) à Tel Quel, en passant par le situationnisme (années 60-70), est en effet liée à « l’idée révolutionnaire ». Une certaine idée révolutionnaire qu’on peut elle-même qualifier avec Jean-Claude Milner de « croyance révolutionnaire » [3]. En quoi consistait cette croyance révolutionnaire ? Selon les époques, et finalement quelle que soit l’époque, en une croyance à la révolution socialiste (la révolution d’Octobre en URSS) ou la révolution culturelle (la révolution chinoise pour les écrivains et artistes de Tel Quel réunis autour du « mouvement de juin 1971 » [4]) ou une révolution anarchiste/communiste (pour Debord et l’Internationale situationniste). De ces avant-gardes, on peut effectivement dire avec Debord — je cite la phrase exacte : « Les avant-gardes n’ont qu’un temps ; et ce qui peut leur arriver de mieux, c’est, au plein sens du terme, d’avoir fait leur temps » (c’est Debord qui souligne. Cf. Guy Debord, « In girum imus nocte », Oeuvres cinématographiques complètes, Gallimard, 1994, p. 266.).
Nous sommes aujourd’hui dans une période particulièrement réactionnaire. Il est de bon ton de renvoyer les avant-gardes dans « la poubelle de l’histoire ». De certaines expériences révolutionnaires, le contemporain, revenu de tout, dit qu’elles sont datées, il oublie qu’elles ont fait date. « Transformer le monde, a dit Marx ; changer la vie, a dit Rimbaud : ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un », disait Breton. Vous rêvez. Au fond, ces écrivains ne se sont-ils pas tous trompés ? Pourtant, les « illusions » passées (quant à la révolution chinoise et au « marxisme »), ni Sollers ni Pleynet n’ont jamais renié ce que la pensée et la poésie chinoises (et même Mao) avaient pu apporter à leur conception et à leur pratique de la littérature et de la poésie. Quant au mot de révolution, je me contenterai de rappeler comme l’avait déjà remarqué Jacques Henric dans un entretien de 1996 (cf. « Le temps où nous sommes », Éloge de l’infini, folio 3806, p. 1043) qu’il n’a jamais été abandonné par Sollers, au contraire, même si son sens a été, au fil du temps, considérablement repensé et enrichi (cf. Pour célébrer la vraie révolution française (1989) et Qu’est-ce qu’une révolution ?). Et si, en fin de compte, tout était à repenser selon la formule énigmatique de Rimbaud en son temps (qui n’est pas que le temps de la Commune) : « En Grèce, ai-je dit, vers et lyres rythment l’Action. [...] La poésie ne rythmera plus l’action : elle sera en avant [5] » ?
Dans l’entretien « Littérature et révolution : vérité de l’avant-garde », je retiens, quant à moi, entre autres, l’insistance mise sur la notion de sujet (détaché de toute connotation psychologique ou subjective, de toute subjectivité métaphysique) : elle était déjà au coeur des interventions de Sollers (et de Kristeva) lors du colloque de Cerisy « Artaud, Bataille : Vers une révolution culturelle » qui s’était tenu quelques mois auparavant. Elle le sera explicitement dans Femmes dix ans plus tard [6]. Vous noterez aussi la constante référence aux écrits de Freud, de Lacan, d’Artaud, de Lautréamont, de Joyce et de Hölderlin qui ne sera jamais démentie par la suite. Référence qui permet de définir le nouveau : « le nouveau dont nous parlons, c’est un nouveau qui doit se penser par rapport à la négation, qui fonctionnerait en somme comme négation de la négation, c’est le processus où il se constitue, qui nous permet en même temps de définir aussi la fiction. » (Marcelin Pleynet)


LITTÉRATURE ET RÉVOLUTION
VÉRITÉ DE L’AVANT-GARDE
VOIR SUR PILEFACE
JEAN-LOUIS HOUDEBINE : Mars et avril 1973 : Philippe Sollers, vous publiez H, et vous, Marcelin Pleynet, Stanze ; des passages importants de ces deux livres avaient déjà été donnés dans Tel Quel 40 (« Incantation dite au bandeau d’or »), et dernièrement dans Tel Quel 51 (« Das Augenlicht » et « Travestilait »), en après-coup immédiat de la décade de Cerisy organisée par Tel Quel l’an dernier (Artaud, Bataille : Vers une révolution culturelle). Comment vous semble devoir se caractériser la situation socio-politique idéologique dans laquelle viennent aujourd’hui s’inscrire vos livres ? Ceci en rappelant que Lois, paru l’an dernier, traçait déjà, et continue de tracer avec force, cette ligne de rupture positive dont le « Mouvement de juin 71 » a constitué par ailleurs un moment d’expansion idéologique-politique particulièrement important.
PHILIPPE SOLLERS : La rupture qui a été accomplie par la partie réellement productive de Tel Quel, c’est-à-dire en définitive par les pratiques les plus avancées à l’intérieur de Tel Quel, il serait tout à fait erroné de la voir, comme d’ailleurs le souligne l’éditorial de notre dernier numéro (Tel Quel 53) [7], comme exclusivement déterminée par une situation politique. L’enchevêtrement, et la complexité de cette rupture, demandent une analyse serrée : parce que précisément il est de l’intérêt de ceux qui ont été pris de court par cette transformation, de la faire passer exclusivement pour un « virage » politique conjoncturel, voire anecdotique. En fait, il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps pour comprendre ce qu’a été une certaine accumulation quantitative à Tel Quel, et donc, aussi, le saut qualitatif qui s’est produit, et à plusieurs niveaux à la fois. Il faut revenir là-dessus, car si l’on ne tenait pas compte que tout, dans notre pratique, est déterminé par les obstacles que nous rencontrons sur notre route, ces obstacles étant eux-mêmes produits par le creusement et l’avancée mêmes de ce que nous produisons, obstacles trouvant immédiatement leur soutien dans les forces sociales, politiques et idéologiques qui n’ont pas intérêt à cet avancement de notre pratique — si on ne comprenait pas cette reconduction permanente des résistances que nous traitons, on ne pourrait comprendre grand-chose à ce qui se passe à Tel Quel. Je dirai que la véritable raison, du point de vue de notre pratique spécifique, de cette cassure de 1971, qui est apparue de façon spectaculaire comme une rupture politique, c’est l’antagonisme irréductible qui s’était manifesté, à l’intérieur même de Tel Quel, entre deux conceptions de la pratique du langage. A partir du moment où ces deux conceptions, l’une formaliste, profondément fermée sur une appréciation positiviste, abstraite, du langage, et l’autre essayant de dégager une autre dimension, sont entrées l’une par rapport à l’autre dans un antagonisme irréductible, la crise politique et idéologique a pris toute son extension ; et ceux qui aujourd’hui voudraient masquer cet aspect, cette vérité profonde du problème, par tel ou tel artifice politique, que ce soit du point de vue opposé, ou de notre propre point de vue, manqueraient la causalité déterminante de cette crise.
Avec quoi avons-nous rompu ? Avec un statut de notre pratique spécifique qui aurait consisté dans sa mise en tutelle. Mise en tutelle de la part du savoir universitaire, surtout depuis mai 68 — car tout ici part de l’ébranlement de mai-juin 68 : la longueur d’onde a mis un certain temps à se déclencher au niveau de notre pratique, mais la crise est à dater de là —, et mise en tutelle de la part, disons, de la politique institutionnelle. On peut dire que ces deux appareils avaient cru pouvoir considérer que Tel Quel, c’est-à-dire finalement des forces de travail portant sur le langage de la modernité, pouvait être en quelque sorte transféré dans leur processus de réforme.

Manifestation place Tian-An-Men, le 4 Mai 1919.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Et je ferai ici un rappel de ce qu’a pu être le Mouvement du 4 mai 1919 en Chine, car ce qu’on a peut-être oublié de constater, c’est que ce mouvement qui a précédé de deux ans la création du parti communiste chinois, et qui a été impulsé par les étudiants et les intellectuels, a trouvé sur son chemin, immédiatement, une réaction formaliste, comme dit très bien Mao Tsé-toung, qui a donné par la suite le style stéréotypé dans le mouvement révolutionnaire. Ce style stéréotypé, dit Mao, a été une réaction contre le Mouvement du 4 mai. Et je pense que ce qu’il faut analyser aujourd’hui, c’est tout ce qui fait réaction à la charge révolutionnaire de mai 68. Rupture, donc, avec le savoir universitaire, en relation d’ailleurs avec l’institutionnalisation politique, nommément révisionniste, puisque comme chacun sait, le pcfr [8] est devenu le gestionnaire de la culture bourgeoise, et que le trafic entre le savoir universitaire, en position de croyance de domination sur les différentes pratiques de langage, et l’institution politique révisionniste, réformiste, rendait quasiment impossible toute continuation de la recherche d’avant-garde et de notre pratique spécifique même. J’ajoute que cette crise ne nous a pas pourtant mis sur des positions d’ultra-gauche, comme certains ont pu un moment le croire ou l’espérer ; c’est-à-dire que si nous avons rompu avec l’institution du savoir universitaire, qui aurait été notre tuteur, pour lequel nous aurions travaillé dans notre pratique, et si nous nous sommes éloignés de cette institutionnalisation politique réformiste, ce n’est pas pour rentrer dans le cercle fermé des différentes édifications groupusculaires à langage dogmatique, ceux dont Mao dit très bien que, devenus des phonographes, ils oublient que leur devoir est d’apprendre du nouveau et de créer du nouveau. La situation se complique du fait que ces réactions dogmatiques à la liquidation réformiste et à cette sorte de monnayage du savoir vidé de ce qu’aurait pu être la leçon réelle de la crise de l’Université et du savoir en mai 68, sont en grande partie reprises en charge par des groupements révolutionnaires qui formulent, à l’égard des intellectuels et notamment des écrivains d’avant-garde, des exigences nettement au-dessus de leurs moyens, et qui sont incapables d’apprécier la conjoncture actuelle, laquelle exige au contraire une stratégie très souple, de type « démocratie nouvelle », justement, ainsi que Mao la définit ; et on ne peut que constater, entre ce point de vue dogmatique et l’appréciation concrète de la situation réelle pour nous, une différence nette. Il n’en reste pas moins que cette nouvelle transformation de 71 a désorienté profondément toutes les forces qui avaient cru pouvoir se servir de Tel Quel, exploiter notre pratique, dans un but de censure, de bouchage de notre expérience ; c’est si vrai que ce désarroi continue de se traduire par des attaques très vives, réactionnaires, et je n’en prendrai qu’un exemple, au niveau du pcfr : celui de Thibaudeau qui monnaye servilement sa carrière de bureaucrate révisionniste en calomniant ses anciens amis. Je dois dire à ce propos que du monarchisme de ses débuts littéraires (voir son premier livre, Une cérémonie royale) à son rôle actuel de dénonciateur de l’avant-garde, une certaine boucle, archaïque, régressive, me semble bouclée. Autres résistances : celles qui viennent du bavardage spéculatif qui avait cru trouver dans Tel Quel une plate-forme de publication et qui a mené un travail de sape constant pour que ce qui n’a jamais cessé précisément d’être le point de vue déterminant de Tel Quel, à savoir la pratique d’avant-garde littéraire, soit éjecté de son poste de décision ; je fais allusion ici aux interminables dissertations philosophico-parascientifiques qui n’auraient demandé qu’à ronronner à longueur de temps dans cette revue, alors que les membres les plus avancés de Tel Quel au niveau de la pratique d’avant-garde ont tout de suite compris que tout ce que proposaient ces dissertations n’avaient plus rien à voir avec l’apparition des phénomènes nouveaux de la vie sociale qu’eux-mêmes, dans la transformation pratique de leur langage, s’attachaient à refléter. Ce qui détermine la rupture, et qui se reflète dans les publications qui vont avoir lieu, c’est quelque chose qui porte sur un point décisif : les transformations de la langue en fonction de ces nouveaux phénomènes apparaissant dans la vie sociale, transformations qui auront, dans les années à venir, des effets de démarcation entre l’ancien et le nouveau tout à fait importants ;
et là encore je ferai remarquer que l’ébranlement marqué en Chine par le Mouvement du 4 mai est déterminé très soigneusement par Mao comme quelque chose qui a été une nouvelle façon de parler, d’écrire, de refléter le nouveau dans la société, dans l’histoire : le grand mérite de ce mouvement du 4 mai, dit Mao, « est d’avoir arboré à ce moment-là à la fois le drapeau de la lutte contre l’ancienne morale pour la nouvelle, et celui de la lutte contre la nouvelle littérature contre l’ancienne ; toutefois ce mouvement culturel n’avait pas encore la possibilité de s’étendre aux masses ouvrières et paysannes » [9], ce qui semble bien recouper la situation où nous sommes actuellement en France.
MARCELIN PLEYNET : Dans la perspective de ce que vient de dire Sollers, je voudrais formuler quelques remarques générales qui me semblent importantes dans cette mise en place du nouveau, ou si vous préférez, en ce qui concerne le fond idéologique sur lequel cette mise en place du nouveau s’appuie. Il me semble que dans le champ idéologique qui est le nôtre s’est constitué à la fois une sorte d’optimisme politique et une véritable théologie marxiste. Ce qui me paraît intéressant dans cette constatation, et qui ne paraîtra pas orthodoxe bien évidemment, c’est que si on prend ce problème au moment où il se noue, c’est-à-dire au moment où Marx peut en produire la synthèse historique, il se produit à ce moment-là un phénomène nouveau, dans l’histoire, dans les stades historiques que Marx détermine, à savoir le conflit, tout à fait nouveau, entre la bourgeoisie et le prolétariat et tel qu’il vient bouleverser complètement cette sorte de vérité transhistorique que la bourgeoisie veut représenter ; mais si ce nouveau, à ce moment-là, est vraiment nouveau, et il l’est, fondamentalement, il est bien évident qu’on ne peut qu’à peine aujourd’hui encore en apprécier les effets de nouveauté. Ce qui se marque là, et à partir d’une lecture de ce que peut être l’apport que Mao Tsé-toung est le seul à marquer dans ce champ-là, c’est le fait que cette nouveauté, on va peut-être prendre dix mille ans à la découvrir et qu’elle vient de naître ; et c’est bien ce qui nous a conduit à opérer notre rupture avec le révisionnisme, avec un académisme marxiste, et ce qui permet de penser qu’à travers toutes les réalisations positives, concrètes, que cette lutte a marquées, il y a aussi des phénomènes qui n’ont pas été interrogés, justement dans cet optimisme, bien entendu tout à fait justifié, que la pensée de Marx, et ensuite celle de Lénine, ont pu développer : il me semble qu’il y a eu ainsi pas mal de refoulé, même à travers les réalisations positives, refoulé qu’on peut lire aujourd’hui dans les conséquences logiques qu’il produit en Russie et dans la grande majorité des partis communistes occidentaux sous la forme du révisionnisme ; on tient par là un rapport qui peut justement, dans le cadre d’une appréciation de la situation politique actuelle, ne pas être versé du côté d’une analyse académique : c’est-à-dire que le travail, depuis Marx, en est véritablement à ses premiers pas, à son commencement ; ce que par exemple on peut noter, et dans le champ qui est spécifiquement le nôtre, le champ idéologique, c’est que si, apparemment, et avec des effets spectaculaires, importants, et positifs, on a pu voir des transformations considérables sur le plan économique et sur le plan politique, on peut dire en revanche que, dans le champ idéologique, l’idéologie bourgeoise maîtresse de ce champ a été troublée, mais qu’elle n’a pas connu réellement la révolution que par ailleurs, dans certains cas, on pouvait remarquer sur le plan politique et sur le plan économique. Or qu’est-ce que cela signifie ? Peut-on encore appeler « révolution » une transformation se situant sur le seul plan économique ou politique, et qui laisse subsister à côté tout un champ de la pratique sociale, le champ idéologique, qui, parce qu’il n’a pas produit la révolution qu’il doit produire, reste encore en ses points les plus stratégiques aux mains de la maîtrise académique ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les autres révolutions se trouvent historiquement, jusqu’à ce que Mao apporte là de fondamentalement nouveau, d’une certaine façon aux mains de la bourgeoisie. Ceci, si l’on veut comprendre la tactique et la ligne politique des interventions de Tel Quel.
LE SUJET
- Les mécanistes (Althusser) nient le sujet pour conserver en eux, enfoui, enterré, ce dont les idéalistes se servent comme "au-delà". [...] Faire du sujet un dehors transcendant ou le nier, revient du point de vue du matérialisme dialectique, à une négation de la dialectique. [...] Il y a des pensées qui se définissent par une négation-dénégation (X sans Y : procès sans sujet etc...), et qui répètent mécaniquement cette négation. Or la négation de la négation, loin d’être un masque de la transcendance, ouvre sur la pluralité des contradictions, le procès de la contradiction (avec du sujet, c’est-à-dire une dialectique complexe entre objectif et subjectif) [...] Si le sujet est seulement pour vous une illusion idéaliste (...), ne nous parlez pas de la découverte scientifique de Freud.
Ph. Sollers, Sur le matérialisme, 1974.
PH. SOLLERS : Exactement. Je pense qu’il faut insister sur le fait que nous n’avons pas encore vu le commencement de Marx, et je dirai qu’il en est de même du commencement de Freud. Ce n’est certainement pas un hasard si aujourd’hui, et dans les dernières années, a pu se produire un déblocage minimal de la théorie marxiste avec Althusser, c’est indéniable, mais déblocage qui, pour des raisons politiques évidentes à qui veut bien en faire l’analyse, est resté très inférieur à celui qui s’est produit, par exemple, de la part de Lacan sur Freud. S’il est vrai, ce que je crois, que Lacan commence Freud, et ce n’est pas du tout une simple question de « lecture » — si cela est vrai, donc, l’ambiguïté du « commencement » du marxisme à travers Althusser apparaît immédiatement, car ce « commencement » ou ce « re-commencement » devrait être fondamentalement lié au nouveau historique, idéologique et théorique apporté par Mao Tsé-toung et, en conséquence, si ce « re-commencement » n’apprécie pas ce nouveau, dans le réel, il reste un raté de « re-commencement ». Or c’est bien ce que définit aujourd’hui l’illusion théorique et politique d’une position à l’intérieur du parti révisionniste, liée d’ailleurs, et ce n’est pas un hasard, au savoir universitaire, à l’impossibilité de se décrocher d’avec ce parasitage du discours universitaire et d’avec l’institutionnalisation d’une organisation politique en dépérissement objectif, même si elle a l’air de maintenir ce corps mort qu’est sa structure ancienne, vidée de son contenu : c’est par là qu’on peut voir que ce « re-commencement » reste en question, profondément en question. Et je voudrais ajouter que nous maintenons, quant à nous, notre analyse du révisionnisme en fonction du dogmatisme, c’est-à-dire d’un dogmatico-révisionnisme, thèse qui a immédiatement déplu à tous ceux qui croient que pour combattre le révisionnisme il suffit de s’en tenir aux principes purs et durs d’un dogmatisme qui aurait été malheureusement trahi, et c’est la question, nommément, du rôle extrêmement négatif du stalinisme, question à laquelle personne ne peut se dérober, puisque nous pensons que le nouveau apporté par Mao sur ce plan, c’est un combat mené à la fois contre le dogmatisme et contre le révisionnisme, lutte très tortueuse, sinueuse, dont la révolution culturelle, ses suites, ses paliers qui se dégagent dans la pratique même des masses chinoises, montre bien que là est le problème. Cette illusion, que l’on pourrait « re-commencer » le marxisme, en poser les problèmes fondamentaux, tout en restant lié au discours universitaire et à un appareil politique doublement vidé de son histoire et de son contenu pour n’y être jamais rentré vraiment, autrement dit, cette illusion qu’il y aurait encore dans le parti révisionniste une gauche interne externe possible, c’est la méconnaissance à la fois du nouveau produit historiquement et théoriquement par Mao, intraitable par le discours du savoir universitaire codifié par la bourgeoisie, et qui pèsera encore longtemps de tout un poids qui est son héritage traditionnel ; c’est aussi la méconnaissance en profondeur de ce nouveau, de cet autre nouveau qu’est le commencement de Freud, avec cette question du sujet que nous posons avec insistance. On voit bien l’impossibilité dans laquelle se trouve un éventuel « recommencement » du marxisme de se situer à ce niveau-là. Si nous reprenons constamment cette question du sujet, c’est précisément pour combattre à la fois la dégénérescence économiste d’un « marxisme » qui ne l’est plus que de nom, et le mécanisme théoriciste incapable de poser les problèmes sur le plan de la pratique réelle et en dehors d’un discours lui-même clôturé, circonscrit par la découverte freudienne (ce qui donnera les théories du « procès sans sujet », etc.). C’est enfin pour combattre le subjectivisme inhérent au dogmatisme et au sectarisme, c’est-à-dire une vieille façon de poser l’analyse des contradictions historiques et sociales.
M. PLEYNET : On peut en effet poser la question : pourquoi le nouveau et l’avenir du marxisme est-il aujourd’hui déterminé par la Chine ? Plusieurs aspects dans la réponse qu’on peut apporter à cette question : tout d’abord, si l’on regarde les deux grandes révolutions sociales qui se produisent aussi bien en Russie qu’en Chine, on constate que la base est paysanne, et qu’elles ratent pratiquement partout ailleurs. Que se passe-t-il alors sur cette base paysanne ? On a immédiatement, en même temps, comme théorie de cette révolution, la réflexion de Lénine, et une transformation qu’on pourrait dire sociale interne à la Russie, avec Staline, c’est-à-dire avec le dogmatisme et pratiquement le refus de l’interrogation de Lénine ; mais pourquoi aujourd’hui ce qui s’est produit là et ce qui s’est bouché dans le champ occidental, pourquoi cela se produit-il et se déplace-t-il en Chine ? Et sur la même base : Mao s’appuie sur les masses paysannes, et ce faisant produit une théorie qui reprend et transforme le travail opéré par Marx et celui opéré par Lénine, travail qui nous revient aujourd’hui et nous pose évidemment des questions considérables face à ce qu’est devenu le marxisme en Occident ; face aussi à notre situation concrète, puisque nous n’allons pas pouvoir nous appuyer sur des masses paysannes : nous sommes dans un pays bourgeois, de capitalisme libéral avancé ; et le problème qui se pose à nous, comme le disait Sollers tout à l’heure, c’est celui du sujet, et nous n’allons pouvoir éclairer, déterminer l’investissement idéologique dont chaque sujet est porteur qu’à travers un type d’analyse qui lui aussi, et par rapport justement à l’intervention marxiste, est profondément nouveau, à savoir Freud. Je crois qu’on a là une structure très précise, qui à la fois prend en considération l’apport unique jusqu’à maintenant dans le champ marxiste, de Mao Tsé-toung, et qui permet de penser cet apport de l’intérieur d’un sujet forcément investi par l’idéologie bourgeoise.
PH. SOLLERS : Il faut le préciser : qu’est-ce que ça a été, les crises de Tel Quel ? Évidemment toujours des crises politiques, entre une droite et une gauche, depuis le début ; mais plus fondamentalement, pour comprendre plus en profondeur le sens et l’enjeu de ces crises politiques, je dirai que ça a été le rapport à Freud. Toutes les crises qui se sont déclenchées à Tel Quel ont été simultanément des crises politiques et des crises sur le rapport à Freud ; il n’y a pas un seul membre de Tel Quel, qui ait quitté Tel Quel ou qui se soit dressé contre Tel Quel, avec telle ou telle option politique, sans qu’il s’agisse en fait, de sa part, d’un refus de considérer la théorie freudienne. Si on pense qu’intervient là, et de façon déterminante, une pratique qui est la pratique « littéraire » ; à savoir une pratique de langage, qui dégage le sens de toutes nos positions, de toutes nos transformations, on voit très bien que le nœud de tous les problèmes s’inscrit dans la question de la découverte freudienne, jusque et y compris dans la rupture de 1971, puisque en même temps que se déroulait une lutte politique intense contre une droite liée à un certain nombre d’options révisionnistes-réformistes, se développait également une lutte théorique pour décider si oui ou non la question de Freud serait abordée dans son tranchant ou si l’on en resterait à des approximations « philosophiques » ; et c’est là-dessus que la décision, en effet, s’est faite. Il est probable qu’il en sera de même dans les développements qui s’annoncent ; peut-être avec une orientation de gauche en apparence, et pas tellement de gauche en réalité : car le problème du rapport à Freud sera probablement, une fois de plus, le point déterminant.
M. PLEYNET : C’est précisément sur ce point que je voudrais insister ; car on pourrait croire que dans les remarques que nous venons de formuler, nous nous adressons uniquement au révisionnisme ; mais il est clair que nous pouvons adresser ces mêmes remarques au dogmatisme, certes sous une autre forme, mais toujours à partir de Freud. Par exemple : j’ai employé souvent le mot « bourgeois » ; c’est devenu étrangement banal, on trouve ça dans toutes les feuilles de chou ronéotypées ou imprimées ; or ce que je tiens à préciser, et que certains ont toujours tendance à oublier et c’est bien pourquoi il faut y revenir (c’est toujours là, cela fait partie de notre histoire), c’est que le stade historique constitué par la bourgeoisie a été positif, et qu’il faut se garder de culpabiliser ce problème de la bourgeoisie, ou d’appartenance à la bourgeoisie ou à la petite bourgeoisie, car le culpabiliser, c’est encore un phénomène d’introjection de l’idéologie bourgeoise, c’est la servir encore d’une façon ou d’une autre ; et je crois qu’on assiste précisément dans le dogmatisme à une réaction de ce genre, qu’une lecture de Freud doit démasquer.
PH. SOLLERS : Le discours dogmatique, et nous en avons pratiquement chaque jour les preuves concrètes, est toujours l’indice de problèmes sexuels. Il faut absolument le dire, car on ne doit pas compter sur nous pour faire semblant de ne pas nous en apercevoir. Et c’est vrai aussi, non seulement des discours dogmatiques, mais aussi des discours droitiers, qui échouent à se mesurer à la réalité pratique, concrète, et qui sont toujours ailleurs que là où ils croient être. C’est cela que nous critiquons : les sujets de ces discours ne parlent jamais de l’endroit où ils sont, de leur pratique concrète, c’est d’ailleurs pour cela qu’ils ont si peu envie que la question du sujet soit abordée, car à ce moment-là, ça en dirait long sur leur façon de parler toujours d’un autre lieu que celui où ils sont réellement. Cela est vrai du discours droitier, disons plus exactement, des discours spéculatifs-régressifs, dans la mesure où ce qui se marque en eux, c’est leur incapacité à se mesurer à des pratiques d’avant garde, des pratiques de langage (que ce soit Artaud, Bataille, Joyce, etc.), ce qui révèle ce manque philosophique, venant de philosophes, à se mesurer à ces pratiques, et qui est au fond leur méconnaissance du freudisme, au niveau de la théorie comme de son application.
J.-L. HOUDEBINE : Nous voici donc conduits à envisager le rôle politique de votre travail de fiction. L’éditorial de Tel Quel 53 l’affirme clairement : « La force politique qu’emprunte la fiction du moment transformateur de la rencontre de l’histoire avec la science, telle est la leçon que l’avant-garde doit tirer de son expérience et de sa pratique. » Il est à cet égard évident que vos livres relèvent précisément de cette pratique nouvelle, inédite, instaurant un nouveau rapport entre littérature, science, philosophie : pourriez-vous essayer de définir ce rapport ? Plus exactement : puisqu’il ne s’agit pas bien sûr de ces types de « décloisonnements » interdisciplinaires chers à tous les éclectismes, mais bien d’une pratique dialectique maintenant l’hétérogénéité des champs sondés et convoqués, et donc de leur lutte, comment, concrètement, cette dialectique se pratique-t-elle, dans la langue ? Et comment peut-elle être dite faire partie intégrante de la lutte politique et idéologique ? Ce qui est poser, précisément, cette question de la fiction comme remplissant aujourd’hui une fonction politique irréductible, et du rôle joué par une avant-garde esthétique (et sans doute plus particulièrement littéraire) dans le procès général des luttes de classes.
PH. SOLLERS : J’ai envie de répondre tout de suite par une phrase de Bataille qui écrit : « La vérité que poursuit la science n’est vraie qu’à la condition d’être dépourvue de sens, et rien n’a de sens qu’à la condition d’être fiction. » Car, finalement, toutes les positions que nous allons avoir, toutes les transformations et publications que nous allons faire, comment va-t-on s’en défendre ? En méconnaissant ce qui est leur détermination principale, c’est à-dire la transformation de la langue, car c’est de cela, en fait, qu’il s’agit. On verra ça dans quelques années. Je pense que la coupure que nous sommes en train d’introduire pourra prouver, dans une dizaine ou une vingtaine d’années, et d’une façon très précise, qu’il y a eu à un moment donné quelque chose qui s’est produit à l’intérieur d’une langue morte et qui aura donné une langue vivante. Qu’est-ce que cela veut dire ? Que tout ce qui se concentrait, dans le reflet de la fiction, dans le reflet « littéraire », était soumis à un refoulement donnant une langue morte à sujet absent. Eh bien, il s’est produit une explosion, et cette explosion est datable, elle suit de peu un ébranlement important dans les pays capitalistes avancés, du type de celui qui s’est produit en France en 1968 ; cela veut dire que cette explosion fait passer une langue morte (assimilable, si vous voulez, à un bas-latin), à une langue tout à coup vivante, et que si cette langue est vivante, c’est qu’il s’y produit précisément du sujet, et que s’il s’y produit du sujet, dans cette langue vivante, c’est précisément qu’une barrière d’inhibitions a été levée, et que brusquement un immense continent, pluriel, de problèmes nouveaux, à effets rétroactifs, historiques, surgit dans cette langue. Il est évident qu’on ne peut pas séparer la façon dont ça parle de ce dont ça parle ; et je crois qu’il sera notable que, dans les années 1970 de notre culture, brusquement ça s’est mis à parler, et que ça s’est mis à parler de choses dont on n’avait jamais entendu parler, et à en parler également d’une façon qu’on n’avait jamais entendue.
Je crois que cette datation que l’on pourra faire dans un certain temps, car nous allons évidemment subir une censure profonde comme un cimetière, sera facilement connectable, pour l’historien, — c’est-à-dire pour l’historien qui se mêlera pratiquement de la découverte du nouveau dans l’histoire —, avec les grandes transformations socio-historiques de la fin du XXe siècle. Elle sera connectable avec le décentrement historique que connaît notre culture, avec le surgissement de l’Asie dans la problématique historique mondiale, avec les progrès fulgurants des sciences et des techniques, avec l’impact redoublé après-coup de la découverte freudienne, qui, comme la révolution astronomique, a attendu près d’un siècle avant d’avoir ses véritables effets dans la philosophie et l’idéologie, et va devenir pleinement opérante aujourd’hui. Il est clair que cette vérification va tracer une ligne de démarcation entre le nouveau et l’ancien, dont, si l’ancien la pressent, puisque par définition il ne peut la connaître, il ne doit vouloir à aucun prix, car c’est sa mort. Autrement dit, ce n’est pas une figure de rhétorique que de dire qu’il s’agit d’une lutte à mort, puisqu’il s’agit d’une lutte entre une langue morte et une langue vivante.M. PLEYNET : Je voudrais préciser cette question du nouveau dont nous parlons, par rapport à l’idéologie aujourd’hui dominante, laquelle peut donner l’impression qu’elle accepte du nouveau, dans ses universités et ailleurs par exemple, à Vincennes, etc., que ça se développe, que ça bouge, et donc qu’elle est prête à accepter ce nouveau. Mais le nouveau dont il est ici question n’est pas une addition d’avant-gardisme et de miroitements formels mis les uns au bout des autres ; le nouveau dont nous parlons, c’est un nouveau qui doit se penser par rapport à la négation, qui fonctionnerait en somme comme négation de la négation, c’est le processus où il se constitue, qui nous permet en même temps de définir aussi la fiction ; parce que la fiction qui titille le bourgeois, ça ne manque pas, il y en a dans tous les coins ; vous avez d’un côté une espèce de logorrhée et/ou de logomachie généralisée, que le bourgeois accueille selon un titillement qui lui procure en définitive beaucoup de plaisir, en prenant bien sûr un air pincé, mais en somme c’est très bon quand même, et de l’autre côté une sorte de rétention de fiction, qui donne l’impression, par rapport à la vieille littérature, de produire des effets de blancs sur la page qui sont absolument « révolutionnaires », mais qui en fait ne sont que des effets de décoration par rapport à l’académie, et qui n’interviennent pas réellement sur ce problème de négation de l’idéologie bourgeoise, ou qui interviennent simplement comme négation apparente sous la forme, justement, d’une négation que l’idéologie bourgeoise est capable d’accepter et qui ne réinvestissent pas leur pratique dans l’histoire. C’est là précisément que le nouveau dont nous parlons est tellement nouveau qu’il est pratiquement inacceptable.
PH. SOLLERS : Il se définit d’être inacceptable par l’ancien, et selon une inacceptabilté qui n’est pas du tout à marquer au niveau d’une « illisibilité » mais au niveau du sujet, du sujet dans cette langue vivante. Le nouveau n’est pas ici un simple nouveau de langue...
M. PLEYNET : C’est une question de syntaxe, en ce qui concerne le nouveau de langue...
PH . SOLLERS : C’est le sujet de cette langue et de cette syntaxe qui est inacceptable ; ce n’est pas telle ou telle « forme » ; et finalement, dans ce sujet inacceptable — et je pense a W. Reich, ou à des percées de cet ordre — ce qui est inacceptable, du sujet de cette langue et de cette syntaxe, c’est son sexe ; parce qu’il s’agit précisément de quelque chose qui trace la coupure entre deux systèmes astronomiques, si je peux dire, de la sexualité. Je m’expliquerai par cette phase d’Artaud : « Le temps des succubes et incubes est passé ; il a été remplacé par celui des petits boutiquiers, commis d’administration, garçons de banque, prêtres, médecins, professeurs et savants, qui croient tenir Artaud parce qu’ils sont jour et nuit dans son sexe, comme si mon sexe était le soleil de la réalité. » Vous voyez ce que je veux dire en parlant de la révolution astronomique dans ce domaine. Ce qui est inacceptable dans ce sujet, cette langue vivante, cette syntaxe nouvelle, c’est que ce qui s’y investit ne soit plus centrable, ne comporte plus de centration. On le voit très bien quand Artaud dit : « comme si mon sexe était le soleil de ma réalité ». Qu’est-ce qui fait que le langage, la syntaxe, et le sujet d’Artaud sont inacceptables, qu’est-ce qui fait qu’Artaud doit être maintenu par les exploiteurs dans son rôle de mort, puisque pour la névrose Il faut qu’il y ait du mort pour assurer cette espèce de survie molle qui est celle de l’investissement névrotique —, qu’est-ce qui est subverti là ? Aurait-on trouvé un nouveau centre qui serait le sexe ? Voilà, je crois que ce qui est en train de s’annoncer, c’est la subversion de tout centre, quel qu’il soit, et cela nous conduit à comprendre la position d’un langage qui ne serait plus centrable ; mais cela nous amène aussi à entrevoir pourquoi, dans la réalité sociale la plus quotidienne, toute centration de type familial, institutionnel, devient impossible si ce nouveau surgit, cette nouvelle langue, ce nouveau sujet, etc. Et cela ne va pas se faire sans des affrontements très durs.
M. PLEYNET : Je pense en effet qu’il se passa là quelque chose au niveau de la langue, et au niveau de la place du sujet, qui est profondément révolutionnaire dans l’idéologie qui aujourd’hui investit profondément le sujet, et si vous y regardez d’une manière suffisamment ample, et précise, vous vous apercevrez que dans sa culture, dans ses déplacements idéologiques, le sujet que vous pouvez rencontrer aujourd’hui, il est né au XXe siècle ; il n’a pas d’autre culture, il n’a pas d’autre fond historique que celui fourni par cette sorte de trans-historisme ; et je crois que ce qui surgit là, à travers la Chine, à travers ce que Marx marque comme départ, qui surgit donc à travers ce conflit, dont nous parlions tout à l’heure, déterminant dans l’histoire, et qui est si nouveau lui aussi qu’on l’explore encore, qu’il surgit peut-être aujourd’hui seulement dans la fiction —, ce qui se marque là c’est ce que Sollers avait déjà noté dans Promesse 23-24, où il disait : « la poésie comme sublimation ponctuelle (la logorrhée et la rétention dont on parlait tout à l’heure : c’est cela précisément) prend alors une triple fonction d’écran, vers l’histoire, le sexe, et la science » ; et je crois qu’on voit bien, en effet, ce qui, de l’histoire, du sexe, de la science, surgit dans cette nouvelle langue dont nous parlons, et ne peut surgir que de ce champ-là, dans cette nouvelle langue, et non plus du tout de la « sublimation ponctuelle » et de l’intérêt que tel individu porte à son sujet, à son sexe, à son histoire et à sa science...
PH. SOLLERS : ... Ce qui est tellement vrai, qu’on peut soutenir l’apparent paradoxe suivant : le surgissement de ce nouveau sujet dans cette nouvelle langue n’est rien d’autre que ce que Mao appelle le « langage riche et vivant des masses ». Ça ne sera pas telle ou telle ponctualité, individualité, subjectivité : ce qui se marquera du surgissement du sujet dans la langue, dans la syntaxe, et dans ce triple rapport, nouveau, entièrement nouveau, ne sera pas un problème de mémoire centrée sur la subjectivité, même avec des effets aussi prestigieux que ceux de Proust, ce sera au contraire cette absence de centre dans laquelle surgit un sujet, et qui ne fera rien d’autre que de donner enfin la parole à ce « langage riche et vivant des masses ». C’est donc tout le contraire du surgissement d’un sujet au-dessus des masses. Il s’agira au contraire d’un surgissement par coupes, en rappelant d’ailleurs que ce « langage riche et vivant des masses », on n’en connaît encore rien ; la littérature ne nous en dit rien, et la littérature d’avant-garde pas plus que les autres, la plupart du temps. Un langage va s’effondrer en tant que langue morte dans l’académisme du faux nouveau dont Pleynet parlait tout à l’heure, langage qui va tout simplement crever de sa non-ouverture au sujet, qui entraîne sa non-ouverture à l’histoire, au sexe, aux sciences...
M. PLEYNET : ... Est-ce qu’on ne pourrait pas caractériser ce faux nouveau comme une addition de particularismes ?
PH. SOLLERS : Oui, je vois personnellement ce faux nouveau sous l’espèce du formalisme, et il entraîne toute une spéculation positiviste, dérisoire, sur un découpage néo-positiviste du langage, qui ne tient aucun compte du problème du sujet tel que le commencement de Freud le pose (le sujet n’existe pas, pour cette formalisation néo-positiviste). D’autre part, on peut le caractériser très facilement comme la rupture entre le subjectif et l’objectif, c’est à-dire que, par ailleurs, les recherches formelles convergent toutes vers un sens qui ne répond pas du « langage riche et vivant des masses », un sens théologique, métaphysique. Alors qu’au contraire, supposez qu’on mette en question le sujet (je ne dis pas la subjectivité) à travers le « langage riche et vivant des masses », on verrait apparaître immédiatement d’énormes pans de réalité, positifs en ceci que ce serait le réel même qui aurait la parole, et non pas tel ou tel point subjectif, crispé sur sa propre représentation fantasmée.
Je tiens évidemment à préciser que lorsque nous parlons de ce point de vue nouveau implique par et dans le « langage riche et vivant des masses », ça n’est pas du tout pour en revenir à une problématique humaniste. Ce qu’il y a d’assez comique dans la lutte en impasse entre un « humanisme marxiste » et « anti-humanisme théorique de Marx », c’est que finalement dire « ce n’est pas l’homme qui fait l’histoire », ce qui est juste, pour dire « ce sont les masses qui font l’histoire », ce qui est juste aussi, ça ne veut pas dire que « les masses » c’est « un ensemble d’hommes » ! Car ce qu’on voit revenir dans la plupart des discours « marxistes » contemporains à travers la formule « ce sont les masses qui font l’histoire », dès qu’il s’agit de l’idéologie, est précisément le vieil humanisme traditionnel ; c’est-à-dire que, à ce moment-là « les masses », retour du refoulé dans le discours où l’idéologie n’est pas considérée dans son efficace propre, deviennent une assemblée d’« hommes ». C’est un déplacement sur place du problème de l’humanisme, on n’en sort pas, et toutes les vieilleries préfreudiennes, reviennent dans ce discours, au niveau de l’idéologie. Donc, le problème des masses est à traiter non pas avec la catégorie refoulé de l’humanisme, refoulée par une conception profondément mécaniste du sujet qui confond langage et idéologie, comme nous l’avons plusieurs fois souligné (sujet « interpellé » par l’idéologie : conception aussi simpliste que rétrograde), mais dans le champ de l’idéologie il faut opérer avec la catégorie de sujet qui n’est déterminable que dans son articulation même au langage. Et c’est pour cela qu’un discours « marxiste » qui ne peut pas se mesurer à la découverte freudienne ne peut rien nous dire, ni de l’idéologie, sauf à développer une théorie scientiste, dix-neuviémiste, ni des masses elles mêmes, dont le concept demeure alors complètement abstrait ou se remplit d’ensembles d’« hommes », et l’humanisme bourgeois revient là comme chez lui.J.-L. HOUDEBINE : Je crois en effet que tout cela, si mal perçu par tant de soi-disant « marxistes » contemporains, est pourtant parfaitement clair. Les livres que vous publiez, l’un et l’autre en mars et avril de cette année, joueront sur ce plan aussi, tout leur rôle. C’est précisément cette pratique spécifique, lisible dans H et dans Stanze, que je voudrais maintenant interroger .
Philippe Sollers, un an seulement sépare la parution de H de celle de Lois dont les effets sont pourtant très loin d’être épuisés : sans doute faut-il voir dans cette accélération assez stupéfiante du rythme de votre travail dans la fiction, la marque de cet impact politique dont nous venons de parler ; mais ce phénomène est également lié à une pratique, à une économie de sujet, irréductible à toute visée politiste ; je pense notamment à tel passage de H que j’avais lu dans « Das Augenlicht » publié dans Tel Quel l’automne dernier : « mais on s’en fout de ta sagesse tu vois pas qu’on doit se battre immédiatement dans l’écrasement tu vois pas l’urgence la misère l’exploitation des tonnes de béton sur les corps l’abrutissement les tâches concrètes modestes oui mais ça deviendrait vite absurde dans le souvenir d’ensemble il y a aussi une métaphysique du concret concret beaucoup de nos camarades sont en pleine foi non critique je vois pousser des cornettes dans l’humanisme je sens des soutanes dans le placard la vieille vengeance contre l’exception se redissimule » : ce qui correspond d’ailleurs d’une manière très exacte à tous les problèmes que vous venez d’évoquer dans cet entretien.
La question est donc la suivante : qu’en est-il, et d’une manière encore très générale, de cette pratique du sujet telle que de Lois à H chacun peut en constater et en étudier le développement et la transformation ? Et je voudrais bien poser cette même question à Pleynet, puisque, si du moins on s’en tient à une banale chronologie, la situation peut paraître assez différente, étant donné que votre dernier livre de poésie, Comme, a été publié en 1965.PH. SOLLERS : Lois, ça a été l’expérience d’une explosion. Ce qui a sauté avec cette pratique-là, c’est en quelque sorte ma pratique antérieure ; mais il faut souligner que c’est le premier livre de moi qui paraît après mai-juin 1968, Nombres, le livre précédent, paraissant en avril 1968. Lois, ça a donc été un saut qualitatif dans la langue même : principalement une transformation rythmique, et si vous comparez à Nombres, une transformation de l’économie du sujet dans le rythme, la syntaxe, la langue, et ce que je pourrais appeler une ponctuation violente. Il y a, dans Lois, une ponctuation bizarre par rapport à ce que j’avais fait jusque-là. Prenons par exemple le point d’exclamation. Il est très fréquent dans Lois, il intervient à l’intérieur de phrases non ponctuées comme des agrégats logiques, un peu comme s’il s’agissait de télégrammes non ponctués coupés par ces points d’exclamation. Qu’est-ce que cela veut dire au niveau de l’énergie dépensée ? Ceci, qu’il y a quelque chose d’extrêmement rapide qui se passe, qui condense les phrases, qui donne une syntaxe où l’on voit apparaître ce qui sera le principe du téléscripteur en même temps phonique de H, tout cela est marqué d’un signe d’événement, le point d’exclamation, qui a son sens propre, celui d’un franchissement de la résistance ou de la censure : ça y est, ça va ! Il est probable que Lois constitue ainsi une sorte de matrice de transformation des mots, cela étant d’ailleurs démarré, à l’état pratique, chez Artaud ou chez Joyce. C’est une langue en relief qui arrive comme ça, tout à coup, et d’une manière plus générale, une matrice d’opérations sur la langue. A partir de là, ce qui s’est développé, c’est la possibilité de lier cette énergie ; un peu comme le passage entre système primaire et système secondaire.
Dans H, on a donc quelque chose qui est entièrement non ponctué, apparemment, mais qui est ponctué de l’intérieur : il n’y a plus les signes de franchissement, les signes de décharge, on peut dire que l’énergie y est liée, et en même temps la complication interne de cette langue liée est évidemment beaucoup plus grande ; le sujet, si vous voulez, y est plus innombrable. Cela veut dire que la recharge dans Lois a procédé par une accumulation quantitative assez énorme, avec des premiers essais de rédaction se référant à un système antérieur, utilisant des structures comme on en trouve dans Nombres ou dans Drame ; et tout à coup, devant le fait que ça n’allait pas, quelque chose a sauté au niveau même de l’intervention de percussion dans la langue. Je peux noter cet élément technique, qui a son intérêt, c’est à partir de ce moment que j’ai commencé à écrire directement à la machine : c’est-à-dire avec une autre disposition dans l’espace par rapport à ce qui s’écrivait, et cela a été probablement rendu possible, non pas du tout par l’élément mécanique que représente la machine à écrire elle-même, mais par l’extrême rapidité auditive déclenchée par ce type de travail ; autrement dit, le fait d’écrire est devenu tout à fait subordonné, alors qu’il était beaucoup plus important autrefois (au niveau graphique, etc.), est devenu secondaire par rapport à l’élément auditif ; il y a eu une sorte d’ouverture plus grande de l’oreille. C’est ce type d’écriture qui s’est développé avec H. Il s’agit de quelque chose de très différent de l’écriture automatique, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon, on pourrait parler d’orchestration ad libitum : que ce soit écrit ou non, enregistré ou non, on approche de la « publication permanente qui n’a pas de prix » de Ducasse, c’est-à-dire d’une opération de langage qui n’entre plus dans une volonté consciente d’intervention. Ce qui ne veut pas dire du tout que c’est n’importe quoi mis bout à bout, mais que la liaison dans le langage peut, ou non, se dérouler de façon pratiquement ininterrompue, par étapes, séries, parce qu’elle a trouvé sa coupure incessante.M. PLEYNET : Cette question de temporalité est intéressante : il y a là en effet quelque chose qui répond à une économie du sujet. Comme a été publié en 1965, la première partie de Stanze paraît en 1969 ; il y aurait évidemment de nombreux problèmes biographiques à soulever ; constatons d’abord que tout cela s’inscrit dans un champ spécifiquement poétique lié à l’histoire proche et très ancienne de cette spécificité, c’est de là que ça vient ; en même temps, entre Comme et Stanze il y a une énorme différence, dont cette temporalité pourrait peut-être répondre, précisément : Comme est un livre qui fait à peu près une soixantaine de pages, alors que la moitié de Stanze fait déjà plus de cent soixante-dix pages, et cela constitue seulement la moitié du projet global, qui comportera neuf Chants. Il est bien évident, également, qu’entre 1965 et 1973, il s’est passé beaucoup de choses, et particulièrement en 1968 ; à ce propos je dois dire que Comme, aussi bien que les deux autres livres que j’avais publiés avant, est un livre présenté d’une manière presque entièrement négative ; chacun de ces livres est en fait écrit contre quelque chose, il tente de nier quelque chose, et il y a là d’ailleurs un symptôme qui s’inscrit généralement au dos de la couverture des livres, et cela figure en quatrième page de couverture de Comme, et autant que je m’en souvienne il en était de même pour Paysages en deux, symptôme qui est à chaque fois une sorte de revendication tout à fait abstraite de la liaison d’articulation de la langue au tout social, comme une sorte de désir, comme le marquage symptomatique précisément d’une absence de liaison...
J.-L. HOUDEBINE : Cette revendication, ou mieux, cette négation est également marquée à l’intérieur de Comme, lorsque vous écrivez notamment « toute cette foutue poésie subjective », et plus loin, « j’écrirai de la politique »...
M. PLEYNET : C’est cela. Il y a là un problème qui reste alors posé, suspendu, et pour le résoudre cela a pris du temps, car le problème, lui, n’est pas abstrait, c’est le problème de sujet qui doit surgir avec sa biographie, avec lui-même avec ses histoires et avec l’Histoire, et c’est sans doute, pour moi tout au moins, un point très important, comme vous le voyez bien au marquage de la manifestation abstraite, de ces manifestations d’intention sur la couverture ou sur la page, et à leur réalisation intervenant aujourd’hui dans une transformation de la langue, et que ce soit vraiment là comme réel et plus seulement comme écrit. Il y a dans tout cela, en effet, une temporalité spécifique qui vient jouer, et ce n’est sans doute pas un hasard si j’ai retrouvé, peu de temps après avoir remis le manuscrit de Stanze, un ancien texte de moi, datant de 1957-1958, et bizarrement assez proche, du point de vue des surgissements thématiques tout au moins, de Stanze, texte qui avait été commencé alors après la lecture de De natura rerum de Lucrèce ; c’est un texte [10] dont je ne répondrais pas aujourd’hui, mais qui brusquement, à travers une tentative de maîtrise d’un certain type d’écriture, à travers le bouleversement que produit l’histoire dans cette fausse tentative de maîtrise, resurgit dans un tout autre champ, dans un tout autre espace historique, avec Stanze. Je dois dire enfin que ce qui a été également pour moi très déterminant, pendant que j’écrivais Stanze (et c’est marqué d’une certaine façon à la fin du livre), c’est la traduction que Sollers a donnée des poésies de Mao Tsé-toung : travail déterminant pour moi quant à la reprise globale du projet de Stanze ; en 1969, au moment où je terminais le premier Chant, ce sont ces traductions des poésies de Mao Tsé-toung qui m’ont permis de ressaisir la globalité du livre, en me permettant de prendre connaissance d’un type d’intervention qui justement pouvait reprendre tout un champ culturel d’une manière apparemment trans-historique pour la situer dans l’histoire concrète et en faire une force révolutionnaire ; de la même façon qu’il y avait là un surgissement qui permettait de penser l’articulation au tout social qui ne soit pas prise dans le b-a ba de la scolastique marxiste, qui soit vivante, et qui permette à la langue, à ce qu’elle doit dire aujourd’hui, de surgir, qui lui permette de tenir (même vis-à-vis de mon propre discours, qui est évidemment toujours présent) un discours toujours surprenant ; pour moi, j’entends.
PH. SOLLERS : C’est cela qui est passionnant dans ce problème de l’articulation de la temporalité biographique sur la temporalité historique, c’est que ça passe par la reconnaissance de la temporalité du sujet, qui n’est pas du tout la temporalité de la biographie, et qui n’est pas non plus la temporalité linéaire historique telle qu’elle se développe dans le discours historiciste. Ce que fait probablement surgir cette temporalité du discours, qui peut opérer sur lui même des retours-refontes, et des sauts, il faut bien voir qu’il y a là quelque chose qui vient se mêler de l’affaire, à savoir l’inconscient, dans son ignorance du temps, mais qui est une ignorance savante, si on peut dire : une ignorance qui en sait long, même si elle a l’air de n’en rien vouloir savoir. Je crois que nous aurions l’un et l’autre beaucoup à dire sur l’aspect auto-analytique de ce travail, ce sera pour une autre fois. On serait en droit d’exiger cette vigilance analytique de qui se mêle d’écrire aujourd’hui ; je veux dire qu’on est tout de même en droit d’exiger de celui qui développe une pratique de langage, non pas que tout soit clarifié de part et d’autre (on n’a pas à réclamer une professionnalisation du rapport à l’inconscient !), mais qu’il y ait tout de même de l’analyse, sans quoi rien ne s’écrit.
Je voudrais dire à ce propos que de même qu’il y a une langue morte et une langue vivante, il y a un temps mort et un temps vivant. Il y a ce surgissement profond, rétroactif, difficilement datable, dans ces enchevêtrements, qui est le temps propre du sujet dans le langage, ça va donner la possibilité pour ce langage de se brancher tout à fait autrement sur l’histoire. Ceci est véritable dans Stanze ou dans Lois, ou dans H. Et j’ai vu, quant à moi, l’opération se dérouler pour ainsi dire sous mes yeux : la connexion avec des temporalités historiques différentes, s’ouvre en fonction comme algébrique du fait qu’est abandonnée une instance de temps mort dans le discours. Le temps mort, je voudrais le définir par une intervention d’Artaud :« Comme si le temps n’était pas frite
n’était pas cette cuite frite
de tous les effrités du seuil
réembarqués dans leur cercueil. »M. PLEYNET : Ce problème de temporalité est décidément très important, en particulier sitôt qu’on aborde des pratiques comme celles de l’écriture, de la musique, de la peinture, etc. J’y pense à nouveau en fonction de ce vieux texte, dont je parlais tout à l’heure : il y a donc ce texte, qui fait soixante pages, puis ceux qui ont suivi, et qui sont tout à fait différents, et maintenant des aspects de cet ancien texte qui resurgissent aujourd’hui. Ce que je voudrais noter, à la manière d’une question en suspens, c’est qu’il y a dans ces problèmes de temporalités, de temporalités autres, quelque chose qui concernerait à la fois la jouissance, le refoulement et l’histoire. Car c’est quand même assez bizarre : je n’avais montré ce premier texte à personne, je n’ai pas cherché à le publier, et c’est dans d’autres textes très différents que j’ai investi cette relation entre moi et ce tout social qui faisait problème ; et c’est aujourd’hui, à travers une autre traversée historique, que je vois resurgir ce texte, avec des effets de langue qui étaient précisément alors déjà proposés dans ce texte ancien. On a là, me semble-t-il, une sorte de point de repère, ou de sismographe, dans ce champ de temporalités autres, dans lequel une lecture freudienne permet, en certains points, de se retrouver ; dans la liaison « langue-jouissance inconscient-histoire », liaison fondamentale aussi bien pour ce qu’on pouvait dire en commençant à propos du marxisme, que maintenant en ce qui concerne la fiction, et dans ce que nous avons dit du rôle politique de la fiction.
PH. SOLLERS : Ce n’est certainement pas un hasard si l’effondrement du temps mort, qui est lié à une levée de censure, et en tout cas à l’abandon d’une position de fétichisation de l’écrit qui ne trouve malheureusement que trop bien ses théoriciens d’occasion, qui est lié, donc, à une levée de la lettre — comme on dit une levée d’écrou —, ce n’est certes pas un hasard si un des indices de sens immédiat de ce qui se passe là, c’est ce qu’on peut appeler l’humour ; détail sur lequel j’aimerais insister. Je ne veux pas simplement parler du mot d’esprit, du jeu de mots, du calembour, et autre menue monnaie qui passe dans l’échange social comme court-circuit d’une économie libidinale (espace abrégé d’une dépense psychique minimale) : c’est pour cela que ça donne du plaisir, que ça fait rire, etc. Il y a eu par exemple dans l’appréciation de Lois à cet égard, une méconnaissance totale, réductrice, refoulante, qui a consisté à s’en tenir à quelques effets apparents, comme si vraiment il s’agissait d’un entassement de petites plaisanteries, y compris de petites plaisanteries privées : il y a même un certain nombre de personnes qui ont été empêchées de lire ce livre parce qu’elles ont cru s’y reconnaître sous tel ou tel faux-nez ; je dirai presque que c’était voulu, parce que je pense qu’il faut qu’un écrit produise le panneau dans lequel ceux qui sont appelés à collaborer à son avenir par leur non-lecture tombent ; un écrit c’est aussi un miroir aux alouettes, c’est quelque chose qui peut consommer de l’alouette. Ce que j’appelle ici la fonction d’humour, pour reprendre ce que disait Pleynet quant à la liaison très particulière de la jouissance à la temporalité à la fois biographique et historique, c’est quelque chose de beaucoup plus sans mesure, dont la petite monnaie du jeu de mots n’est qu’une dérivation ; autrement dit, c’est quelque chose dans quoi il semblerait bien que le langage, une fois franchi un certain niveau de censure, d’auto-censure, baigne. Je crois par exemple que la difficulté où l’on est d’apprécier le Finnegans Wake, de Joyce, est un peu du même ordre ; on peut avoir l’impression qu’il s’agit de l’entassement d’un certain nombre de monnaies lexicales, alors que la conception d’ensemble reste non vue : or cette conception d’ensemble a trait à une tentative de levée en masse du refoulement du sujet dans le langage, et qui, on le sait très bien, porte sur des problèmes de cycles historiques nommément référés par Joyce à Vico, qui ont toute leur importance dans l’orchestration métrique des langues. Il y a une façon de refuser ce que j’appelle le temps vivant par opposé au temps mort, en faisant de ce temps vivant une petite monnaie d’écoulement partiel de la jouissance. Ce qui est probablement visé par l’« art moderne » dans ses tentatives les plus conséquentes, c’est un rapport à la jouissance qui n’a rien à voir avec ce rapport à l’objet partiel (qui est là pour ainsi dire comme un piège). Et là aussi ce n’est pas un hasard s’il n’y a tout de même pas beaucoup de gens qui en parlent, de la jouissance. Ce qu’élabore Lacan maintenant, par exemple, est infiniment éloigné des répétitions universitaires à propos de « l’instance de la lettre », de « métaphore et métonymie », etc. Ça a trait à la tentative de poser une jouissance qui serait une jouissance ne trouvant pas son raté dans l’objet et sur cette sorte de mur de fond de la position phallique. Ce qui ne veut pas dire du tout que cette jouissance se situerait en deçà de la position phallique, au contraire. Elle annonce à la fois la reconnaissance discordante de cette position et une dialectisation inouïe du langage, celle du sujet « innombrable », justement. Cela est annoncé par Nombres, marqué par Lois, déplié par H, il me semble.
M. PLEYNET : Je voudrais indiquer quelque chose, qui concerne à la fois ce que Sollers vient de dire à propos de l’objet partiel, et ce que je disais tout à l’heure quant au passage de Comme à Stanze, c’est-à-dire d’un petit livre à un volume plus grand, et qui s’est manifesté lorsque j’ai été amené à choisir le titre du livre. Ce titre, qui est là, maintenant, repris dans la modulation générale du livre, n’est pas, en fait, le titre d’un livre ; c’est le titre d’une série de livres qui n’ont pas de titres, qui s’appellent « Chants » ; il s’agit d’une série, dont j’ai eu besoin, et j’ai encore besoin pour faire démarrer, et pour poursuivre cette série, de la penser d’une façon double, en deux temps, à savoir dans un premier moment sous la forme de neuf Chants, mais dont la structure générale, qui comprend ces neuf Chants, est une structure qui peut quasiment se multiplier à l’infini. Ce qui est proposé là ne renvoie pas à un objet qui serait fini et saisissable, à un livre, même pas à quelque chose qui serait sur la page, mais à quelque chose qui pourrait se trouver partout, hors de la page et hors du livre ; même si ce travail se finit un jour, il ne se pensera jamais pour autant comme fini. Il y a ici un type de rapport à la norme, que l’objet, le tableau ou le livre, viendrait représenter pour une idéologie déterminée, et un excès par rapport à cette norme : il est évident que cet excès n’a pas de fin, et que, du coup, il va faire sauter tout ce que la norme, dans son épuisement même, va décider de marquer, c’est-à-dire même la fin de l’objet. La norme peut déclarer demain que l’art va se continuer sous la forme d’un anti-art : elle ne le déclarera d’ailleurs que dans la mesure où elle aura peur de l’excès qui vient la déborder.
PH. SOLLERS : Je dirai alors que l’excès en question, — et c’est marqué également dans Lois au niveau des dialogues entre fini et infini —, ouvre sur l’humour dans lequel baigne le langage. Le langage est humour. Si j’ai écrit Lois, cela a été pour sortir d’un entourage social absolument cafardeux entre tenant des moments de rigolade. Le côté sinistre comme le côté rigolo me sont désormais totalement étrangers : le rire, à son point ultime, ne rit pas. Ceci, pour rappeler que l’époque avec laquelle nous avons rompu en 1971, et qui voyait se développer autour de Tel Quel une « ceinture de chasteté réviso droitière », comme on l’a appelée, est bien une des époques les plus sinistres que j’aie jamais vécues dans mon existence. Cette remarque en passant, donc, et pour prendre date. Humour, pour moi, ça veut dire à la fois infime et énorme. Ça ne se prend pas dans la main, c’est exactement sérieux, aussi bien.
Si cet excès est sans fin, c’est parce qu’il est toujours à nouveau le commencement de ce qui met fin à ce qui empêche l’excès. Ce n’est pas un excès que vous pouvez poser en dehors de son opération, puisque c’est chaque fois l’opération qui empêche que soit mis fin à l’opération. Et cela donne en effet cette « sortie », dont témoigne tout l’art moderne, sortie hors du cadre du livre, du tableau, etc., c’est-à-dire hors de tout ce qui peut « découper » un sens. C’est également évident en musique, chez Schönberg ou chez Webern : il s’agit d’organisations souples d’intégrations qui comportent un vide suffisant à l’intérieur de l’opération d’intégration elle-même pour que cela ne se remplisse jamais. Bords sans bords. Dans la langue, ceci est encore loin d’être obtenu, mis à part, par exemple, ces interventions, qui sont tout à fait de cet ordre, et que j’ai appelées d’écriture permanente, laquelle peut être écrite ou ne pas l’être, c’est là, je crois, le point décisif. Il y a, au fond, deux sortes d’écriture : l’une qui est là, parce qu’elle ne pouvait pas être ailleurs, et l’autre, qui aurait très bien pu ne pas être écrite. Ce serait un peu le critère pour distinguer ce qui relève d’une avant-garde et ce qui participe d’une pseudo-avant-garde, entre quelque chose qui se passe ou bien qui est répété. A part, bien sûr, les interventions d’Artaud ou de Joyce, on ne peut pas dire que la langue dite littéraire relève de ce type d’opérations et pourtant c’est bien là le lieu où l’excès, le rapport fini-infini, avec du trans-fini en cause, etc., peut se révéler déterminant, pour tout rapport du sujet au discours, et donc pour tout rapport du sujet à l’histoire, si on veut dépasser le schéma idéologique perspectiviste, évolutionniste, du XIXe siècle.J.-L. HOUDEBINE : Venons-en alors à une question plus précise sur H. H relève pour vous d’un « polylogue extérieur », que vous opposez au « monologue intérieur » ; et il y a en effet dans votre texte un autre rythme, un autre phrasé très ample de la langue, dans lequel se pratique une lutte de contraires ininterrompue, n’hésitant pas à traiter de larges séquences où ré-intervient comme une fonction « représentative » dans la modulation générale du procès. Et cela conduirait à poser une question (vous venez d’ailleurs de l’évoquer vous-même en partie) sur l’insistance, de plus en plus affirmée, de la référence musicale (Gesualdo, Monteverdi, Purcell/Schönberg, Webern/Stockhausen) dans votre travail ; vous disiez déjà dans Lois : « la musique pourrait bien être mon langage ». Mais je pense aussi à une autre musique, à une autre modulation, celle du texte d’Hölderlin, par exemple, dont la réminiscence active était déjà pratiquée dans Lois, mais qui me semble plus particulièrement amplifiée dans H ; Hölderlin, dont étrangement, comme vous me le disiez récemment, on parle si peu en cette époque où le discours sur la schizophrénie tend à se multiplier. Et ce serait là, bien sûr, vous interroger sur ce procès du « sujet en procès » dans H, selon l’expression employée par Kristeva.
PH. SOLLERS : Je voudrais tout d’abord revenir sur ce qui s’est passé en français. Disons en gros que le XXe siècle apparaîtra sans doute ponctué par l’intervention surréaliste, et d’une manière beaucoup plus faible, beaucoup plus didactique, scolaire, sans les erreurs positives du surréalisme, par ce qu’on a appelé le « Nouveau Roman ». Les critiques que nous avons, que vous avez formulées à propos du surréalisme, ne doivent pas empêcher de considérer qu’au niveau de la place du sujet dans la langue il y a eu, avec le surréalisme, quelque chose qui s’est passé, et qui a été, à mon avis, par la suite, profondément refoulé. C’est entendu : le surréalisme s’est trompé ; c’est entendu : Breton, en tout cas, n’a pas su poser la réalité, dans le langage, de ce qui avait été frôlé par la découverte d’une rupture avec la maîtrise d’un sujet sur son langage. Cette maîtrise, nous le savons, est périmée ; elle est périmée, non par le surréalisme, mais par la découverte freudienne, que le surréalisme manque ; mais du moins, il frôle la question. On peut considérer, si vous voulez, que le « Nouveau Roman » intervient très généralement sur ce terrain-là comme refoulement de cette place du sujet : je n’en veux pour preuve que ces exercices académiques, sur fond de théorie néo-positiviste, qui nous éloignent considérablement de ce qui s’est passé de fondamental dans l’histoire. Autrement dit, comme nous l’avons souligné plusieurs fois, l’espace français, dans le domaine de la littérature, entre la période d’effervescence du surréalisme et aujourd’hui, mise à part la considérable exception d’Artaud, est pour nous sans aucun intérêt. Il y a, bien sûr, le problème « Joyce » ; mais précisément, il n’est pas français. Je pense qu’il y a une surdité spécifique de notre culture ; il n’y a pas de musique française. Rameau, Debussy, bien sûr, mais cela, finalement, n’a pas grande importance ; non, il n’y a pas de musique française. Cela signifie que pour qui veut se livrer à quelque événement dans l’ordre du discours, nous sommes très défavorisés par rapport au jeu de la langue fermé par l’hégémonie bourgeoise et sa surdité congénitale. Il en va évidemment tout autrement dans d’autres aires culturelles : l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre. Il est clair que dans H il y a un appel à ces aires culturelles en ce qui concerne le rapport de la langue à la musique.
Est-ce qu’il y a une poésie française ? Je n’en suis pas si sûr. Il est très probable que mis à part Hugo dont le tourniquet métrique, même avec ses monotonies, propose un rythme à la langue, tout ce qui s’est fait en poésie depuis un siècle s’est fait sous la forme de la protestation linguistique, c’est-à-dire par fragmentation. Est-ce que Lautréamont et Mallarmé représentent les possibilités d’émergence d’un rapport de la langue à la musique ? Je ne le pense pas : ce n’est pas un hasard si Mallarmé s’est vu obligé d’écrire un texte intitulé « La musique et les lettres » : il était très conscient du manque orchestral de la langue française ; et si Lautréamont a eu cette fonction de coupure, c’est beaucoup plus pour des raisons finalement conceptuelles et logiques que pour des raisons de refonte en profondeur de la langue ; c’est si vrai que les Chants de Maldoror sont un système rhétorique subverti (voir à ce propos le livre de Pleynet), et que les Poésies sont une opération translogique. Vous savez très bien que, pour les surréalistes, la musique n’existait pas, et je ne vois pas du tout que, de ce point de vue, la situation ait évolué, sauf en ce qui concerne Artaud, puisque celui-ci a produit un événement considérable dans la rythmique, la syntaxe, l’audition. Verdict social : schizophrénie. Cela nous fait donc un premier parcours.
Dans la question d’Hölderlin, il faut évidemment remonter un peu plus haut. Il y a là en effet quelque chose de plus ancien, qui n’a pas le tranchant de l’intervention d’Artaud, laquelle est bien l’élément incontournable. Mais je ne pense pas qu’on puisse introduire en ce point une limite, dans la mesure où ce serait perpétuer une idéologie de l’impossible au niveau d’une tentative moins centrée encore que celle d’Artaud ; c’est-à-dire qui serait moins marquée dans sa position de rejet, ou qui n’aurait pas uniquement comme fonction de se situer dans le rejet. Vous voyez la difficulté du problème : vous êtes dans une culture, dans une aire linguistique-historique à rejeter ; c’est pratiquement impossible ; parvenir au rejet, c’est l’aventure et l’expérience inimitable d’Artaud, et c’est assez inouï que ça ait pu se produire, et c’est bien pour cela que ça n’a rien à voir avec le surréalisme, qui est au contraire la ré-ingestion de tous les présupposés, de tous les aveuglements de cette culture, de cette histoire, de cette civilisation, de cette langue : voir le cirque Aragon.
Essayons de chercher alors si on pourrait partir d’ailleurs, tout en étant dans cette prison française. Je ne redirai jamais assez combien les critiques fondamentales écrites dans Lois ou dans H, c’est contre le nationalisme et le chauvinisme qu’elles le sont : il paraît qu’il y en a qui projettent dans Lois on ne sait quel « antisémitisme », j’ai lu ça, dernièrement, sous la plume d’un flic de service. Ce flic, à qui on a soufflé ça pour des raisons ultra-évidentes, au lieu de se rendre compte que la force de percussion de Lois porte en premier lieu sur la culture nationale française, sur le chauvinisme français, sur cette espèce de résidu merdeux, raciste, et antisémite (c’est dit en toutes lettres dans le livre), qu’est la culture française —, ce flic, donc, croit, ou feint de croire, qu’il s’agit « d’antisémitisme ». C’est le voleur qui crie au voleur. Je dois dire qu’une telle volonté de contresens est proprement stupéfiante et utile en ceci qu’elle dévoile l’antisémitisme viscéral, nationaliste et chauvin de cette couche murmurante de la petite bourgeoisie française, bien française, définitivement française, incurablement française. La France, hein, MERDE, comme vous dites ! Et il faut y insister, car c’est encore foutu de nous retomber sur le poil, cette vieille histoire : on sent très bien, actuellement, des courants, se situant même « à gauche », et qui essaieraient de sauver, au besoin par n’importe quelle falsification, leur petite franfrance. Que les choses soient claires, au niveau idéologique : j’écris quant à moi pour dénoncer ce qui est « français ». J’écris pour dénoncer toute forme de racisme, de nationalisme et d’hypocrisie sur ce sujet : il faut croire que Lois a touché juste pour que le refoulé le fasse savoir. Je reviendrai en détail là-dessus si on m’y oblige.M. PLEYNET : C’est leur enfrance, qu’ils veulent sauver !

Hölderlin, Mnemosyne.
ZOOM : cliquer sur l’image.

PH. SOLLERS : Voilà ! Leurs souvenirs d’enfrance !
Pourquoi la question d’Hölderlin est-elle si complexe ? Tout d’abord, comme vous dites, on parle de schizophrénie, et il semble qu’aucun discours ne veuille aller voir du côté d’Hölderlin ; je ferai remarquer que c’est la même chose pour Joyce. Cela prouve, encore une fois, que les discours universitaires, discours à tout faire actuellement en circulation, ont du mal à se mesurer à certains phénomènes. Il est clair qu’on ne peut pas se prononcer dans Hölderlin comme ça, dans Artaud et dans Finnegans Wake non plus ; ça n’est pas facile ; ça n’est pas facile à monnayer dans la presse électorale ou à l’université. Il y a une seconde difficulté : c’est que Hölderlin s’est vu, comme par hasard, repris par un discours de commentaire philosophique prude, celui de Heidegger, dont ce n’est évidemment pas le propos de voir ce qui émerge là brusquement dans l’histoire. Hölderlin est un des grands enterrés de notre culture : Lois et H ont aussi pour fonction de le ressusciter, si vous voulez, et c’est pour cela qu’il joue un rôle de personnage dans H où il est là, en effet, comme un spectre qui vient répéter quelque chose qui aurait été raté par la raison occidentale. Mais Nietzsche aussi. Il est là en tant que refoulé, et refoulé par l’incapacité du discours philosophique à se vivre comme risque de langue, au lieu de se vivre en position de commentaire de la mort de celui qui s’y produit. Le discours philosophique, depuis Marx et Freud, est une vaste nécropole, où le problème consiste pour le fonctionnaire philosophique, lequel vit par ailleurs d’une façon très honnête, à évoquer des morts pour des morts. Cela n’a rien à voir avec ce que la langue peut déclencher si elle est prise au niveau du rythme, de la métrique, etc., et là, Hölderlin produit quelque chose qui n’a pas d’équivalent en français. Je ne pense pas que Pleynet me contredira sur ce point ; de toute façon, lui aussi a beaucoup à dire sur Hölderlin, sur ce que celui-ci a été pour lui. Et c’est pourquoi le problème de la musique n’est pas du tout un problème de « musicalité » : c’est bien autre chose, où il y va du rythme, de la diction, de la pensée. Il s’agit donc de saisir cette inter-connexion, européenne et mondiale, entre les différents passés de langues, liés à leurs propres problèmes philosophiques, et les différentes interventions musicales qui s’y sont produites. Ce n’est nullement une attitude passéiste, car tout cela est pris dans une refonte historique mondiale qui doit faire tomber les frontières, les cloisonnements, les territoires.M. PLEYNET : Je suis tout à fait d’accord avec ce que Sollers vient de développer, notamment en ce qui concerne l’importance de Hölderlin, et ce qui me paraît essentiel dans ce qui vient d’être dit, c’est ce rapport que Sollers a établi entre l’intervention d’Artaud et celle de Hölderlin. En ce qui me concerne personnellement, Artaud et Hölderlin ont été très tôt décisifs, et assez bizarrement, mais pas tant que cela d’ailleurs, dans un ordre chronologique inversé, à savoir d’abord Artaud, et ensuite Hölderlin. Ce qui a été décisif, et qui m’a beaucoup appris, dans ce type de rapprochement que Sollers vient de souligner, ce sont les derniers textes de Hölderlin, les textes dits « de la folie », dans la mesure où, justement, ils reprennent à la fois les textes plus anciens dans des séquences historiques très vastes, dans un retour et dans une syntaxe qui me semble très moderne ; j’y ai beaucoup appris, particulièrement quant à ce rapport dont je parlais tout à l’heure, rapport fantasmé, de désir d’articulation au tout social de la langue, et qui se marque, à propos de Hölderlin précisément, dans Paysages en deux où Hölderlin figure sous la forme de l’évocation du récit d’une visite que lui fit Waiblinger : « Nous prîmes congé. En descendant l’escalier, par la porte ouverte, nous l’avons vu encore une fois arpentant sa chambre à pas pressés. Un frisson d’horreur me parcourait. Je pensais aux fauves, qui dans leur cage vont d’un côté à l’autre. Pleins de stupeur, nous sortîmes en courant de la maison. »
Je pense précisément que la trajectoire biographique et historique dont nous parlions tout à l’heure est là marquée de telle façon que, finalement, il fallait en passer par cette coupure pour pouvoir écrire ce qui s’écrit aujourd’hui.
A propos de Lautréamont et de ce que vient de dire Sollers, j’aimerais y ajouter ceci qui reprendrait aussi ce que dit Lautréamont : Le XXe siècle connaîtra sa langue, elle est née un peu partout et nulle part sur l’autre rive, et ceux qui l’ont vue passer à cet endroit se sont bien gardés de la reconnaître ; qu’est-elle devenue depuis ? Certains pourtant l’ont vue se diriger d’un pas ferme vers les recoins obscurs et les fibres secrètes des consciences : c’est là qu’il faut aller la chercher aujourd’hui.PH. SOLLERS : A propos de cette question du rythme : Lacan dit que la pulsion la plus proche de l’inconscient, contrairement à la pulsion scopique, à tout ce qui intéresse le champ du regard, c’est la pulsion invocante. Or Stanze s’intitule précisément « Incantation dite au bandeau d’or ». Il y a dans la tradition culturelle française une surdité, un mutisme, à l’égard de l’incantation, et cela a probablement joué un grand rôle dans ces sur-investissements à propos de l’écriture, de cette surlittéralisation du langage, et cette impossibilité d’accéder, et sous une forme qui ne serait évidemment pas celle du lyrisme ancien, à un lyrisme moderne qui serait ponctué d’une manière sérielle et accordé à cette pulsion invocante ; sans quoi le chemin vers la tragédie grecque, vers l’archéologie même de toute notre culture, serait rendu absolument impossible. Et c’est là précisément que Hölderlin et Artaud font intervenir quelque chose d’absolument évident à quoi je pense qu’on a voulu tout simplement clouer le bec. La stratégie de Lautréamont, probablement très conscient de l’impossibilité de produire une rupture en ce point, est une stratégie du détour ; d’où sa force, d’où son côté irréversible ; mais il n’empêche que quelque chose ne s’y abîme pas, si je puis dire ; quelque chose ne s’y désarticule pas. C’est bien sûr l’utilisation prodigieusement souple des possibilités rhétoriques au niveau du discours : mais au niveau de la langue, je pense qu’Artaud fait surgir quelque chose d’autre, qui percute à un niveau plus microscopique, non ?...
M. PLEYNET : Je dirai que Lautréamont développe une stratégie, là où Artaud est offensif ; il y a une ponctuation stratégique chez Lautréamont, alors qu’il y a un bombardement de ponctuations, un bombardement atomique, avec Artaud...
PH. SOLLERS : C’est cela ; le piège à inconscient que constitue Lautréamont est sans exemple, on peut utiliser cette expérience sur les formes du discours, utiliser en même temps ce bombardement atomique de langue, reprendre les problèmes rythmiques et invocatifs tels qu’ils ont été posés par Hölderlin en direction de la Grèce, et essayer de dialectiser toutes ces données, finalement tous les points de rupture du discours occidental, un peu comme Pound a de son côté admirablement essayé de le faire tout en ne trouvant pas à mon sens le point de vue critique qui lui permette d’en sortir (j’écrivais la fin de H, à Venise, en voyant Pound sous ma fenêtre). C’est dans cette dialectisation que se jouent aujourd’hui la poésie, le roman dont on peut dire qu’une nouvelle forme « d’épopée » est en train de sortir. Appelons cette nouvelle forme : du wake.
M. PLEYNET : Je voudrais dire encore une chose à propos d’Artaud et de Hölderlin, et de la place que Lautréamont occupe. En ce qui me concerne, en tout cas, et à partir de ce que Sollers vient de dire du français, de la langue française, de l’absence de musique française comme de poésie française — des effets musicaux, relativement mineurs, et une « poésie » des états d’âme liée à des phénomènes idéologiques parfaitement analysables (pas de poésie réellement lié aux forces qui sont en jeu dans l’histoire), ce qui alors a été pour moi d’une très grande importance, pour déborder le caractère — comment dire ? — médiocre du français, c’est quand même Lautréamont ; c’est lui qui m’a permis de penser une sortie possible et d’aborder à la fois la lecture d’Artaud et celle de Hölderlin que souligne Sollers ; c’est à la fois la clôture que marque Lautréamont, et l’extériorité qu’il détermine par rapport à cette clôture qui m’a permis de sortir des limites du ghetto de cette culture française et de tout ce qu’elle programme. Il me semble qu’on peut situer Lautréamont juste à l’angle de cette articulation historique.
PH. SOLLERS : Exactement, et on pourrait formuler qu’une certaine utilisation parasitaire d’Artaud est possible, alors que la machinerie des Chants de Maldoror et des Poésies récuse plus essentiellement le même type d’utilisation. Une certaine utilisation d’Artaud reste possible, sur fond des contenus culturels : une interprétation spiritualiste, occultiste, peut se perpétuer, et évidemment on se garde bien d’aller interroger dans leur coupe, et dans leur coupe coupe, les derniers textes d’Artaud avec ce qu’ils disent, c’est-à-dire RIEN ; et on s’attarde au contraire à profiter de ce qu’Artaud a brûlé dans sa traversée.
C’est pourquoi j’ai insisté sur l’aspect logique du problème, c’est-à-dire sur l’impossibilité désormais de faire du sens plein et centré : c’est là que Lautréamont est décisif. Au niveau d’une autre périodisation, qui est l’histoire des langues, on pourra dire que soit Artaud, soit Joyce, par exemple, produisent une refonte autre. C’est à propos de ces phénomènes différents que j’indiquais la nécessité d’une dialectisation, a partir de tous ces rapports qui fondent l’histoire de notre discours réel : réel, pas imaginaire. Il ne faudrait tout de même pas croire qu’il suffirait de prendre le langage existant empiriquement dans la réalité sociale et de le refléter passivement.J.-L. HOUDEBINE : Nous avons déjà été conduits, au cours de cet entretien à évoquer plusieurs fois votre pratique dans Stanze. Pour essayer cependant de préciser encore, si vous le voulez bien, Marcelin Pleynet : il y a dans votre texte toute une dimension d’écriture qu’on pourrait dire relever de l’épique, notamment par cette scansion qui s’y développe d’un rapport actif à l’histoire mondiale, aux modes de production tels qu’ils se sont succédé au cours de cette histoire, avec leurs pratiques idéologiques propres, signifiantes, sexuelles, etc. ; en même temps, cette dimension épique se trouve constamment travaillée par ce qu’on pourrait appeler une fragmentation infinie de la langue, une (dé)multiplication des points de vue opérée dans le plein de chaque unité signifiante ; et c’est ainsi que s’opère sans doute cette actualisation extrêmement incisive caractéristique également évidente de votre texte. Cela poserait en même temps la question à travers cette double scansion, du rapport entre savoir et non savoir dans votre texte, dans la mesure où ce rapport qui s’y développe est en même temps celui d’une contradiction qui passe par le procès d’une dépense du sujet, à travers des textes, à travers la langue, à travers toute notre actualité politique et idéologique. Si ce qui n’est encore qu’une première impression de lecture vous semble fondée, pouvez-vous vous expliquer sur votre travail en ce sens, dont vous avez déjà donné des éléments très importants, d’ailleurs, dans les remarques que vous avez formulées avec Sollers au cours de cet entretien ? Et d’une manière très générale, qu’en est-il de votre rapport à ce qui a été traditionnellement appelé « poésie » dans notre culture ?
M. PLEYNET : Ce que vous dites des stades historiques me paraît important dans la perspective de ce que nous avons pu dire en commençant : à savoir tout ce qui regarde la transformation culturelle et le nouveau stade historique que prépare le conflit entre la bourgeoisie et le prolétariat ; mais il faut faire intervenir ici Freud, dans la mesure même où c’est de poésie qu’il est question. Intervention qui est d’autant plus importante en fonction de ce que traite Stanze, au sens, si vous voulez, où Freud peut dire : religion = retour du refoulé. Et il faut bien voir que « religion », ce n’est pas seulement les églises que l’on peut connaître, mais que pour nous aujourd’hui, la « religion » est marquée à 90 % dans une structure familialiste ; c’est là que se situe, aujourd’hui plus que jamais, le fond de la religion ; disons : une religion laïque.
J’ai donc essayé de penser cela sous la rubrique « religion = retour du refoulé », à travers tous ces champs historiques, avec, en ce qui concerne la poésie, ce phénomène que traduit assez bien ce vers d’Horace : « les poètes sont les interprètes des dieux » ; et cette autre phrase, tout aussi classique, tout aussi apparemment peu transgressive, de Tacite : « les hommes, quand ils sont saisis par la terreur, inventent en même temps qu’ils croient ». Je crois qu’on peut voir à travers ces propositions le mode de développement analytique des phénomènes dont se trouve investi un sujet contemporain à travers l’histoire qui les porte et qui va les déborder. Alors, pour réaliser ce projet pour intervenir à cette profondeur, pour toucher à ce refoulé qui est partout, et qui se manifeste immédiatement, il fallait trouver un langage, une forme de discours qui puisse être, par rapport à tout ça, décapante, qui puisse produire les mêmes effets de condensation et de déplacement que ce type de refoulement produit ; le projet de ce discours serait en quelque sorte de retrouver une langue et une écriture qui reproduiraient dans le champ même de l’analyse quelque chose comme la langue et l’écriture de l’ivresse et du rêve. Pour cela, j’ai utilisé dans le langage ce qu’on pourrait peut-être appeler des cartouches de langues, c’est-à-dire des charges et des agglomérations de langue(s) qui, aussi bien dans ce qu’elles portent que dans ce qui les investit d’une façon stratifiée, mettent en scène, justement, des effets de refoulement et doivent les analyser et les faire surgir ; mais non pas les analyser et les faire surgir d’une manière didactique académique universitaire, mais les analyser et les faire surgir dans la langue même du rêve, dans le lit (des langues) du sujet concerné. Du coup, on ne peut pas parler de cela d’une façon unifiée ; ce qui caractérise cette méthode, me semble-t-il, c’est tout d’abord qu’elle ne peut se répéter ; un exemple qui me paraît éclairant : c’est celui de Schönberg expliquant à un de ses correspondants : « la gamme fondamentale de douze tons, je ne peux pas vous la démontrer systématiquement, dans mon travail, parce que c’est une méthode que j’utilise, ce n’est pas un système ». Pour que ces cartouches soient efficaces à l’intérieur de ce déploiement, il faut évidemment qu’elles ne se renouvellent pas sous une forme systématique, car alors elles relèveraient précisément du refoulement, ou de la répétition de la névrose ; il faut au contraire qu’elles soient chaque fois, comme peut l’être un rêve, surprenantes ; il faut qu’elles surprennent chaque fois le sujet (et aussi bien le sujet qui écrit ; ce n’est pas un savoir qui produit cela), donc aussi bien le sujet qui écrit que le sujet qui lit, dans son refoulement.
Il y aurait bien sûr de très nombreux exemples à donner ; en voici un. Il porte sur le début du troisième Chant dont le corpus culturel dominant est la Grèce. J’ai voulu scander dans ce début du troisième Chant (et d’une façon très visible pour peu qu’on s’y arrête, c’est-à-dire si l’on a intérêt à déchiffrer son rêve) le tempo de ce signe égal que Freud marque entre « religion » et « retour du refoulé » — j’ai donc inscrit tout cela sous la forme de la portée musicale ; et comme il s’agissait aussi d’articuler ce chant sur la Grèce au chant qui le précède sur l’Égypte, j’ai choisi de programmer l’ensemble de ce travail par des références à un dieu grec plus ou moins directement importé d’Égypte : Protée. Ce choix n’est bien entendu pas seulement déterminé par sa
« portée » anagrammatique, il tient aussi à ce qu’il forme « cartouche signifiante » avec le sens qu’il contient, on sait que Protée est un dieu qui, dès que l’on essaie de le saisir, peut prendre toutes sortes de formes (un peu comme l’inconscient), qui a la connaissance du passé, du présent et de l’avenir, et qui peut comme l’inconscient entendre le chant des sirènes... N’y a-t-il pas là justement toute une stratification formelle qui se propose et par laquelle à l’intérieur de laquelle se déchiffrent mutuellement les investissements et les déplacements « religieux » qu’elle programme. Dans la suite directe des métamorphoses de ces portées (de ces Protées) j’ai introduit ce qui devait nécessairement les lier à une sorte de temporalité analytique : la musique (l’art des muses) avec pour la représenter Euterpe, dont la traduction du grec « euterpos » signifie « bien rassasiée ». Vous avez ainsi une série de stratifications, de couches signifiantes critiques les unes par rapport aux autres et qui se mettent réciproquement en situation d’analyse. On voit bien comment la traduction, et si je puis dire, l’analyse, l’interprétation « Euterpe-bien rassasiée » découvre et remarque tout ce qu’indique l’essai de Fonagy publié en 1970 (« Les bases pulsionnelles de la phonation »). Dans ce Chant III, il n’est pratiquement pas question nommément de Protée ou d’Euterpe, quoique, en même temps, les deux charges culturelles, les deux charges analytiques qu’ils représentent bombardent littéralement ce Chant. On pourrait avoir là un exemple significatif de ce que nous disions tout à l’heure concernant le rapport à l’histoire, au sexe et à la science, et aux diverses censures qui refoulent ce rapport. En effet, que développe cet exemple ? d’une part une structure religieuse répondant des multiples transformations formelles dont elle fait si je puis dire État dans ses déplacements « d’intérêt », tels que les marquent les modulations de son chant ; et d’autre part (partant du principe énoncé par Lacan que l’inconscient est structuré comme un langage) avec la traduction de ce qui, dans cet espace culturel, programme le chant « Euterpe-bien rassasiée » (on sait qu’Euterpe était la muse, à la double flûte, du chant lyrique) le fond sexuel analytique (la langue ou l’oreille de la langue) de cette mise en place, de cette mise en forme, de cette danse : refoulé/religion/histoire/langue.J.-L. HOUDEBINE : Sollers, à vous de conclure ?
PH. SOLLERS : Je crois que Pleynet vient de montrer très bien comment l’interaction entre plusieurs couches d’interventions critiques les unes par rapport aux autres donne un espace de multiplication de la langue, ou plutôt des langues, par tout ce qu’elles sont incapables de penser elles-mêmes sitôt qu’elles se constituent en systèmes ; autrement dit, si elles se constituent pour donner le sujet conscient. Ce qui s’écrit s’adresse, dans sa plus grande partie, à l’inconscient ; ce mode d’adresse définit l’intervention, puisque si ça s’adresse à l’inconscient, cela ne veut pas dire que ça s’adresse seulement à l’inconscient de l’autre (avec un petit « a »), mais d’abord à l’inconscient du lieu d’émission. Ce qui permet de comprendre que si cette fonction de l’Autre (avec un grand « A ») n’est pas posée par rapport au fonctionnement de ce langage (je ne dis pas : par rapport à son sens), une lecture à plat y persiste. La forme particulière que cela prend dans « H », c’est le dédoublement permanent du lieu d’émission sous la forme du dialogue, coupé par des interventions monocordes, si on peut dire, non dialoguées, qui sont un peu comme des recharges de cette dualité d’émission. On peut prendre cette dualité aussi bien comme mise en scène que comme fonctionnement d’un langage qui se saisirait dans son rapport à l’Autre. C’est toute la dialectique de cette langue qui se pose ainsi : si ça ne peut pas se répéter, si c’est obligé de toujours consommer de l’inattendu, ou de la surprise, c’est précisément parce que la langue se produit dans ce rapport de fonctionnement à l’Autre. Donc ce qui choit, ce qui tombe de ce fonctionnement structural, c’est un reste. Et ce sont deux conceptions du langage, et en définitive du monde, qui sont ici en jeu : ou bien, ce qui tombe du langage, de son fonctionnement, c’est du reste ou bien c’est le plat de résistance. Vous me posiez la question tout à l’heure : comment ce langage, cette pratique du langage peut-elle être reçue ? Eh bien, il y a deux positions absolument inconciliables : c’est que si c’est pris comme plat, comme plat de résistance à plat, c’est rigoureusement non traitable. Si c’est pris comme reste, et que ce reste se greffe sur d’autres restes, alors on a ce fonctionnement infini, qui peut donner cet éclairage rasant, de biais, le seul possible de l’histoire et du sujet. Il faut dire qu’il y a quelque chose qui ne peut pas s’éclairer de plein fouet ; il y a quelque chose de tordu dans le langage, et c’est cela qui fait que le langage ne se voit pas comme tel, tordu comme il est ; c’est bien pour cela qu’il y a de l’inconscient.
La position de ce langage, par couches, avec sa charge de pulsion invocante, donc de la pulsion la plus proche de l’inconscient, dans son rapport à l’Autre, c’est très difficile de la pratiquer, mais c’est la seule façon de comprendre quelque chose à l’histoire. Ce qui m’a frappé, quand j’ai écrit H, — c’est au niveau du rapport de la voix avec elle-même, de sa division d’avec elle-même (et je n’entends pas forcément par voix ce qui s’énonce comme vocal), ce que j’ai été amené à aborder, c’est une dimension qui peut paraître bizarre à première vue, et qui est la littérature « prophétique » de la Bible. A travers cette longue traversée d’éléments historiques, passant par des éléments parfaitement triviaux (car ces livres, contrairement à l’impression qu’on pourrait avoir avec ce que nous venons de dire, sont bourrés aussi d’éléments quotidiens, banals, d’informations, telle coupure de journal, telle nouvelle sur l’histoire mondiale, telle réflexion prise au hasard ; ce qui n’est pas de l’ordre du collage, mais qui relève d’une logique qui n’est pas une logique de l’ordre narratif habituel, qui est au contraire une logique comme verticale, opérant ses coupes comme l’entend autre chose que la conscience), à travers, donc, cette longue traversée de H, il y a à la fin une intervention du discours prophétique enfoui de la Bible. Comme si cette espèce de recreusement, à la fois progressif et rétro-actif, amenait, dans l’ordre de la voix, ou de l’écoute, la transcription la plus profondément invocante. Ceci pour dire que le fonctionnement lui même se charge de ce qu’il doit découvrir. La différente nouvelle est introduite par la dimension dialectique historique, épique, du sujet dans cet arrachement au langage. C’est l’introduction du H. L’Hautre.


L’avant-garde reconnaissante

Denis Roche.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Je lis sur un site consacré à Denis Roche :
« Louve basse paru en mars 1976, l’hebdomadaire Les Nouvelles littéraires proposait l’automne suivant un dossier intitulé NOTRE AVANT-GARDE et en intronisait Denis Roche à la rédaction en chef. Le dossier se composa donc d’un texte de Denis Roche : Deux ou trois choses que je sais d’elle, reproposé ci-dessous, d’un texte de Philippe Sollers suivi d’un entretien avec ledit, d’une bande dessinée de William Burroughs et d’un texte de Christian Prigent. »
Deux ou trois choses que je sais d’elle
 . Avec ce rappel : « De Sollers : "Un écrivain révolutionnaire qui écrit comme tout le monde n’est pas révolutionnaire." »
. Avec ce rappel : « De Sollers : "Un écrivain révolutionnaire qui écrit comme tout le monde n’est pas révolutionnaire." »
LIRE SUR PILEFACE :
Marcelin Pleynet, Sur les avant-gardes révolutionnaires
L’avant-garde aujourd’hui (dialogue entre Marcelin Pleynet et Philippe Sollers)
L’avant-garde et après ?


De Tel Quel à L’Infini
Peu après la mort de Sollers, un ami écrivain et éditeur me demandait : « Et maintenant, qu’allez-vous faire ? » Réponse : Continuer, au feeling. Tout reprendre. Tel Quel 92 numéros. L’Infini 148 numéros. La bibliothèque est en feu.

Dans la bibliothèque : Tel Quel, L’Infini, Pleynet, Sollers, etc...
ZOOM : cliquer sur l’image.

[1] Cf. Jean-Louis Houdebine tel quel.
[2] Le comité de rédaction de la revue était composé de Andrée Barret, Jacques Chatain, Jean-Louis Houdebine et Guy Scarpetta.
[3] Cf. Jean-Claude Milner : Relire la révolution.
[4] Et, est-il besoin de le rappeler, bien d’autres.
[5] Avec toutes les questions que posait Heidegger en 1972 dans une lettre à Roger Munier. Cf. Un certain silence... sur Le Dit de la poésie d’Arthur Rimbaud.
[6] « Le plus clair, dans tout ça, c’était une formidable entreprise de destruction du « Sujet »... Le Sujet, tel était l’ennemi. » Cf. Althusser dans Femmes.
[7] Cet éditorial précise les positions du Mouvement de juin 1971 dans sa lutte contre « l’hégémonie bourgeoisie-révisionnisme ». Il y précise en quoi « révisionnisme » et « dogmatisme » sont complémentaires (d’où le concept de « dogmatico-révisionnisme »). « Les deux masques les plus hideux qu’ait jusqu’à ce jour empruntés l’histoire moderne », le fascisme et le stalinisme (« même si la nostalgie débile en traîne encore ici ou là »), y sont fermement dénoncés. Le stalinisme :
Le stalinisme est pour nous spécifié par les formes dogmatiques que peut prendre, à un certain stade de régression, l’idéologie socialiste face aux contradictions qu’elle met en jeu.
Dénonciation et définition certes insuffisantes, mais qui méritent d’être rappelées : elles témoignent de ce que Tel Quel croyait trouver en Chine : « une critique de gauche du stalinisme ».
Dans le même numéro on trouve un texte de Nicos Poulantzas : Note à propos du totalitarisme, et des inédits de Lu Xun.
[8] Le parti communiste français révisionniste. A.G.
[9] Lire : Mao, La démocratie nouvelle (janvier 1940)
 . Mao y développe longuement son analyse du Mouvement du 4 mai 1919.
. Mao y développe longuement son analyse du Mouvement du 4 mai 1919.
[10] Publié dans Tel Quel, n° 63 sous le titre « Le chant zéro ».




 Version imprimable
Version imprimable


 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


