
Quand Kafka écrivait son Journal intime...
HIVER 2024 - 2024 : voilà cent ans que Franz Kafka n’est plus de ce monde. Malgré sa disparition, il ne cesse de réapparaître dans de multiples écrits. Quoi de plus autobiographique qu’un journal intime ?
BONNES FEUILLES - Une exploration de l’âme agitée d’un des plus éminents écrivains du XXème siècle. Franz Kafka (1883-1924), employé chez Generali Assurances, n’a publié qu’une infime partie de ses œuvres de son vivant. Ses écrits, imprégnés par la peur de la maladie et de la solitude, le désir mêlé à la crainte du mariage, le conflit avec son milieu familial et religieux et sa recherche de rédemption, se reflètent dans chaque page de son Journal.
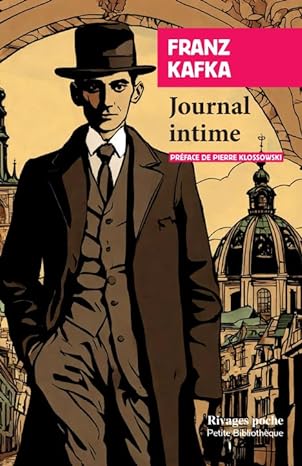 Franz Kafka nous a uniquement laissé des œuvres fragmentaires, que ce soient ses romans, ses aphorismes ou ses journaux intimes. Malgré tout, leur inachèvement n’empêche pas des oeuvres fines, et une attention accordée au détail. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette intensité constamment brisée par l’insatisfaction, mais toujours ravivée par l’espoir, voire la conviction, de parvenir à une plénitude.
Franz Kafka nous a uniquement laissé des œuvres fragmentaires, que ce soient ses romans, ses aphorismes ou ses journaux intimes. Malgré tout, leur inachèvement n’empêche pas des oeuvres fines, et une attention accordée au détail. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette intensité constamment brisée par l’insatisfaction, mais toujours ravivée par l’espoir, voire la conviction, de parvenir à une plénitude.
Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages, traduites et préfacées par Pierre Klossowski.


Préface
Franz Kafka ne nous a laissé que des fragments ; ses romans le sont au même titre que ses aphorismes et ses journaux intimes. Mais ce qui frappe de prime abord, c’est que l’inachèvement n’exclut pas une subtilité et une minutie du détail peu communes. Rien de plus poignant que cette intensité sans cesse interrompue par l’insatisfaction, sans cesse reprise par l’espérance, voire la certitude d’une totalité à conquérir.
« Celui qui, de son vivant, ne vient pas à bout de la vie – écrit-il en octobre 1921 dans son Journal – il a besoin de l’une de ses mains pour écarter un peu le désespoir que lui cause son destin – il n’y arrive que très imparfaitement – et de l’autre main il peut enregistrer ce qu’il aperçoit sous les décombres, car il voit autre chose et plus que les autres, il est donc mort de son vivant et il est essentiellement le survivant. »
Désormais la tentation sera grande d’interpréter l’absence de terme comme la négation de celui-ci, le jalonnement de la voie comme de la sporadicité, l’énigme irrésolue, la cryptographie non déchiffrée comme de la complaisance dans l’étrangeté et dans la mystification de l’absurde. Nous ne pouvons en aucun cas parler de lui comme s’il n’avait pas eu de vision finale. Celle-ci se reflète dans chacun de ses mots ; quand bien même la phrase resterait en suspens, on peut l’appréhender, mais on ne saurait en aucun cas confondre les prédispositions à la vision avec la vision elle-même.
Le Journal de Kafka est tout d’abord le journal d’un malade qui désire la guérison. Non pas un malade qui se confond peu à peu avec sa maladie comme Nietzsche, à la fois lucide et délirant ; Kafka n’admet pas la tragédie comme solution. Mais il veut la santé pour le plein épanouissement des ressources qu’il devine en lui, il croit donc à la santé comme à un bien nullement méprisable. Un esprit intègre pour avoir craint de surestimer ce qu’il ne possédait pas en propre et que les autres possédaient dans la banalité, peut alors connaître ce grave et décisif malentendu que Kafka s’est avoué lui-même : « Le fait que je n’ai rien appris d’utile et – ce qui est étroitement lié – que je me suis laissé dépérir physiquement, ce fait peut cacher une intention. Je voulais ne pas être détourné, détourné par la joie de vivre d’un homme sain et utile. Comme si la maladie et le désespoir ne détournaient pas autant ! »
Toute l’œuvre de Kafka respire l’attente du Royaume messianique. Pour lui, la guérison, mais aussi la jouissance justifiée de la santé coïncideront avec l’avènement du Royaume et comme le Royaume n’est encore venu pour personne, nul ne saurait surestimer ce qui échappe encore à tous : alors la santé sera sainteté.
Comment se produira cet avènement ? Le Royaume n’est-il pas au milieu de nous et le Messie, n’est-il pas déjà venu ? Par instants Kafka appréhende la béatitude céleste au sein même de la vie terrestre : « … Il est parfaitement concevable que la magnificence de la vie soit répandue autour de chacun et cela toujours dans sa plénitude, mais voilée dans la profondeur, invisible, fort loin. Elle se trouve là-bas point hostile, point réfractaire ni sourde. L’invoque- t-on par le mot juste, par son nom véritable, alors elle vient. C’est là le caractère de la magie qui ne crée pas, mais qui invoque. »
Une variante de cette appréhension est celle déjà ressentie par la théologie médiévale de l’indestructibilité du Paradis terrestre : « Nous fûmes créés pour vivre au Paradis, le Paradis était destiné à nous servir. Notre destination a été changée ; que celle du Paradis l’ait été aussi, c’est ce qui n’est pas dit. Nous avons été chassés du Paradis, mais le Paradis n’a pas été détruit pour cela. Cette expulsion en quelque sorte est une chance, car si nous n’en avions pas été chassés, le Paradis aurait dû être détruit. » Le Paradis terrestre nous attend. Et Kafka veut y rentrer coûte que coûte. Kafka ne veut pas quitter ce monde visible promis au Royaume pour un monde invisible. Sans doute, le monde visible contient l’invisible comme sa justification virtuelle : « Personne ici ne crée rien de plus que sa possibilité spirituelle de vivre ; peu importe qu’il donne l’apparence de travailler pour se nourrir, pour se vêtir, etc. ; avec chaque bouchée visible une invisible bouchée lui est tendue, avec chaque vêtement visible un invisible vêtement. C’était là la justification de chaque homme. Il semble fonder son existence par des justifications ultérieures, mais ce n’est là que l’image inversée qu’offre le miroir de la psychologie, en fait il érige sa vie sur ses justifications. Il est vrai que chaque homme doit pouvoir justifier sa vie (ou sa mort, ce qui revient au même), il ne peut se dérober à cette tâche », parce que, aussi, « l’homme ne saurait vivre sans la confiance en quelque chose d’indestructible en soi, cependant l’indestructible autant que la confiance peuvent lui demeurer constamment cachés. L’une des possibilités d’expression de ce demeurer caché est la croyance en un Dieu personnel », d’autant plus que « croire signifie : libérer en soi l’indestructible, ou plus exactement se libérer, ou plus exactement : être indestructible, ou plus exactement être ». Si donc ce monde-ci ne saurait être détruit « que du lieu d’où il fut jugé bon », libérer en soi l’indestructible ne serait-ce pas alors même ce retour à l’indestructible Paradis qui se confondrait ainsi avec le fait d’être ? Ne serait-ce pas là justement libérer le monde invisible dans le monde visible ? Mais qui d’autre le pourra si ce n’est le Libérateur par excellence : le Messie ?
« Le Messie viendra sitôt que l’individualisme de la foi le plus irréfrénable sera devenu possible – que personne n’anéantira plus cette possibilité, que personne ne tolérera plus l’anéantissement, lors donc que les tombes s’ouvriront. C’est peut-être là toute la doctrine chrétienne tant dans la démonstration de l’exemple qui doit être suivi, d’un exemple individualiste, que dans la démonstration de la résurrection du Médiateur, au-dedans de l’homme particulier. » Il semble qu’on assiste ici chez Kafka à une confluence du judaïsme et du christianisme et que Kafka fasse un moment coïncider le second avènement, la parousie du Messie déjà venu avec l’avènement prochain et non encore accompli du Messie. C’est pourquoi ailleurs il peut s’exprimer singulièrement lorsqu’il écrit : « Le Messie ne viendra que quand il ne sera plus nécessaire, il ne viendra qu’un jour après son arrivée, il ne viendra pas au dernier jour, mais au tout dernier », ce qui semble indiquer que cette résurrection du médiateur au sein de l’homme particulier se sera universalisée, le Messie lui-même n’étant alors qu’une expression, une consécration de l’universelle résurrection.
Or, tant que santé et sainteté se trouvent séparées, le cafard règne, la folie est possible, l’ennui est maître, la lucidité donne dans le désespoir. La santé s’incarne dans quelques-uns, la maladie ravage beaucoup d’autres. La santé n’est pas plus un argument contraignant que la maladie. L’une et l’autre se déprécient mutuellement selon que l’on change de camp. « Une faiblesse, un manque précis mais trop difficile à décrire… me retient autant de la folie que de tout essor. Pour cette raison qu’elle me retient de la folie, je la cultive ; par peur de la folie, je sacrifie l’essor et à cet échange, sur ce plan qui ne connaît point d’échanges, je perdrais certainement… » La vie apparaît alors elle-même comme « un perpétuel détournement qui ne permet pas même de se rendre compte de quoi il détourne » jusqu’à ce que celle que l’on a choisie, pour avoir plus particulièrement détourné « de la joie de vivre d’un homme sain et utile », se révèle enfin comme une intention d’abord cachée. Cependant, « chaque homme ici-bas se voit poser deux questions de croyance, la première relative à la crédibilité de cette vie, la seconde relative à la crédibilité de son but. À ces deux questions un chacun, du fait même de sa vie, répond si immédiatement et si fermement par un oui, qu’il en devient douteux que les questions aient été comprises justement. Toujours est-il qu’il faut dès lors se frayer un chemin vers un propre oui fondamental… ».
D’où ce refus de valoriser le désespoir :
« Quelque misérable que soit mon fond… il me faudra pourtant… chercher à atteindre au meilleur avec les moyens qu’il m’offre ; ce n’est qu’un pur sophisme que de dire qu’on ne peut, avec ces moyens, atteindre qu’à une seule chose et que par conséquent cette seule chose serait la meilleure et que cette meilleure chose serait le désespoir. »
Si le Messie est déjà venu et qu’il a souffert pour tous les hommes, les malades dont la maladie les purifie du péché lui seront certainement plus proches que les hommes sains dont la santé rend le péché opaque. Alors, la maladie est la Porte étroite : le malade qui se voit refuser la santé peut trouver dans la maladie la voie qui mène au-delà de la santé, vers la sainteté. L’homme qui jouit de la santé peut choisir le climat de la maladie ; sa propre santé l’empêchait de vivre de la vie de Dieu qu’il trouve enfin au milieu de la maladie des autres. Dans les deux cas, la santé paraît obstruer la vraie voie. Et il semble que la vie saine soit contre Dieu.
Mais si le Messie n’était pas encore venu, alors la maladie ne serait qu’une forme de son attente ; elle appellerait le Messie, elle le nommerait, elle l’invoquerait, elle le contraindrait de venir, elle serait autant la preuve de sa venue prochaine que celle de sa non-venue dans le passé.
Or, l’avènement de son Royaume ne va-t-il pas immédiatement restituer la sainteté à la santé aujourd’hui injustifiable dans l’état de péché ? N’abolira-t-il pas avec le péché le détour nécessaire de la maladie ? Et la sainteté ne cessera-t- elle pas alors d’être l’état d’un seul ? Le Royaume ne donnera-t-il pas à tous de jouir de leur santé dans sa sainteté et tous ne seront-ils pas sanctifiés dans leur santé ? Tous enfin ne seront-ils pas alors justifiés ?
Venue irrévocable ou non-venue du Messie, avènement accompli ou encore attendu et prochain : Franz Kafka se sent à la fois sollicité par la confiance chrétienne comme par l’espérance judaïque sans participer absolument ni à l’une ni à l’autre. Ainsi fut possible l’attraction que Kierkegaard exerçait sur lui et la méfiance qu’il lui inspirait dans le même temps. Davantage le Kierkegaard de la période de la crise que de celle de la foi qui s’épanouit dans les Discours religieux. En dépit de son lien fraternel avec le théologien danois, il semble parfois qu’il l’ait secrètement en horreur : pareille « tentation », il en voyait l’illustration dans Cervantès. Sancho Pança est tenté par Don Quichotte ; car c’est bien Don Quichotte qui selon lui est le Diable : et Sancho qui incarne l’homme sain et sensé n’échappe à la folie que grâce aux divertissements qu’il tire du spectacle des entreprises du Diable, obligé d’exécuter lui-même ce qui n’avait pu séduire Sancho.
Août 1945. Pierre Klossowski



Introduction
Franz Kafka a parfois été confondu avec le mouvement expressionniste allemand et, d’une façon plus générale, avec les velléités révolutionnaires de la génération intellectuelle de 1918-21 ; en fait il est en réaction contre ces mouvements qui, souvent, caricaturèrent plutôt qu’ils n’exprimèrent la soif de justice et de rédemption d’une société ayant survécu à la catastrophe et ne subissant pas moins l’attrait des atrocités futures. La recrudescence du titanisme qui caractérise alors les manifestations d’avant-garde, Franz Kafka la ressentit pour son propre compte ; mais le motif principal du titanisme, le meurtre du Père, si fructueusement sondé par Freud, si souvent falsifié par tant de jeunes littérateurs déchristianisés ou déjudaïsés, Franz Kafka lui restitua son authenticité religieuse. La guerre psychologique déclenchée par Freud contre les croyances fondamentales de la vie bourgeoise, guerre dans laquelle devait se lancer toute la jeune intelligence européenne et particulièrement la jeune littérature allemande des années weimariennes, a souvent fait accuser à tort ou à raison l’esprit judéo-allemand d’être un agent dissolvant. Peut-être ne s’est-on pas rendu compte alors que, pour autant qu’il s’agissait d’esprits d’origine juive, on se trouvait devant des cas de déjudaïsation identiques à ceux de la déchristianisation et participant, d’une égale manière, à la décomposition générale que l’antichrétien Nietzsche, sous prétexte de frayer la voie à une race forte, avait favorisée de toute la puissance de son génie.
« Ce que j’annonce, avait-il dit au début de sa Volonté de Puissance, c’est l’avènement du nihilisme européen. » Et parvenu au sommet où se rejoignent lucidité et folie, il s’était écrié dans l’appréhension des catastrophes futures : « Je suis à la fois la déchéance et l’essor. » Moins de trente ans plus tard, Franz Kafka dressait en ces termes le bilan de sa conscience déjudaïsée :
« … J’ai puissamment assumé la négativité de mon temps, qui m’est d’ailleurs très proche, que je n’ai pas le droit de combattre mais que dans une certaine mesure j’ai le droit de représenter. Pas plus à la maigre positivité qu’à l’extrême négativité qui se retourne en positivité, je n’ai eu de part héréditaire. Pas plus que je n’ai été introduit dans la vie par la main déjà débile du christianisme tel Kierkegaard, je ne me suis accroché, tels les Sionistes, au bout du taleth d’Israël qu’emporte le vent. Je suis un terme ou un commencement. » Mais avant de le constater il avait noté cette revendication : « Ce ne sont pas la paresse, la mauvaise volonté, la maladresse… qui me font échouer ou pas même échouer en toutes choses : vie de famille, amitié, mariage, profession, littérature, mais c’est l’absence du sol, de l’air, de la Loi. Me créer ceux-ci, voilà ma tâche… tâche la plus originelle… » Si les ouvrages de Franz Kafka, particulièrement ses grands romans baignent dans une ambiance d’« inquiétante étrangeté », ce n’est point par complicité avec cette négativité de son temps qu’il prétend assumer ; si les situations qu’ils décrivent affectent régulièrement des formes oniriques, ce n’est point par abandon aux méandres du rêve, moins encore par adhésion à la discontinuité : ce grand peintre du malaise et du dépaysement ne voit dans ces deux états que des formes d’aliénation du péché, que les mises en scène des forces paralysantes auxquelles l’homme se voit livré tout entier quand il a rompu, renié, sinon simplement oublié les éternels liens de son existence avec les puissances parentales et divines.
Trois éléments ont déterminé la carrière de Franz Kafka : le conflit avec le père et la communauté juive ; la vie célibataire ; la maladie. Pour résoudre le conflit avec le père et la communauté juive, il a invoqué la volonté d’une recherche personnelle de Dieu ; pour donner un sens décisif à sa solitude, il s’exclut du mariage et, comme Kierkegaard, rompt ses fiançailles ; c’est alors que la maladie, incurable, éclate : mais s’il lui faut la consommer jusqu’à la mort comme le châtiment de la solitude, pour absoudre cette dernière, il saura dégager de ce châtiment une exégèse personnelle du Mal et du Bien, il élaborera une forme particulière de kabbale : « Toute cette littérature n’est qu’un assaut livré aux extrêmes frontières de ce monde, note-t-il dans son Journal, le 16 janvier 1922, et si le sionisme n’était survenu entre-temps, elle aurait pu facile- ment développer une nouvelle doctrine secrète, une nouvelle kabbale. Il est vrai que cela exige un génie on ne sait combien incompréhensible qui, à nouveau, pousse ses racines au sein des vieux siècles ou bien qui recrée les vieux siècles et qui ne se dépense pas dans tout ceci, mais qui à présent commence seulement à se dépenser. »
VOIR SUR PILEFACE
La lettre à son père, dont Max Brod a publié d’importants fragments, révèle les données du conflit avec le père et de l’explication avec la tradition patriarcale juive à laquelle il fut amené. Le père prétend représenter le seul judaïsme véritable. Mais cette représentation est équivoque, elle n’a plus rien de coercitif pour le fils. Ce qui est douloureux pour ce dernier qui éprouvait alors le besoin d’une pareille contrainte. Le père ne donne-t-il pas lui-même l’exemple de l’émancipation par rapport au judaïsme authentique, du fait de sa formation, de son tempérament de pionnier, de sa réussite par le travail et de son élévation sociale ? L’ambiance de la maison paternelle est donc suspecte aux yeux du fils qui souffre d’un ritualisme sans contenu.
Kafka, par conséquent, éprouve le besoin de trouver Dieu en dehors de la communauté religieuse d’où Dieu semble s’être retiré. Cependant, en dépit de sa carence religieuse, le père demeure redoutable aux yeux du fils, du fait de sa vitalité, de son génie d’entreprise, de sa puissance matérielle enfin, dont le fils ne cesse de dépendre dans une certaine mesure. Pendant quelques années il se dévoue aux soucis du père, vaine tentative de liquider sa dette envers la puissance paternelle.
Vouloir chercher Dieu en dehors de la communauté et de la tradition patriarcale représentée par le père, n’est-ce pas vouloir le trouver frauduleusement par rapport à la Loi ? Si le père ne pouvait s’imposer à lui du fait de son formalisme vide, n’offrait-il pas cependant le vivant exemple de l’accomplissement de la Loi par le fait pur et simple d’avoir fondé et entretenu une famille ? Voici que sur le chemin qu’il a choisi pour trouver Dieu, le sentiment de son isolement se manifeste tantôt comme péché à l’égard de la Loi, représentée par le père, tantôt comme la tentation de pécher contre le Dieu de la vraie voie. C’est bien là sa nostalgie d’une vie conjugale qui par intermittences s’affirme tout au long de son Journal. Au-delà de la Loi reniée, la volonté de chercher Dieu entre en concurrence avec le besoin de postérité qui, dès lors, n’est plus en effet qu’une nostalgie contrariante. Le besoin de postérité peut-être ressenti comme besoin de survie : toujours est-il qu’en dehors de toute communauté religieuse, de toute orthodoxie, il se présente comme une nécessité naturelle qui risque d’enchaîner plus étroitement celui-là même qui s’était affranchi des liens de la communauté patriarcale. « Je ne connais pas de plus grande dette que de devoir la vie à un homme », avait dit Kierkegaard. Et Kafka, dans ses moments de détresse sur la voie qu’il avait choisie, également conscient de cette dette, semblait alors ne voir d’autre moyen de la liquider que dans l’acte d’engendrer, de ne s’en trouver quitte qu’après avoir transmis la dette en donnant la vie. L’homme peut alors se dire : « Cela ne dépend plus de toi, à moins que tu ne le veuilles. Par contre, l’homme sans enfant : cela dépend toujours de toi, que tu le veuilles ou non, à chaque instant qui met les nerfs à l’épreuve, cela dépend de toi et sans résultats… » Et il ajoute : « Sisyphe était célibataire. » Le Journal intime de Franz Kafka donnerait-il la clé de ses ouvrages, la clé ne serait, en effet, que celle-là. Le célibataire ne l’est jamais de gré quoi qu’il puisse dire, quoi qu’il semble. Il croit peut-être avoir fait son choix en vivant dans la solitude. Il ne se rend pas toujours compte alors qu’à moins d’assumer la responsabilité de sa solitude, il se trouve condamné d’avance non pas à vivre seul, mais parce qu’il vit seul. Et c’est bien là le chef d’accusation secret que le héros du Procès ignore jusqu’au moment de son exécution. Le célibataire, aujourd’hui, est en effet une anomalie qui n’a pu devenir si commune et si banale que dans le monde insensé qu’est le nôtre. Vivre seul et refuser de participer par le mariage à la communauté religieuse ou sociale, c’est là une décision telle qu’elle suppose au moins une vocation déjà consacrée par un certain ordre hiératique (par exemple, le sacerdoce dans le monde catholique) quand elle n’exprimerait pas la pure et simple abstention à l’égard de la communauté dans un monde désorienté, anarchisant, etc. Or, cette dernière condition, ce fut celle de Franz Kafka : une fois rejetée la communauté juive avec sa tradition patriarcale, il se vit lui-même jeté en tant que déraciné spirituel au sein d’un monde où tout acte n’a plus qu’une valeur relative du fait des modes d’existence de ce monde. Dès lors, la position équivoque du célibataire que Kierkegaard avait également connue au sortir du monde chrétien, Kafka la connaît au sortir du monde judaïque.
Dieu leur offre de le servir ici-bas au sein de la communauté humaine ; Kierkegaard et Kafka refusent parce qu’il se peut que cette offre ne soit faite que pour les éprouver. Alors le fait d’avoir refusé peut être ressenti par la suite tan- tôt comme péché d’orgueil, tantôt comme signe d’élection selon que s’affirmera avec plus ou moins de force le sentiment de culpabilité par rapport à la Loi ou la connaissance de la vraie voie. Dans ce refus, Kierkegaard et Kafka se sont rencontrés devant le sacrifice d’Abraham. Kierkegaard, en renonçant à sa fiancée, avait voulu reproduire dans sa vie le geste d’Abraham renonçant à sa postérité et décider ainsi sa vie par l’absurde, par le « saut de la foi » au-delà duquel le temporel lui serait rendu dans l’éternel, comme Isaac fut rendu à Abraham. Mais Kafka ne voit pas la possibilité du « saut » : « Si déjà il possédait toutes choses et qu’il dût néanmoins être mené plus haut, il fallait alors, du moins en apparence, que quelque chose lui fût enlevé, cela est logique et ne signifie pas de “saut” ». Et en supposant d’autres Abraham : « … Il est possible qu’ils n’aient pas même encore de fils et déjà il le leur faut sacrifier. Ce sont là des impossibilités et Sarah a raison d’en rire… Mais un autre Abraham. Un Abraham qui, à tout prix, veut sacrifier justement… mais qui ne peut croire que ce soit lui qui est appelé. Il craint que, bien qu’il monte en selle en tant qu’Abraham avec le fils, il ne se transforme chemin faisant en Don Quichotte. » Quel est donc le motif d’une pareille ironie, sinon le sentiment de n’avoir rien eu à sacrifier ; le besoin de postérité persistait dans la solitude et cette solitude ne pouvait tenir lieu de sacrifice quand bien même le désir d’une vie conjugale eût été sacrifié à la recherche personnelle de Dieu. Et ainsi le geste d’Abraham demeurait « inimitable ».
Le choix d’une épouse, s’il promet de perpétuer le sang familial en introduisant dans la communauté du père le sang étranger, représente en même temps pour le fils un acte d’affranchissement par rapport au père et l’assumation d’une propre responsabilité paternelle. C’est l’exercice de sa majorité que le fils affirme alors contre la tutelle mourante du père comme la suppression de ce dernier et Kafka, dans son étrange récit – Le Jugement –, a représenté les circonstances obscures dans lesquelles cet exercice pouvait échouer lamentablement. L’exercice de la majorité était-il prohibé chez Kafka, refusa-t-il d’assumer à son tour une responsabilité paternelle ? « La violente mais vaine menace que mon père avait coutume de proférer : je te déchirerai comme un poisson, – en fait il ne me touchait pas du bout des doigts – cette menace se réalise à présent indépendamment de lui-même. Le monde – F. est son représentant (sa fiancée) – et mon moi, engagés en un conflit insoluble, sont en train de déchirer mon corps. » L’obsession de la Loi reniée aurait donc agi en lui sous forme de sentiment d’infériorité. Mais ce terme psychanalytique fausserait, en le limitant, le comportement essentiellement religieux de Kafka. Au-delà de la Loi patriarcale, la volonté de chercher Dieu se traduit chez Franz Kafka d’abord par l’acte de créer : « Écrire, forme de la prière. » L’acte créateur peut être ressenti comme possibilité d’accéder à l’éternel.



Pierre Klossowski, d’origine polonaise et frère aîné du peintre Balthus, a grandi dans un environnement artistique et littéraire, influencé par des figures telles que Rainer Maria Rilke et André Gide. Après s’être impliqué dans la psychanalyse à Paris et avoir écrit sur le marquis de Sade, il noue une amitié significative avec Georges Bataille. Durant la Seconde Guerre mondiale, il étudie la théologie et s’engage dans la Résistance. Revenu à la vie laïque après la guerre, il publie en 1947 Sade mon prochain, un ouvrage marquant.
Son premier roman, La Vocation suspendue (1950), explore sa crise religieuse. Ses œuvres les plus notables incluent la trilogie Les Lois de l’hospitalité et Le Baphomet (1965), récompensé par le prix des Critiques. Pierre Klossowski a également contribué au cinéma, travaillant sur plusieurs films, dont Au hasard Balthazar, de Robert Bresson.
À partir des années 1980, il se dédie principalement au dessin, gagnant une reconnaissance croissante dans ce domaine, y compris le Grand Prix National des Lettres en 1981. Ses expositions ont été célébrées en France et à l’international.


« Nous creusons la fosse de Babel. » | Le Journal intime de Franz Kafka (Extraits)
Journal intime - Notes choisies dans d’autres journaux - Considérations sur le péché, la souffrance, l’espérance et la vraie voie - Méditations.

Référence bibliographique : Franz Kafka, Journal intime, suivi de Esquisse d’une autobiographie, Considérations sur le péché, Méditations, traduction par Pierre Klossowski, Paris, Grasset, 1945




 Version imprimable
Version imprimable


 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



1 Messages
Sur le Journal de Kafka, on peut aussi consulter sur pileface :
Laurent-Margantin présente ici son travail autour de Kafka (pileface, 12 Juillet 2019).
par Laurent-Margantin
UN AUTRE EXTRAIT