Je m’étonnais récemment qu’on ne se soit jamais véritablement interrogé sur la stratégie opérée par Sollers à l’égard des médias [1]. En parcourant une ancienne revue — « Lieux extrêmes : spécial Philippe Sollers » [2] — à la recherche d’un article sur Portrait du Joueur où je croyais l’y trouver, je tombe sur un texte que Philippe Forest a écrit en « post-scriptum » à son essai, à bien des égards inaugural, intitulé Philippe Sollers et publié au Seuil en 1992. J’avais oublié ce texte. Eh bien, avec la perspicacité qu’on lui connaît, Forest, revient sur les « malentendus » suscités par son livre et, prolongeant d’une certaine manière les propos que Barthes avait tenus dans Sollers écrivain en 1979 [3], analyse précisément la « stratégie médiatique » de l’écrivain (plus généralement : de l’intellectuel moderne) : « une stratégie du décalage calculé, du double discours — l’ironie —, de la déception acceptée. A cette condition seulement, écrit Forest, sous les projecteurs de la télévision, dans le papier glacé des magazines, un sens peut quelquefois passer. Où qu’on le lui demande, Sollers accepte de parler ; mais ce n’est jamais pour tenir le discours qu’on voudrait lui voir tenir ».
Post-scriptum :
La vie est textuellePhilippe Forest
"Attaquez à découvert mais soyez vainqueur en secret ...
Le grand jour et les ténèbres, l’apparent et le caché : voilà tout l’art.""Retirer son corps quand l’œuvre est accomplie, telle est la Voie du Ciel."
Les critiques adressées au livre que j’ai consacré aux romans de Sollers (Philippe Sollers, Seuil, 1992) ont été nombreuses. Je n’en discute pas le bien-fondé. Il me semble seulement qu’au même titre que certains éloges, elles ne portaient pas véritablement sur le travail que j’avais proposé. Elles étaient seulement des réactions — pincées, scandalisées, agacées — devant cette proposition à laquelle on peut effectivement ramener mon livre si on n’a pas le goût, le temps ou le courage de procéder à sa lecture : l’œuvre de Sollers requiert cette approche patiente, attentive, minutieuse que l’on doit à toute authentique entreprise littéraire. Aux yeux de beaucoup, j’aurai été coupable d’avoir osé cette "hénaurmité". Il va de soi que, à cet égard, je persiste et signe.
Une autre objection cependant m’a retenu. Venue de quelqu’un qui ne découvrait pas l’œuvre de Sollers, elle touchait à un problème réel posé par la structure même de la démonstration. Le livre, en effet, s’organise en deux parties qui s’opposent ostensiblement. La première, rédigée avec le concours de Sollers, consiste en "repères biographiques". La seconde, intégralement tirée de ma thèse de doctorat, traite exclusivement des romans, approchés les uns après les autres, dans leur ordre chronologique. La division visible du livre en deux parties — la mention discrète des lieux et dates de rédaction pour chacune de celles-ci accusant encore cette division — amène à concevoir le livre sur le vieux modèle de tous les manuels d’histoire littéraire : "Sollers, sa vie, ses œuvres". Le clin d’œil — peut-être vaut-il mieux le préciser — était calculé.
Simultanément, cependant, le texte se refuse à se soumettre entièrement à ce modèle. Les lecteurs les plus attentifs n’ont pas manqué de s’en apercevoir. Sollers a voulu que figure dans l’histoire de sa vie la mention de ses rencontres avec les personnages féminins qui habitent ses fictions. J’ai, pour ma part, fait précéder la première partie du livre d’une épigraphe empruntée au Sollers écrivain de Barthes. On lit ainsi en tête des repères biographiques cette formule on ne peut plus explicite : "Peu d’hommes donnent à ce point l’impression d’un seul et même texte (tissu) en quoi se prennent à la fois l’écriture et la parole quotidienne : pour certains la vie est textuelle."
Quant au dernier chapitre de l’ouvrage, il pose de la manière la plus directe qui soit la question des rapports entre écriture et existence, entre fiction et vérité pour conclure en affirmant la nature, particulière mais indéniable, de leur indissociabilité.
Il est donc légitime — et même judicieux — de relever la duplicité de la démonstration proposée. D’un côté, le livre proclame, haut et fort, la stricte séparation de la vie et des œuvres. De l’autre, il ne cesse de contredire cette affirmation, en mêlant de manière plus ou moins visible les deux registres tout comme il fait alterner en lui-même photographies de l’auteur et reproduction de certaines pages de ses manuscrits.
Cette duplicité, puisqu’il faut la justifier, est avant tout de nature tactique. Sur le fond, s’il est vrai comme le soutient Barthes que "la vie est textuelle’’, s’il est juste comme l’affirme Sollers qu"’écrire est aussi affirmer sa biographie", alors séparer la vie du texte, l’écriture de la biographie, revient à dissocier ce qui devrait être indissociable et à commettre du coup un indéniable contresens.
VOIR SUR PILEFACE
J’en suis d’autant plus convaincu que c’est là exactement la thèse que j’ai défendue contre la revue Actes de la Recherche en Sciences Sociales dans le numéro 39 de la revue L’Infini. Face à une sociologie réductrice de la littérature, il s’agissait de rappeler cette évidence : l’intelligence véritable d’une œuvre n’est possible que si l’on accepte de lire ensemble et le texte et la stratégie sociale qui porte celui-ci.
Distinguer la vie et l’œuvre pour mettre l’accent sur cette dernière, peut cependant, dans un contexte historique particulier, n’être pas entièrement dénué de signification. Il ne s’agira pas alors de sacrifier à ce "contre sainte-beuvisme" de convention qui est aujourd’hui de règle dans trop d’universités. L’objectif sera de répondre à cette négation bête et obstinée du texte à laquelle travaille par tous les moyens l’actuel marché journalistique du livre. Et pour ce faire, on usera de ce simple moyen : lire les textes de manière calme, méthodique et posée pour les donner à comprendre et en faire jaillir le sens.
Dans le contexte actuel, l’enjeu est clair ou devrait l’être. L’urgence d’une stratégie adaptée s’en déduit. Puisque personne — ou presque — ne semble vouloir se souvenir des textes anciens, puisque personne — ou presque — ne semble prêt véritablement à lire les textes récents, c’est sur ce point qu’il faudra mettre l’accent avec obstination. En choisissant pour mon travail le plus traditionnel et le moins imaginatif des plans — celui qui consiste à étudier les romans un à un dans l’ordre de leur parution —, en optant pour l’analyse de texte, je n’avais pas d’autre ambition que celle-là : restituer la présence des livres. De ce point de vue, la bataille est loin d’avoir été une victoire totale. Le soupçon est bien né chez certains que les romans pourraient après tout exister. Mais, dans l’ensemble, ce sont les vieux réflexes pavloviens qui ont joué : on a ressorti pour la centième fois la fiche sociologique de Sollers — "doctrinaire narcissique" et "mandarin provocateur", "diva du showbiz littéraire" — mais, de littérature, il n’a pratiquement pas été question.
Il faudra donc insister dans cette direction mais non sans laisser entendre à l’intention des plus avertis que l’attention exclusive accordée aux œuvres a, comme je le disais plus haut, une valeur essentiellement tactique. Il ne s’agit surtout pas de déplacer la censure du terrain de la littérature à celui de la biographie, du domaine des textes à celui de ce manège social où ceux-ci s’inscrivent. Il faut simplement s’essayer à faire sauter cette censure dans le champ où elle s’exerce aujourd’hui avec le plus de force et de lourdeur. On peut imaginer que d ’ici quelques années, des bataillons d’érudits s’attacheront à commenter doctement chaque page de Paradis ou de Femmes tout en refusant obstinément de considérer la trame biographique, sexuelle, sociale et politique dont ces textes sont indissociables. Après tout, des cohortes de sollersiens, il y en eut hier, certains s’en souviennent ; il y en aura peut-être demain, certains s’en inquiètent. Cela serait l’une des formes possibles de la récupération. Je n’aimerais pas donner l’impression d’avoir, par avance, participé à celle-ci. C’est pourquoi, dans le désœuvrement tout relatif qui suit la publication d’un livre, on peut s’amuser à anticiper la prochaine bataille qui peut-être n’aura pas lieu.
* Opposer, de manière dogmatique et absolue, la vie et l’œuvre, le moi social et le moi créateur, ne mène nulle part. Deux impasses symétriques s’ouvrent pour aussitôt se refermer. D’un côté, un éventuel "puritanisme savant" qui prétend ne considérer que le texte dans sa superbe clôture mais échouera toujours à le comprendre car il restera aveugle à sa dimension proprement biographique. On peut disserter à l’infini sur les mécanismes textuels à l’œuvre dans Lois ou Portrait du Joueur car l’écriture de Sollers, par sa richesse et sa complexité, se prête à ce type d’analyse. Mais cela sera en vain si on ne fait pas sentir que ces mécanismes emportent avec eux une expérience et un savoir, sexuel, social et politique, non simulés. Le carnet rouge du Cœur absolu fait autant partie de Sollers que les énigmatiques fragments de Nombres. Les doctes commentateurs de cette œuvre ne pardonneront pas à son auteur d’avoir fait passer quelques femmes vivantes dans le paysage asexué de leurs architectures théoriques.
L’autre impasse, étant symétrique, peut se déduire de la première. Elle consiste à ne retenir de l’écrivain que ce faux-semblant de lui-même qu’est l’image que, par jeu et par calcul, il négocie sur le marché permanent du spectacle. Mais que peut-on comprendre à l’image d’un écrivain lorsqu’on n’y fait pas rentrer la part d’écriture qui constitue celle-ci ? Le scandale naîtra cette fois-ci lorsque cette part, avec ce qu’elle comporte substantiellement d’art et de pensée, se manifestera trop clairement, venant troubler le passage des apparences négociées, rentabilisées. D’où les réactions d’effroi, de gêne et stupéfaction lors de la parution du Rire de Rome.
Ainsi, d’un côté, à la vie, on oppose un simulacre de l’œuvre ; de l’autre, on oppose à l’œuvre un simulacre de la vie. Or, l’œuvre est partie intégrante de la vie. La vie est partie intégrante de l’œuvre. Non pas à la manière de ces esthètes "fin de siècle" qui, bouffis de narcissisme, n’envisageaient pas d’autre génie que dans leur vie, pas d’autre chef-d’œuvre qu’eux-mêmes. Il y a un dandysme de Sollers — dont il a d’ailleurs exposé les principes il y a quelques années dans un petit texte — mais celui-ci est aux antipodes de ce que l’on met d’ordinaire sous ce terme. Ici une vision forte existe et il n’y a pas de raisons pour que, sous des masques appropriés, elle ne s’exprime aussi bien dans l’œuvre que dans la vie.
Tout se ramène à cette preuve par n’ŒUF qui seule est garante de la victoire d’un individu dans la guerre du temps et que l’œuvre manifeste. Celle de Sollers dit sans fin la soustraction au règne monotone de l’espèce, l’envol répété au-delà du filet aliénant que fait peser sur nous toute forme de socialité. Le geste de l’écriture, tel que chaque livre l’expose, est l’une des armes de cette victoire.
Mais il n’y a aucune raison de penser que cette victoire dans l’œuvre doive se solder par un échec dans la vie. Ce serait retomber dans ce "catéchisme Flaubert" que Sollers précisément dénonce. Pour lutter contre la perspective insupportable qu’un écrivain puisse ainsi "gagner sur les deux tableaux", la malveillance sociale ne sera jamais à court d’arguments et de fictions : on soupçonnera Sollers de "mythomanie sexuelle" comme d"’imposture intellectuelle" ; on laissera entendre que son paradis dissimule un enfer, que la jubilation qu’il affiche n’est qu’un masque derrière lequel se trahissent le désespoir et le dégoût de vivre ; on cherchera en somme à creuser un précipice entre Sollers et lui-même pour se donner la satisfaction d’un avantage factice. On lit à ce sujet dans Carnet de nuit :
"Le nihilisme à propos du génie : "quelque chose d’autre que lui vivait en lui, passait par lui, allait plus loin que lui, était très différent de lui," etc. Bref, sans cesse : lui n’était pas lui."
* Le malentendu est donc là qui entoure l’individu tout comme la méconnaissance s’attache à l’œuvre. Et puisqu’il s’agit ici de feindre de se détourner de cette dernière, à défaut d’écrire l’un des chapitres de cette "éthologie des intellectuels" que Barthes appelait de ses vœux, faisons l’essai, pour finir, de quelques remarques et allons droit à l’un des nœuds de ce malentendu.
Ce qu’on reproche d’ordinaire de la manière la plus systématique et la plus véhémente à Sollers, c’est la multiplication de son image dans le miroir des média. On peut d’ailleurs noter au passage que ce reproche est d’autant plus savoureux qu’il est souvent le fait des agents mêmes du spectacle qui vivent de cette multiplication des images et la sollicitent. Il va de soi qu’un écrivain ne devrait pas se prêter avec autant de complaisance et de bonne volonté à ce jeu. Il devrait mesurer le nombre et le caractère de ses interventions, la forme de celles-ci, ne consentir qu’avec un visible dégoût à l’inévitable compromission de son image, conscient du caractère sacral de sa mission et de sa personne. Aux termes de cette loi, Sollers est coupable : il ne répugne pas à fréquenter les "mauvais lieux", il ne se soustrait pas aux mises en scène, il est là où il ne devrait pas être. La malveillance sociale lui fera donc la leçon dans deux registres complices : devenant psychanalyste pour l’occasion, elle l’accusera de céder aux sirènes de son propre narcissisme ; retrouvant de manière bien opportune des convictions politiques qu’on ne lui connaissait pas, elle lui fera remarquer qu’il se laisse entièrement récupérer par le spectacle qu’il prétend contester.
La réprobation est si unanime que Sollers, aujourd’hui, n’est plus guère interrogé que sur son irresponsable et puérile conduite. On le somme avec gravité de se justifier. Sa ligne de défense est la suivante. Multiplier son image peut être l’une des manières les plus habiles de nier celle-ci (Barthes aurait sans doute dit : d"’empêcher qu’elle ne se fixe"). Au cours d’un entretien récent Sollers déclarait : "On peut être, comme Beckett, absolument rebelle à toute forme de communication. On procède par défaut, en creux, avec une immense rigueur pour ne pas se laisser happer... Mais je me demande si procéder par excès, par prolifération, ne revient pas à la même négation de l’image. Porter une quantité de masques, c’est une façon de conserver la personne en brouillant sans arrêt l’image."
De plus, réplique encore Sollers, engager son image dans le jeu social est une nécessité et un impératif pour le romancier qui n’entend pas fermer les yeux sur le monde dans lequel il vit : "Je crois que, chez moi, cette médiatisation relève de la technique. Pourquoi ? Parce que j’écris sur la société de mon temps, sur ses acteurs, ses manipulateurs, ses coulisses, ses intérêts, ses non-dits, ses tartufferies. Je fais mes livres avec ça depuis longtemps. J’ai donc besoin de savoir comment ça marche. C’est de l’anthropologie, en quelque sorte."
Mais l’enjeu est également politique : "Je trouve que la littérature est un art de combat. Si vous voulez : la médiatisation est la continuation de la subversion par d’autres moyens."
* C’est, pour ma part, de cette dernière proposition que j’aimerais rebondir. Je suis toujours frappé, en effet, lorsque j’assiste aux interventions médiatiques de Sollers par leur caractère éminemment paradoxal. Et ici, tout particulièrement, l’"écriture" et la "parole quotidienne", de manière calculée, participent indubitablement d’un même texte.
Encore faut-il s’entendre sur le sens du mot "paradoxe". Celui-ci n’est pas le pur non-sens. Il n’est pas davantage ce tour de passe-passe un peu vain par lequel on joue à donner une forme apparemment contradictoire et vaguement brillante à un lieu commun. Le paradoxe ne serait alors rien de plus qu’une coquetterie de la doxa, un des stratagèmes dont elle use pour feindre d’être autre chose qu’elle-même. Il fut un temps où des écrivains — Paul Valéry, notamment — firent, dans la société française, commerce de ce genre de maximes, d’autant plus rassurantes qu’elles donnent d’abord le frisson de l’incompréhensible.
Chez Sollers, le paradoxe est, étymologiquement, "ce qui est contraire à l’opinion commune". Il suppose donc l’analyse préalable de la doxa, le repérage de ses nœuds et de ses articulations. Il consiste en l’affirmation d’un sens qui soit la négation stricte et précise des principaux lieux d’ancrage si idéologiques de cette doxa — négation stricte et précise signifiant également négation non récupérable dans quelque discours que ce soit. Défini ainsi, le paradoxe est donc la forme exacte et l’expression constante de la subversion.
VOIR SUR PILEFACE
Que l’œuvre de Sollers soit paradoxe perpétuel, il me semble possible de le démontrer. L’athéisme radical qui s’y manifeste dans les domaines sexuel, social ou religieux est bien pris à contre-pied de la sacralité inconsciente qui est au principe de toute collectivité. L’obscénité, le refus de la sexualité réglée, un certain art de la vie privée, l’hommage au catholicisme, l’ironie, l’insistance sur sa propre biographie sont — dans la fiction — autant de formes conjuguées de ce paradoxe perpétuel.
Le jeu — dans la vie réelle — avec l’image de soi que monnaye le spectaculaire, en est une autre. C’est ce qui ressort clairement, me semble-t-il, de chacune des interventions de Sollers. Celles-ci, en effet, visent de manière délibérée, à porter la contradiction à l’intérieur même du système, par le jeu de l’ironie et du paradoxe — l’ironie étant très exactement cette manière subtile et discrète de faire affleurer une parole paradoxale dans le discours même de la doxa. Non pas se retirer du système car c’est alors se résoudre à l ’impuissance et à l’inexistence. Non pas se jeter à corps perdu dans ce système car c’est alors le piège de la récupération qui est, de manière symétrique, impuissance et annihilation.
La navigation de l’intellectuel moderne n’aura de sens que si elle lui permet de passer entre les deux écueils. Elle suppose une stratégie du décalage calculé, du double discours — l’ironie —, de la déception acceptée. A cette condition seulement, sous les projecteurs de la télévision, dans le papier glacé des magazines, un sens peut quelquefois passer. Où qu’on le lui demande, Sollers accepte de parler ; mais ce n’est jamais pour tenir le discours qu’on voudrait lui voir tenir.
Magazines féminins et hebdomadaires à grand tirage s’adressent systématiquement à lui pour chacun de leurs ineffables dossiers sur le désir et la sexualité des Français. Sollers s’exécute alors d’un article qui est l’impeccable réfutation de toute la niaiserie qui le sollicite. Le lecteur, s’il n’était pas hypnotisé par le déferlement des images et le leurre des sondages, découvrirait ainsi un texte qui tranquillement annule tout ce qui l’environne : la partie emporte l’ensemble. Une phrase ou une proposition produiront le même effet dans le déluge des stéréotypes télévisuels.
Le jeu peut se poursuivre sous d’autres formes, au-delà du cercle strict des média mais dans ce qui n ’en continue pas moins de relever de la logique du spectaculaire. Au cours d’un colloque dominé par de sourcilleux heideggeriens, on soutiendra ainsi, à la consternation générale, que Voltaire est le plus grand et le plus grec des philosophes modernes. Devant de jeunes artistes, on se refusera le succès trop facile qui consisterait à exploiter la veine polémique de la Fête à Venise : on parlera de Cézanne, mais pour mieux citer Parménide. Ce même Parménide dont mécènes et producteurs ont dû se demander ce qu’il venait faire dans le film sur Rodin qu’après tout ils avaient payé de leur argent : une référence à Camille Claudel n’eût-elle pas été plus adaptée ?
A ceux qui attendent de vous que vous fassiez l’écrivain, vous indignant et vous exaltant à propos, pontifiant sur commande, on opposera la lente et longue lecture de Bussy-Rabutin, de Eckhart ou de Paradis Il. Histoire de démontrer que la littérature est très précisément géométrie dans l’espace : textes rapprochés dans l’instant le plus présent et à l’intersection desquels se tient un individu habitant, indélogeable, le lieu de sa propre parole.
Qu’est-ce que la littérature quand elle se pratique ainsi en direct ? Elle est le plus interdit des gestes car elle nous oblige à une attention nouvelle, nous qui ne sommes plus habitués qu’à cette grammaire du spectacle qui découpe en brèves séquences le flux répétitif et hypnotique de ses lieux communs. Une heure de lecture habitée est une terrible épreuve de vérité. Certains ne pardonneront pas à celui qui la leur auraient infligée. Sollers est ainsi passé maître dans l’art de se rendre insupportable. C’est ce qu’on appelle faire "événement". Il se joue de l’hostilité qu’il suscite autant que de l’admiration qu’il fait naître. Dans sa stratégie médiatique, il y a quelque chose qui relève du gambit, ce coup qui, aux échecs, consiste à sacrifier un pion pour dégager le jeu et s’assurer un avantage décisif : feindre de perdre pour mieux l’emporter, décevoir à dessein pour mieux démasquer le jeu adverse, consentir au non-sens pour y faire scintiller le sens. Dans l’instant, au milieu du brouhaha burlesque, du ram-dam du ressentiment, Sollers se contente de manifester l’irréfutable et tranchante présence de la parole. Cela suffit.
* Cette pratique subversive est aussi — le croira-t-on ? — une ascèse et un jeu. Contrairement à tous les préjugés, on est ici aux antipodes du narcissisme qui est adhésion passionnée à sa propre image. La gymnastique médiatique — tout comme la mise en scène de soi-même par l’écriture — impose l’attitude inverse : prise de distance vis-à-vis de son image, détachement vrai. Les moins hallucinés des salariés du spectacle pressentent quelquefois la sainteté à l’envers à laquelle leurs gestes les obligent. Il y faut une humilité profonde, la conscience claire que son corps n’est plus qu’un guignol avec ses grimaces, ses tics, son épaisseur propre dont l’écran vous dépossède pour en faire des signes approximatifs.
Quelque part, Sollers commente les nombreux clichés auxquels Picasso a consenti. C’était là sa contribution à la représentation permanente. Sur tous, i toisait l’objectif, semblant dire : "Mon image est mon cadavre, je vous l’abandonne". Picasso s’inventait ainsi "nature morte" ou "vanité" dans le regard du photographe pour ressusciter dans le geste du peintre. Que l’iconophilie soit nécrophilie est une hypothèse intéressante. Et qu’il faille se défaire en permanence de cette double dévotion morbide mérite qu’on s’y arrête. Il reste alors à se considérer soi-même comme un pantin acceptable dont on tirera les ficelles, réfugié bien loin dans la hauteur des cintres. Jouant de son image tapie dans le télévisuel, Sollers ne me semble pas procéder autrement.
Au bout de l’ascèse, au terme de cette sainteté ordinaire, il y aura bien sûr la libération qui est joie. Celle-ci n’est que l’autre nom de cette position verticale — en surplomb de son propre corps — à laquelle on parvient quelquefois. Et, dans cette posture nouvelle, le spectacle peut devenir inépuisable amusement.
Cela est entendu : vivre est donner prise au malentendu. Et, pour un artiste, ce malentendu est à la fois la conséquence obligée de I’œuvre et la source nécessaire de celle-ci. On peut s’en désoler et maudire la cruelle "bénédiction" qui vous livre au sadisme attentif et attentionné de votre mère, de votre épouse ainsi que de toute la ménagerie sociale. Nous sommes tous si spontanément romantiques que la douleur nous semble inséparable de l’élection, que la souffrance nous est le signe le plus sûr du génie. Pourtant, sans rien perdre de son intensité mais en se défaisant de certaines de ses grimaces usées, la tragédie peut se faire comédie.
Car il est une jouissance du malentendu. C’est d’elle que témoignent certains des plus grands écrivains du siècle, dans leur œuvre comme dans leur biographie. A mille lieux du lamento romantique, cette jouissance consiste dans la vision ironique et amusée du tissu social attaché à nier obstinément l’image de vous-même que vous y avez déléguée.
Sauf incurable stupeur sentimentale, chaque individu a dû, me semble-t-il, faire, dans son existence privée, l’expérience de cette jouissance du malentendu. Certains en font même un audacieux art de vivre. Ainsi le narrateur de Femmes qui expose sa méthode en quelques confidences qui m’ont toujours paru d’une irréfutable vérité psychologique :
"Propagandes croisées... Tout cela s’équilibre... Ce qu’il y a de meilleur avec les femmes, c’est de les choisir comme pour un orchestre, une rosace contradictoire... De façon à se faire tout reprocher, tout, et le contraire de tout. Le concert est fascinant à entendre, chacune enfonce son clou selon ses intérêts. Il faut écouter sans rien dire, s’amuser sans trop le faire savoir... Les basses continues du ressentiment... Les violons du regret... Les trombones de la menace et de la prédiction négative... Les clarinettes de l’ironie appuyée... Les flûtes de la moquerie... Les trompettes de la malédiction... La grosse caisse, ou les cymbales, de la demande d’argent... Le piano de la mélancolie... Les pizzicati de la contradiction mécanique..."
Les amateurs apprécieront.
Mais que l’on passe maintenant de la comédie du désir à la bouffonnerie médiatique, et le malentendu restera identique : la part du ressentiment sexuel n’y est-elle pas la même ? Sur un plateau de télévision comme sur une scène plus intime s’affrontent les "propagandes croisées" de la négation sociale dont, avec le détachement nécessaire, on peut se plaire à jouir. On lit à cet égard dans Carnet de nuit :
"Quelqu’un se met à te faire la morale. Écoute bien : toute sa généalogie est en jeu. Deux sciences à fonder : physiologie de la lecture, gynécologie de la morale. Un con ou une conne en train de moraliser, c’était déjà un plaisir. Un salaud ou une salope, plus encore. Laisse durer, endure : une sorte d’extase est au bout, paysage du temps, origine muette en convulsion, convaincue, touchante."
Lorsque l’on regarde Sollers évoluer dans l’arène du médiatique, dépenser avec générosité et ironie tant d’images contraires et différentes de lui-même, collaborer enfin avec délectation au malentendu qui fait aussi sa jouissance, sans doute n’est-il pas inutile de se souvenir de ces quelques remarques. La farce est extase, et inversement.
PHILIPPE FOREST
[1] Cf. Diderot, Céline, Vailland, Beauvoir, Sollers à la télévision : c’est possible ! (enfin : ça le fut).
[2] J’en ai cité des extraits dans De la guerre.
[3] Cf. Sollers écrivain.




 Version imprimable
Version imprimable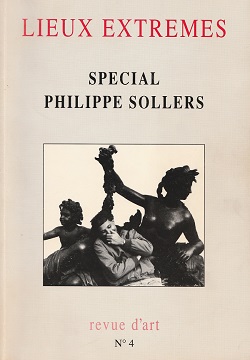



 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


