

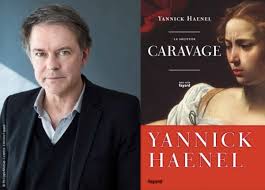 YANNICK HAENEL
YANNICK HAENEL
La solitude Caravage
Editeur : Fayard, 21 février 2019.



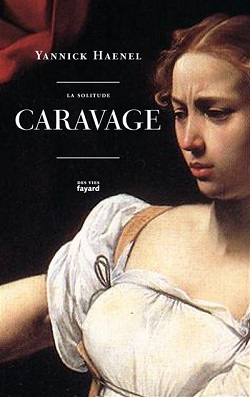 « “Vers 15 ans, j’ai rencontré l’objet de mon désir. C’était dans un livre consacré à la peinture italienne : une femme vêtue d’un corsage blanc se dressait sur un fond noir ; elle avait des boucles blondes, les sourcils froncés, et de beaux seins moulés dans un chemisier. Elle tenait une lame et, calmement, découpait la tête d’un roi.” Ainsi débute ce récit qui plonge dans le tableau du Caravage, Judith décapitant Holopherne. Comment la représentation d’un crime politique a-t-elle pu lancer ma vie érotique, voilà l’énigme de ce livre qui interroge la puissance des figures peintes. Au fur et à mesure de cette plongée subjective, tous les tableaux du Caravage affluent ; et le récit s’approfondit à travers une étude de la vie de cet artiste devenu, plusieurs siècles après sa mort, le plus grand des peintres. Je m’intéresse à l’expérience intérieure du Caravage. Comment peignait-il ? Que cherchait-il à travers ces scènes de crime, ces têtes coupées, cette couleur noire qui envahit peu à peu tous ses tableaux ? Notre époque, pourtant criblée de violence, ne veut pas regarder l’horreur en face. Le Caravage, lui, est frontal : il expose crûment la vérité criminelle de l’espèce humaine ; il nous apprend à garder les yeux ouverts sur l’innommable.
« “Vers 15 ans, j’ai rencontré l’objet de mon désir. C’était dans un livre consacré à la peinture italienne : une femme vêtue d’un corsage blanc se dressait sur un fond noir ; elle avait des boucles blondes, les sourcils froncés, et de beaux seins moulés dans un chemisier. Elle tenait une lame et, calmement, découpait la tête d’un roi.” Ainsi débute ce récit qui plonge dans le tableau du Caravage, Judith décapitant Holopherne. Comment la représentation d’un crime politique a-t-elle pu lancer ma vie érotique, voilà l’énigme de ce livre qui interroge la puissance des figures peintes. Au fur et à mesure de cette plongée subjective, tous les tableaux du Caravage affluent ; et le récit s’approfondit à travers une étude de la vie de cet artiste devenu, plusieurs siècles après sa mort, le plus grand des peintres. Je m’intéresse à l’expérience intérieure du Caravage. Comment peignait-il ? Que cherchait-il à travers ces scènes de crime, ces têtes coupées, cette couleur noire qui envahit peu à peu tous ses tableaux ? Notre époque, pourtant criblée de violence, ne veut pas regarder l’horreur en face. Le Caravage, lui, est frontal : il expose crûment la vérité criminelle de l’espèce humaine ; il nous apprend à garder les yeux ouverts sur l’innommable.
Mais chez lui, il n’y a pas seulement le couteau : il y a aussi la perle. Elle scintille de tableau en tableau, comme le signe d’un désir plus intense encore que les ténèbres ; et ce grand feu blanc qui fait étinceler les scènes du Caravage vient du féminin. On dit que le Caravage peint avant tout des hommes, et qu’il les rend désirables. Mais regardez les femmes, Judith, Salomé, Marie-Madeleine et la Vierge, ou plutôt les prostituées qui jouent ce rôle : c’est elles et leurs splendides visages qui sont en avant. C’est elles qui amènent cet univers fiévreux vers la lumière. Ce sont ces héroïnes qui s’arrachent sur le fond noir, et ouvrent le monde du Caravage à la grâce d’un nouvel amour. » — Yannick Haenel.
A suivre...

Narcisse, 1598-1599 [1].
Photo A.G., Rome, palais Barberini, 18 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

22 février 2019. Le livre est sorti. Je l’ai trouvé ce mercredi 20 dans ma boîte aux lettres avec une (trop) généreuse dédicace de son auteur. Je m’y suis plongé aussitôt et l’ai lu d’un seul trait, oubliant les mails à envoyer, les coups de téléphone à donner et même des rendez-vous que j’ai reportés. Le livre d’Haenel est un grand livre que je range aux côtés du Manet de Bataille, du Paradis de Cézanne de Sollers, du Giotto de Pleynet et de La peinture et le mal de Henric. Je cite ce dernier livre car jamais, à mon sens, un écrivain n’a approché d’aussi près les mystères et de la peinture et du mal. Mais, à ma connaissance, Henric (pas plus que Bataille) ne parle pas du Caravage qui aurait pu pourtant figurer « dans la série "les Incorruptibles" » de son incontournable essai [2]. J’ai vu les tableaux du Caravage à Rome à la galerie Borghese, à la galerie Doria-Pamphilj, à l’Église Saint-Louis-des-Français, à Madrid (Sainte Catherine d’Alexandrie est visible au musée Thyssen-Bornemisza), au Louvre et, plus récemment, lors de l’exposition « Caravage à Rome, amis & ennemis » du musée Jacquemart-André. Les peintures me fascinaient (une amie peut en témoigner). L’énigme de la vie agitée (ô combien !), querelleuse, joueuse du Caravage me troublait (comme celle de Villon ou de Rimbaud). J’avais acheté à Rome et lu le livre, admirablement illustré, de Roberto Longhi (Le Caravage, éditions du Regard, 2004) : l’énigme de cette vie persistait. Je ne dis pas que Yannick Haenel l’a résolue, mais jamais, un livre ne l’a approchée d’aussi près. La solitude Caravage est le récit d’une « expérience intérieure » (la notion est de Bataille : « J’entends par expérience intérieure ce que d’habitude on nomme expérience mystique : les états d’extase, de ravissement, au moins d’émotions méditée » / « L’expérience est à elle-même son autorité, mais toute autorité s’expie. »), ou, plus exactement le double récit d’une double expérience intérieure : celle de l’écrivain Haenel (de l’âge de ses quinze ans et la découverte du portrait de la Judith de Judith décapitant Holopherne (Fillide Melandroni sur qui vous apprendrez beaucoup de choses) à l’écriture même du livre en 2018), celle du peintre Michelangelo Merisi da Caravaggio (né en fait à Milan, la ville de saint Ambroise, et non à Caravaggio comme on l’a longtemps cru, le 29 septembre 1571, jour de la saint Michel-Archange, d’où son prénom — vingt-cinq ans après que le Concile de Trente (1545-1563) a réaffirmé la conception catholique du péché originel, treize ans avant la mort de saint Charles Borromée), le seul peintre condamné à mort parce qu’ayant été jusqu’au crime dans des circonstances plus qu’étranges (Haenel tient son hypothèse). Patiente méditation sur le péché (« Le péché entre-t-il partout ou s’arrête-t-il à la porte des oeuvres ? » / « toutes choses doivent concourir pour le mieux, même le péché », p. 306), le mal radical (« On croit échapper au mal, mais il en sait toujours plus sur nous que nous-mêmes. Le mal précède le bien. Caravage le sait », p. 263), le noir (« à l’origine il y a le noir, et peindre consiste à faire venir quelques rayons sur ce noir »), la mort (« Il paraît que la mort ne peut se regarder en face ? Si le Caravage a les yeux rouges, c’est parce qu’à travers le noir originel il ne fait que ça », p. 201), la résurrection et la vérité en peinture (l’expression est de Cézanne et Haenel consacre un chapitre à « Cézanne et Caravage »), nourri de références (implicites ou explicites) à Baudelaire, à Rimbaud (c’est dans le chapitre consacré à saint François d’Assise qu’on peut lire cette phrase d’une brûlante actualité : « chez François lui en imposent l’ardeur de la solitude, la violence qui se vit dans une âme et un corps comme un combat contre toute autorité, qu’elle soit celle de la curie romaine ou celle du diable », p. 213) et à Maître Eckhart (le noir encore : « si quelqu’un peignait en noir le plus haut parmi les anges, la ressemblance serait bien plus grande que si on voulait peindre Dieu dans la forme du plus haut des anges », p. 307), à Bataille aussi bien sûr (Caravage n’est-il pas, littéralement et dans tous les sens, le coupable par excellence ?), le livre de Haenel est, dans les temps obscurs d’aujourd’hui (où le mal rôde et la haine déborde), salutaire. Laissons le dernier mot à Haenel (ce sont les dernières phrases du livre) :
Est-ce que nous répondons vraiment à la parole ? Est-ce que nous vivons selon la vérité ? La peinture du Caravage mène à ce point où il n’est plus possible de se mentir. C’est un point où l’on est enfin vivant, où la source existe infiniment — et à chaque instant. Où plus rien ne nous sépare du temps. Où celui-ci se donne à nous, et où nous nous donnons à lui. La peinture et la littérature existent là.
Je m’arrête. Lorsqu’ils disaient adieu à un être aimé, les Romains ouvraient une fenêtre et d’une voix forte, afin qu’on l’entende jusqu’aux collines, scandaient trois fois son nom : Caravaggio ! Caravaggio ! Caravaggio !
Trois chapitres sur les cinquante-quatre que comporte le livre, librement illustrés.

Autoportrait en Bacchus, 1592-1595
Photo A.G., Rome, galerie Borghese, 23 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

Chapitre 10
Tout le Caravage
C’est le monde entier, ce sont des poires, des figues, des prunes, des iris, des œillets, des jasmins, du genêt, de la vigne, des gouttes de rosée, la corde cassée d’un luth, un miroir et une carafe, une corbeille débordant de raisins, un garçonnet en chemise blanche qui pèle un fruit, un sabre taché de sang, des couteaux, des violons, tout un monde rouge et torturé qui étincelle ; et voici d’autres lumières, d’autres ombres, saint Paul désarçonné, Isaac le couteau sous la gorge, un Baptiste buvant à la fontaine et Salomé portant sa tête dans un plat, Jean-Baptiste, encore lui, hilare et jeune, enlaçant un bouc, puis une tablée de joueurs de cartes agitée de tricheurs, des pèlerins, des apôtres, des fossoyeurs, des bourreaux, quelques anges qui sourient, une croix, des culs, des seins, des épaules dénudées, des lèvres qui séduisent, une diseuse de bonne aventure, une petite sainte en pleurs, des reflets qui vous ouvrent au ciel, au dieu qui resplendit ou qui s’éteint, des éclats de ciel noir, des éclats de ciel rouge, des éclats de rien, une perle nouée d’un papillon noir, un flacon abandonné, un collier, des brocarts bleus et verts, des robes de courtisanes, des bergers, des Bacchus repus et charmeurs, et mêlés à la Passion du Christ des trognes de bourreaux qui s’acharnent, grimacent et flagellent, des ermites qui écrivent, un crâne à la main, drapés de rouge, des ramures d’automne desséchées jaune et ocre, un bouc, un agneau, un âne et des molènes, une Vierge qui endort l’Enfant au son du violon d’un ange, un petit gobelet qui rappelle le baptême où je n’en finis plus de boire en rêve, une jeune larme qui coule sur la joue d’une Madeleine inconsolable, quelques boutons de nacre, une écuelle et des ombres violettes, des bouches qui crient, du sang qui coule, des chapeaux à plumes qui flamboient et des pourpoints rayés de jaune, des gants percés, des cartes biseautées, des têtes empanachées, des têtes coupées, de belles dames au regard qui fuit, des vauriens grimés en petits dieux, l’un arborant une couronne de lauriers, une coupe de vin noir à la main, l’autre le visage vert d’un Bacchus malade, un autre encore mordu par un lézard, et qui geint comme un petit porc, et de nouveau le rondouillard, avec son air vicieux d’empereur dans l’orgie, et de nouveau la splendeur qui vous chavire, le Christ mort et pourtant plus vivant que nous tous, et l’œil d’Isaac effaré sous le couteau, et l’ombre insensée, la clarté qui tue, un tabouret qui vacille au bord du vide sous le poids de Matthieu écrivant son Évangile, et lorsqu’on ferme les yeux, tous les détails qui vibrent et glissent d’un tableau vers l’autre, la vision qui se brouille juste avant la joie, et voici, dans un éclair, abrupte comme une apparition, la Vierge allongée, morte, au-dessous d’un drap rouge où s’enveloppe en silence le nom secret de toute présence, ses pieds nus qui dépassent, fragiles, comme en lévitation, et le baquet au bas du lit où l’on devine l’éponge, l’eau usée, la merde, le crâne de Goliath, le reflet de Narcisse, David torse nu brandissant la tête du Caravage, le cri rond de Méduse, la croupe blanche d’un cheval, des pieds sales, des ongles noirs, la roue dentée de Catherine, le corps percé du Christ, un serpent écrasé, un ange au sexe heureux, de nouveau des saints qui écrivent, et le Christ à la colonne, le Christ capturé, le Christ couronné, le Christ renié par Pierre, flagellé, déposé au tombeau, et son bras levé vers Matthieu qui sépare la lumière et les ténèbres, qui conçoit comme un peintre la matière des choses, un mélange, une pâte, un prisme, et avec les couleurs voici de nouveau le visible en extase, la joie d’un Amour victorieux, la main de sainte Ursule caressant la flèche qui la transperce, saint François s’évanouissant entre les bras d’un ange, puis de nouveau Isaac, Salomé, Judith, la Vierge et l’Enfant, Jean-Baptiste, des draps rouges, des draps blancs, un crâne et des feuillages, la chair qui en jouissant éclaire notre vertige, une pluie dorée imprégnant un corsage, une semence inconnue qui se mêle aux pigments et fait naître la peinture ;et à travers tous ces corps, toutes ces choses, une seule lumière, discrète, insistante, sacrée, qui prend mille apparences et ne brille que pour vous, l’éclat de l’être l’aimé qui s’annonce et disparaît en silence, comme font les dieux, les déesses, et qui, en se dissipant dans la fatigue de cette nuit, vous comble, comme le plus réussi des baisers.

Le Martyr de saint Mathieu (détail), 1600.
Photo A.G., Rome, Église Saint Louis des Français, 16 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

Chapitre 17
La vie du Caravage
J’aimerais parler de l’expérience intérieure du Caravage ; pas seulement du feu qui anime son esprit, mais de ce qui a lieu lorsqu’il peint :de la vérité qui s’allume dès qu’un homme comme lui avance son pinceau vers une toile.
Les nuits blanches, les coups de foudre, l’exigence et les idées fixes, le désir sexuel, le vertige des trouvailles, les victoires secrètes, les milliers d’heures à regarder la toile, la rage et le découragement, l’obscurité soudaine et les sauts d’harmonie inouïs, les crises, les maladies, la torpeur, la frénésie, les engouements et l’endurance, la fatigue, les cauchemars, la peur d’être damné, la peur d’être tué, la violence physique, l’ardeur mystique, la rigueur de l’étude, le désir de perfection, l’ivresse et les débordements, l’amour extrême et l’extrême solitude : tout cela est-il racontable ?
Il y a une phrase du grand penseur franciscain Jean Duns Scot que je me répète depuis des années, et à laquelle je mesure tout : « Être une personne, c’est connaître la dernière des solitudes. » S’il y a quelqu’un sur cette terre qui a connu la dernière des solitudes, c’est bien le Caravage.
La vie des peintres est souvent tragique, parce qu’elle rejoue celle de la matière, qui crée des mondes et se décompose ; celle du Caravage est violente, brève, rapide : né en 1571, mort en 1610, il ne vit que trente-neuf ans. Originaire de Lombardie, dans le Nord de l’Italie, il se déplace sans cesse : Rome, Naples, puis Malte et la Sicile, et de nouveau Naples. En un peu plus de quinze ans, il peint une soixantaine de tableaux qui changent l’histoire du monde, séjourne plusieurs fois en prison (parfois, s’en évade) et, après avoir tué un homme, endure la vie des fugitifs. Protégé par une famille noble (selon certains historiens, il en serait peut-être un membre illégitime), aidé par des cardinaux et de nombreux mécènes qui collectionnent ses œuvres, son succès est aussi fulgurant que sa vie malheureuse.
On dit qu’il était irascible, impulsif, arrogant ; et qu’il ne cessait de se battre. Il fut le peintre le mieux payé de son temps ; et comme tel fut la proie de rivalités incessantes ; on le jalousait, il répliquait violemment ; on s’arrangea pour que la postérité réduisît son talent ; il surclassait ses collègues et choquait le goût de l’époque ; ses tableaux furent parfois décrochés des églises ; il fut souvent malade, blessé, fiévreux ; et s’il lui arriva d’être hébergé dans un palais, il préférait la vie des tavernes, le désordre des bouges et la fréquentation des putains à celle des prélats (il savait séduire aussi bien les uns que les autres) ; malgré son succès, et l’argent qu’il tirait de ses tableaux, il mourut pauvre, malade, absolument seul, comme u n misérable (ainsi son cadavre fut-il jeté dans une fosse commune).
On ne possède aucune lettre de lui, juste une signature, mêlée au sang de Jean-Baptiste, au bas d’un grand tableau qu’on peut admirer dans la cathédrale de La Valette, à Malte, où il vécut entre 1607 et 1608.

Il était le contemporain de Shakespeare, de Cervantes et de Monteverdi ; il peignait sans dessiner au préalable (et lui seul procédait ainsi) ; son atelier était entièrement noir, et ses modèles, trouvés dans la rue, se tenaient dans la pénombre ; il aimait les couteaux, les poignards, les épées :se vouer aux formes qui se disputent les ténèbres et la lumière implique d’être tranchant.
C’est le seul peintre de cette ampleur à avoir commis un crime ; et Stendhal, fasciné pourtant par les homicides, et grand connaisseur de la peinture italienne, y voit une raison pour le trouver négligeable. Mais beaucoup d’autres l’ont trouvé gênant, excessif, déplorable — Nicolas Poussin ne déclarait-il pas qu le Caravage était venu pour « détruire la peinture » ? (On a découvert depuis que Poussin, en secret, en était admiratif et avait scrupuleusement copié La Mort de la Vierge.)

La Mort de la Vierge, 1601-1606.
Photo A.G., Paris, Le Louvre, 25 janvier 2017. ZOOM : cliquer sur l’image.

D’ailleurs, ses premiers biographes, Mancini, Baglione, Bellori, qui l’avaient plus ou moins connu, étaient avant tout des rivaux vexés, c’est à-dire des ennemis, qui mirent sournoisement du sable dans l’engrenage de sa postérité en l’accusant de « déprécier la majesté de l’art », de « mépriser les belles choses » pour s’adonner à « l’imitation des choses viles ».
Ce triple zèle dans la malveillance contribua à officialiser la mauvaise réputation d’un Caravage qui n’eut jamais aucun défenseur, et dont la postérité fut ainsi biaisée d’entrée de jeu ; on lui attribua en effet un nombre exagéré de tableaux (et parmi eux, la moindre scène de beuverie, la moindre trivialité noirâtre) afin de réduire son génie en le diluant dans une abondance médiocre. Ainsi, contrairement à la plupart des grands peintres, qui bénéficient traditionnellement des vertus de l’hagiographie, fut-il privé de reconnaissance : on l’oublia pendant deux siècles.
Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, grâce à des peintres comme Courbet et Manet, qui rouvrent nos yeux à la vérité d’un monde débarrassé de tout idéalisme, que nous sommes redevenus capables de voir sa peinture, et qu’en toute logique il recommence à exister à nos yeux. Mais Élie Faure en parle à peine dans son immense et géniale Histoire de l’art ; André Malraux, dans Les Voix du silence en fait quant à lui un simple précurseur de Georges de La Tour ; et même Georges Bataille, qui a pourtant écrit un livre fulgurant sur Manet, et dont l’œuvre entière s’ouvre à cet abîme où art, extase et sacré récusent le « cauchemar global de la société », ignore le Caravage. Même Les Larmes d’Éros, son dernier livre, où se trouvent stockées les images de la culture occidentale qui font coïncider ce qu’il nomme la « vie religieuse » avec cette « pleine violence qui joue à l’instant où la mort ouvre la gorge de la victime », oublie le Caravage, alors qu’un tableau comme Judith décapitant Holopherne, sans parler des représentations de David et Goliath ou de la tête de Méduse auraient sans nul doute, s’il les avait connus, passionné cet amateur d’Éros cruel qu’est Bataille (et s’il me plaît à moi d’imaginer la rencontre entre Bataille et le Caravage, alors ce livre en sera l’impossible document).

Caravage, Ecce home, 1605.
Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.

Chapitre 50
Approche du Christ
Je m’arrête un instant à Messine, face à La Résurrection de Lazare. On est en 1609. Le Caravage approfondit une solitude qui le dépouille ; il s’abîme dans une obscurité qui se resserre sur son souffle ; on dirait qu’il disparaît : d’ailleurs on ne sait plus rien sur lui -où vit-il ? avec qui parle-t-il ? Le Caravage rejoint son propre mystère. C’est la nuit, et il peint : sa main, dans l’ombre, trace de brusques lueurs qui, en fouillant l’épaisseur du péché, scintillent à la recherche de la grâce.
Il arrive qu’à force de regarder des peintures on se mette à voir quelque chose de très simple ; et que cette simplicité se change en lumière.
Depuis que je m’aventure à écrire sur la vie et l’art du Caravage — depuis qu’avec ce livre je me suis mis à chercher dans la matière de la peinture une vérité qui pourrait se dire —, je suis guetté par un mouvement qui abandonne mes phrases en même temps qu’il les appelle : elles semblent partir dans des directions qui m’échappent, et je ne les reconnais pas toujours ; mais je les laisse faire, car il me vient avec elles l’espérance qu’en se perdant elles parviennent à s’éclairer d’une lumière qui n’est pas seulement raisonnable, à glisser vers je ne sais quoi de plus ouvert que leur sens, à entrer dans un pays plus inconnu encore que la poésie, où la vérité fait des apparitions étranges, comme s’il existait encore autre chose que la nuit et le jour, un temps qui échappe à leur contradiction, qui n’a rien à voir avec leur succession, qui défait le visible en même temps que l’invisible.
La peinture a lieu ici, à ce point d’éclat où l’on ne s’appartient plus, où le Caravage échappe non seulement à ses bourreaux, à ses ennemis, aux chevaliers de l’Ordre, à la mort qui le condamne et prend chaque jour une forme différente, mais aussi à ses mécènes, à ses amis, à ses amours, à tous ceux qu’il connaît à Rome, à Malte, à Syracuse ou à Naples, à tous ceux qu’il ne connaît pas et dont il redoute les désirs et le ressentiment.
Là, le visible s’efface ; et ne dépend plus de rien, ni du temps ni de l’espace, ni des histoires personnelles ni d’aucune conception sur l’art. La peinture et le mystère se rejoignent, comme ils se sont rejoints un jour sur un mur de la grotte de Lascaux, comme ils continuent à coïncider par fois, follement, sans qu’on puisse savoir pourquoi ni comment.
La solitude du Caravage réside dans cet emportement qui l’amène à vivre la peinture comme un moyen pour atteindre le mystère ; et à vivre le mystère comme un moyen pour atteindre la peinture. Ce mystère serait-il le nom de quelque chose de plus grand que nous, ou le rien à quoi nos vies sont mêlées et vers quoi elles se compriment, il n’affirme de toute façon qu’une chose qui manque. Parfois, rien n’est plus clair.
Alors voici :à force de regarder la peinture du Caravage et de m’interroger sur son expérience intérieure, sur la nature de son angoisse, sur la progression du péché dans sa vie et l’intensité de ce qui, à la fois, le sépare et le rapproche de la lumière, je me suis aperçu que de tableau en tableau, centimètre après centimètre, il se rapprochait du Christ.
L’histoire du rapport entre le Caravage et le Christ mériterait la matière d’un livre entier ; en un sens, c’est l’objet de celui-ci -mais il n’est pas si facile d’y accéder :un tel objet ne peut être abordé qu’à travers les tours et détours d’une passion, elle-même hésitante et emportée, timide et contradictoire, qui avance et recule, s’enflamme, se refroidit — s’interroge : il faut du temps, des phrases, et la capacité de convertir la pensée qui vient de ces phrases et de ce temps en une expérience, c’est-à-dire un récit.
Autrement dit, il faut en passer par de la littérature :elle seule, aujourd’hui que l’ensemble des savoirs s’est rendu disponible à travers l’instantanéité d’un réseau planétaire qui égalise tous les discours et les réduit à déferler sous la forme d’une communication dévitalisée, se concentre sur la possibilité de sa solitude ;elle seule, par l’attention qu’elle ne cesse de développer à l’égard de ce qui rend si difficile l’usage du langage, donne sur l’abîme ; elle seule prend le temps de déployer une parole qui cherche et qui soit susceptible, à travers ses enveloppements, de faire face au néant, de détecter des brèches, de susciter des passages, de trouver des lumières.
Au fil des années, le Caravage se rapproche du Christ :on le mesure en observant l’évolution de leur distance dans les tableaux. En 1599, ils ne sont pas encore dans le même cadre : alors que Jésus se tient dans La Vocation de saint Matthieu, le Caravage est dans Le Martyre, le tableau d’en face — il est présent, d’une manière douloureuse, aux côtés du crime, plutôt que dans l’aura de la vocation. On a vu qu’il se contente de lancer, d’une toile à l’autre, un regard angoissé, honteux et peut-être défiant au Christ. L’innocence est impossible ; le Caravage est enfoncé dans l’épaisseur du péché ; et pourtant, il n’a pas encore tué.
À peine quatre ans plus tard, en 1603, le voici de plain-pied avec Jésus : il est présent dans la scène de L’Arrestation du Christ, ce tableau saisissant, plein de tumulte et de cris nocturnes, qu’on peut voir à la National Gallery de Dublin, où, dans une extraordinaire mêlée à sept personnages comprimés dans un étau de ténèbres, des soldats en armure s’emparent du Christ que Judas, aux traits déformés par la laideur morale, vient de trahir.
Tandis que le Christ, mains jointes et la tête enveloppée d’un large pan de manteau rouge qui protège sa lumière intérieure comme un dôme angélique, détourne son regard de ses agresseurs avec une douceur affligée, quelqu’un, isolé à droite du tableau et qui ne fait partie ni de la troupe des soldats ni de celle des apôtres, émerge de la masse en s’efforçant d’éclairer la scène à l’aide d’une lanterne qu’il lève au-dessus des têtes ; son visage est fatigué, mais il est dans la lumière, le regard tourné vers le Christ dont il essaie de s’approcher : c’est lui, c’est le Caravage. Le sens de cette métaphore est clair : par son art, le peintre s’efforce de se rendre présent aux temps sacrés, il éclaire le monde depuis l’invisible auquel l’ouvre la peinture ; mais on peut penser que, avec son visage levé avidement vers la scène, le Caravage fait plus qu’éclairer son atelier mental. Ses yeux tourmentés et sa bouche ouverte expriment une attente, comme si le Caravage cherchait avant tout à se rapprocher du Christ. Mais le salut n’est pas à sa portée : entre le Christ et lui, l’espace est bloqué (par des corps, par les fautes du Caravage) — la distance est encore grande entre les deux.
Et nous voici donc en 1609, en Sicile, à Messine : le Caravage est condamné à mort par le pape, recherché par l’Ordre de Malte, cerné par une vendetta personnelle ; il se cache et il peint - il n’y a pas plus seul au monde que lui.
En six ans, il a énormément peint le Christ, on se souvient, entre autres, des deux Flagellation. Voici qu’à grands traits ocre, rouges et noirs, négligeant désormais le détail des carnations pour approfondir avec plus d’intensité l’espace dramatique où entre vie et mort s’agitent les humains, il se consacre à ce qui est peut-être son plus grand tableau, le plus audacieux : La Résurrection de Lazare.

Caravage, La Résurrection de Lazare (détail), 1609.
Musée régional de Messine. ZOOM : pour voir l’ensemble, cliquer sur l’image.

Nous sommes dans le sépulcre, les murs très hauts sont enduits d’ombre et, dans le fond du tableau, l’immensité d’une porte noire ouvre à la mort ou au salut. Deux hommes soulèvent la dalle et sortent le corps de Lazare que le bras du Christ ressuscite. L’espace tout entier, occupé par une foule en cascade d’où émergent des visages grimaçants, semble chavirer au cœur de la béance entre vie et mort, que le bras du Christ va réparer.
Toute la composition tient par la rencontre miraculeuse entre la ligne horizontale formée, comme dans La Vocation de saint Matthieu, par le bras tendu du Christ, et le corps nu, dépouillé de son suaire et de ses bandelettes, de Lazare, dont la rigidité cadavérique forme une croix qui annonce celle sur laquelle le Christ, à son tour, mourra et sera ressuscité.
Entre le Christ et le corps de Lazare soutenu par ses deux sœurs, un homme dont le visage est tourné vers le Christ (alors que tous les autres personnages regardent en direction de Lazare) semble couper la trajectoire résurrectionnelle ; il est au milieu du tableau, et sans prendre part à l’événement, encore moins à la stupéfaction générale, il s’avance vers le Christ.
Le contraste entre les deux est flagrant : autant le visage de cet homme est couvert de lumière, au point qu’on lui dirait le visage brûlé, autant le Christ disparaît dans l’ombre.
Cet homme, c’est le Caravage. Il s’est peint là, à quelques centimètres du Christ ; ses mains sont jointes et touchent presque celle de Jésus tendue vers Lazare qui va reprendre vie.
Que se passe-t-il exactement entre eux deux ?
De quelle nature relève cet échange ? Y a-t-il même échange, ou un simple côtoiement ? On a la sensation que cet homme au visage en feu remonte le cours de l’action, comme s’il voulait accéder à la source même de ce geste christique — ou lui demander quelque chose : une bénédiction ? Un pardon ? L’amour se tient ainsi debout dans la grâce ; on ne sait s’il la regarde ou la reçoit. En un sens, la lumière dorée qui baigne le visage du Caravage ne peut provenir que du Christ, lequel s’est vidé de sa lueur et demeure dans l’ombre ; une ligne verticale coupe la tête du Caravage, exactement positionnée entre la lumière et les ténèbres. Le Caravage est plus près que jamais du Christ, son visage est comme brûlé par la lumière évangélique, ses mains sont jointes, mais il est à côté. Sans doute ne sera-t-il pas possible de s’avancer plus dans la lumière : rien n’est plus tragique que de voir ce petit espace brûlant et rouge qui le sépare encore du Christ. Cet espace est le nôtre : c’est là que nous vivons, dans les quelques centimètres où s’approche et s’éloigne la possibilité du salut ; ces quelques centimètres sont notre lopin intime, celui dans lequel nous tournons en rond dans le feu qui nous consume et peut nous détruire aussi bien que nous illuminer ; où nos désirs, à force de se creuser, ouvrent peut-être une tombe au lieu de trouver l’issue.
Entretiens avec Yannick Haenel

Caravage, Saint Jérôme écrivant (détail), 1605-1606.
Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : pour voir l’ensemble, cliquer sur l’image.

France Inter, Boomerang, jeudi 21 février 2019, par Augustin Trapenard.
À milles lieues d’une énième biographie, "La solitude Caravage" (Fayard), en librairie aujourd’hui, propose autant une exploration de l’intimité de son auteur, qu’une réflexion sur le geste créateur et sur le langage. On parle anarchie, mysticisme, désir, peinture et Delphine Seyrig, avec Yannick Haenel, invité de Boomerang.
Cela commence par le commentaire d’un texte de Mendès-France écrit il y a trente-six ans et qui, dit Haenel, aurait pu être écrit ce matin...


La mémoire ne nous alourdit pas. L’épaississement de la sensibilité contemporaine va avec la perte de la mémoire.
Ce que je trouve beau c’est le moment où tout chavire, c’est le moment où le vertige me remplace, je ne suis plus là pour contrôler quoi que ce soit, c’est l’ivresse ...
Penser à une femme, c’est écrire. J’associe l’écriture à quelque chose de féminin, quelque chose que je n’ai pas, rencontrer une jouissance qui n’est pas la mienne. J’ai toujours eu une femme dans ma tête pour le dire comme Freud !
Je pense que le feu est calme. En chacun de nous, il y a quelque chose d’indomptable. Duras dirait quelque chose d’irréductible, ce point où la société n’a plus prise sur nous...
Le Caravage parmi nous
France Culture, Répliques, 11 mai 2019.
Avec Yannick Haenel et Hector Obalk.
Si le Caravage fait,aujourd’hui, l’objet d’une admiration unanime, les mots manquent pour dire la beauté et l’originalité de son œuvre. Alain Finkielkraut et ses invités tenteront, dans cette émission, d’arracher l’émerveillement à l’indicible.
« Contre Nicolas Poussin qui le qualifiait de destructeur de l’art, la postérité a tranché. Le Caravage fait aujourd’hui l’objet d’une admiration unanime. Il peignait à Rome dans les premières années du XVII° siècle et ses toiles nous procurent une émotion immédiate. De tous les peintres d’autrefois il est l’un de ceux qui nous parle le plus. Mais que nous dit-il exactement ? Qu’aimons nous en lui ? Qu’est ce qui fait l’originalité et la beauté de son œuvre ? Qu’a-t-il apporté à la peinture et à notre manière de voir le monde ? Pour répondre à ces questions le vocabulaire nous manque cruellement. Les mots nous font défaut et nous avons du mal, un mal fou à sortir du registre exclamatif. »

Yannick Haenel : « Je crois que la peinture pense »
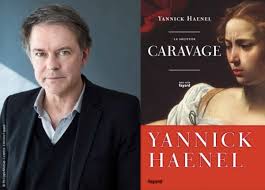 La solitude Caravage qui vient de paraître chez Fayard est un livre qui fera date dans la connaissance et la portée de l’œuvre du génie italien. Comme dans ses romans, Yannick Haenel dévoile une suite prodigieuse de précisions, de scènes et d’illuminations qui se lisent par bonds. C’est un tour de force : ces toiles si connues, si commentées et qui ont quatre siècles se posent devant nos yeux comme si c’était la première fois. Voici le Caravage vivant, miraculeusement là. L’auteur nous a accordé un grand entretien.
La solitude Caravage qui vient de paraître chez Fayard est un livre qui fera date dans la connaissance et la portée de l’œuvre du génie italien. Comme dans ses romans, Yannick Haenel dévoile une suite prodigieuse de précisions, de scènes et d’illuminations qui se lisent par bonds. C’est un tour de force : ces toiles si connues, si commentées et qui ont quatre siècles se posent devant nos yeux comme si c’était la première fois. Voici le Caravage vivant, miraculeusement là. L’auteur nous a accordé un grand entretien.
Votre livre s’ouvre sur une scène décisive. Vous êtes isolé dans une bibliothèque du lycée militaire du Prytanée dans la Sarthe où vous êtes pensionnaire à 15 ans. Vous découvrez une image parcellaire de Judith décapitant Holopherne (1600) du Caravage centrée sur le visage à l’érotique éblouissante de la jeune femme.
Dans Le sens du calme (Mercure de France 2011) vous décriviez que dans ce même lieu, à la même époque, vous avez lu Kafka et Flaubert. Peut-on dire que ces scènes primitives dans cet endroit particulier ont fondé vos sens ?
Le Prytanée militaire de La Flèche, j’en ai fait mon lieu originaire : celui dont on s’extirpe, celui où l’on s’initie.
 C’est le topos de ma mythologie personnelle — mon « mythe individuel du névrosé », pour parler comme Freud. Alors forcément, j’y reviens, je ne cesse de puiser dans ce stock émotif, et de réélaborer son récit. Ce qui a eu lieu là-bas, dans les années 80, a décidé de mon engagement dans l’écriture. Quelque chose, dans ce trou de l’adolescence provinciale, m’a été donné. La dépossession a engendré une vocation ; le vide m’a lancé vers la littérature.
C’est le topos de ma mythologie personnelle — mon « mythe individuel du névrosé », pour parler comme Freud. Alors forcément, j’y reviens, je ne cesse de puiser dans ce stock émotif, et de réélaborer son récit. Ce qui a eu lieu là-bas, dans les années 80, a décidé de mon engagement dans l’écriture. Quelque chose, dans ce trou de l’adolescence provinciale, m’a été donné. La dépossession a engendré une vocation ; le vide m’a lancé vers la littérature.
Du coup, j’ai tendance à condenser dans ce lieu clos toutes sortes d’événements ; parmi eux, il y a eu la découverte concomitante de l’érotisme et de la peinture : c’est en regardant un portrait de femme — ce que je croyais n’être qu’un portrait — que je suis venu à la vie du désir. De cette excitation première est né mon goût pour la peinture, dont la nature s’est révélée pour moi aphrodisiaque. Non seulement la peinture (en l’occurrence celle du Caravage) déclenche du désir, mais elle est animée par le désir : sa substance même, sa matière, c’est l’érotisme — même quand il s’agit d’une corbeille peinte, ou de l’arrestation du Christ.
La vue du visage et des seins de la Judith du Caravage m’a fait former un monde. Des fantasmes, des envies, des folies. J’ai commencé à extrapoler. Les phrases viennent ainsi, la fiction est d’abord un petit bricolage libidinal, une histoire qu’on se raconte à soi-même. Qu’est-ce qui s’invente à travers l’onanisme ? En général, rien, mais il arrive qu’on y mette tant de violence et tant de nuances que cette activité, démentiellement, devienne un travail d’apprentissage et qu’on parvienne à préciser sa vision en même temps que son goût à travers l’endurance tenace d’une obsession. Soyons clairs : l’obsession sexuelle est le secret de la peinture. Celle-ci ne porte pas sur l’effectuation éventuelle des étreintes, mais sur la peau — sur la soif qu’on a de la peau. La peinture, c’est ce qui fait de l’épiderme un monde.
Je peux, en fermant les yeux, parcourir entièrement avec mes mains, dans l’air invisible, certains tableaux que j’aime plus que tout ; je crois que chaque mince craquèlement du tableau du Caravage Judith décapitant Holopherne, à force d’y penser, depuis plus de trente ans, m’est devenu familier, comme le corps de certaines personnes qui me bouleversent, qui m’ont bouleversé. Ce dont il est question au début de La Solitude Caravage, c’est une expérience — aussi dérisoire que sublime, aussi glorieuse qu’enfantine —, de révélation. La peinture, je n’en suis pas un spécialiste, j’en fais l’expérience comme je peux, c’est-à-dire avec passion ; je n’en suis pas non plus un amateur, un de ces types qui auraient avec elle des plaisirs d’esthète. Car j’en attends plus, et même j’en attends tout : je ne désire pas seulement qu’elle serve mon plaisir, je veux qu’elle me chavire — qu’elle m’ouvre à une vérité du désir.

Caravage, Judith décapitant Holopherne, 1600.
Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.

Ce tableau précisément est un des enjeux de votre ouvrage. Il semble s’adresser à vous directement et on vous suit décortiquant ses secrets. Vous le retrouvez partout au fil du texte, dans des lieux d’exposition, il est votre point de capiton, pour reprendre une expression de Lacan. Vous exposez même la découverte de l’identité de la femme peinte par le Caravage. Sans ce souvenir adolescent acéré, sans ce tableau, ce livre aurait-il été écrit ?
C’est vrai, sans ce tableau, sans cette expérience intime qu’il déclenche dans ma vie, je n’aurais pas écrit sur le Caravage. Quel intérêt ? Je ne suis pas un historien d’art, je n’ai aucune autre légitimité pour écrire sur la peinture que ce que celle-ci produit en moi. À travers l’émotion qu’elle me procure, j’ai la folie de croire qu’il y a quelque chose qui peut se transmettre, quelque chose qui relève d’une intensité pensante. L’écriture fait voir : du coup, il arrive, dans ces moments de grande tension heureuse, que les phrases donnent accès à des lignes de nuances, à des inflexions de couleurs, à de vibrations de formes qui ne pourraient s’atteindre autrement que par cet effort du langage sur lui-même qui est l’un des traits de la littérature. En écrivant ce livre, j’ai plongé dans une concentration nocturne qui a été propice à ces éclaircissements qu’exigeaient les tableaux que je cherchais à faire voir. Il n’y a pas d’images dans le livre ; je n’en voulais pas, et d’ailleurs la collection « Des Vies » de Fayard n’en comporte pas. Je trouve qu’on fait trop confiance aux images : on en met une, et on croit que les gens voient. Mais une image ne donne pas forcément à voir. Il faut trouver une parole qui soit capable de faire entendre la pensée qu’il y a dans le tableau. Par pensée, j’entends la vie secrète de la forme. Il n’y a que la littérature qui soit capable d’écouter une pensée qui ne se dit pas. Voilà, être capable de signer l’éblouissement dont on est l’objet, c’est le travail auquel j’assigne l’écriture.
Et puis, pour que j’aie le culot d’insérer mon livre dans la procession immense de tous ceux qui ont été consacrés au Caravage, il a bien fallu que je m’invente une sorte de présomption : l’idée, par exemple, que j’avais compris une chose qui n’a pas été comprise, l’idée que la flamme qui anime le Caravage me parle à moi précisément. C’est ce que Flaubert appelait « se monter le bourrichon ». Dans mon cas, c’est ce petit roman qu’aura été l’histoire de la Judith dans ma vie qui m’a stimulé : je ne me suis pas demandé si j’avais le droit d’écrire sur le Caravage, je l’ai pris. La légitimité, la littérature se l’invente ; elle n’en a aucune a priori, contrairement aux sciences — c’est ce qui la rend si trouble, et si libre.
L’écriture, en tout cas l’expérience que j’en fais, est tendue par un souhait d’intensité tel qu’il peut confiner au désir de prodige : les phrases, j’en attends des fulgurances, des ténuités décisives ; elles portent un feu. La nuit, j’avais l’impression qu’elles étaient comme des torches allumées vers les toiles du Caravage ; grâce à elle, les toiles s’éclairaient ; et le Caravage, réciproquement, m’a accordé un feu, une solitude, une compréhension affamée du monde, comme jamais ça ne m’était arrivé.
Pour revenir à la présomption, à l’idée qu’on apporte peut-être quelque chose de neuf, il y a par exemple le saut, chez le Caravage, de Dionysos au Christ — saut éminemment nietzschéen (bien avant Nietzsche, évidemment) —, et personne, à ma connaissance, n’en a rien dit : dans les premières années de la peinture du Caravage, tous ces ragazzi couronnés de lierre, ces Bacchus arrogants ou lascifs affirment un rapport très sexuel avec le monde, puis cette place est occupée abruptement par l’apparition du Christ. Ça me paraissait lumineux — sans doute grinçant aussi — de faire entendre l’expérience du Caravage là — dans la tension entre la jouissance païenne et la piété christique. On sous-estime de manière stupéfiante l’expérience métaphysique et spirituelle du Caravage ; on le réduit à un violent aventurier surdoué. Ce sont quand même des choses aussi essentielles que brûlantes qui traversent son geste artistique : que faites-vous, dans votre vie, de ces deux tendances de l’esprit : le dionysiaque et le christique ? C’est de l’invisible extrêmement agité, qui peut très vite, si vous ne le pensez pas, tourner au démoniaque, et vous détruire sans même que vous le sachiez. Oui, où en est le Caravage de sa vie : il suffit de regarder ses tableaux pour comprendre que cette question, il se la posait sans arrêt. Non pas comme on ferait le point, mais comme on répond à une exigence, à un appel, à la vérité elle-même. Où en suis-je dans l’histoire de la vérité ? C’est le sujet des tableaux du Caravage ; et ce je, c’est chacun de nous.
Mais je m’éloigne. Vous avez raison, sans la Judith, je n’aurais pas fait le saut.

- La conversion de Marie-Madeleine
Un soir, après avoir acheté plusieurs monographies du Caravage, vous dites avoir vu toute sa peinture, tout Caravage, dans la frénésie folle d’une sorte de binge watching pictural. La peinture agit sur vous comme une compulsion joyeuse : avec ce peintre, c’est tout ou rien ?
Ce n’est pas tout ou rien, c’est tout ! Le Caravage fait partie de ces artistes qui suscitent une adhésion passionnée. Il y a chez lui un élan absolu qui implique qu’à votre tour vous tiriez de vous des forces que vous n’aviez pas.
Je vais le dire ainsi : pour écrire sur un peintre comme lui, il faut se sacrifier. C’est-à-dire tirer de soi des lueurs qui semblent impossibles. Lui vouer une passion endurante, ne faire que ça. À un moment de l’écriture de ce livre, c’était l’été, un mois d’août caniculaire. J’étais seul à Paris pendant des semaines. Tout était blanc et sec, désert. Je ne dormais plus, c’était merveilleux, je transportais avec moi partout un sac de lourdes monographies du Caravage, et le désir d’écrire me soulevait fanatiquement, au point qu’il m’est arrivé le matin de sortir beaucoup trop tôt sans m’en rendre compte : le café où je vais écrire depuis des années était encore fermé, il était six heures du matin, en août, à Paris, tout était fermé, et moi je piaffais de joie avec mes kilos de livres. « Compulsion joyeuse » : vous avez raison, c’est exactement ça.
Je crois qu’avec la peinture, la révélation est progressive. On voudrait que le tout d’une œuvre soit donné comme dans une apparition, mais j’ai bien dû me rendre à l’évidence que la Judith n’est pas tout le Caravage : il y a une initiation qui commence, et qui ne finira jamais. J’ai mis en scène dans le livre une sorte de nuit étoilée de la peinture, où tous les tableaux du Caravage se sont animés ensemble. Ça a eu lieu, et en même temps c’est un fantasme. Avec la peinture, on peut vieillir ; c’est même l’un des domaines où vieillir vous prodigue des bénéfices, car la peinture vieillit avec celui qui la regarde, et les yeux ne cessent de s’agrandir. J’aime de plus en plus le Caravage, comme j’aime de plus en plus Titien, Rembrandt, Zurbaran, Bacon.
Le Caravage est né en 1571 et mort en 1610. Une vie rocambolesque de trente-neuf années où il est facile de s’attarder sur les moments spectaculaires dont le plus important a lieu le 28 mai 1606. Il tue un homme en duel après un différend lors d’une partie de jeu de paume. Vous montrez avec force la complexité de cette affaire. Il s’agirait bien plutôt d’une légitime défense face à un proxénète issu d’une grande famille et donc protégé…
Oui, la violence du Caravage, je trouve bête de la rabattre sur sa vie, sa légende, son caractère. Bien sûr que c’était un homme ombrageux, irascible, véhément, susceptible, tout ce qu’on veut : les biographies le disent, les témoignages se recoupent, c’est incontestable. Et alors ? Il faudrait que les artistes soient des gens sympathiques ? Le Caravage dormait avec un couteau, il se querellait avec tout le monde, il avait un casier judiciaire extravagant, mais en même temps c’était le plus grand artiste de son temps. Sa violence ne peut pas le diminuer ; je crois qu’il faut la penser : d’abord dans le contexte de rivalités artistiques de l’époque, et la récente exposition au musée Jacquemart-André l’a montré : Rome, à la fin du 16e siècle, est un théâtre de la cruauté où le marché artistique, aux mains des prélats qui règnent sur les commandes et donc sur l’argent, jette les peintres les uns contre les autres, à travers une émulation que le Concile de Trente et son programme d’art au service de l’Église encouragent. Ensuite, cette violence, il faudrait la penser d’un point de vue métaphysique : elle témoigne d’une conscience qu’a le Caravage de ce qui arrive au monde. La Renaissance est bel et bien achevée, le temps de la sublimation et des idéalités harmonieuses est liquidé. La peinture du Caravage prend au sérieux l’événement même de la violence : il n’y a pas d’apaisement dans son œuvre.
Quant à l’épisode célèbre où il tue un homme, eh bien il y a des bibliothèques entières sur le sujet. Mais l’essentiel de mon livre consiste à interroger ce qui arrive à quelqu’un dont l’expérience intérieure s’égale à hauteur de mort. Il n’est pas devenu criminel pour rien. Je ne dis pas qu’il a tué juste pour voir (il en paie les conséquences : quatre années d’exil, et en un sens il en meurt) ; mais pour un peintre qui n’aura fait que disposer sur ses toiles des témoignages brûlants de ce qu’il en est du mal, et revenir obsessionnellement sur des décapitations ou des décollations, l’homicide dans lequel il est impliqué relève d’un passage à l’acte dont la logique est terrible. La mort est son domaine. Qui s’en est donc approché plus que lui ? Qui l’a sentie comme lui sous ses doigts ? Entre le pinceau et le couteau, il y a chez le Caravage un échange symbolique qui signe à la fois son audace en tant qu’artiste et sa condamnation en tant que pauvre humain. Disons qu’il a ouvert dans sa vie — c’est son destin, sa fatalité — cette brèche où la peinture et le crime se touchent. Quel artiste a tué ? Je crois qu’à part le Caravage, il y a l’étrange Gesualdo, le prince compositeur, qui est son exact contemporain.
Je ne sais ce que les spécialistes vont penser de mes conclusions concernant la scène de crime du 28 mai 1606, mais il ne s’agissait sans doute pas, comme on l’a colporté paresseusement, d’une dispute à propos d’une partie de jeu de paume ou d’un pari perdu, mais d’un véritable « duel d’honneur ». Ranuccio Tomassoni, on le sait maintenant, était un petit mafieux qui officiait avec son frère dans l’une de ces milices du secteur de Campo Marzio, le centre historique de Rome, et qui sous prétexte d’assurer la sécurité, pratiquait le clientélisme, l’escroquerie, et le proxénétisme. Ces activités étaient couvertes, voire blanchies par son nom : sa famille était en effet très respectée à Rome. Et figurez-vous qu’il n’était pas le proxénète de n’importe qui, mais de la jeune prostituée qui a posé pour Judith décapitant Holopherne, le tableau qui a hanté toute ma jeunesse. Elle s’appelait Fillide Melandroni, elle avait à peine 20 ans, l’air d’une princesse, et venait de Toscane. Le Caravage et Tommasoni se détestaient, ils étaient également violents et sûrs d’eux ; je n’ai pas pu m’empêcher de penser qu’en plus de leurs tempéraments volcaniques, il y avait cette femme entre eux ; j’en ai tiré les conséquences. Je ne sais pas s’ils se sont battus expressément pour elle ce jour-là, mais dans l’accumulation de haine qu’il y avait entre ces deux-là, elle y était quand même pour quelque chose. On suppose en effet qu’elle a été la maîtresse du Caravage, et je pense qu’ayant posé quatre fois pour lui (elle « fait » Judith, Madeleine, Sainte Catherine d’Alexandrie — et il a même existé son portrait par le Caravage, qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais dont on a conservé une photographie), elle est nécessairement devenue une autre, et a échappé à son maquereau : une femme qui devient de l’art peut-elle continuer à accepter d’être considérée comme une traînée ? Il y a eu, à cause du Caravage, grâce à lui, un conflit d’intérêt entre le proxénète et le peintre, et elle en était l’enjeu. C’est ainsi que je me raconte cette affaire.

Bacchus adolescent.
Galerie des Offices, Florence. ZOOM : cliquer sur l’image.

Vous dressez le portrait d’un artiste en guerre. Au-delà du fait de vivre dans une région et une époque où le crime est roi, Le Caravage agit souvent violemment parce qu’il aime la bataille. Mais il s’avère qu’il est absolument haï par la concurrence féroce de la scène artistique de l’époque qui lui attribue d’ailleurs des tableaux moyens pour affaiblir sa renommée étourdissante. Le Pape est contre lui, l’Ordre de Malte veut sa mort, ses biographes sont ses ennemis. Vous atomisez dans votre livre la gigantesque falsification dont il est victime de son vivant et jusque dans la postérité.
Oui, rarement un homme aura été aussi seul. Il a eu disons des protections politiques, sinon il n’aurait pas tenu plus d’un an ou deux à Rome, mais en gros ils sont tous contre lui. D’abord parce que c’est le plus grand des peintres, ce qui suscite la rancœur des médiocres ; et parce qu’il est très vite le mieux payé, ce qui suscite carrément de la méchanceté autour de lui. On oublie souvent dans l’histoire de l’art les questions de jalousie (il faudrait écrire une histoire de la critique du point de vue de la jalousie !). Quand on lit les critiques artistiques ou littéraires, même aujourd’hui où hélas ils disparaissent, on a tendance à les prendre pour argent comptant, on fait confiance au discours critique, mais celui-ci n’est-il pas aussi — et souvent — le reflet de préjugés, d’incompréhensions organisées, voire d’animosités, de petites félonies qui visent parfois à rabaisser, voire à détruire un artiste ? Il n’y a pas d’impartialité, ça n’existe pas : il y a juste des gens, autour d’une oeuvre, qui se demandent s’ils ont intérêt ou non à l’aimer. Et en général, les génies déclenchent de l’animosité.
Le Caravage a été une victime spectaculaire de la postérité : il y avait l’idée qu’il était gênant, non seulement son caractère était impossible et il avait froissé tout le monde, mais son art lui-même, nouveau, direct et délivré de l’idéalisme qui pesait encore à l’époque sur la peinture, discréditait les autres peintres. Il fallait s’en débarrasser. Les premières biographies qui lui sont consacrées sont écrites par des ennemis : elles sont perfides, pleines de mensonges, et visent à fixer la légende d’un fou. Par ailleurs, on lui attribue vite, et pour longtemps, des centaines de tableaux qui sont des croûtes. Le moindre tableautin noirâtre, avec des gitons ou des ivrognes, on dit : c’est un Caravage. C’est parfois voulu, parfois non. Le résultat est le même : on ensevelit la mémoire du Caravage sous un amas d’oeuvres médiocres. On fait de lui un peintre de genre, un artiste mineur. Du coup, on ne le voit pas. Ça va durer des siècles. Au 20ème siècle, Georges Bataille, qui pourtant aurait dû s’émerveiller qu’existe une telle peinture, n’en parle pas, André Malraux le considère comme un sous-Georges de la Tour, un peu trop véhément… Le Caravage, à part quelques spécialistes raffinés comme Roberto Longhi qui s’y sont consacrés dans l’ombre dès les années 30, ça fait à peine soixante ans qu’il est redevenu un grand peintre. Mais regardez son succès actuel : finalement, cette conspiration autour de son nom lui a redonné du temps, et octroyé une nouvelle jeunesse. Je crois en la vengeance inconsciente de la société envers ceux qui lui échappent : il aura fallu des siècles pour qu’à la faveur de désattributions précises, on stabilise le corpus autour d’une soixantaine d’oeuvres, et que le Caravage gagne sa guerre. Il l’avait toujours gagnée, mais maintenant on le sait.
Les mots fameux d’Arthur Rimbaud — « Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes » — s’applique parfaitement à la vie et à l’œuvre du Caravage. En étirant le temps de quatre siècles jusqu’à nous, comment expliquer que l’échauffourée intellectuelle soit quasi inexistante aujourd’hui ? Dans la presse, on ne lit pratiquement que des critiques positives partout sur tout, est-ce le signe d’une époque où le spectacle viscéralement aphone a gagné ?
Le combat spirituel existe toujours, même sans combattants. Quant à la presse, je ne sais pas, il me semble qu’elle obéit à un processus plus général — planétaire même — qui non seulement égalise, mais assigne tout à l’insignifiance. Il faut que ça tourne : la rotation de la marchandise est une forme de mise à mort. Le spectaculaire intégré est sans réplique, Debord l’a dit depuis longtemps. Par ailleurs, je crois que la paix frileuse que vous décrivez relève moins d’un éventuel problème de jugement ou de courage des critiques que d’une modalité plus métaphysique — une tournure de l’époque, qui absorbe celle-ci dans l’impossibilité à penser. Car des critiques virulents, il y en a, mais leur colère est une forme d’exacerbation de l’impuissance. Un « tourbillon de rancune », comme dirait Nietzsche, qui est la conséquence stérile d’un narcissisme particulièrement surdéveloppé à l’ère de la surveillance généralisée.
Par ailleurs, je pense sérieusement que plus personne n’aime la littérature. Beaucoup font semblant de l’aimer. Il y a une simulation sociale autour de la littérature, qui avait encore récemment son utilité dans le secteur culturel, et qui draine un peu de publicité (de moins en moins), un peu d’événementiel (toutes ces fêtes pour les sorties de livres…), mais plus vraiment de passion. La société se fout absolument de la littérature ; et c’est pathétique, parce que de plus en plus d’écrivains, de leur côté, ne font plus que la chercher en s’adaptant à elle, en ajustant leur livre à son script commercial, à son horizon audio-visuel. Tous ces livres qui sont des téléfilms… Bref, s’il y a encore quelques singularités, bien sûr, qui aiment la littérature, elle n’a jamais été si seule. Qui, du coup, se battrait aujourd’hui pour elle ? Qui déchaînerait les foules, intellectuellement, pour ou contre un livre de littérature ? Je crois que cette solitude actuelle est sa chance. Je dirais même son salut.
Vous intitulez un de vos chapitres « La sagesse ne viendra pas. » qui est une phrase de Guy Debord. Ce peintre n’a jamais trouvé le calme ?
Je pense que le calme ne faisait pas partie de son registre. Le Caravage aimait l’intensité, il dépensait sa vie ; il ne s’est pas économisé, il n’a cessé de griller ses positions, la violence était son art. Brusquer le monde, c’est aussi une méthode. Regardez comme avec le Caravage les ténèbres ont reculé. Comme les vieilles formes sont devenues ridicules. Regardez comme la représentation s’est élargie grâce à lui. Ce fond noir qu’il invente nous regarde aujourd’hui comme le témoignage le plus vivant de ce qu’il en est du monde et de l’esprit.
Il est mort à 39 ans, absolument épuisé, sans argent, sans rien. Dans le monde du sacrifice, il n’y a ni temps mort ni répit. Si votre vie est prise dans un cercle sacrificiel, vous n’en sortirez jamais. À l’intérieur de ce cercle, vous vivrez le feu, et celui-ci éclairera les murs de votre monde, qui, si vous êtes un grand artiste, sont aussi les parois du monde.
J’aime bien que vous ayez repéré cette phrase de Guy Debord. C’est à la fin de Panégyrique. Elle me fait penser à certaines devises des princes de la Renaissance florentine. « La sagesse ne viendra pas » : c’est abrupt, insolent, aristocratique, c’est le grand art. Il ajoute : « Le léopard meurt avec ses taches. » Les véritables aventuriers se rejoignent à travers le temps sur le fait qu’ils ne lâchent rien. C’est ce que j’appelle la solitude. C’est à la fois une vertu, un territoire et une couleur (entre le noir et le jaune-flamme).
 Sans avoir compté, il est fort possible que le mot que vous employez le plus dans La solitude Caravage soit « scintiller, scintillement ». C’était déjà le cas dans votre dernier roman Tiens ferme ta couronne (2017). Votre écriture sur la peinture, tout comme votre œuvre romanesque, fait scintiller les détails. J’en vois trois : un filet d’eau lumineux que boit Jean Baptiste, la subtile perle de la boucle d’oreille de Judith, un petit carré blanc presque abstrait dans « La conversion de Marie Madeleine ».
Sans avoir compté, il est fort possible que le mot que vous employez le plus dans La solitude Caravage soit « scintiller, scintillement ». C’était déjà le cas dans votre dernier roman Tiens ferme ta couronne (2017). Votre écriture sur la peinture, tout comme votre œuvre romanesque, fait scintiller les détails. J’en vois trois : un filet d’eau lumineux que boit Jean Baptiste, la subtile perle de la boucle d’oreille de Judith, un petit carré blanc presque abstrait dans « La conversion de Marie Madeleine ».
On dit que le diable est dans les détails, vous montrez le strict inverse.
Merci pour cette formule : faire scintiller les détails. Je prends ! Je pense que la moindre des choses, quand on écrit, c’est de se rendre disponible à la précision. La généralité est toujours banale. Je me rends compte en vous lisant que la goutte d’eau et la perle sont une même chose : la perle, c’est de la rosée spiritualisée. Quant à ce carré blanc où la lumière se prend elle-même pour objet et se recueille, on peut le concevoir comme l’abri mystérieux du divin — ou sa version chromatique profane. Dans une goutte d’eau, celle qui abreuve le Baptiste, il y a l’univers entier qui par irisation vient se réfléchir ; il y a aussi bien sûr l’horizon du baptême, c’est-à-dire la possibilité du salutaire. La perle, quant à elle, est un concentré d’érotisme, comme pour d’autres le talon aiguille. À mes yeux, la beauté de la peinture se donne là, à travers ces étincelles sensuelles qui peuvent sembler secondaires, mais qui font du tableau un territoire scintillant, justement. Si ça ne scintille pas à l’intérieur, c’est que c’est mort.
Et par retour, les détails ouvrent au royaume des phrases. Pas de littérature sans détails. Je vois ces points de lumière partout à l’oeuvre ; je m’y baigne. C’est là que j’atteins mon propre point de solitude, c’est par là que ça s’ouvre. Faire scintiller l’être, c’est la grande chose — une variante, plus métaphysique, de l’enchantement. Je suis assez pour le « plus de jouir » ! Écrire pour déprécier, pour faire parler le manque ou la rancune, cela m’est complètement étranger. Je cherche une brèche, je cherche des richesses poétiques, il y a des usages de la liberté qui sont encore à venir. Le désir n’est pas encore asséché, la fontaine n’est pas vide. Trouver la perle, étendre le domaine de l’érotisme, préciser des lumières, c’est à cela que je m’emploie à travers la littérature.

- La Conversion de Marie-Madeleine, détail.
Vous avancez que « Le Caravage est le premier peintre à prendre au sérieux le néant ». Les noirs puissants et les clairs obscurs associés qui gorgent son œuvre et ont aussi fait sa renommée auraient une valeur ontologique ? Si Le Caravage illustre par ses apports stylistiques une avancée dans l’histoire de l’être, nous sommes loin d’une peinture de la violence et de la pauvreté que l’histoire a retenu…
Il m’arrive de penser que la peinture n’a pas besoin des humains, elle se tient au cœur de son propre point aveugle. J’imagine souvent les tableaux seuls, dans les musées, la nuit. Leurs silences dialoguent. La solitude de la peinture est aussi inouïe que celle de la littérature. Qu’est-ce qui s’ouvre à travers ces rectangles de lumière ? Pierre Michon dit que la peinture est une « fabrique généralisée de noblesse ». C’est juste : les ragazzi du Caravage ne deviennent-ils pas des dieux ? Il leur met un peu de vigne dans les cheveux et voici que ce sont des Bacchus.
Mais moi, je crois que la peinture pense. Le Caravage pense. Il en va de l’être dans ses tableaux. Chez lui, si les couleurs et les formes s’ajustent selon cette guerre qu’il perçoit entre le clair et l’obscur, s’il invente ce fond noir pour mettre la lumière à l’épreuve de sa possibilité, c’est parce que tout se joue pour chacun de nous entre deux abîmes : disons entre l’issue et l’impasse, entre la trouvaille et le malheur, ou — à l’époque du Caravage — entre Dieu et le néant.
C’est là que ça se joue, dans l’ontologie fondamentale. Ou, si vous voulez, dans le spirituel. On sous-estime toujours l’éclat spirituel qu’il y a dans les tableaux du Caravage : quelle puissance prend pourtant le sacré chez lui ! Regardez les torses du Christ. Regardez le tremblement qui parcourt les visages autour de Lazare quand Jésus le ressuscite. Regardez la tête effrayante de Goliath tenue par David.
Entre nous, il n’y a rien d’autre que l’être. Surtout à l’époque du Caravage. La politique ? À la fin du 16è siècle, c’est le pape, les rois, les princes, voilà tout : qui donc pourrait s’imaginer faire de la politique ? L’amour ? Bien sûr, mais chez le Caravage, il est dans les pigments, dans la joie folle qu’on met à trouver de la lumière sur un visage. Une matière inlassable parcourt les désirs qui se jettent sur ces rectangles.
Philippe Sollers, en lisant mon livre, m’a dit : « Vous sauvez le rectangle ». C’est une formule énigmatique, mais qui m’a comblé. Les images palpitent, leur violence, comme chez Delacroix ou Bacon, s’élancent vers l’impossible. On voit en effet, de loin, le Caravage comme un peintre réaliste, le peintre des pieds crasseux et des gitons braillards, mais les énigmes qu’il peint relèvent de l’incarnation, c’est-à-dire de l’absolu du corps et d’un en plus qui se dérobe, et peut relever d’un reste mystique. Le visible ne parvient pas à se contenir ; le visible déborde dans l’invisible. Il y a bel et bien des choses invisibles qui sont peintes, non ? Zurbaran, Rembrandt, le Titien et le Caravage ne cessent de lancer leurs figures peintes vers un débordement de la représentation.
Vous avez décelé l’essentiel : le Caravage est à penser, à évaluer, à voir dans l’histoire de l’être. Je suis entré pendant un an, jour et nuit, dans la peinture du Caravage, je m’y suis consacré comme on se baigne dans l’être. J’ai sans cesse voulu garder la tension entre peinture et littérature, entre le fait que je regardais et que j’écrivais. La peinture, c’est de la pensée : ce qu’un tableau montre, c’est ce qui ne se voit pas. Il y a là quelque chose qui relève de l’aléthéia — de cette forme grecque de la vérité qui se manifeste comme une apparition, un dévoilement, un retrait qui se déclôt. Ce qui a lieu dans l’être, je le comprends en méditant sur les peintures du Caravage, c’est la mise en éveil de la vérité. C’est pourquoi j’aime tant ce peintre, et Cézanne, Van Gogh et Bacon : ils témoignent en faveur d’une violence de l’être, d’un déchaînement du Dasein. L’extatique de la peinture, c’est ce qui m’a fait écrire ce livre.
Le Caravage intérieur de Yannick Haenel
Avec « La Solitude Caravage », l’écrivain livre une belle variation sur la vie de l’artiste (1571-1610), d’où sa subjectivité et ses préoccupations ne sont jamais absentes.
Par Eric Loret

- Le Souper à Emmaüs, 1606
Académie des beaux-arts de Brera, à Milan.
A l’âge de 15 ans, Yannick Haenel connaît une épiphanie érotique en découvrant Judith et Holopherne, du Caravage (1571-1610). Mais seulement le visage de l’héroïne, pas la totalité du tableau. C’est un détail, dans un livre : « A son oreille, une adorable perle était fixée par un nœud de velours noir dont la boucle formait un papillon. » Cette perle et ce papillon, ajoute-t-il, « veillèrent ensemble sur mon désir ; ils en étaient l’image – ils en devinrent même la clé ».
S’il s’inscrit dans une collection biographique, La Solitude Caravage est, on le comprend dès l’abord, avant tout un autoportrait en artiste de son auteur. Haenel a lu tous les livres sur le peintre milanais, il se décrit comparant les reproductions et noyé dans les souvenirs de ses visites à Rome, Berlin ou La Valette. Mais, même s’il raconte la vie dangereuse de Michelangelo Merisi da Caravaggio en se fondant sur les recherches les plus récentes, c’est à une lecture toute personnelle de l’œuvre qu’il se livre, sortant dès la première page son sujet des parages troubles et homoérotiques où la tradition l’a longtemps situé.
Eclairs rimbaldiens
L’interprétation d’Haenel se place sous le signe de la vérité, de la décollation comme dévoilement dans le sang, cri vers l’abîme. La Judith du Caravage n’est en effet pas seulement une amante désirable mais aussi une tueuse. Ce n’est qu’en 1997, lors d’un voyage à Rome avec une femme aimée, qu’Haenel – dit-il – découvre l’intégralité de la toile : la lame, le sac qui attend la tête coupée, le sang qui gicle.
La Solitude Caravage sera donc un essai bataillien où « le meurtre prend la place du sexe » et dont le narrateur se fait volontiers voyant, transpercé d’éclairs rimbaldiens. « Il m’arrive de penser qu’on n’a pas encore vraiment pris la mesure de ce tableau », avance-t-il par exemple à propos du Bacchus de Florence : « L’acte dont procède une telle peinture – cet acte rigoureux qui nous fait carrément entrer une lame ironique dans les yeux – possède la capacité de dissoudre ce qu’il y a d’éternellement convenable dans la représentation picturale. » L’art du Caravage est ici d’ordre sacrificiel : le regardeur l’éprouve comme une ordalie.
Envers lumineux
Le héros d’Haenel est certes querelleur, comme les anciens biographes nous l’ont décrit, mais aussi obscur, obsédé, infiniment occupé à créer. Le noir et le gras (celui de la suie des chandelles, de la lumière faible) sont ses attributs charnels : ne peint-il pas avec un charbon issu des os calcinés que, suppose Haenel, ses assistants dérobent à des squelettes humains ? « La mort fait partie de la substance même de la peinture – on peint avec les morts. » Il y a cependant un envers lumineux : « Je crois aussi, on le dit moins, que le Caravage vécut dans un éblouissement de visions où les formes sont des ivresses colorées. »
Dans cette version ultraromantique, le « royaume » est l’horizon de l’œuvre et Caravaggio a peint pour nous en entrouvrir les portes. C’est en ce sens eucharistique qu’Haenel analyse La Décollation de saint Jean-Baptiste où, selon lui, s’échangent le sang du saint et l’encre de la signature du peintre : « Sur ce plan du mystère où nos âmes trempent toutes dans le sang du Christ, [Caravage] est reçu dans le salut. » Au-delà des enjeux biographiques et esthétiques, c’est encore une fois, on l’aura compris, la question du mal et de la vie digne que traite l’écrivain de Tiens ferme ta couronne (Gallimard, prix Médicis 2017), sous un jour moins riant cette fois, mais non moins aigu.
Eric Loret, Le Monde du 9 mars 2019.
A l’exposition Caravage à Rome, amis & ennemis du musée Jacquemart-André (visible jusqu’au 28 janvier).
Judith décapitant Holopherne

Caravage, Judith décapitant Holopherne (détail).
Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.


Caravage, Judith décapitant Holopherne (détail).
Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.

Madeleine en extase

Caravage, Madeleine en extase, 1606.
Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.


Caravage, Madeleine en extase dite « Madeleine Klain », 1606 (?). Collection particulière.
Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.

Voici pour la première fois réunies deux versions de la Madeleine en extase, un tableau de Caravage dont on connaissait la composition grâce à une réplique fidèle, signée Louis Finson (Marseille, musée des Beaux-Arts).
Ces deux peintures — l’une dite « Klain », attribuée à Caravage depuis longtemps et l’autre, également de la main du maître, découverte en 2015 et encore jamais exposée en Europe — sont présentées ensemble afin d’ouvrir le débat des critiques.
Réalisé sans doute à la même époque que Le Souper à Emmaüs, le thème de l’oeuvre a vraisemblablement connu un succès immédiat. L’iconographie de la Madeleine en extase est tout à fait innovante : sa pose, tout en préfigurant les extases des saintes du Bernin, renvoie à celles des statues antiques de ménades et de satyres ivres, ainsi qu’à Ariane endormie et à Méléagre mourant. Le visage consumé et hagard de la sainte trahit l’extase d’une pécheresse convertie, plongée dans une lumière contrastée qui révèle ses courbes abandonnées.
Certains historiens de l’art ont rapproché le ventre enflé de la sainte de celui du modèle de la Mort de la Vierge conservé au musée du Louvre, tableau peint par Caravage en 1605. (notice de l’exposition)
LIRE : Philippe Dagen, Le Caravage, une avant-garde à lui tout seul pdf

VOIR AUSSI :
La Madeleine en extase, l’original du Caravage enfin retrouvé ?
et Autres Madeleine.
David avec la tête de Goliath

Caravage, David avec la tête de Goliath, 1605-1606.
Photo A.G., Rome, Galerie Borghèse, 23 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

Julia Kristeva, dans le chapitre « Décollations » de son livre Visions capitales, décrit Judith tranchant la tête d’Holopherne. Elle y voit « l’image d’une féminité guerrière, castratrice, sans merci », « l’apothéose de la femme de tête qui fait plus que castrer — qui décapite l’homme le plus impitoyable », « le positif de Gorgone, sa version splendide et triomphante. » (p. 77). Kristeva ne reproduit pas le tableau de Caravage mais celui, magnifique, d’Artemisia Gentileschi, « le plus grand peintre féminin ». Par contre, Kristeva reproduit le David avec la tête de Goliath (1605-1606) du Caravage qui se trouve à la Galleria Borghese, à Rome. Elle écrit (p. 88) :
« Je garde pour mon musée imaginaire le coléreux Caravage et la farouche Artemisia Gentileschi. Le peintre vagabond, Caravage, amoureux des têtes coupées, ne s’est épargné ni Judith, ni saint Jean, ni Isaac. Je choisis l’humour macabre de son David avec la tête de Goliath. Ramassé, sculptural, le jeune David à la peau dorée montre le regard incurvé d’un éphèbe grec ; alors que le chef branlant du sinistre géant, confié aux mains distraites du futur roi, arbore en toute simplicité les traits de l’artiste lui-même : face criminelle louée pour la circonstance au magasin des accessoires de la commedia dell’arte. Le roi ne regarde pas la tête coupée, personne ne regarde une tête coupée, sinon les amateurs de tableaux, les voyeurs comme vous et moi. Croyez-vous qu’il y ait quelque chose à voir ? David vous fait voir que non. La décollation abondamment montrée signe le terminus du visible. C’est la fin du spectacle, messieurs-dames, circulez ! Il n’y a plus rien à voir ! Ou plutôt il n’y a que ça à voir, mieux, à entendre. Ouvrez maintenant vos oreilles, si elles ne sont pas trop sensibles. Le fond de l’horreur, ça ne se voit pas ; ça s’entend, peut-être. Remisons les palettes, et à bon entendeur salut ! À moins que cette intimité sadomasochiste, continuellement profanée, à la Caravage, ne soit le dernier temple moderne ? Et qui se prolonge dans les sex-shops hard, les raves et autres installations. À méditer après, en avoir pris plein les yeux. »
Le Caravage, anges et bourreaux, le cycle de Saint Mathieu
un film d’Alain Jaubert (1998)
Cycle de Saint Mathieu de Michelangelo Merisi, dit Le Caravage - 1600 - Église Saint-Louis des Français, Rome Saint-Mathieu.

La Vocation de saint Mathieu (détail), 1600.
Photo A.G., Rome, Église Saint-Louis des Français, 16 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

Le Caravage inventa une nouvelle manière de « chasser » l’obscurité qui surprendra ses contemporains avant d’être imitée de l’Espagne aux Pays-Bas.
Chargé de représenter trois étapes de la vie de l’évangéliste Matthieu : la Vocation, la Visite de l’ange et le Martyre, Caravage traite les trois scènes d’une toute nouvelle manière. Gestes, couleurs, éclairage, tout compose une sorte de mise en scène théâtrale qui tient compte aussi de l’architecture du lieu et de l’approche du visiteur.

Caravage, dans la splendeur des ombres
un film de Jean-Michel Meurice (2015)
Le premier artiste moderne. Une vie brève et violente. Un talent et une célébrité précoces. Une enfance lombarde, dix années de succès à Rome, des commanditaires riches et puissants, un caractère vif et irascible, une attirance pour les bas-fonds et les querelles, toujours armé, plusieurs fois emprisonné, condamné à mort pour meurtre, contraint de fuir de Rome, traqué par la police papale, en cavale à Naples, puis en Sicile et à Malte, il meurt à 39 ans. Selon la légende son cadavre fut abandonné sur une plage, comme celui de Pasolini. De quoi nourrir la légende. Avec le temps, son nom disparut des mémoires. Ses œuvres n’étant pas signées, on lui attribua toutes celles jugées grossières, vulgaires et d’un réalisme de mauvais goût, on attribua les siennes à d’autres. Pendant trois siècles son œuvre fut ainsi démembrée et oubliée.
L’œuvre telle qu’on la connaît aujourd’hui est une renaissance, le fruit du travail des historiens. Sur plus de cinq cents œuvres qu’on lui attribuait, trois siècles après sa mort, moins de cinquante étaient réellement autographes.
Le film raconte cette histoire et part sur les lieux d’exposition de 22 œuvres majeures à Rome, Malte, Paris, Rouen, Montpellier.

Ernest Pignon-Ernest. Naples, 1988-1995
« L’histoire de Naples ne s’efface pas ; s’y superposent mythologies grecque, romaine, chrétienne. Niçois, j’y ai retrouvé une familiarité ancienne, essentielle, comme ce sentiment, en marchant à Cumes dans l’antre de la Sibylle, d’un retour au ventre de la terre : des retrouvailles avec des origines immémoriales.
Dans l’entrelacs des rues, mes images interrogent ces mythes, elles tracent des parcours qui se croisent, se superposent ; elles traitent de nos origines, de la femme, des rites de mort que sécrète cette ville coincée entre le Vésuve et les terres en ébullition de la Solfatare sous laquelle Virgile, déjà, situait les Enfers ; elles convoquent Caravage, parlent des cultes païens et chrétiens que porte aux ténèbres cette cité ensoleillée. C’est une quête au long cours, qui a duré des années, de ce qui fonde ma culture, ma sensibilité méditerranéenne. »
in Ernest Pignon-Ernest Gallimard 2014.

Ernest Pignon-Ernest : Caravage, David et Goliath, 1988.
Photo . ZOOM : cliquer sur l’image.

David et Goliath d’après Caravage, 1988, dessin original à la pierre noire réunissant les têtes tranchées de Pasolini et Caravage, collé Via Seminario dei Nobili, Naples.
Le dessin, qui occupe la partie centrale de la composition, représente le jeune David, grandeur nature, tenant dans la main droite une poignée de cheveux et de l’autre la tête de Goliath qu’il brandit d’une fenêtre. Les photographies occupent la partie inférieure de la composition. La photographie offre une vue rapprochée de l’installation in situ [...]. On remarque une différence de traitement du dessin entre les parties anatomiques très travaillées et le drapé qui est resté, comme le cadre, à l’état d’esquisse. L’artiste est fidèle à l’œuvre de Caravage même s’il la revisite en changeant légèrement la composition. Il fait disparaître l’épée de David et actualise l’œuvre en associant à la tête de Goliath celle de Pasolini, comme en témoignent les photographies accompagnant le dessin préparatoire. Une observation attentive de l’œuvre de Caravage permet de constater que la main droite de David n’est pas apparente, son bras droit étant complètement plongé dans l’obscurité. Ernest Pignon-Ernest est donc allé puiser dans une autre œuvre du maître italien, L’Amour vainqueur l’élément manquant à sa composition [3].

Ernest Pignon-Ernest : Caravage, La Mort de la Vierge, 1990.
Photo . ZOOM : cliquer sur l’image.

Dessin à la pierre noire inspiré de Caravage, collé à Spacca Napoli, 1990.
C’est là qu’Ernest Pignon-Ernest a collé durant la nuit une citation de la mort de la vierge du Caravage. Il n’a gardé que le visage, le buste, la main droite et le bras gauche de la vierge. Le lendemain matin, deux vielles femmes, deux vendeuses de cigarettes et autres babioles, toujours assises derrière une petite table dans la rue, se sont mises à veiller cette image [4].
Le site d’Ernest Pignon-Ernest
Aux côtés de Yannick Haenel, l’inspiration par la peinture
France Culture, L’Art est la matière par Jean de Loisy, 29 novembre 2020.

Pour moi écrire, essayer de faire de la littérature, ça relève d’une manière de faire parler ce qui ne parle pas, de faire parler les choses muettes - comme dit Poussin de la peinture - et de donner voix à ce qui est silencieux, ou à ce qui est privé. Je me souviens de m’être entraîné, quand j’étais un tout jeune homme et que je voulais écrire, à décrire un tableau que je voyais à travers une fenêtre. Je crois que c’est l’enfance de l’art de faire ça. Sans m’en rendre compte, ce petit exercice - qui est en réalité un exercice de rhétorique, qu’ont inventé les grecs - je l’ai incorporé à chacun de mes livres. Je sais que dans mes romans, et je m’en rends compte parce qu’on me l’a dit, il ya sans cesse des pauses ou des respirations, qui relèvent d’un arrêt contemplatif, d’un arrêt émotif devant une oeuvre d’art, que se partagent des personnages. De manière générale j’ai soif, j’ai une forme d’intempérance qui fait que j’ai envie de voir des oeuvres d’art, en particulier la peinture, ça ne me suffit jamais, comme un amoureux que l’être humain ne cesse de combler et qui ne cesse qui lui manque à la fois. Il faut que ça se répète : il m’en faut toujours plus, il faut que j’aille voir les tableaux ou que j’en dispose des reproductions autour de moi, comme un rituel quotidien.
On a une bibliothèque intérieure : il y a des livres que je n’ai pas vraiment besoin de relire, j’en dispose rien qu’en y pensant, ainsi que certaines phrases, certaines couleurs. Il y a toute un palette qu’on finit par s’approprier qui devient naturelle. Je sais quel rouge ou quel mauve presque ocre me convient chez Delacroix, je vais le chercher quand j’ai besoin d’écrire : je veux dire par là que j’appuie sur une touche de mon cerveau et ce rouge me vient sous les doigts. Je sais aussi que dans Fra Angelico il y a une douceur près du ventre de la Vierge qui, pour moi, est à la fois du lait et du miel. À force de travail c’est comme si j’en avais la pâte sous mes doigts et que j’aimais le mettre sur le visage des femmes dont je parle, de mes personnages.
Je ne sais pas si l’artiste a une responsabilité, il fait ce qu’il veut. Il y a un bras d’honneur au fond de chaque geste artistique. Mais il y a aussi un absolu : un artiste est un chercheur de vérité, il me semble qu’à peu près tout le monde a abandonné cette tâche dans la société contemporaine. On remplit des fonctions mais on ne cherche plus la vérité ou des vérités, ou sa vérité. Les chercheurs de vérités, comme les porteurs de lanternes dans la nuit dont parlait Stevenson, n’ont pas besoin de la ramener sans cesse. Ils sont gratifiés par l’endurance des choses les plus extrêmes, de la destruction, qui est là à chaque instant, ils la sentent. Comme disait Baudelaire, "ça sent la destruction" et en même temps ils voient l’éclaircie. Je crois qu’être un artiste c’est vivre, aimer, ressentir. Je vois une fontaine au coeur de chaque instant mais je vois aussi le noir, le cauchemar.
Le Caravage (1571-1610) : Fils de Méduse
France Culture, Une vie, une œuvre (mars 1998)
Avec Ernest Pignon-Ernest.

Hector Obalk vous fait redécouvrir le Caravage
De l’utilisation intelligente du numérique.

L’affaire Caravage
Le 26 juin 2019, dans Charlie hebdo, Yannick Haenel racontait sa visite au cabinet Turquin et sa découverte du tableau Judith et Holopherne, dit "le Caravage de Toulouse", dont la vente publique qui était prévue le 27 juin sera finalement annulée (cf. Encore le Caravage). Un documentaire, fruit de trois ans d’enquête, retrace l’histoire de ce tableau et dévoile les coulisses du monde de l’art. Il se regarde comme un polar.
Réalisateur : Frédéric Biamonti, 2020, 86’.
Une enquête captivante sur les mystérieuses traces du chef-d’œuvre Judith décapitant Holopherne, découvert à Toulouse et attribué au Caravage.

En 2014, un tableau retrouvé dans un grenier près de Toulouse provoque une onde de choc dans le monde de l’art. Après examen, le cabinet d’expertise parisien d’Éric Turquin attribue cette Judith décapitant Holopherne à Michelangelo Merisi, dit le Caravage (1571-1610).
Réalisé en 1607, le tableau est estimé entre 120 et 150 millions d’euros. L’État français classe alors l’œuvre “trésor national” et interdit sa sortie du territoire pendant trente mois, jusqu’en novembre 2018. Mais son authentification divise les spécialistes internationaux. Si certains détails semblent porter la marque du maître du clair-obscur, d’autres éléments, tel le visage parcheminé de la servante Abra, suscitent le doute. La toile aurait-elle pu être exécutée, partiellement ou en totalité, par le peintre et marchand d’art flamand Louis Finson, qui a réalisé plusieurs copies du Caravage ? Pour mettre un terme à la controverse, Éric Turquin décide d’organiser une vente aux enchères spectaculaire à Toulouse. Coup de théâtre la veille de l’événement : la toile est cédée gré à gré à un acheteur étranger, proche d’un grand musée new-yorkais, pour un montant confidentiel…
En tentant d’analyser la fascination que suscite le Caravage, ce documentaire propose une immersion dans la vie tumultueuse du maître italien. De Paris à Naples en passant par Londres et New York, il plonge en même temps dans les arcanes du marché de l’art, entre querelles d’experts, stratégies d’acquisition des musées et enjeux financiers colossaux.
A VOIR OU A REVOIR SUR ARTE jusqu’au 23/03/2020.
Jordi Savall : Lachrimae Caravaggio (Hespèrion XXI)
Festival de Maguelone 2012

Jordi Savall - viole de gambe
Ferran Savall - voix
Philippe Pierlot - viole de gambe
Sergi Casademunt - viole de gambe
Lorenz Dufschmidt - viole de gambe
Xavier Puertas - violon
Xavier Diaz-Latorre - luth, theorbe & guitare
Perdo Estevan - percussions
Les morsures sonores du Caravage

Le chef d’orchestre, chef de chœur, violoncelliste et violiste Jordi Savall.
ANDY SOMMER/MEZZO. ZOOM : cliquer sur l’image.

A l’occasion d’un beau concert, capté dans l’Hérault en 2012, le violiste Jordi Savall propose un contrepoint musical aux toiles du peintre italien.
Par Renaud Machart
Jordi Savall joue naturellement le répertoire pour son instrument, la viole de gambe, dont il est le plus éminent interprète. Il dirige aussi des concerts symphoniques, des opéras. Mais le Catalan à la belle et noble figure, né en 1941, aime surtout créer des programmes thématiques (souvent entre Orient et Occident) et s’entourer d’une bande de musiciens complices – dont certains sont ses partenaires depuis la formation, en 1974, de l’ensemble Hesperion XXI (qui, au XXe siècle, s’appelait d’ailleurs Hesperion XX).
On notera particulièrement, au cours de cette captation d’un concert donné en 2012 dans la belle cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), lors du Festival de musique ancienne de Maguelone, la présence du génial et impassible percussionniste Pedro Esteban qui donne leur sel et leur nervure rythmique à ces musiques le plus souvent affligées, mais, parfois, enjouées.

Le programme, intitulé « Lachrymae Caravaggio, l’Europe musicale au temps de Caravage », trouve sa source dans la rencontre, il y a dix ans, de Jordi Savall et de l’écrivain Dominique Fernandez, tous deux « fascinés par l’art et la vie de ce peintre visionnaire qu’a été Michelangelo Merisi da Caravaggio », écrit Savall dans le livret d’accompagnement de l’enregistrement, paru en 2007, de ce subtil programme pour son propre label Alia Vox.
Cruautés harmoniques
Dans ce même livret, Dominique Fernandez a signé sept textes d’admiration pour ce peintre à la vie aventureuse et scandaleuse, qui « aime représenter l’acte de tuer [et] y trouve à la fois une volupté funèbre et une exaltation dionysiaque ». Chacun d’entre eux décrit autant de tableaux fameux du Caravage, tandis que sept « stations » offrent un contrepoint musical à ces toiles.

On retrouvera, dans certaines des belles musiques du début du XVIIe siècle, jouées, improvisées et chantées (par Ferran Savall, fils de Jordi) au cours de ce concert, des cruautés harmoniques et des douleurs aiguës : une « correspondance » (au sens baudelairien) aux tableaux du Caravage, dont chaque exemple, écrit Savall, « contient mystérieusement toute une vie, avec ses souffrances, ses doutes, ses moments de bonheur, d’ombre et de lumière ».

Manque, cruellement, depuis sa disparition, le 23 novembre 2011, la grande, belle et si poétique Montserrat Figueras. La chanteuse était présente dans presque tous les programmes que donnait Hesperion XXI, notamment, chaque été, au Festival de Fontfroide, près de Narbonne, dans l’abbaye de ce lieu enchanteur où, avec son époux Jordi, elle avait fondé un beau rendez-vous de musique.

Quelques mois après la disparition de « sa muse, sa compagne et sa meilleure amie », le Catalan lui rendait hommage au début de ce beau et ténébreux concert qui lui est consacré : « Elle ne mourra jamais, car, comme disait le poète, on ne meurt que quand on nous oublie. C’est pourquoi les larmes, dont toutes ces musiques parlent, ne sont pas seulement des larmes de tristesse, mais aussi des larmes de joie pour toutes les années qu’elle a été avec nous. »
« Lachrymae Caravaggio, l’Europe musicale au temps de Caravage » (œuvres de John Dowland, Orlando Gibbons, William Brade, Antonio Cabezón…) par Ferran Savall (voix), Hesperion XXI, Jordi Savall (viole et direction). (France, 2012, 82 min).
Renaud Machart, Le Monde.
Caravage sous le regard de Savall et Fernandez
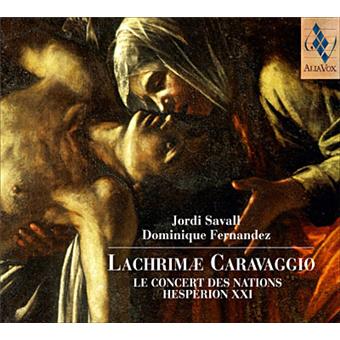 JORDI SAVALL, inspiré par l’oeuvre de Michelangelo Merisi, dit le Caravage, a improvisé, entouré de ses musiciens du Concert des Nations, d’Hespèrion XXI, et de son fils, le chanteur Ferran Savall, plusieurs stances musicales intitulées Lachrimae Caravaggio. Le CD est accompagné d’un livret commenté par Dominique Fernandez, qui comporte un choix de sept toiles du peintre. Histoire et explication d’une correspondance esthétique.
JORDI SAVALL, inspiré par l’oeuvre de Michelangelo Merisi, dit le Caravage, a improvisé, entouré de ses musiciens du Concert des Nations, d’Hespèrion XXI, et de son fils, le chanteur Ferran Savall, plusieurs stances musicales intitulées Lachrimae Caravaggio. Le CD est accompagné d’un livret commenté par Dominique Fernandez, qui comporte un choix de sept toiles du peintre. Histoire et explication d’une correspondance esthétique.
Par JEAN-LOUIS VALIDIRE
Le Figaro. Publié le 7 avril 2007 à 06:00, mis à jour le 15 octobre 2007 à 02:05
LE FIGARO. - Pourquoi précisément ces sept tableaux ?
Dominique FERNANDEZ. - Il y a deux Caravage, celui de la jeunesse, plus frais, et puis celui qui tombe dans la violence, la cruauté, la douleur. J’ai choisi les tableaux de la seconde partie, plus dramatiques. À travers les motifs religieux, il exprime des souffrances humaines.
Jordi SAVALL. - J’ai essayé de choisir une mélodie qui rende compte de la description des martyrs et de cette tendresse qu’il porte sur les êtres humbles, comme dans un film dont le thème serait le Caravage. Ensuite, je décline toutes les improvisations. La lecture du texte a aidé à construire la forme du projet autour de sept tableaux, car le chiffre sept a un caractère symbolique. À l’instar des Sept dernières paroles du Christ sur la Croix, le projet, c’est pour moi les sept dernières paroles de Caravage. C’est comme si j’étais entré dans cette peinture musicale.
D. F. - Quand j’ai écouté pour la première fois la bande musicale, je me suis dit que c’était dommage qu’il n’y ait pas de voix. La peinture du Caravage c’est aussi une sorte de cri.
Autant le commentaire installe le peintre dans son actualité, autant la musique l’accompagne dans son siècle. Est-ce que ce décalage est voulu ?
J. S. - Si vous écoutez bien, la musique parle de l’époque, comme le texte explique les symboles. La musique est aussi totalement d’aujourd’hui dans le traitement des dissonances, les mélodies sont traitées avec une totale liberté. Pourquoi renoncer lorsque l’on fait un portrait musical d’un peintre du XVIIe siècle aux éléments de l’époque qui le caractérisent ? Mais il faut en même temps le situer dans notre temps. La modernité n’est pas déterminée par le moment où l’objet a été conçu. Notre-Dame de Paris est ancienne, mais elle fait aussi partie du Paris d’aujourd’hui.
Quelle place occupe Caravage dans l’histoire de la peinture ?
D. F. - C’est une révolution. C’est l’introduction du vérisme. Toute la peinture de la Renaissance idéalise. Raphaël et même Michel-Ange dessinent des êtres parfaitement intemporels, éthérés, à la limite qui ne sont pas des êtres humains. Caravage prend ses modèles dans la rue, et particulièrement les mauvais garçons, les prostituées, et il les peint tels quels, sans les idéaliser ni les transfigurer. Sa Vierge, c’est une prostituée enceinte qui s’était suicidée et que l’on a retrouvée dans le Tibre. Elle était donc à trois titres pécheresse. Il prenait les gens le plus en dehors de la société et les mauvais garçons, il ressemble à un modèle de Pasolini. C’est lui qui introduit le clair-obscur, l’éclairage indirect qui tombe sur une partie du tableau, et qui sera repris par Rembrandt, La Tour et tout le monde. Avant, il y avait une lumière intemporelle, dont on ne sait d’où elle vient, comme dans les tableaux de Raphaël. Il y a ensuite cette double lecture. Les sujets sont religieux parce que c’est l’Église qui commande les oeuvres. Mais à travers, il raconte une histoire de violence et de passion. C’est très autobiographique, c’est d’ailleurs pour cela que j’ai pu écrire mon roman, La Course vers l’abîme.
J. S. - Il y a un autre parallèle avec la musique. Caravage, c’est une découverte des années 1950, comme la musique ancienne. Ce sont deux mondes qui se situent dans le même contexte. Avant 1950, qui connaissait Machaut, Monteverdi ? Cela m’a fasciné de mettre ensemble musique, littérature et peinture pour actualiser cette période. L’époque du Caravage était révolutionnaire et, à un moment, on ne l’a pas compris. Stendhal n’avait rien compris à la musique baroque.
D. F. - Il n’avait pas plus compris Caravage. Il le cite une fois pour dire « ce scélérat de Caravage ». Ce n’est pas sa faute, mais celle de l’époque... Il faudrait d’ailleurs s’interroger sur le double retour de la musique baroque et de la peinture du Caravage.
Est-ce que vous entendez de la musique lorsque vous regardez un tableau ?
D. F. - Oui. Dans les Caravage, en plus, on trouve beaucoup de musiciens, le Joueur de luth ou Les Musiciens qui est à New York, où quatre jeunes gens jouent. Dans La Fuite en Égypte, il y a un ange qui joue du violon et quatre jeunes gens qui jouent.
J. S. - Dans la musique, il y a quelque chose de très proche de la peinture. Les instruments graves sont pleins de couleurs sombres, le chant est ambré ; le violon, c’est l’éclat et la lumière éblouissante. J’ai été très à l’aise pour me plonger dans cette époque, car le son de la viole de gambe nous envoie directement dans les ténèbres.
Lachrimae Caravaggio, 1 CD Alia Vox, 20 eur.
Jordi Savall au tableau
par Bertrand Dermoncourt, publié dans L’Express le 04/04/2007.
Tout commence en 2005, à Barcelone, lors de la grande rétrospective Caravage au musée des Beaux-Arts de Catalogne. Savall y avait donné une série de concerts, illustrant le parcours de l’artiste (1571-1610) à l’aide de compositions de son temps, signées Monteverdi ou Gesualdo. Fort de cette expérience, il a voulu aller plus loin, en écrivant une musique qui rende compte des impressions ressenties face aux toiles du Caravage. "Son oeuvre est d’une grande modernité et témoigne d’une époque en pleine crise spirituelle. Comme la nôtre", souligne Jordi Savall.
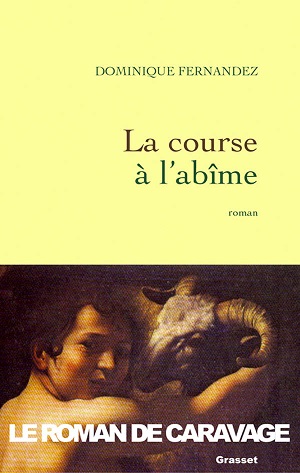 Pour élaborer son projet, Savall s’est imprégné du roman La Course à l’abîme, que Dominique Fernandez a écrit à partir des tableaux et de la biographie du Caravage. Il était donc naturel qu’il lui propose de participer à l’élaboration du disque. Dominique Fernandez a retenu sept tableaux du maître, qu’il présente et commente dans le très riche livret du CD. Pour L’Express, les deux complices reviennent, exemples à l’appui, sur ce travail original.
Pour élaborer son projet, Savall s’est imprégné du roman La Course à l’abîme, que Dominique Fernandez a écrit à partir des tableaux et de la biographie du Caravage. Il était donc naturel qu’il lui propose de participer à l’élaboration du disque. Dominique Fernandez a retenu sept tableaux du maître, qu’il présente et commente dans le très riche livret du CD. Pour L’Express, les deux complices reviennent, exemples à l’appui, sur ce travail original.
Parmi les sept tableaux du Caravage retenus par Dominique Fernandez, il y a Le sacrifice d’Isaac, Martyre de Saint-Matthieu, Dans la main de l’ange,
la Déposition de croix —
Dominique FERNANDEZ : De ce tableau se dégagent une émotion intense et, en même temps, un pathos retenu. Il faut bien en observer la construction, qui s’apparente à une pyramide instable. Cette composition répond au goût baroque d’alors de la dissymétrie et de l’équilibre précaire. Ce n’est pas un hasard si notre époque, à la recherche de certitudes, se reconnaît dans l’art du Caravage. A l’idéalisation d’un Raphaël et des peintres de la Renaissance, on préfère le vertige et les doutes de l’art baroque.
Jordi SAVALL : Dans ce disque, j’ai cherché à restituer la violence très directe qui se dégage de ces peintures. Vers 1600, certains musiciens n’hésitaient pas à utiliser la dissonance afin de choquer l’auditeur. Je ne me suis pas privé de ces effets. J’ai également emprunté certaines techniques à des compositeurs d’aujourd’hui, comme Arvo Pärt. En juxtaposant des morceaux lents et denses à d’autres plus légers, en mélangeant les influences populaires et savantes, j’ai voulu retrouver ces équilibres instables dont parle Dominique Fernandez.
la Décollation de saint Jean-Baptiste
Dominique FERNANDEZ : C’est le plus grand tableau peint par le Caravage : 3,60 sur 5,20 mètres. Il représente la mise à mort de saint Jean-Baptiste. Pour un esprit non prévenu, la scène figure plutôt un crime crapuleux, tel qu’il peut se produire à n’importe quel coin de rue, plutôt qu’un épisode de l’histoire sainte. Comme souvent, le Caravage figure un monde cruel, où la grâce n’existe pas. Symboliquement, les deux tiers du tableau sont envahis par l’obscurité ; seul le meurtre est projeté dans la lumière, avec ce rouge profond qui jaillit de la gorge de l’agonisant. C’est avec ce sang que le peintre a signé son oeuvre, la seule signature qu’il ait apposée à l’un de ses tableaux.
Jordi SAVALL : Le Caravage utilise de forts contrastes de couleurs. En enregistrant le disque, je disposais, moi aussi, d’une large palette instrumentale, du simple violon au grand orchestre de 40 musiciens, de l’improvisation intimiste à la monumentale fanfare funèbre. Pour garder une cohérence à l’ensemble, et pour atteindre la même unité que le Caravage, des thèmes reviennent, obsédants, tout au long du disque.
David et Goliath
Dominique FERNANDEZ : Miracle de l’art italien : les scènes les plus crues sont toujours belles. Sur le thème rebattu de David et Goliath, le Caravage invente autre chose, avec ce David accablé par l’acte qu’il vient de commettre. Le jeu d’ombre et de lumière est porté à un point dramatique inégalé. Le fameux "clair-obscur’’ est devenu une éclaboussure de lumière dans un gouffre de ténèbres.
Jordi SAVALL : Le défi musical le plus délicat de ce projet était de trouver un équivalent sonore à ces textures sombres. J’ai donc particulièrement développé les sonorités graves, avec une basse en ostinato [répétition d’une ligne mélodique], qui passe d’un morceau à un autre, comme le noir envahissant l’espace. Sur quatre titres, mon fils Ferran improvise, en chantant. Je crois que l’on y ressent le déchirement intérieur, l’humanité bouleversante de ce David et Goliath, impossible à exprimer en paroles. Avec ce disque, j’ai cherché à me laisser envahir par l’univers poétique du Caravage. J’espère être parvenu à rendre compte d’une expérience intime, de cet espace imaginaire né de la confrontation avec ces peintures.
[1] Ecouter Narcisse, de Caravage avec le psychanalyste Gérard Wajcman et l’artiste Rebecca Digne.
[2] Henric évoque seulement en quelques lignes, d’ailleurs très belles, Le Caravage et Saint Matthieu et l’Ange qu’il a vu à l’église Saint-Louis-des-Français de Rome (Grasset/Figures, 1983, p.236-237)
[3] Cf. Musée des Beaux-Arts de Caen.
[4] Cf. Ernest Pignon-Ernest à Naples.



 Parution le 21 février
Parution le 21 février
 Version imprimable
Version imprimable



 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



23 Messages
Une étude technique et scientifique « approfondie » devra déterminer si une attribution au Caravage, maître italien du clair-obscur, est possible. « Par mesure de précaution », le tableau ne pourra pas quitter l’Espagne.
Il devait être mis à prix pour 1 500 euros. Le gouvernement espagnol a bloqué ce jeudi 8 avril, à quelques heures des enchères, la vente d’un tableau, pensant qu’il pouvait être du Caravage, le maître italien du clair-obscur.
Cette huile sur toile, appelée « le Couronnement d’épines » et considérée jusqu’alors comme l’œuvre d’un peintre issu de l’école de José de Ribera, a été déclarée « inexportable » et ne pourra pas sortir d’Espagne, « par mesure de précaution », ont indiqué à l’AFP des sources gouvernementales. LIRE ICI.
Le 26 juin 2019, Yannick Haenel racontait sa visite au cabinet Turquin et sa découverte du tableau Judith et Holopherne, dit "le Caravage de Toulouse", dont la vente publique qui était prévue le 27 juin sera finalement annulée (cf. Encore le Caravage). Un documentaire de Frédéric Biamonti nous dévoile les coulisses du monde de l’art. Il se regarde comme un polar. VOIR ICI.
Lu dans le Guardian :
« Un chef-d’œuvre du Caravage volé dans une église de Palerme il y a 50 ans et classé parmi les œuvres "les plus recherchées" par le FBI, a été conservé dans la maison d’un puissant chef mafieux, qui a découpé un morceau de la toile afin de convaincre l’église catholique de conclure un accord pour sa restitution, selon le témoignage inédit du prêtre qui a tenté de le récupérer. » (The Guardian)
La Nativité avec saint Laurent et saint François.
ZOOM : cliquer sur l’image.
Voici une note rédigée par Stephane Massonet sur le Caravage de Yannick Haenel. Elle vient de paraître dans la revue Europe n°1085-1086 Septembre-octobre 2019,
Yannick HAENEL : La solitude Caravage (Fayard, 20 Euro).
Nous savons qu’une jeune femme étrusque lui offrit un jour une reproduction d’un tableau de Cy Twombly qu’il accrocha au-dessus de sa table de travail. Naissance de Vénus : cette grande boule de feu l’intrigue, l’illumine, le nourrit. Elle guide d’un œil bienveillant son écriture. La rencontre avec la déesse était inévitable. Elle devait avoir lieu dans le tableau d’un peintre qui peuple ses toiles avec les paroles de poètes comme Valéry, Mallarmé, Catulle ou encore Octavio Paz, car pour Yannick Haenel, l’illumination naît de la peinture, alors que son œuvre nous invite à de longues promenades à travers les musées où l’on découvre comment la couleur traverse son écriture lumineuse. Cette écriture réalise la vision de Rimbaud, à savoir que mots et lettres sont des couleurs qui irradient comme des ondes à travers la page. Entre le don de cette femme énigmatique et le trait enflammé de Twombly se confirme le thème méditerranéen qui traverse l’œuvre de Yannick Haenel. Sa quête de l’Italie se place sous le signe de l’illumination et de la peinture du Quattrocento. Mais l’Italie est également le lieu où l’écrivain relit tout Bataille et reste saisi par la dépense et l’ouverture de cette pensée sur l’impossible et le sacrifice. Une telle lecture dans le pays de la lumière devait nécessairement le conduire sur les traces du Caravage, à la rencontre de cette peinture noire et solitaire de la Contre-Réforme, traversée par les thèmes de l’ivresse et du désir. Ici, c’est une déesse nocturne que nous nous apprêtons à rencontrer. Ainsi, Yannick Haenel progresse parmi les tableaux du Caravage à la recherche de « la vérité qui s’allume dès qu’un homme comme lui avance son pinceau vers une toile ». C’est l’étincelle de la création qu’il cherche. Pour la trouver, il faut avancer à travers le noir de la toile, trancher au travers de sa nuit la plus sombre afin de compter les longues heures de solitude passées devant un bout de lin tendu sur un châssis en bois, couteau à la main, tentant de montrer ce que personne d’autre n’avait jamais vu jusqu’alors, car si Caravage aime l’ombre, il semble lui préférer la lame tranchante. Seule manière de découper des « formes qui se disputent les ténèbres et la lumière ». Face à ce peintre maudit, l’auteur constate que Bataille n’a jamais rien écrit sur lui. Yannick Haenel soupçonne pourtant une parenté secrète entre les deux hommes, parenté qui passe par Goya et Francis Bacon qui saisissent dans l’image le nerf de la violence, de la bouche ouverte ou du cri déchiré. Alors que tout dans la solitude de Caravage nous ramène dans les parages de la mort et du sacré, l’auteur ne peut qu’imaginer entre Bataille et le peintre une rencontre dont ce livre voudrait être « l’impossible document ».
Bien plus qu’une étude sur la peinture du Caravage, le livre de Yannick Haenel est un roman d’apprentissage qui mêle la découverte de la peinture à la recherche du désir dans laquelle viennent se confondre différentes femmes. Cette quête commença il y a bien longtemps, lorsque l’écrivain avait quinze ans. Dans la bibliothèque d’une école militaire, il feuillette un livre sur la peinture italienne dans lequel il découvre l’image d’une femme. D’emblée, il reconnait celle-ci comme l’objet de son désir. Tout en cette image atteint le vertige de la perfection : le regard sévère, les bras tendus et cette grande gorge qui ressort « comme une apparition qui déchire la nuit ». L’écrivain est foudroyé. Il s’agit de Judith décapitant Holopherne, un tableau du Caravage qui se trouve au Palais Barberini à Rome. Quinze ans plus tard, lors d’un voyage à Rome où il est accompagné par une femme « au visage d’ange » qui ressemble à la Dame à la Licorne sur laquelle il écrit son premier texte sur l’art, voici qu’il découvre que cette image vue dans un livre n’était qu’un détail. Le tableau du Caravage lui révèle une tout autre scène, brutale et sanglante, dans laquelle l’amante, tel une mante religieuse, est devenue une tueuse. La violence de cette toile le bouleverse. L’écrivain passe de l’illumination à l’humiliation, se froissant avec la femme au visage d’ange qui l’accompagne, et découvrant que cette fois-ci, c’est probablement lui qui perd la tête, ou du moins que cette décapitation sanglante met en jeu son propre aveuglement face à l’objet de son désir. A partir de ce moment, commence une quête frénétique à travers les livres et les musées, à la découverte de ce peintre obscur dont Yannick Haenel veut saisir l’expérience intérieure qui est moins un état qu’une ouverture dans la toile, un point vibratoire où l’on commence à voir ce que le peintre a vu, où comme lui nous entrons en dialogue avec la mort. C’est ainsi que les couleurs du désir et de la mort se mélangent sur sa palette comme le rouge et le noir. Ils exigent que nous nous rendions disponible à ce fond noir de la toile. De fait, en poursuivant ce visage de Judith, Yannick Haenel la retrouve dans d’autres toiles, comme la Sainte Catherine d’Alexandrie, une décapitée qui sera la sœur chrétienne de Judith. Enfin, lorsque son identité est dévoilée, nous apprenons que l’homme dont le Caravage prit la vie au cours d’un duel était le proxénète de la belle Judith. Par ce meurtre, le peintre devient un hors-la-loi qui doit habiter « l’éclat sombre » de cette lutte entre la lumière et les ténèbres.
C’est donc un Caravage sombre et enivré, aux prises avec le sacré que nous donne à lire Haenel. Afin de suivre ce trajet, il faut lire les pages consacrées à La corbeille dans lesquelles on découvre la clé de ce sacré pictural. Après avoir plongé dans le côté noir de cette peinture, apparaît un sacré qui est une face illuminée par l’abîme et ouverte sur une possibilité gratuite qui « se manifeste depuis l’éclaircie que provoque la foudre ». Ici, nous nous logeons dans un lieu du tableau où le clair et l’obscur se rencontrent, où s’impose une beauté qui prend forme d’apocalypse, une beauté qui tout à la fois sauve et détruit. Elle ouvre la peinture du Caravage vers des représentations plus complexes où le sacré devient pictural avant de nous introduire dans le domaine du sacrifice par la nervure de l’érotisme. En suivant le visage de cette femme tant désirée à travers différentes toiles, Yannick Haenel trace un parcours dans lequel l’auteur découvre « sa » chance, celle d’avoir reconnue la déesse, de trouver que derrière ce visage se cache non pas un crime, mais une nouvelle naissance, celle d’une femme qui traverse le miroir pour tuer le monstre qui entrave sa liberté, car tuer le montre nous place au cœur de l’initiation. Ces pages racontent donc un voyage intérieur au cœur du sacré, un voyage traversé par la couleur du feu. Si tant d’efforts ont été déployés dans le passé pour nous faire oublier le Caravage, pour occulter sa peinture, voici donc que Yannick Haenel dresse les éléments d’une contre-mythologie. Contre l’oubli, c’est la solitude la plus noire qui donne naissance à cette œuvre, alors que le peintre semble trouver en ce lieu la flamme qui vient éclairer la toile de son feu intérieur.
Stéphane MASSONET
smasson80@yahoo.com
Le temps des écrivains, par Christophe Ono-dit-Biot, mars/août 2019.
Nos invités sont deux grands fascinés. Par Virgile, pour Frédéric Boyer, qui publie une nouvelle traduction, chez Gallimard, d’un texte iconique de l’Antiquité, « Les Géorgiques » de Virgile, sous le titre « Le Souci de la terre ». Face à lui, Yannick Haenel, fasciné, lui, par le peintre Caravage, et qui publie, chez Fayard, « La Solitude Caravage », un texte sur sa découverte, assez romanesque, hautement sensuelle, de la peinture du génie, à la bibliothèque du Prytanée de La Flèche, alors qu’il était adolescent. Ce fut comme une apparition…
Crédit : France Culture
C’est ce que nous raconte Yannick Haenel dans sa dernière chronique de Charlie.
Charlie Hebdo, 17 juillet 2019.
ZOOM : cliquer sur l’image.
En direct des grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture, Mathilde Serrell est aujourd’hui en 1598, à Rome, où le peintre et voyou Le Caravage surclasse ses rivaux avec sa représentation de « Judith et Holopherne ».
Caravage, Judith décapitant Holopherne, 1600.
Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.
Bagarres de rues, nuits de défonces, rivalités en tous genre : c’est la « thuglife » à Rome, et un des caïds s’appelle Michelangelo Merisi Da Caravaggio, aussi connu sous le nom de « Caravage ».
Ce peintre au service du Cardinal Del Monte vient de « tuer le game » avec sa version de Judith décapitant Holopherne. Le sujet est classique : une scène de l’Ancien Testament où la veuve Judith séduit le général assyrien Holopherne, puis lui coupe la tête dans son sommeil pour délivrer son peuple. Sauf que la représentation qu’en donne ce Caravaggio n’a rien de classique : c’est à la fois gore et sexy.
Une lumière violente traverse la toile, l’hémoglobine gicle à gros jets, et Judith est prise sur le vif en train de décapiter Holopherne. Le visage de l’héroïne meurtrière est mi-étonné, mi-dégouté, tandis que sa poitrine se gonfle d’excitation sous son corsage blanc transparent. À côté d’elle, une affreuse servante fripée se tient prête à recueillir la tête du tyran dans un sac.
Avec Yannick Haenel, écrivain français et chroniqueur, auteur de La Solitude Caravage (Fayard, 2019) :
France Culture
Dans sa dernière chronique de Charlie hebdo, Yannick Haenel revient sur le fameux Caravage découvert à Toulouse (voir ici) dont on apprenait hier qu’il avait été mystérieusement vendu avant même la mise aux enchères prévue pour ce jeudi 27 juin.
Charlie Hebdo, 26 juin 2019.
ZOOM : cliquer sur l’image.
Qui est le mystérieux acheteur du tableau du Caravage ?
Deux jours avant la vente aux enchères de « Judith et Holopherne », un acheteur anonyme s’est porté acquéreur de la fameuse peinture. Son identité intrigue.
Par André Trentin
Le tableau attribué au Caravage, Judith décapitant le général Holopherne découvert dans un grenier toulousain, a été vendu aujourd’hui de gré à gré. La vente aux enchères prévue le jeudi 27 juin à la Halle aux grains de Toulouse est donc annulée. Voilà pourtant des semaines qu’Éric Turquin, expert parisien en tableaux anciens, et Marc Labarbe, le commissaire priseur de Toulouse, faisaient monter la pression autour de cette vente hors du commun d’une œuvre dont ils estimaient la valeur à 100-120 millions d’euros. Les deux mille curieux qui étaient attendus pour l’événement en seront pour leurs frais. La nouvelle divulguée par communiqué ne donne ni le prix de vente ni le nom du destinaire du tableau sauf, précision importante, qu’il sera exposé dans un musée à l’étranger grâce à la générosité d’un acheteur privé aujourd’hui anonyme. S’ils sont logiques, les deux organisateurs de la vente ont dû obtenir un prix proche de ce qu’ils désiraient pour leurs clients, qui restent toujours anonymes. Pour la vente prévue le 27, la mise à prix était de 30 millions. On doit être sûrement bien au-dessus.
Ce qui est certain, c’est que très peu de temps avant la vente publique, Turquin comme Labarbe étaient sûrs d’avoir un acheteur. « J’en avais déjà un en 2015 », nous a confié Turquin avant que le Louvre ne déclare la toile « trésor national », ce qui a empêché toute vente en dehors de la France pour une durée de trente mois. Ces jours-ci, les deux hommes ont bien vu s’afficher les candidats à un achat, car pour participer à leurs enchères, il fallait présenter une lettre de banque ou réaliser un dépôt de cinq millions d’euros.
Turquin et Labarbe ont toujours pensé que « leur » Judith et Holopherne, œuvre puissante, violente et dramatique, avait plus sa place dans un musée que dans le salon d’un particulier. Ils ne se sont donc pas trompés si l’on s’en tient à la seule information sur la vente qu’ils ont laissé filtrer. Avant le non-événement du 27 juin, en les poussant dans leurs retranchements, on parvenait presque à leur faire dire que le tableau de Toulouse partirait pour les États-Unis… Keith Christiansen, qui s’occupe des tableaux anciens du Metropolitan Museum, n’a jamais caché que pour lui le tableau de Toulouse était un Caravage. Pour les deux hommes, l’Asie, en fait Hong Kong, qui ne possède aucun Caravage, pouvait se montrer intéressée. Il excluait a priori les pays du Golfe, où les tensions militaires ne cessent de grimper, qui ont la tête ailleurs.
Toujours est-il qu’ils ont rondement mené leur affaire. Ils ont fait voyager le tableau à Milan (novembre 2016-février 2017), à New York (mars), à Londres (mai). Il a été exposé récemment à Paris, dans la galerie Kamel Mennour, et à Drouot, enfin dans l’hôtel des ventes de Marc Labarbe à Toulouse, place Saint-Aubin. En plus de ces opérations, des annonces ont été placées dans toutes les revues spécialisées, visant en particulier les États-Unis, l’Asie et le Golfe. Les réseaux sociaux ont été utilisés à fond avec une palme spéciale pour Instagram. L’agence Bronx, sous le contrôle tatillon de Turquin et Labarbe, a conçu un site attrayant, thetoulousecaravaggio. « Nous n’avons pas de doute, dit Turquin, aucun des acheteurs potentiels dans le monde n’ignore la vente du 27 juin. On aurait pu la faire à Aurillac, ç’aurait été pareil. » Selon lui, partout, les réactions ont été positives sauf dans deux pays, la France, avec la passivité totale du Louvre, et l’Italie, en proie à des querelles entre caravagistes.
Les trente mois durant lesquels le tableau a été bloqué en France n’ont pas été perdus. Il a été nettoyé, radiographié, expertisé par des célébrités mondiales… Pour être prêt le jour « J », bien d’autres dépenses ont été engagées. Il a fallu payer une chambre forte à Paris, des assurances, les transports, des services de sécurité… Entre 2 et 3 millions d’euros auraient ainsi été dépensés, qui normalement sont à la charge des propriétaires. Les propriétaires devront aussi acquitter un impôt de 6,5 % qui correspond à une taxe forfaitaire sur les plus-values. Forfaitaire, car nul ne connaît le prix d’une précédente acquisition. Avant que le tableau réapparaisse miraculeusement en mars 2014 à Toulouse, il faut remonter à Anvers en 1689 – et encore, ce n’est pas complètement certain – pour trouver sa dernière trace. À cela s’ajoutent les commissions du cabinet Turquin, l’expert en tableaux (en moyenne 5 %, mais ce pourrait être moins), et celles du commissaire priseur (là, c’est top secret), Marc Labarbe, le tout chapeauté par une TVA à 20 %. Un pourboire, car le tableau semble avoir atteint le prix espéré par les vendeurs.
Le Point, 25 juin 2019
« L’évènement le plus décisif, aujourd’hui, c’est la possibilité, dans une vie, de l’expérience poétique. Comment accéder à la poésie ? Aucune autre question n’a d’importance. » C’est ce qu’écrit Yannick Haenel. Alors, bien sûr, nous l’aborderons avec lui cette question. L’écrivain français partagera aussi avec nous son amour pour les peintures du Caravage. Et au passage, il nous emmènera vers notre pays spirituel. Yannick Haenel signe « La solitude Caravage » (Fayard) et « Tout est accompli » avec François Meyronnis et Valentin Retz (Grasset).
Et dieu dans tout ça ? rtbf, 12 mai 2019.
crédit : rtbf
Entretien animé par Josyane Savigneau autour de :
- "La solitude Caravage" de Y. Haenel.
- Et : "Tout est accompli » publié le 4 mai 2019, un essai à trois voix mais un seul texte (Y Haenel, F. Meyronis, V. Retz), tous trois Mousquetaires de la revue Ligne de risque.
"La Solitude Caravage" de Yannick Haenel remporte le Prix Méditerranée Essai !
"Les réponses de Yannick Haenel sont à l’image de son livre, belles, précises et fébriles" Télérama
"C’est aussi beau que passionnant" France Inter
"C’est un tour de force : ces toiles si connues, si commentées et qui ont quatre siècles se posent devant nos yeux comme si c’était la première fois." Diacritik
"Un excellent romancier [...] Il parle de la peinture avec beaucoup de sensibilité" Radio-Classique
"Avec « La Solitude Caravage », l’écrivain livre une belle variation sur la vie de l’artiste, d’où sa subjectivité et ses préoccupations ne sont jamais absentes." Le Monde
Le palmarès des autres prix Méditerranée 2019
Jérôme Ferrari, Photo DR/ACTES SUD
Parrainés notamment par la ville de Perpignan, ces prix récompensent cinq écrivains dans les catégories roman français, roman étranger, premier roman, essai et poésie.
Présidé par l’académicienne Dominique Bona, le jury des 34e prix Mediterranée a remis, mercredi 17 avril, ses distinctions littéraires :
ROMAN FRANÇAIS
Jérôme Ferrari a été récompensé pour son dernier roman A son image (Actes Sud)
ROMAN ETRANGER
Marco Balzano a reçu le prix du meilleur roman étranger pour Je reste ici traduit par Nathalie Bauer (Philippe Rey). Ces deux catégories sont dotées de 2000 euros chacune.
PREMIER ROMAN
Dans la catégorie premier roman, la lauréate est Leila Bahsaïn pour Le ciel sous nos pas (Albin Michel).
ESSAI
En parallèle, Yannick Haenel a été recompensé pour son essai La solitude Caravage, paru le 20 février chez Fayard et devenu un phénomène des ventes avec près de 7500 exemplaires vendus (source GFK).
POESIE
Enfin, dans la catégorie poésie,Valérie Rouzeaua été distinguée pour son recueil Sens Averse (répétitions), publié chez La Table Ronde.
Le jury des Prix Méditerranée compte parmi ses membres Jean-Christophe Rufin, Amin Maalouf, Danièle Sallenave et Patrick Poivre d’Arvor. Ces récompenses littéraires sont parrainées par la ville de Perpignan, le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, la région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées et la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon. Fondé en 1985 à Perpignan par le Centre méditerranéen de littérature, le prix Méditerranée « a pour ambition de valoriser l’espace culturel entre les différents pays dont la Méditerranée est le creuset, et de reconstruire le récit épique des diversités fondatrices de son identité ».
L’an dernier, Kamel Daoud avait reçu le prix Méditerranée pour Zabor ou les psaumes (Actes Sud). Le prix Méditerranée étranger était revenu à l’écrivain américain Daniel Mendelsohn pour Une odyssée : un père, un fils, une épopée traduit de l’anglais par Clotilde Meyer et Isabelle D. Taudière et publié chez Flammarion
Crédit : www.livreshebdo.fr/
Arnaud Wassmer reçoit l’écrivain Yannick Haenel pour un livre dans lequel il raconte le Caravage, peintre d’un tableau biblique qui a provoqué un coup de foudre.
RCF, Regards, lundi 8 avril.
« La peinture est par nature aphrodisiaque »
Yannick Haenel est décidément un des écrivains les plus importants de notre époque. Avec La Solitude Caravage, il prouve une nouvelle fois son talent, de poète à décrire les tableaux du Milanais, et son talent à penser l’art.
Par Vincent Jaury
Un grand livre est un geste d’amour. Proust, aussi pessimiste qu’il pouvait l’être, n’aurait jamais pu écrire sa Recherche s’il n’était animé par une sincère affection pour ses personnages, pour ce petit monde honni et si merveilleux, grotesque et si séduisant.
Yannick Haenel est de cette famille d’écrivains. Depuis des décennies, livre après livre, il rumine, au bon sens du terme nietzschéen. Le corps des femmes, le sacré, le lieu de la littérature, l’ivresse, passent à travers sa rumination joyeuse. Une joie réelle, c’est-à-dire traversée par la mort. Une joie comprise, digérée, assurée de sa souveraineté : une joie réelle, parce que donnant accès à la pensée du malheur. Le contraire du mauvais ruminant qui digère mal son malheur et qui finit ressentimental.
Ce n’est donc pas un hasard si Haenel a choisi Caravage comme objet d’étude, objet de passion, objet d’amour, pour son dernier livre. S’il montre de son écriture poétique que Caravage met fin à la Renaissance, tant son oeuvre est habitée de souffrance, d’effroi, de sang, de craintes, de froncements de sourcils, de gestes atroces, bref abritant un grand malheur dont le noir de ses tableaux témoigne, Haenel perçoit dès qu’il le peut, les éclaircies qui en émanent. Bacchus est de ce côté-là, du côté de l’incandescence. Oui, il y a chez Caravage, comme chez Haenel, une alliance du Christ et du dionysiaque, du supplicié et de la grande santé, du sacrifié et de la vitalité.
La joie qu’a éprouvée Haenel à rencontrer Caravage, à le côtoyer de près, de nombreuses années, le dialogue qui s’est installé entre ces deux artistes, ce coup de foudre amical nous est transmis à nous lecteurs : le gai savoir a triomphé. Que demander de plus à un livre ?
ENTRETIEN
Il y a une peinture matricielle qui fonde l’énergie de ce livre, c’est le Judith décapitant Holopherne de Caravage. Pouvez-vous nous dire un mot de l’importance que ce tableau a eu dans votre vie ?
C’est simple : j’ai cristallisé sur la figure de Judith. J’avais quinze ans. J’étais pensionnaire au Prytanée militaire de La Flèche. Je souffrais, je me demandais ce que je foutais là. À la bibliothèque, j’ouvre un volume de peinture italienne. Je tombe sur un portrait, en noir et blanc, d’une femme aux boucles claires et aux sourcils froncés ; elle a une perle à l’oreille, surmontée d’un ruban noir en forme de papillon. Son corsage est lui aussi froncé, très serré sur une poitrine qu’on devine lourde. C’est le coup de foudre. Je rencontre à quinze ans l’objet de mon désir. J’arrache la petite image du livre, je la garde sur moi, elle va peupler mes nuits, mes fantasmes. Quinze ans plus tard, j’ai trente ans, je découvre le tableau en entier, à Rome, je comprends que cette femme aux sourcils froncés est en train de découper la tête d’un homme. Le désir et la mort se rejoignent, la peinture me révèle les secrets de l’existence. Je plonge dans l’oeuvre de Caravage, je ne vais plus cesser d’y voir à la fois un abîme de pensée et un volcan aphrodisiaque.
Ce n’est pas une biographie au sens classique du terme, car pour vous les faits ont un statut mineur. Pourquoi minorez-vous les faits dans l’explication de la vie d’un artiste et de son oeuvre ?
Je raconte quand même la vie de Caravage, et toutes ses aventures en détail. En gros, on trouve dans mon livre tout ce qui est trouvable dans les archives. Mais ce qui m’intéresse, c’est l’expérience intérieure du peintre, ce qui a lieu dans la solitude de l’atelier, le face-à-face avec sa nuit intérieure. On a beaucoup trop réduit Caravage au folklore de l’artiste maudit, on bavarde sur sa violence sans essayer de la penser. C’était un homme ténébreux, véhément, irascible, belliqueux, sa vie a été passionnément débridée, mais je crois que l’extrême violence qui le traverse jusqu’au crime lui ouvre les yeux, elle lui permet de faire l’expérience de la prédation humaine fondamentale, et de peindre ce qu’il peint, et qui est inouï : le monde dominé par les bourreaux, la mise à mort qui affecte tous les corps. Comme plus tard Van Gogh ou Bacon, c’est un peintre en guerre.
Que trouve-t-on selon vous chez Caravage que nous ne trouvons pas chez les autres peintres ?
D’abord, des corps non idéalisés. Regardez la différence entre Michel-Ange et Caravage, c’est sidérant : chez Caravage, les corps sont sexuels. Quand Jean-Baptiste est peint nu, il a vraiment un sexe. Ensuite, il y a le peuple, les pèlerins, les prostituées, les mauvais garçons : ils ne sont pas dans le décor, ils sont vraiment là. Enfin, chez lui plus que chez aucun autre, il y a une crudité tragique sur le sort de l’espèce. Dans les tableaux profanes, la séduction, la maladie, le désir érotique, la tricherie sont peints avec une précision douloureuse ; dans les tableaux sacrés, il y a une qualité de présence dont la limpidité vous serre le coeur : regardez les torses du Christ, et le déchaînement de sadisme autour de lui, on est loin des scènes statiques de la Renaissance. Regardez la Madeleine pénitente : cette larme qui coule sur sa joue est celle de votre amoureuse, on voudrait la boire. Caravage m’a fait aimer passionnément les Évangiles. Chez lui, le sacré est cru, parfois sale, violent, absolu.
Vous avez beaucoup lu sur Caravage. Avez-vous l’impression d’avoir ouvert de nouvelles pistes de lectures ?
Je ne suis pas historien d’art. Il y a des livres passionnants et novateurs sur Caravage, dont celui de Michael Fried, Le Moment Caravage. J’ai cherché une écriture dont la texture même, souple, sensuelle, large, puisse accueillir toutes les nuances des peintures. Je décris beaucoup les tableaux, je trouve que les livres sur la peinture ne les décrivent pas assez. La peinture est silencieuse, mais elle pense, il faut trouver les mots pour écouter cette pensée. Il y a sûrement quelques aperçus neufs dans mon livre, par exemple le passage chez Caravage entre Bacchus et le Christ, il me semble que personne n’en parle, alors que c’est une clef inouïe. Mais c’est d’abord un livre modeste, un livre d’écrivain qui tente de méditer sur une expérience artistique, sur le déchirement, la joie folle, la soif de vivre toujours intensément.
EXTRAIT. Achetez ce numéro.
Ce qui nous pousse à écrire sur l’art : en direct du Salon "Livre Paris"
avec Yannick Haenel, écrivain récemment couronné du prix Médicis en 2017, pour Tiens ferme ta couronne (Gallimard) vient de publier chez Fayard un livre sur Caravage. Un Caravage de la solitude, c’est à dire sur les parts d’ombre et méconnus de ce personnage.
Dominique de Font-Réaulx, conservatrice générale des musées de France, directrice du programme culturel du musée du Louvre vient de sortir un livre extraordinaire, un livre référence : Delacroix, la liberté d’être soi, aux éditions Cohen&Cohen.
et Georges Didi Huberman, philosophe, historien de l’art, professeur à l’EHESS mais aussi guitariste, passionné de flamenco… Auteur prolifique d’une soixantaine de livres et qui vient nous parler de Ninfa dolorosa : essai sur la mémoire d’un geste (Gallimard), quatrième volume de la série Ninfa.
L’Art est la matière par Jean de Loisy
« La Solitude Caravage » de Yannick Haenel, de main de maître
Quête esthétique et spirituelle, le très beau texte de Yannick Haenel sur la peinture du Caravage est le récit d’un chemin vers la beauté et le désir d’absolu.
L’œuvre de Yannick Haenel est portée par l’idée de quête – en témoignent dans ses fictions ses personnages d’Ulysse urbains évoluant en marge. « Je cherche un lieu, écrivait-il dans Le Sens du calme. Ce lieu n’existe pas dans l’espace ; il s’ouvre par la parole, et se met à vivre à l’intérieur des phrases qui me viennent. »
Son dernier livre, récit consacré à sa fascination pour la peinture du Caravage, n’échappe pas à cette attraction vers l’esthétique, l’intellectuel et le spirituel. L’art du peintre italien lui est apparu un jour par l’image de Judith décapitant Holopherne : « La main de Judith m’a initié à la peinture : inséparable du couteau, elle tient ferme sa couronne. Grâce à elle, j’accédais à d’autres mains, celle du Christ qui, désignant Matthieu au fond de son bureau des douanes, et séparant par la ligne impeccable de son bras la lumière et les ténèbres, refait le geste impérieux et relâché d’Adam que Michel-Ange a dessiné sur le plafond de la Sixtine ; (…) toutes ces mains qui donnaient la mort ou la lumière, qui recevaient le courage ou la grâce, et, plus secrètement encore, et d’une manière aussi brusque qu’invisible, tenaient le pinceau du Caravage ».
« C’est précisément ce monde entier qui scintille sur la toile d’un peintre »
Ce texte n’est pas une étude scientifique sur la peinture du Caravage mais le jaillissement d’un regard littéraire qui confine à l’action de grâce, l’appel du Christ n’étant jamais loin de l’auteur dans son récit. L’homme Caravage s’incarne aussi dans cette recherche, vivant et singulier dans son époque, son destin lié à celui de ses toiles, l’auteur faisant pénétrer progressivement son lecteur dans l’idée de solitude. « La solitude du Caravage réside dans cet emportement qui l’amène à vivre la peinture comme un moyen pour atteindre le mystère. »
L’écriture lovée dans le contrastant éclat des tableaux, Yannick Haenel s’incline vers les figures saisies par le peintre : saint François, saint Paul, Lazare, le Christ… et leur énigme lui semble soudain presque accessible. « Ouvrir sa bouche, étancher sa soif, chercher Dieu : je ne sais dans quel ordre le mystère s’ouvre, ni comment il nous gratifie, mais la goutte d’eau n’est pas seulement ce qui rassasie, elle est une rosée qui double en filigrane le passage des jours ; et même si le fond de l’existence est noir, la fraîcheur d’un ruissellement secret nous fait tendre les lèvres : à chaque seconde, un psaume réclame en silence une rivière pour notre gorge asséchée ; la détresse connaît bien cette espérance, elle en discerne même la lumière, car à travers une goutte d’eau c’est le monde entier qui se donne, et c’est précisément ce monde entier qui scintille sur la toile d’un peintre, reflété en un prisme où la nacre rejoue à l’infini le mouvement des couleurs et la variété des formes. »
Sabine Audrerie, La Croix du 14 mars 2019.
Le Caravage d’Haenel
L’OBS du 14 mars 2019.
ZOOM : cliquer sur l’image.
Présentée ce matin à la Colnaghi Gallery, à Londres, la toile Judith et Holopherne, découverte en 2014 et attribuée au Caravage, entame une tournée d’expositions avant sa mise aux enchères le 27 juin prochain à Toulouse.
C’est dans le grenier d’une propriété toulousaine que ce tableau avait été retrouvé en 2014, après cent ans d’oubli. Confiée à l’étude du commissaire-priseur Marc Labarbe, l’œuvre avait alors été attribuée au Caravage (1571-1610) par le cabinet d’expertise Éric Turquin, une paternité longtemps remise en question… De fait, l’attribution se révèle une tâche particulièrement complexe lorsqu’elle concerne Le Caravage, un artiste largement copié, qui ne signait pas ses œuvres et réalisait souvent deux versions d’un même sujet. Ainsi, la version originale du Judith et Holopherne, présentée cet automne au musée Jacquemart André et conservée au Palazzo Barberini à Rome, est datée vers 1598-1600, tandis qu’une seconde version aurait été réalisée par l’artiste en 1607, une toile perdue depuis 1619 qui serait donc réapparue à Toulouse… Mais les plus dubitatifs attribuent ce tableau à Louis Finson (1580-1617), un marchand et peintre franco-flamand qui a réalisé de nombreuses copies des tableaux du maître lombard et aurait reçu en dépôt, probablement du Caravage lui-même, la seconde version du Judith et Holopherne. Cependant, dès 2015, des analyses menées sur le tableau de Toulouse mettaient en lumière ses liens matériels comme stylistiques avec les œuvres du Caravage des années 1600-1607. Le nettoyage récent du tableau a également permis de révéler l’extrême qualité de son exécution, digne du maître du clair-obscur lui-même, grâce à l’allégement des vernis et à la suppression de quelques repeints. Représentant un fameux thème caravagesque, issu d’un épisode biblique (la Juive Judith décapitant le général assyrien Holopherne pour défendre la ville de Béthulie), l’œuvre dégage de fait un pathos et une tension dramatique inégalables. Ces analyses scientifiques viennent donc accréditer l’hypothèse soutenue par Éric Turquin, ainsi que de nombreux autres spécialistes, et justifient une estimation actuelle entre 100 et 150 millions d’euros.
Classé « trésor national » en 2016, Judith et Holopherne ne pouvait être vendu à l’étranger avant novembre 2018, le temps (30 mois) d’offrir à l’État français la possibilité de l’acquérir. Mais l’œuvre n’a finalement pas rejoint les collections françaises, la faute sans doute à son coût astronomique et au manque de certitude quant à son authenticité. Le certificat d’exportation ayant été accordé, le tableau fera tout d’abord escale à Londres à la Colnaghi Gallery, jusqu’au 9 mars, puis à New York, du 10 au 17 mai, avant d’être présentée, du 17 au 23 juin, à l’Hôtel des Ventes Saint-Aubin à Toulouse. Il sera mis aux enchères le 27 juin dans la Ville rose, à la Halle aux grains, lors d’une vente menée par la maison Marc Labarbe, en collaboration avec le cabinet d’expertise Turquin.
Chloé Subra, Connaissance des arts, 28-02-19.
Artprice (depuis Londres) : Le « Caravage de Toulouse » fait son coming out
Michelangelo Merisi, dit il Caravaggio ou le Caravage, Judith et Holopherne (vers 1607), 144 x 173,5 cm.
ZOOM : cliquer sur l’image.
« Si j’avais pu choisir de retrouver une œuvre parmi toutes celles qui ont été perdues au cours de l’histoire, une seule, j’aurais sans hésitation choisi celle-là ». Par cette confidence, l’expert en tableaux Eric Turquin exprime sa fascination pour la peinture connue comme le « Caravage de Toulouse », dont il se trouve être en charge de la vente avec le commissaire-priseur Marc Labarbe.
Thierry Ehrmann : « Au terme de cinq années de recherches, d’analyses et de rebondissements, les deux hommes ont annoncé que les propriétaires étaient résolus à laisser le Marché de l’Art décider de la valeur de cette œuvre exceptionnelle, d’une rare puissance, à laquelle l’État français a finalement accordé son visa d’exportation ».
Ce jeudi 28 février à la galerie Colnaghi à Londres, alors que les ventes aux enchères battent leur plein, Eric Turquin et Marc Labarbe ont confirmé lors d’une conférence de presse que la peinture Judith et Holopherne sera mise en vente aux enchères le 27 juin 2019.
Seulement, la vente ne se fera pas du tout là où on pourrait l’attendre. Ce ne sera ni à Londres ni à New York, ni même à Paris que le dernier acte de cette pièce se jouera, mais là où tout a commencé : dans le sud-ouest de la France. C’est en effet dans le grenier d’une habitation près de Toulouse que l’oeuvre a été retrouvée par hasard en 2014. Et ce sera Maître Marc Labarbe, le commissaire-priseur toulousain qui avait été contacté à l’origine par les propriétaires, le premier à avoir reconnu les qualités exceptionnelles de l’oeuvre, qui se chargera de conduire cette session de vente extraordinaire.
L’opération revêt une importance cruciale. Non seulement pour tous les amateurs d’art à travers le monde, friands de belles histoires et de sensations fortes, mais aussi et surtout pour le Marché de l’Art français. Trente ans après la vente historique à Paris des Noces de Pierrette (1905) de Pablo Picasso, une vente aux enchères organisée sur le sol français pourrait à nouveau bouleverser le Marché de l’Art mondial.
Une œuvre de qualité muséale
Comme l’a révélé Artprice au mois de janvier, les vendeurs ont opté pour une stratégie extrêmement originale pour vendre une œuvre encore plus originale.
Car il s’agit d’une œuvre exceptionnelle à bien des égards. Son sujet (une décapitation biblique), son âge (plus de 400 ans), sa découverte (dans un grenier du sud de la France) et surtout son attribution au Caravage ainsi que la puissance du regard de Judith confèrent à ce tableau une place très spéciale dans l’Histoire et sur le Marché de l’Art.
68 œuvres seulement du Caravage sont connues à ce jour, dispersées à travers l’Occident. Beaucoup sont restées en Italie, ornant les plus belles églises de Rome, de Naples et de Sicile, tandis que ses autres tableaux font la renommée des plus prestigieuses institutions européennes et américaines : la National Gallery, le Metropolitan Museum et le Louvre en possèdent trois chacun, alors que le Prado et l’Ermitage se contentent d’un seul tableau du Caravage.
Aussi tous les grands musées doivent-ils rêver d’acquérir celui-ci. Malheureusement, peu d’entre eux en ont les moyens. L’estimation actuelle de l’oeuvre la donne entre 100 m€ et 150 m$. Or, le budget d’acquisition annuel du Musée du Louvre (le premier musée de la planète en nombre de visiteurs) reste lui-même inférieur à 20 m€. Les musées japonais, anglais ou russes, qui convoitent nécessairement cette œuvre inattendue sur le Marché, pourront difficilement entrer dans la compétition.
A moins qu’un Etat décide d’accorder une enveloppe exceptionnelle, les musées publics devront s’effacer devant les grands collectionneurs privés. Les milliardaires occidentaux, asiatiques et moyen-orientaux ont tour à tour raflé les plus belles pièces passées aux enchères ces dernières années. Leur immense puissance financière paraît sans limite lorsqu’il s’agit d’investir dans les derniers joyaux de l’Histoire de l’Art en circulation. (artprice.com)
Caravage. Des 2 versions - Judith décapitant Holopherne - laquelle est la vraie. Controverse sur une attribution
Après avoir analysé le tableau le plus connu, Jacques Tcharny analyse le "Caravage de Toulouse"
[...] Maintenant regardons ce tableau : une lourde Judith, qui n’est visiblement pas Fillide Melandroni, à la peau flasque, aux yeux vides, aux gros seins minables, fixe distraitement le spectateur tout en écoutant ce que lui chuchote à l’oreille sa servante, une commère qui la regarde. Cette dernière montre un goitre monstrueux sur un cou raccordé par des « coutures ? » au tronc : on ne peut pas parler de corps dans ce cas ! Son nez bourgeonnant, ses rides grotesques, sa bouche édentée, sont les éléments dominants de son visage. Leurs commérages inintéressants forment le « centre psychologique » du tableau, si l’on peut dire.
Dans cette situation, on se demande comment la longue épée qu’elle tient de la main droite, complètement statique, a pu ouvrir en deux le cou d’Holopherne ! Sans doute est-ce un miracle de la peinture ! Cette « Judith » tient sa lame tellement de travers qu’il lui est strictement impossible de trancher la tête du barbare. La mollesse de l’acte est incroyable. Quant aux mains, ce sont des poèmes de nullité : les doigts, gourds et mal formés, ne tiennent pas l’arme, ils sont purement anecdotiques. Les yeux des deux femmes sont vides et rendent l’expression du néant. La sensation du spectateur c’est d’observer deux bovidés tranquilles et inexpressifs. La tête d’Holopherne est orientée vers le haut, de telle manière que le spectateur ne peut pas voir ses pupilles, en totale opposition avec ce que devrait être la vision de sa souffrance par l’observateur, comme dans la première version décrite. Aucune énergie ni aucune profondeur de champ n’existent ici. La lumière, très réduite et très vague, se perd dans un vide sidéral : celui d’une composition décorative due à un peintre secondaire. Quant au rideau rouge du fond, inerte, il occupe tout l’espace : le peintre était incapable de centrer son travail, de rendre les volumes par la lumière. Au grand dam du spectateur, le ressenti en est une morne confusion. Cette peinture est, stricto sensu, inepte. L’inclure dans le catalogue des œuvres du Caravage serait absurde.
Jacques Tcharny , wukali.
A suivre...
« Vers 15 ans, j’ai rencontré l’objet de mon désir. C’était dans un livre consacré à la peinture italienne : une femme vêtue d’un corsage blanc se dressait sur un fond noir ; elle avait des boucles châtain clair, les sourcils froncés et de beaux seins moulés dans la transparence d’une étoffe. »
Ainsi commence ce récit d’apprentissage qui se métamorphose en quête de la peinture. En plongeant dans les tableaux du Caravage (1571-1610), en racontant la vie violente et passionnée de ce peintre génial, ce livre relate une initiation à l’absolu.
« À notre époque d’épaississement de la sensibilité, regarder la peinture nous remet en vie. On entre dans le feu des nuances, on accède à la vérité du détail. C’est une aventure des sens et une odyssée de l’esprit. Aimer un peintre comme le Caravage élargit notre vie. »
France Culture, La Dispute, 28 février 2019.
Le Jeune Jean-Baptiste au bélier, 1602.
Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.
Dans une ardente biographie, l’auteur tente d’approcher au plus près l’origine du geste du Caravage.
Le tableau est conservé à la Galerie nationale d’Art ancien de Rome, dans le palazzo Barberini, mais c’est dans les pages d’un livre qu’il s’offrit pour la première fois au regard de l’adolescent. Non pas toute la toile, mais un fragment : un beau visage de femme, concentrée, sourcils froncés. A son oreille, une perle fixée par un ruban de velours noir. « Il arrive qu’un détail rivalise avec le monde : cette perle, ce papillon noir me plaisaient à ce point qu’ils jouèrent un rôle crucial dans ma vie », raconte Yannick Haenel aux premières pages de ce beau livre ardent par lequel tout ensemble il renoue avec cette révélation esthétique et érotique initiale, et s’interroge sur la puissance des « énigmes enflammées » qui peuplent la peinture. Et plus particulièrement l’œuvre du Caravage, puisque la jeune femme à la perle qui l’ensorcela jadis s’avère l’intraitable Judith de Béthulie qui trancha le cou du général assyrien Holopherne afin de libérer sa ville assiégée, épisode biblique qui inspira au peintre milanais la sublime toile Judith décapitant Holopherne.
De la contemplation picturale, l’écrivain tient la certitude ancienne qu’« à travers ses éclaboussements de rouge ou la pensivité discrète de ses lueurs, […] la peinture voit plus loin que notre écrasement dans ce mauvais rêve qu’on nomme l’humanité », et que « le monde peint a partie liée au royaume, et qu’en un sens, il est lui-même le royaume ». Entendons par là que l’expérience esthétique réelle et profonde, contact avec « le fond vibratoire et peut-être infini du tableau » — non pas son thème, non plus que ses motifs, ni même le jeu des couleurs et des formes, mais « ce nid de flammes où la lumière et l’ombre, en se livrant une bataille sans merci, ne cessent de nous initier à ce qui échappe au visible » — est une expérience du sacré. Qui, face aux toiles du Caravage, atteint pour Yannick Haenel une telle intensité, une telle évidence qu’il a à cœur d’approcher au plus près l’origine du geste du peintre, le monde intérieur où il prend sa source.
C’est sous cet angle qu’il entreprend de retracer la biographie de l’artiste, dans l’Italie de la fin du xvie siècle, ravagée par la peste. « J’imagine le jeune Caravage déchiffrant dans la suie grasse qui colle aux murs pestiférés des figures qui n’existent pas, détaillant ces taches noires qui sont comme le souffle porté des visages emportés par le néant… » D’où vient « le noir du Caravage » ? D’où vient la lumière aux éclats de nacre, la limpidité d’eau vive qui balafre ce drap de ténèbres ? Et quel est cet « autre pays », cet autre « plan de la vie » dont ses tableaux nous entrouvrent la porte ? Les réponses de Yannick Haenel sont à l’image de son livre, belles, précises et fébriles.
Ed. Fayard, coll. « Des vies », 332 p., 20 €.
Nathalie Crom
Telerama n°3607, le 26/02/2019
Juditha triumphans devicta Holofernis barbarie de Vivaldi
Aria n°25, Vagaus (serviteur d’Holopherne) interprété par Cecilia Bartoli (« The Vivaldi Album », 2000).
La scène se passe après le meurtre d’Holopherne.
Armatae face et anguibus
A caeco regno squallido
Furoris sociae barbari
Furiae venite ad nos.
Morte, flagello, stragibus
Vindictam tanti funeris
Irata nostra pectora
Duces docete vos.
Armées de vos torches et de vos serpents,
De votre royaume aveugle et funeste,
Barbares compagnes,
Furies, venez à nous.
Avec la mort, l’étrivière, le massacre,
Apprenez à nos
Cœurs irrités
À venger le meurtre de notre chef.
Voilà un nouvel exemple de la furià vivaldienne dans le registre de l’oratorio. Judith triomphante est le seul des trois oratorios qui nous soit parvenu. Créé à l’Ospedale de La Pièta en 1716, la partition concentre le meilleur du génie lyrique et dramatique vivaldien. La genèse et le concert de création sont assez bien documentés car l’œuvre participe à une célébration politique, la victoire de Petrovaradin, terme victorieux de la 6è guerre contre les turcs. Véritable drame sacré, l’oratorio de Vivaldi se prête très bien à une mise en scène, tant l’explicitation des situations, la diversité des airs et des caractères qui sont exprimés, se rapprochent de l’opéra.
Occupée par les troupes de Nabuchodonosor, que dirige le général Holopherne, la ville juive de Béthulie implore la pitié des conquérants : l’une de ses citoyennes, la plus courageuse, la jeune veuve Judith, entreprend de séduire Holopherne et vaincre les troupes d’assiégeants. Vivaldi raconte musicalement, la visite de Judith chez Holopherne, lequel tombant amoureux d’elle, organise illico un banquet. Profitant du sommeil du général, la veuve le décapite, aidée par sa fidèle servante, Abra. A l’ardeur fragile de la jeune femme répond l’expérience de la femme plus mûre, selon un canevas contrasté que les peintres dont Caravage, ont approfondi au début du XVIIe.
Le personnage héroïque de Judith, en réalité la ville de Venise, triomphatrices des turcs, est exalté, commenté, encouragé par le grand prêtre hébreu Ozais ; mais aussi célébré par le chœur des vierges de Béthulie qui souligne le courage exceptionnel de celle qui va libérer la ville des Babyloniens.
En Judith s’incarne l’esprit de résistance face au tyran et à toute forme d’oppression. D’abord féminine et proie du doute, le jeune femme s’endurcit et guerrière, révèle sa nature de combattante. (classiquenews)
Voici la version complète de l’oratorio avec le Venice Baroque Orchestra dirigé par Andrea Marcon (le rôle de Judith est interprété par Manuela Custer, celui de Vagaus par Karina Gauvin).
Toi aussi tu écris aujourd’hui me dit ma belle M. assise à son bureau de travail, "A girl from Ipanema" passant à cet instant à la radio.
Il fait beau ce matin, c’est février ou mai, le temps fait ce qu’il lui plaît. Dans le jardin baigné de soleil j’écoute une émission matinale passée il y a quelques jours à la radio où l’invité était Yannick Haenel venu parler de la solitude Caravage. Ses phrases me réveillent, c’est à chaque fois le cas, je devrais être plus rigoureux et le lire chaque jour. Stylo en main je note quelques mots sur le silence de la peinture, l’amour, la mort, la beauté, le génie du Caravage ; et cette injonction de ne pas se contenter d’une petite vie, mais au contraire d’en faire quelque chose de grand.
Ses propos résonnent en moi et me renvoient, étrangement au dernier essai de R. Jaccard sur Wittgenstein ( l’Enquête de Wittgenstein). Haenel, Jaccard (et Wittgenstein) deux planètes éloignées.
Mais ce paradoxe je ne le tais pas, je tente ici de le dire : Il faut nous dit Wittgenstein répondre à cet impératif catégorique que chacun porte en soi, le devoir de génialité. Car la génialité n’est que l’accomplissement de l’idée de l’homme. L’homme de génie est celui qui veut l’être ; et convoquant comme à son habitude les viennois d’avant la Nuit ( Kraus, Freud), il cite le sulfureux Weininger : Le grand homme n’est pas seulement le plus fidèle à lui-même, le moins oublieux de sa propre vie, celui à qui l’erreur et le mensonge sont le plus odieux et le plus insupportable ; il est aussi le plus social, l’homme le plus solitaire en même temps que le plus solidaire.
Tandis que l’auteur de Tiens ferme ta couronne questionne en fin d’émission ce qui fait battre le coeur, on peut lire à la fin de l’essai sur Wittgenstein que "Je réfléchis se dit, en japonais, je ne cesse de secouer mon propre coeur."
Yannick Haenel, entre ombres et lumières
Yannick Haenel est l’invité de Jean-François Cadet sur rfi (26 février). Ecoutez. Vous m’en direz des nouvelles.
Le texte lu pendant l’émission (18ème minute) est le chapitre 10 du livre : Tout le Caravage.
Crédit : rfi
La Diseuse de bonne aventure, vers 1594.
Phot A.G., Le Louvre, 25 janvier 2017. ZOOM : cliquer sur l’image.
Je lis dans le numéro de mars de Beaux Arts Magazine (dont le titre de couverture est : Pourquoi les copies et les faux explosent dans l’art contemporain) qu’un tableau découvert à Toulouse en 2014, classé trésor national en 2016, sur lequel les spécialistes ne se sont pas mis d’accord, ne sera finalement pas acheté par l’Etat. Il serait quand même estimé à 120 millions d’euros.
Beaux Arts, mars 2019.
ZOOM : cliquer sur l’image.
De son côté Art critique précise : « En avril 2014, on découvrait, dans un état de conservation exceptionnel, dans un grenier de Toulouse, ce qui semblait être une toile du Caravage : une nouvelle version de Judith tranchant le cou d’Holopherne, un des thèmes de prédilection du célèbre maître. Pendant trente longs mois, des spécialistes ont débattu pour savoir s’il s’agissait effectivement d’un Caravage authentique, ou d’un tableau dû à l’un de ses disciples, Louis Finson en tête. Tant et si bien qu’il était impossible de vendre le tableau jusqu’en novembre 2018. Classé trésor national, ce nouveau Judith décapitant Holopherne n’a pas été acheté par l’État français et ses propriétaires actuels ont demandé l’obtention d’un certificat d’exportation qui leur a été accordé, afin de pouvoir vendre la peinture librement sur le marché.
S’il y a encore des doutes quant au véritable auteur de ce tableau, la toile, probablement exécutée à Rome entre 1604 et 1605, a tout de même une valeur marchande hypothétique de 120 millions d’euros. Le tableau sera présenté au public en ce début d’année et sera mis en vente au printemps prochain, à Toulouse, par le commissaire priseur Marc Labarbe. L’expert Eric Turquin est convaincu qu’il s’agit là d’un véritable Caravage. Les enchères risquent bien de décoller, tout comme les débats autour d’une oeuvre de toute façon remarquable. »
Tous les goûts sont dans la nature... Personnellement, je préfère nettement la Judith qui fascina Haenel à 15 ans.