
Raphaël, L’École d’Athènes, 1509-1510.
Rome, musée du Vatican. Photo A.G., 18 juin 2015.
Détail des personnages : cliquer ici.

« Le commencement est ce qui,
dans le déploiement d’essence de l’histoire,
se montre en dernier lieu. »
Martin Heidegger, Parménide.
En janvier 2012, Philippe Sollers publie L’Éclaircie. En juin, il répond aux questions de François Meyronnis et de Yannick Haenel pour la revue Ligne de risque. Retour sur les dieux grecs et, plus précisément, la « déesse vérité » telle que la convoque Parménide dans son Poème — lu par Heidegger pendant l’hiver 1942-1943, « dans un moment du temps — de l’histoire — qui décide de ce qu’on appelle la "pensée occidentale" » [1].
1. Le « Poème » de Parménide est aussi le récit d’une épreuve initiatique : un jeune homme chemine vers une déesse, dans un char emmené par des cavales. Le « Poème » porte à la langue la parole de cette déesse, qui délivre un enseignement. Comment interprétez-vous la présence ici d’un être divin — et le fait que Parménide rapporte la pensée à cet être ? Identifiez-vous, comme Heidegger, la theia — la « déesse » — et la « vérité » — ou plutôt l’aletheia ? « Aletheia » » — est-ce le nom propre de la déesse ?
2. Dans l’Odyssée, Ulysse préfère Pénélope à Calypso : le corps d’une mortelle à celui d’une déesse. Que signifie, d’après vous, cette préférence ? Quels rapports existent-ils, chez les Grecs, entre les athanatoi — les non-mortels — et les mortels ?
3. Ce n’est pas un « destin mauvais », dit la déesse du « Poème » de Parménide, en accueillant l’initié dans sa demeure, « qui t’a envoyé parcourir ce chemin », « loin des hommes, hors de leur sentier battu ». Qu’est-ce, d’après vous, que ce chemin qui mène vers la déesse, et qui se sépare de celui du nombre. Lorsque le nihilisme bat son plein, est-il encore possible de ressentir la « bienveillance » de la déesse, et d’être l’élu ?
4. Il n’y a aucune correspondance, selon Heidegger, entre l’aletheia grecque et la veritas romaine, que l’on traduit dans les deux cas par « vérité ». Quels chemins secrets s’ouvrent à méditer cela ? En quoi cela nous concerne-t-il aujourd’hui ?
5. Ne peut-on pas lire les cours de Heidegger sur Parménide durant le semestre d’hiver 1942-1943 comme un acte de résistance intellectuelle à l’encontre du nazisme ? On appréhende toujours, y lit-on, le monde grec de manière romaine, et du coup, on le manque. On pense toujours le « politique » de façon romaine, c’est-à-dire « impériale ». Heidegger distingue le dieu grec qui « montre et indique » — qui « accorde et dispose » — de l’imperium romain, où tout repose — y compris le numen des dieux — sur le commandement. Il met l’accent sur la différence qui sépare le domaine de l’aletheia, où se déploie le dieu grec, du domaine de l’« Empire ». En opposant ainsi la Grèce de Parménide et l’imperium sous toutes ses formes, ne vise-t-il pas le Reich nazi ? Ne fait-il pas du dieu grec, étranger à la métaphysique, ce qu’il y a de plus étranger au nazisme, déterminé comme l’un des aboutissements de la métaphysique dans son inversion nihiliste ?
6. Que signifie : penser les dieux de manière grecque ? Heidegger indique que ce serait les penser depuis l’aletheia. Est-ce possible à partir d’une langue romane, le français ?
7. Comment situez-vous le « Dieu » catholique, pour lequel vous avez toujours eu de l’intérêt, par rapport au dieu grec ? Comment pensez-vous ensemble Jésus et Dionysos ? Jésus lui même relève-t-il du domaine de l’ « Empire » ? Faut-il enfermer le « Dieu » catholique dans le domaine de l’impérialité romaine ?
8. « Parler et dire sont en soi traduire », dit Heidegger. En dehors du transfert d’une langue dans une autre, sans cesse nous traduisons dans notre propre langue. « Le poème d’un poète — dit-il —, le traité d’un penseur se tiennent dans leur parole propre, simple, unique. Ils nous contraignent à toujours écouter cette parole comme si nous l’entendions pour la première fois. Ces prémices de la parole nous font chaque fois passer sur une rive nouvelle. » N’est-ce pas ce que vous faites vous-même en revenant inlassablement sur les noms propres qui ont illustré le français et en vous penchant sur le destinal de cette langue ? N’êtes -vous pas, en ce sens, un « traducteur » ? Peut-on aborder la parole d’un écrivain sans le « traduire » — sans se « transposer » dans le domaine d’expérience qui a été celui de cet écrivain ?
9. Heidegger, évoquant Parménide, affirme qu’il suffit de peu — à peine quelques pages, plutôt que des forts volumes — pour transmettre, à l’instar des penseurs « initiaux » de la Grèce, ce qu’il nomme le simple. Qu’en pensez-vous ? N’est-ce pas ce qu’ont fait, en français, Lautréamont et Rimbaud ? Mais, surtout, comment s’y prendre, pour l ’homme égaré du nihilisme planétaire, afin de recueillir le simple au XXIe siècle, à l’heure où tout semble disponible et où pourtant tout s’efface ?
10. Souvent, et dans plusieurs textes, Heidegger insiste sur l’alpha privatif dans le mot grec aletheia, et donc sur le rapport de ce terme avec le terme lethé. Dans le cours sur Parménide, il revient sur l’ « essence conflictuelle » de l’aletheia. Que signifie, pour vous, le litige inhérent à la « vérité » ?
11. Pour les Grecs, toute présence et toute absence se déploient — en rapport avec une « avancée dans la lumière » — aletheia — et un « recul dans l’obscurité » — lethé. Mais si l’ « annihilation » peut être, selon Heidegger, un « mode du cèlement », celui-ci a aussi le visage de ce qui sauvegarde. Comment comprenez-vous ce double aspect de la lethé ?
12. Au cœur du familier brille « l’in-quiétant », qui est aussi le « simple », l’« inapparent », « ce qui passe inaperçu ». Les dieux grecs, d’après Heidegger, viendraient s’offrir et se présenter dans le familier depuis cet « in-quiétant ». Ainsi feraient-ils signe de l’étant vers l’être, et pour cela participeraient du « démonique ». L’éclat qui provient des dieux — cette lueur qui brille — octroie aux Grecs « une expérience de l’obscur, du vide et de la béance », dit Heidegger. Qu’en pensez-vous ? Acceptez-vous sa définition de l’ « a-théisme » comme « absence des dieux » déterminée par l’ « oubli de l’être » qui commande et domine l’histoire occidentale ? Si on prend au sérieux cette définition, ne seriez-vous pas exactement le contraire d’un « athée » ?

Philippe Sollers : Faisons attention aux dates. Le Parménide de Heidegger résulte de cours prononcés à l’université de Fribourg-en-Brisgau durant l’hiver 1942-1943. Dès le début, Heidegger nous fait remarquer que deux mille cinq cents ans se sont écoulés depuis le commencement de la pensée occidentale. Nous lisons ces cours en français soixante-dix ans après qu’ils ont été prononcés dans les dernières années, les plus terribles, du régime hitlérien. Nous sommes en pleine guerre mondiale, et la bataille fait rage sur le front russe. On se bat à Stalingrad. En décembre 1941, les Japonais ont attaqué Pearl Harbour. Les puissances de l’Axe — le Japon et l’Allemagne — se battent à la fois contre les Soviétiques et contre les Américains. Heidegger s’exprime donc au milieu d’une véritable convulsion historique. C’est depuis cette convulsion qu’il interroge le poème de Parménide, que je ne nommerai pas, comme lui, un « poème didactique » , mais un poème de pensée. Le bruit et la fureur, voilà des mots faibles pour désigner ce qui se passe ; la démence et l’horreur, ces mots ne sont pas davantage à la hauteur du cataclysme.
Nous sommes, dans cet hiver 42-43, dans un moment du temps — de l’histoire — qui décide de ce qu’on appelle la « pensée occidentale ».
Le destin de cette pensée est envisagé à partir d’une langue et d’un pays, l’Allemagne, en train de sombrer dans une catastrophe abyssale. Heidegger dit : « Nous ne pouvons penser l’essence de la vérité que si nous nous avançons jusqu’aux confins de l’étant en son tout. Nous apercevons alors qu’un moment historique est proche, dont le caractère unique ne se détermine en aucun cas seulement ni d’abord à partir du monde qui est et en lui de notre propre histoire. Il n’"y va" pas seulement de l’être et du non-être de notre peuple historique, il n"’y va" pas seulement de l’être ou du non-être d’une "civilisation européenne", car en tout cela il y va toujours et seulement de l’étant. Antérieurement à tout cela, et de façon initiale, la décision porte sur l’être et le non-être eux-mêmes, l’être et le non-être dans leur essence, dans la vérité de leur essence. Comment l’étant pourrait-il être sauvé et abrité dans le libre espace de son essence aussi longtemps que l’essence de l’être demeure indécidée, non questionnée, voire oubliée ? »
Le point de départ de Heidegger est que nous n’avons plus de rapport avec l’essence de la vérité, et pas davantage avec nous-mêmes. Nous ne savons plus qui nous sommes. Nous ne pensons pas encore, et c’est la seule chose que nous puissions penser. Partir du pas encore, c’est la voie insolite que propose ici le philosophe. Cela convient-il toujours, soixante-dix ans après ? A-t-on avancé, depuis 1942, au-delà du pas encore ? Rien n’est moins sûr. C’est pourquoi on a tout intérêt à se mettre à l’écoute d’une pensée qui, en Grèce, il y a deux mille cinq cents ans, et en Allemagne, il y a soixante-dix ans, énonce l’« essence de l’histoire ». Elle dit : « L’essence de l’histoire qui, parce qu’elle est l’histoire de l’être et que l’être ne s’éclaircit que de façon soudaine, n’accède à son être propre que dans la soudaineté initiale des commencements. L’histoire, accordée à l’essence initiale de l’éclaircie de l’être, est l’envoi qui toujours à nouveau et seul destine l’étant à un déclin, le faisant sombrer dans des cèlements durables. Conformément à ce destin règne à présent le déclin, le soir de ce qui a émergé de façon initiale. Le pays que cette histoire fait entrer dans son espace de temps pour l’y abriter est l’Occident, suivant le sens initial dans l’histoire de l’être, de ce mot. »
Je vous propose de revenir à ce que Heidegger nomme l’expérience de l’« initial ». C’est ainsi seulement que nous aurons une chance d’aller vers un tout nouveau commencement, découvrant au passage que le déclin fait partie de l’essence de la vérité, même si le mot « vérité » s’avère un nom de recouvrement. En effet, ce mot, issu du latin, oblitère un mot grec dont le sens est très différent.
Je remarque que Heidegger débute son commentaire du poème de Parménide au moment où la déesse accueille le jeune mortel, mais le texte grec nous offre une surabondance de détails sur ce qui précède l’arrivée dans la demeure divine. Ce qui saute aux yeux , c’est l’élément féminin du trajet. Ce sont des « cavales » qui emportent l’élu aussi loin, dit le texte, que son cœur en forme le désir. On se retrouve très loin, dans un éloignement qui est à la mesure du désir de chacun. Si celui-ci manque de force, eh bien vous demeurez avec les ébahis sur le « chemin des mortels », radicalement étranger à ce qu’on nommera provisoirement la « vérité », avant de lui donner son nom authentique. Vous tournerez en rond, ressassant avec les ébahis les opinions courantes qui égarent de la « voie de la divinité ».
Des jeunes filles indiquent le chemin au voyageur. « L’essieu brûlant des roues grinçait dans les moyeux, jetant — dit Parménide — des cris de flûte. » Voilà donc des filles et de la musique. Ce sont les filles du soleil qui, dit le texte, « avaient délaissé les demeures de la nuit ». Que j’aie été littéralement habité par le poème de Parménide, on en trouve plus d’une trace dans Paradis. Ainsi, dès les premiers mots : « voix fleur lumière écho des lumières cascade jetée dans le noir ». Tout le livre s’est écrit dans cette dimension poétique, celle de ce que j’ai appelé l’« aujour’nuit ». Personne n’a envisagé que Paradis était à la fois un poème et de la pensée. Un raisonnement rythmé.
Pourquoi Heidegger laisse-t-il tomber, dans son cours, les filles du soleil ? Vous me direz que l’époque n’était pas favorable à une efflorescence féminine vers le divin, d’autant qu’il s’agit d’accompagner un seul mortel vers la déesse. Elles courent vers la lumière en lui faisant cortège, écartant de leur main, dit le texte, le voile qui masquait l’éclat de leur visage. On assiste à un dévoilement du féminin qui décèle l’être lui-même. « Là se dressent — dit le texte — la porte qui donne sur les chemins de la nuit et du jour, un linteau et un seuil de pierre la limitent. Quant à la porte même, élevée vers le ciel, c’est une porte pleine, aux battants magnifiques. Et Diké, aux nombreux châtiments, en détient les clefs dans les deux sens, contrôlant le passage. »
La porte du poème, on la retrouve dans le portail du Zarathoustra de Nietzsche.
Cette porte, entre nous, on ne l’ouvre pas facilement. Diké, la déesse de la justice, en détient les clefs, ce qui augure les plus grandes difficultés : le texte évoque sans ambiguïté la possibilité du châtiment. Un des chapitres du Rire de Rome, livre d’entretiens que j’ai fait avec Franz De Haes, et qui a depuis mystérieusement disparu des consciences, un des chapitres, donc, s’appelle : « Les clefs de Saint-Pierre ». Il y a en effet toute une serrurerie du salut.
Qui va séduire la déesse Diké ? Car il faut la séduire, si l’on désire qu’elle ouvre le passage. On la convainc avec Peitho, la déesse de la persuasion. Mais le jeune homme est incapable de cette séduction. Comment pourrait-il charmer le châtiment ? Ce sont les filles du soleil qui s’en chargent. Elles tiennent à la justice de « caressants propos, afin de la persuader habilement d’ouvrir les battants, ne serait-ce qu’un très court instant ». On ne lève le verrou que dans la soudaineté d’un moment fulgurant. Remarquez qu’ici la déesse ne se laisse séduire que par du divin féminin. Si on parle des dieux grecs, il faut insister sur ce versant-là. Les déesses, apparemment, n’intéressent pas les philosophes. Depuis toujours, je me demande pourquoi.
Plus on ouvre la pensée grecque de manière initiale — en un mot antéplatonicienne —, plus on a de chances de voir apparaître les déesses. Bon, Diké est convaincue, la porte bascule sur ses gonds, et s’offre un « large espace ». « C’est alors — dit Parménide — que, par là, tout droit, les jeunes filles poussent à s’engouffrer le char et les cavales sur la route déjà tracée par des ornières. » « Ornières », dit Rimbaud dans Illuminations : on y voit « des cercueils sous leur dais de nuit dressant les panaches d’ébène, filant au trot des grandes juments bleues et noires ». Et revoilà les cavales !
Rimbaud est le jeune homme du poème de Parménide, le kurios. A-t-il eu des prédécesseurs ? On ne sait pas. Des successeurs ? On les cherche. Osons-le : c’est peu probable. Cela relève de l’impossible.
Le jeune homme, la déesse le reçoit avec bienveillance. Ce n’est pas la déesse de la vérité, mais la vérité elle-même sous une forme « humaine ». Le voyageur raconte ce qui lui arrive : « Elle prit ma main droite en sa main. » Que dit-elle ? Heidegger traduit : « Ô homme, qu’accompagnent d’immortels auriges, grâce aux cavales qui t’emportent parvenant à notre demeure, réjouis-toi ! Car ce n’est pas un destin mauvais qui t’a envoyé parcourir ce chemin — lui qui est en vérité loin des hommes, hors de leur sentier battu. » Plus loin, la déesse continue : « Or voici qu’il te faut de tout faire l’épreuve, tant du cœur sans dissimulation du hors-retrait, anneau accompli, que de t’apparaître tel qu’il paraît aux mortels, où l’on ne peut faire fond sur le non-celé. »
Le « hors-retrait », de quoi s’agit-il ? De la vérité elle-même, mais sous son nom grec d’aletheia. Dans ce mot, on reconnaît le lethé, qui signifie « oubli », « retrait ». De là qu’il n’y a pas d’aletheia sans un rapport soutenu avec son contraire, le lethé. Pas de vérité sans retrait. Tout le commentaire de Heidegger porte là-dessus de façon magistrale.
La traduction courante ne parle pas du « hors-retrait, anneau accompli », mais, plus poétiquement, de « vérité bellement circulaire ». On peut préférer cette traduction, moins lourde, plus efficace, mais qui a le désavantage de ne pas faire surgir de quoi il retourne avec l’aletheia.
VOIR
On a donc une déesse, qui prend avec bienveillance la main droite du jeune homme. Notons au passage que la divinité a une main. D’ailleurs, il y a toute une réflexion dans le cours consacré à Parménide sur la main, et son rapport avec la parole. On y compare la machine à écrire et le manuscrit. La déesse a donc une main, et elle parle. Rien ne nous interdit de la supposer nue (rien à voir avec Diane ou plutôt Artemis mais, surprise à son bain pour un mortel qui va le payer de sa vie : Lacan étrangement, se trompe de déesse).
Le jeune homme est courageux, il a un grand cœur « exempt de tremblement ». On pense à Ulysse, tel qu’Athéna le qualifie. Tout se passe dans le « cœur » avec fulgurance, et non dans des ruminations psychiques où l’on s’embourbe.
La déesse ajoute cette précision au jeune homme : « Tu apprendras également à faire l’épreuve de ceci : comment ce qui paraît demeure tenu dans la nécessité d’être à la mesure du paraître, tandis qu’il transparaît à travers toute chose, et de la sorte, conduit tout à son achèvement. »
Ce qui paraît, le paraître, ce qui transparaît : on a là un véritable spectacle. Un barnum ! On peut s’y laisser prendre, au point de ne plus voir que lui — à ce sujet, se mettre en tête de le critiquer n’est qu’une manière de s’y laisser prendre. A son tour, Debord tombera dans ce piège. C’est qu’il n’a pas poussé assez loin ses cavales. Résultat : le mélange du vrai et du faux, la falsification devenant monde, le scandalisent, et donc le fascinent. Le devenir-falsification du monde réalise la prophétie des sorcières de Macbeth : le vrai est le faux, le faux est le vrai. Aucune morale, fût-ce révolutionnaire, n’y trouve son compte.
Soixante-dix ans après Stalingrad et Pearl Harbour, nous n’en sommes plus exactement au même point. Nous avons eu la révélation d’une catastrophe qui nous projette dans l’ère planétaire. Même si la plupart des esprits retardent considérablement par rapport à cette révélation, elle n’en est pas moins la trame de tout ce qui apparaît autour de nous, le noyau même du spectacle, invisible aux théoriciens du spectacle.
Pour répondre à votre question, Aletheia est bien le nom propre de la déesse, et désigne en même temps l’expérience grecque de la vérité, sans rapport avec la veritas romaine, d’où découlera le concept métaphysique de vérité. J’insiste sur l’aspect féminin de l’aventure, violemment refoulé par toute l’histoire de la philosophie, depuis Platon jusqu’à Heidegger.
De manière logique, vous mettez en rapport le poème de Parménide avec l’Odyssée d’Homère. Mais vous dites qu’Ulysse préfère Pénélope à Calypso. Je crois plutôt qu’Ulysse, tout simplement, veut rentrer chez lui. Chez Calypso, il n’est pas chez lui. Son foyer, c’est Ithaque. Avec le massacre des prétendants, il va y retrouver sa femme, mais aussi son fils Télémaque. Préfère-t-il vraiment le corps d’une mortelle à celui d’une déesse ? N’oubliez pas qu’Athéna veille en permanence sur lui. C’est elle, et non Aphrodite, ou Héra, ou Artémis, qui est la déesse de l’Odyssée. Pourtant, elle est austère, peu encline aux choses de l’amour, mais voilà : elle aime Ulysse et sa ruse. Pas jalouse, néanmoins. Elle ferme les yeux sur les plaisirs d’Ulysse, sans avoir
elle-même la moindre propension à l’orgie, comme sa sœur Aphrodite. Un Français, habité par le destinal de sa langue, Watteau, a peint le Jugement de Pâris, où l’on voit le berger troyen en érection à peine dissimulée en train d’offrir sa pomme à la déesse de l’amour. Mais ce n’est pas le choix du libertin Ulysse, qui préfère quand même Athéna.
L’aletheia grecque n’est pas la veritas romaine. De même a-t-on beaucoup de mal à ne pas donner aux dieux leur nom latin, et à leur restituer leur nom grec. Figurez vous qu’Athéna n’est pas Minerve ; ni Aphrodite, Vénus ; ni Artémis, Diane. Cette affaire de nom est beaucoup plus essentielle qu’il n’y paraît. La chouette de Minerve s’envole toujours trop tard, dit Hegel. Mais c’est parce qu’il oublie un peu trop vite Athéna.
Pour les Grecs, comme le montre l’Iliade, les dieux et les déesses se jouent sans cesse des mortels. Ils ne sont pas toujours bienveillants, ni exempts de passion. Rencontrer un dieu est une expérience dangereuse, et le plus souvent cruelle. C’est le destin d’Achille, de Patrocle et d’Hector. Mais pas celui d’Ulysse, grâce à Athéna. Elle le protège des menées de Poséidon, qui déteste le navigateur aux mille tours.
Les rapports entre les mortels et les non-mortels --- athanatoi — sont éminemment conflictuels. Sans aucune morale, un dieu peut avoir son élu, mais aussi son pestiféré.
Je le répète encore : pas de vérité comme hors-retrait sans un arrachement du retrait. Du retrait, l’élu doit faire l’expérience. C’est aussi une expérience de la mort. Le mythe d’Er, que Platon raconte au livre X de La République, établit qu’il n’y a pas de vérité sans un rapport entre le monde d’« ici » et le monde de « là-bas ».
Le chemin qui mène vers la déesse, lorsque le nihilisme bat son plein, est-ce qu’on peut encore l’emprunter ? Entre nous, le nihilisme n’atteint pas si facilement son plein. Il en remet toujours, et toujours. Avec lui, c’est toujours plus. Mais alors qu’arrive-t-il au chemin ? Un jour, vous vous rappellerez cette conversation comme un âge d’or. Sa possibilité même vous apparaîtra, avec nostalgie, comme divine. La fureur étend son règne, et creuse le gouffre qui absorbe au fur et à mesure le monde. Dans ce cataclysme, est-il possible, me direz-vous, de ressentir la « bienveillance » de la déesse et d’être l’élu ? Ma réponse est sans ambages : on le peut d’autant plus. Comme dit Hölderlin : « Là où est le péril, croît aussi ce qui sauve. » Plus le nihilisme déferle, mieux il vous est loisible de ressentir la bienveillance divine. Mais attention : encore faut-il être appelé et avoir assez de désir dans son cœur pour répondre à cet appel. Il y va, à cet égard, de la responsabilité de chacun. Dans son cours, Heidegger, tout à son exercice académique, emploie le « nous ». En revanche, Parménide raconte une expérience en forme de je.
Plongé dans l’aveuglement, dans lequel l’entretient le Gros Animal, un homme perd tout accès à la vérité comme hors-retrait. Par la même occasion, il perd toute possibilité de faire l’expérience du retrait. Et sans celle-ci, dans toute son âpreté, aucun chemin ne s’ouvre. Les mots « vrai », « faux », traduisent le lien entre les concepts latins de veritas et de falsum. On les retrouve, dans leur contraste, au cœur du calcul, qui à la fin les interchange. Mais cette opposition n’existe pas de cette manière en grec. L’aletheia ne s’oppose pas exactement au lethé : elle conserve en soi ce dont elle s’arrache. Elle découle de l’expérience de l’obscur, de l’abîme, du chaos. La mort n’est-elle pas l’abri de l’être, c’est-à-dire l’« arche du Rien » ?
Le calcul a besoin de l’opposition binaire du vrai et du faux, fût-ce pour les permuter, mais une tout autre expérience met en jeu le rapport du retrait et du hors-retrait. Le problème, c’est qu’il n’y a pas foule pour aller chez la déesse. En pleine Seconde Guerre mondiale, alors que l’Europe est à feu et à sang, et que personne ne pense plus à Parménide, Heidegger décide d’emprunter le chemin « loin des hommes, hors de leur sentier battu ». Son désir le mène, qui l’eût cru ?, vers la déesse. C’est cela qu’ils ne veulent pas savoir, et qui lui vaut le tombereau d’injures sous lequel on le recouvre continuellement. En pleine bataille de Stalingrad, un Allemand a été appelé, après Anaximandre, Héraclite et Parménide. Il a fait une expérience. Était-il un homme ? Possible que pas. Il sera donc l’objet de toutes les récriminations. Et Sollers, est-il un homme ? Eh bien, j’en doute fort. J’ai toujours été scandalisé par le syllogisme qui dispose : tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Avec mon étrange tour d’esprit, ce raisonnement m’a toujours paru faible et agressif par rapport à Socrate. Définir celui-ci comme un homme est le réduire à l’appartenance à une espèce animale.
Quels chemins secrets s’ouvrent à méditer la disjonction entre aletheia et veritas ? Cette disjonction nous permet d’éprouver ce qui a lieu sous nos yeux, à savoir le règne de la falsification. De manière plus flagrante que les « mortels à double tête » d’il y a deux mille cinq cents ans, comme dit Parménide, nous sommes plongés dans l’égarement. Quand la falsification devient monde, toute vérité disparaît. Ou plus exactement celle-ci ne persiste plus que dans les équations dont se sert le calcul pour que ça fonctionne. Et de fait, nous vivons dans l’élément de la destruction, mais ça fonctionne mieux que jamais. Ce dont nous sommes coupés, c’est de l’expérience du lethé, celle dont Platon gratifie le guerrier pamphylien qu’il nomme Er. Heidegger nous montre qu’elle n’est pas sans rapport avec l’expérience même de l’aletheia que met en scène le poème de Parménide. Méditer la disjonction entre aletheia et veritas nous remet devant l’expérience de l’aletheia en tant qu’elle est indissociablement celle du lethé.
Malheureusement, tout est fait pour rendre impossible cette méditation. Je me rappelle la remarque de Françoise Giroud quand, dans un film consacré à la porte de l’Enfer de Rodin, j’avais cité deux énoncés de Parménide : « L’être est, le non-être n’est pas. » Autour de ça, vous avez des bibliothèques entières, mais Mme Giroud s’étonna, inconsciente de son ridicule, qu’on puisse citer ce qu’elle appelait des « banalités ». Mme Giroud qui était le journalisme faite femme, trouvait Parménide banal. Sur cette base, comment voulez-vous méditer la disjonction entre aletheia et veritas ? Après tout, le journalisme n’est-il pas une dégénérescence de la veritas ?
Est-ce que les « chemins secrets » dont vous parlez nous concernent aujourd’hui ? Évidemment oui, mais attention : il n’y a pas de « nous ». Chacun est engagé dans la solitude de son destin. Par ailleurs, il n’y a pas des chemins, il n’y en a qu’un : la voie divine qui mène vers la déesse. Ce chemin, il est tout autre, comme dirait François Meyronnis. On peut l’emprunter en portant, comme Yannick Haenel, le masque du Renard pâle. Débrouillez-vous.
Vous avez raison de rappeler que ce cours d’hiver 1942-1943, on peut l’interpréter comme un acte de résistance à l’encontre du nazisme. Je vous l’ai dit : ce cours est exactement contemporain du siège de Stalingrad, qui fut le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Au moment où Heidegger s’exprime, il y a des millions de morts de par le monde. L’Europe d’un bout à l’autre, est dévastée. Nous sommes à la fin de toute une histoire, et cette fin est un oubli du commencement, c’est-à dire un oubli de l’initial. C’était bien le moment de revenir à l’essence grecque de la vérité, puisque l’homme occidental, manifestement, n’en savait plus rien.
Vu depuis Parménide, le bricolage nazi apparaît comme atterrant de bêtise. Heidegger s’en prend à la fois à l’impérialité de l’Église catholique, qui hérite de l’imperium romain, et à l’impérialisme suprêmement bâtard du Reich nazi qui tente de s’imposer à sa place, en concurrence avec la « métaphysique stalinienne », comme il dit.
Le dieu grec ne dicte aucune loi, à rebours du dieu biblique : il se faufile en passant, allusif. Il fait signe de manière furtive. Si vous ne voyez pas les signes qu’on vous adresse, tant pis pour vous. Comme Ulysse, il faut savoir reconnaître la déesse. Le dieu, en effet, est souvent au féminin, et peut prendre la forme d’une hirondelle.
Les cours de Heidegger s’efforcent de penser depuis l’aletheia. Et c’est ainsi qu’ils font revenir les dieux grecs. Vous me demandez : peut-on effectuer cette opération à partir du français, qui est une langue romane ? Bien sûr. Le français est tout à fait capable de tenir ensemble le hors-retrait et la persistance du retrait, sans quoi la vérité n’est pas la vérité. Si nous assistons à une déliquescence à ce sujet, c’est précisément parce que le dire n’est plus à la mesure des dieux.
On peut se tourner vers les dieux grecs à partir d’une langue romane, parce qu’on peut se tourner vers eux depuis n’importe quelle langue. Heidegger, par exemple, le fait à partir de l’allemand. Je crois, quant à moi, qu’on peut les envisager en français mieux que dans n’importe quelle autre langue, car le français, à travers sa littérature, est particulièrement à même de penser la contradiction interne entre le hors retrait et le retrait.
L’une des contestations les plus radicales de Heidegger à l’encontre de l’idéologie nazie, c’est son attaque permanente du biologisme sous toutes ses formes. Or, nous sommes, aujourd’hui, pris dans un biopouvoir triomphant. Sa substance est précisément l’oubli de l’aletheia. On finira par fabriquer de l’étant humain, comme n’importe quoi d’autre. Hitler, comme disait Lacan, a été, sur ce point, un précurseur. Il s’agit moins d’un choix humain que de la technique elle-même dans son déploiement inexorable. Au moment où Heidegger parle, la Shoah est en cours, et la bombe atomique se prépare de l’autre côté de l’Atlantique.
Dans mon roman L’Éclaircie, je cite cette phrase de Heidegger : « Les dieux sont ceux qui regardent vers l’intérieur, dans l’éclaircie de ce qui vient en présence. » J’ajoute que l’éclaircie est également ce qui met à couvert et tourne vers le négatif. Le champ de tension de la vérité suppose ces deux pôles. Sans eux, on se condamne à la bouillie du grand mélange, celui qui prévaut à l’heure de la falsification généralisée. Pourquoi dire la vérité, dans ces conditions, si c’est pour être mal payé ? Faire l’expérience du plus proche est ce qu’il y a de plus difficile, et de moins représentable. Dans mes romans, c’est de cela qu’il s’agit. Prenez par exemple le début d’Une vie divine : « Tout va très vite maintenant, en plein dans la cible. Plus de temps mort, pas un moment perdu, enveloppement, lucidité, repos et vertige. Soleil nouveau chaque jour, bleu, gris, froid, chaud, pluie, vent, c’est pareil. Mais derrière, à chaque instant, la lumière fait signe. »
Le « Dieu » catholique, comme vous dites, ne me semble pas du tout enfermé dans le domaine de l’impérialité romaine puisqu’il est universel. Par la Trinité, il est en effet une circulation d’amour, à la fois un et trine. Il suppose un quatrième terme, la Vierge Marie. Pas de catholicisme conséquent sans l’assomption d’une femme. Sur ce plan, Heidegger est un peu gêné. S’il est exceptionnel dans le rapport de la poésie avec la pensée, s’il comprend en effet l’œuvre d’art comme parole sous-jacente, on voit bien qu’il est plus à l’aise avec l’architecture et la sculpture qu’avec la peinture. Pour le dire en un mot, il manque l’Italie. Son séjour à Venise relève du ratage. Bon, il y a quand même son texte magnifique sur la Madone Sixtine de Raphaël, qu’il retire au musée pour la restituer à son lieu d’origine, une église. Car il comprend que le tableau de Raphaël répond, en tant qu’œuvre, à la messe catholique. Mais la splendeur du catholicisme ne l’émeut pas. Il lui préfère les souliers de Van Gogh.
Pour moi, le français est en état de traduction constant. Toutes les autres langues attendent leur transposition en français pour être améliorées en lui. Deux exceptions : Dante et Shakespeare. Il aurait été difficile d’écrire Paradis dans une autre langue que le français. Ce livre résulte d’une puissance infinie de relance dans la traduction. En général, je trouve que tout est mal traduit. Mais j’ai besoin du grec, de l’hébreu, du chinois, du sanscrit, et je les convoque dans la nervure du français. L’érudition me sert de base, mais ce n’est pas d’elle que je tiens la pulsation grecque de mes phrases. Pourquoi le cacher : aucune langue n’est plus grecque que le français. C’était d’ailleurs l’avis de Nietzsche. Il y a le miracle grec, le miracle italien et le miracle français, et ces miracles communiquent entre eux. L’allemand, lui, reste sur le seuil.
Je suis en effet un traducteur au sens où je me traduis à moi-même ce qui m’arrive en tant que parole. Ce qui signifie que je suis aussi un lecteur constant. Dans un texte très ancien, qui se nomme Logique de la fiction, j’essaie de montrer ce que cela implique. Savoir se traduire, c’est débloquer sans cesse une accumulation de langage en soi, mais c’est aussi passer à travers le parasitage de la parlote sociale. À l’heure du tweet et de Facebook , jamais le parasitage n’a été aussi puissant. Nous avons donc, plus que jamais, à apprendre à lire. La vérité, c’est que nous ne lisons pas encore. Toujours le pas encore de Heidegger, lequel est un des meilleurs lecteurs qui soient, un des meilleurs traducteurs aussi, parfois un peu tordu, mais il fallait retrouver, par cette torsion, le grand rythme grec. Tout arrive à sa place, Pindare, Eschyle, Sophocle, Parménide, Platon, Aristote, etc. Quant à moi, on m’a reproché l’usage fréquent de la citation. Ils ne comprennent pas que citer est un art, qui suppose une mémoire d’autant plus vivante que la crise s’aggrave. Un autre Bordelais, avant moi, Montaigne, s’est trouvé dans la même situation. Il est même allé voir à Rome si le latin et le grec étaient toujours là. Et ils y étaient, sous la protection active du pape, et cela malgré les « innovations calviniennes ».
Se rendre présent au « simple », avec sa parole, rien n’est plus ardu. C’est néanmoins ce que doit réussir tout écrivain. C’est même cela qui détermine s’il en est un ou pas. Rimbaud, dans cette affaire, se détache tout particulièrement. Il lui suffit en effet de peu, comme Parménide, pour transmettre le « simple ». La problématique de Lautréamont est différente : il s’agit, pour lui, de liquider le romantisme en exacerbant ses effets. Le jour où Poésies sera lu, ce pourrait bien être après la fin du monde. Mais Rimbaud, lui, c’est-à-dire le jeune homme de Parménide, avait rendez-vous avec la déesse : « Au réveil, il était midi » (Aube d’été). Ensuite, il n’a eu qu’à s’éclipser.
Quant à l’homme égaré du nihilisme planétaire, qu’aurions-nous à lui dire ? Nous le laisserons à son égarement. On ne va quand même pas lui expliquer comment s’y prendre pour recueillir le « simple ». Franchement, ce serait perdre son temps. Qu’il s’égare, l’égaré ! Il est perdu depuis toujours, et avant même de naître. Pas question de lui enseigner quoi que ce soit. À son endroit, je n’ai aucun fantasme pédagogique. Ce qui appartient à l’égarement doit lui être laissé. Le pauvre Heidegger, en tant que professeur, a dû s’appuyer des séminaires. Il lui a fallu dire « nous », en s’englobant avec les égarés.
Nous sommes en effet, plus que jamais, engagés dans le tourbillon de l’effacement. Le grand thème de Parménide, c’est l’oubli — le lethé. Disons l’« oublire », beaucoup plus terrible que l’oubli : c’est l’oubli qui ne se sait pas en train d’oublier. L’égaré du XXIe siècle s’oublie lui-même dans l’oubli, et là nous atteignons le retrait. Or, c’est ce retrait que le poète doit faire surgir ; c’est lui qu’il doit montrer.
Dans son cours, Heidegger revient sur le mythe, raconté par Platon, du guerrier, mort au combat, et chargé de rapporter « ici » des nouvelles de « là-bas », c’est-à dire du monde des morts. Il le montre cheminant vers la « plaine de l’Oubli », par une « chaleur terrible et étouffante », précise Platon. Mais au lieu de fuser comme une étoile vers sa vie future, le guerrier Er, empêché de boire de l’eau du fleuve Amélès, revient le douzième jour dans son corps sans savoir comment, et rouvre les yeux sur le bûcher qui va le brûler. Il s’agit toujours d’explorer le retrait. L’éclaircie de la présence se met à couvert, de même qu’Ulysse, dans l’Odyssée, se cache. Pour vivre heureux, vivons cachés, dira Épicure. C’est-à-dire en retrait, comme mortels bienheureux. Le bonheur, aujourd’hui, est plus lourd à porter que le malheur. La société vous dira le contraire, en vous vendant ses ersatz, et en vantant la « malheurosité ». Pas de malheur, pas d’authenticité. On me l’a serinée, cette antienne !
Le « simple », Heidegger a raison de l’identifier à l’inquiétant qui brille au cœur du familier. Sa polémique avec Rilke porte sur cette question : pour lui, l’animal n’a pas de regard, parce que le regard est à la fois une voix, un dire, une parole, et il transperce. C’est ce que j’ai essayé de faire comprendre à propos de Manet. Il faut sauter vers le sans-fond. C’est à cela que convoque le regard d’un peintre. Celui qui ne saute pas dans le sans-fond demeure dans l’illusion qu’il y aurait du sol.
Vous avez raison de parler de l’« essence conflictuelle » de l’aletheia. Il y a en elle un conflit permanent entre retrait et hors-retrait. Et cet « esprit de litige », comme dirait Mallarmé, est en effet inhérent à la vérité grecque.
Tout retrait et tout hors-retrait, mieux que toute présence et que toute absence, se déploient en effet avec une « avancée dans la lumière » et simultanément un « recul dans l’obscurité ». Les dieux frôlent êtres et choses, et apparaissent au milieu du familier. Ils font signe depuis l’être, octroyant aux êtres parlants une « expérience de l’obscur, du vide et de la béance ». Ils sont donc, à la lettre, « inquiétants », autant dire qu’ils nous extraient de toute quiétude.
Si vous dites aux humanoïdes du nihilisme que la mort est l’abri de l’être, vous risquez de passer pour fou. Comme vous y allez, rétorquera-t-on. Le nihilisme est une reconduction interminable du mourir, mais qui ne trouve pas la mort. Il échoue devant le retrait infrangible de la mort. Celle-ci devient aussi inessentielle que ses protagonistes attitrés, le sexe et l’argent. L’« annihilation », en revanche, peut être, comme l’indique Heidegger, un « mode du cèlement », et par là de la sauvegarde. C’est le litige entre aletheia et lethé qui comporte cette sauvegarde. Celui qui fait l’impasse sur le retrait tombe dans une fausse interprétation du hors-retrait, et manque la vérité. Pour lui, le litige se transforme en châtiment automatique.
Plus d’une fois, il m’est arrivé, dans certaines circonstances romanesques, de me dire, avec une soudaineté épiphanique : les dieux sont là. Ça fait longtemps que ça dure. Et je les sens alors autour de moi. Le type a sa folie particulière, attention. C’est très court, mais c’est indubitable. Je ne le dis à personne, sauf à vous. Oui, les dieux sont là. De leur venue, on ne décide pas. Ils viennent vous frôler. Mieux vaut être attentif, mais parfois ils mettent à profit votre inattention. Personne ne connaît la mesure qui permettrait de les faire approcher. Votre volonté, en tout cas, échoue à la fournir.
Au cœur du familier brille l’« in-quiétant », c’est vrai. Mais aussi le rassurant. Le « simple » a une apparence qui passe inaperçue, et cela me va très bien. Les Grecs sont des visuels. La parole passe par le regard pour percer l’écran. Les dieux viennent s’offrir et se présenter dans le familier depuis l’« in-quiétant ». Le plus inquiétant, ici, c’est justement qu’ils se présentent dans le familier. Voila peut-être la marque des dieux grecs. Un point encore. Le familier n’est pas nié parce qu’il serait visité de façon inquiétante. Pas du tout. Le familier m’apparaît sans cesse comme quelque chose de bénéfique. Et même de bienveillant. Merci, Haenel et Meyronnis, de votre visite, qui, à la longue, m’est devenue familière, et pas du tout inquiétante, malgré le démonique du « tout autre ».
Les dieux feraient signe de l’étant vers l’être ? Non, c’est l’être qui vient frôler l’étant, qui tout à coup brille et transparaît. Et avec l’être, vous avez simultanément l’abîme et le lumineux.
Suis-je athée ? Soyons clairs : l’athéisme est une faribole. Ni théisme, ni athéisme, et encore moins indifférentisme, dit Heidegger dans une formule que je reprends volontiers. Le pire, c’est encore l’indifférentisme. La pâleur, la mollesse, l’indécision, tout ce qui caractérise l’humanoïde nihiliste. Des athées exempts de superstition, ou de telle ou telle forme de spiritualisme, je n’en connais pas. Il faudrait qu’ils ne disent que des choses parfaitement rationnelles, sans parasitage douteux. Si on gratte un peu, le discours athée n’est jamais rationnel, c’est-à-dire, en l’occurrence, dépendant d’une expérience de la vérité au sens grec. Je ne vois, dans l’histoire récente, qu’un seul athée parménidien : Sollers. Cela donne la mesure de l’obscurantisme ambiant.
Avoir la possibilité d’avancer sur le chemin qui mène à la déesse, c’est ne pas avoir besoin d’être en train d’y croire. La rencontre avec la déesse est une formidable éclosion de la raison. Du logos, si vous préférez. Celui qui est reçu n’est pas forcément un croyant. En tout cas, se tenir près de la déesse, entouré par les filles du soleil, cela vous change de la bousculade humaine. Et que dit la déesse ? « L’Être est, le Non-Être n’est pas. »
Philippe Sollers, Juin 2012.
Ligne de risque 27, questions de François Meyronnis et Yannick Haenel.
L’Infini 121, Hiver 2012.
Complots, Gallimard, 2016.
Lors de la publication du numéro 27 de Ligne de risque, le regretté Frédéric Badré avait posté sur sa page Facebook cette image.
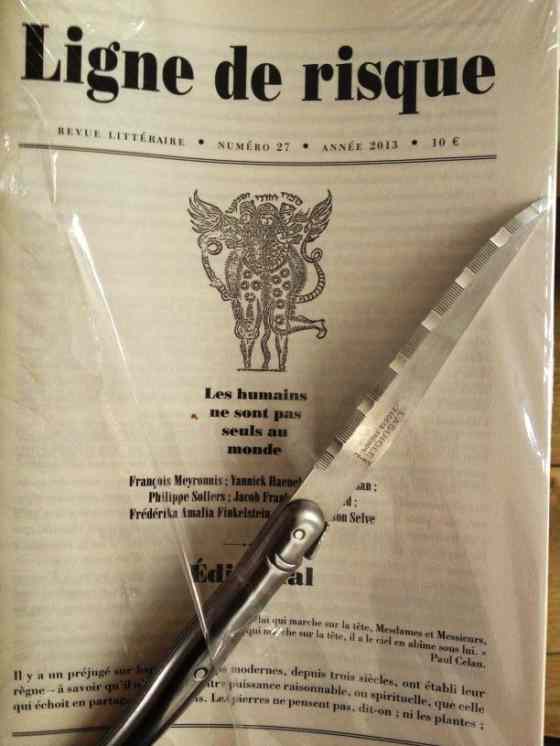
LIRE AUSSI :
 Martin Heidegger, Parménide
Martin Heidegger, Parménide
 Sur les dieux grecs (Heidegger, Parménide et l’hiver 42/43)
Sur les dieux grecs (Heidegger, Parménide et l’hiver 42/43)
 L’Éclaircie : le regard des dieux grecs
L’Éclaircie : le regard des dieux grecs
 Sacré Parménide !
Sacré Parménide !
 La mutation du divin (2005)
La mutation du divin (2005)
 Il faut parler dans toutes les langues (2007)
Il faut parler dans toutes les langues (2007)
 Ulysse et Dionysos
Ulysse et Dionysos
 Marcelin Pleynet, Le Parménide
Marcelin Pleynet, Le Parménide
 Gérard Guest, Reprendre le chemin de Parménide
Gérard Guest, Reprendre le chemin de Parménide
 Beauté — ou l’amour en musique
Beauté — ou l’amour en musique
[1] J’avais longuement analysé ce texte en décembre 2012 dans Sur les dieux grecs (Heidegger, Parménide et l’hiver 42/43). Je le restitue ici dans son intégralité.




 Version imprimable
Version imprimable Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


