Dans sa revue L’Infini, Philippe Sollers accueille « complices ou dévots, gérant l’exégèse du corpus sollersien, et toujours ouverte aux dynamiteurs - lire la lettre fraternelle et salée de Richard Millet à Sollers dans le numéro hiver 2011 » nous dit Jean Marc Parisis, Le Figaro [1].
Suis donc allé rechercher cette lettre. ...Fraternelle ? Oui. Salée ? Vis-à-vis de Sollers ? Non ! J’étais presque déçu, mais cette lettre mériterait d’autres qualificatifs qu’il vous appartiendra de choisir. Elle révèle, à sa façon, l’envers du Spectacle littéraire vécu par Richard Millet, à une génération d’écart de Sollers - celle qui a suivi. Regard décalé dans le temps et l’espace (enfance au Liban pour Millet), avant que les deux écrivains ne finissent par se retrouver côte à côte au comité de lecture de Gallimard...
Pour éclairer plus ces propos, vous propose ensuite, un entretien croisé Richard Millet / Frédéric Beigbeder, Le croisé et le rusé, par Olivier Le Naire (L’Express) et en final, quelques éléments biographiques pour compléter ce portrait singulier qui n’épuise pas le pluriel dans lequel aiment s’ébattre les écrivains - comme le commun des mortels, d’ailleurs...
LETTRE À PHILIPPE SOLLERS SUR LA HAINE ET SUR LE DIABLE
Cher Philippe,
Une journaliste ayant récemment écrit qu’il est de notoriété publique que nous nous haïssons, vous et moi, cette femme se faisant l’écho d’une rumeur à propos de laquelle d’autres échotiers littéraires m’avaient déjà interrogé et s’étonnaient de m’entendre répondre que non seulement nous ne nous haïssons pas mais que vous êtes une des rares personnes, dans la maison où nous travaillons, avec qui je puisse aller à l’essentiel : la littérature, soit ce qu’elle est, et non ce pour quoi on tente de la faire passer, notamment la fausse monnaie romanesque, universellement répandue et toute-puissante alliée des forces du Bien, je voudrais tenter de comprendre qui aurait intérêt à ce que nous le soyons, ennemis, sachant que je ne suis pas plus sujet à la haine qu’aux rivalités littéraires, ayant gardé en cela une forme d’innocence (j’aimerais dire une pureté) qui me permet d’écrire et de vivre librement. Une innocence qui ne m’empêche pas de considérer que j’ai des ennemis, lesquels sont tout d’abord ceux qui nous réputent tels, vous et moi, pour cacher qu’ils nous sont extraordinairement hostiles, eux qui ignorent, par exemple, que nous sommes assis l’un à côté de l’autre, chez Gallimard, dans la salle du comité de lecture, et non par la volonté du prince, mais par un naturel mouvement d’attraction qui nous a placés de la sorte et qui nous permet d’échanger des propos secrets et, souvent, de rire sous cape.
Plutôt que de nommer ces ennemis — leurs visages, leurs patronymes, j’allais dire leur odeur, entrant dans l’insignifiance de mimétismes qui constituent le masque le plus banal —, l’écholalie, la rumeur, la haine du goût et de toute forme de verticalité ayant remplacé la critique littéraire (les journalistes, pour la plupart, ne lisant pas plus les livres que les romanciers ne les écrivent réellement, les uns et les autres entrés dans l’imposture, le journaliste et le romancier s’épaulant, quand ils ne sont pas une même personne, pour produire le corpus romanesque inflationniste et sa glose louangeuse, le métier par ailleurs se féminisant, comme l’enseignement et la police, et la littérature se socialisant sous la forme universelle du divertissement), plutôt que d’en nommer les propagateurs, donc, je vais chercher l’origine de la rumeur, comme au Liban, autrefois, j’apprenais à situer un départ d’obus ou de tirs d’arme automatique, la guerre m’en ayant appris sur l’être humain, particulièrement son abjection, bien plus qu’aucune autre expérience, encore qu’elle ne m’ait pas renseigné sur sa chiennerie comme le milieu prétendu littéraire l’a fait, depuis trente ans que j’y travaille, l’abjection ayant ceci de supérieur qu’elle peut avoir sa beauté, son tragique, non la chiennerie, gui appartient aux esclaves : nos ennemis sont des esclaves, évidemment, c’est-à-dire le petit-bourgeois américanisé et, pour le milieu gui nous occupe, des gens « gui s’accoutument à mal parler et à mal penser » comme disait Pascal, gui savait quelque chose des ennemis et de l’Ennemi. Cela (leur mauvais langage, leur malhonnêteté, la haine qu’ils nous témoignent) suffit à me les rendre méprisables. La haine est le propre du Démon. Je ne hais personne ; je ne puis que mépriser.
A Beyrouth, je n’avais pas de haine pour ceux contre lesquels je me battais ; combattre, c’est justement se placer hors de la haine, dans la pureté des armes et de l’action, et l’on ne parlait pas d’ennemis mais de « ceux d’en face », des « autres », si l’on préfère, avec ce qu’il y a encore d’humain dans ces dénégations.
La haine dont on nous prétend animés l’un envers l’autre n’étant pas fondée (et la rumeur relevant donc du Spectacle, car quel divertissement ce serait, n’est-ce pas, qu’un combat ou une rivalité entre Sollers et Millet !), pourquoi ne serait-elle pas tout son contraire, à savoir que nous sommes le mieux du monde disposés l’un à l’égard de l’autre, pour ne point parler d’amitié, encore que je me méfie de ce mot lorsqu’il est employé par ceux-là mêmes gui nous disent ennemis, lesquels ont à ce point dévalorisé ces vocables que la haine du genre humain semble la seule déclaration qu’on puisse lui faire, Facebook et les autres réseaux de prostitution sociale ayant réduit l’amitié à la même insignifiance que la culture et la vie même. D’aucuns ont tenté de justifier cette prétendue haine par la différence des générations auxquelles nous appartenons, de nos itinéraires et aussi de nos origines : vous, bordelais, anglophile, et supérieurement parisien, c’est-à-dire français (si tant est que l’épithète veuille dire grand-chose, aujourd’hui où l’esprit français — cela même gui fit que ce pays fut grand, comme vous le dites dans ce beau et bref roman sur l’amour et la transmission qu’est l’Étoile des amants — cet esprit est unanimement détesté) ; et moi, originaire de la montagne limousine, presque de nulle part, ayant grandi loin de France, et entretenant avec ce pays et avec Paris des rapports difficiles, n’ayant eu d’expérience politique que les guerres gui ont eu lieu sur le territoire libanais et auprès des que Iles ce gui se passe, en France et en Europe, si tant est qu’il s’y « passe » quoi que ce soit, m’a toujours paru d’une extraordinaire fadeur, laquelle m’a néanmoins donné la désillusion nécessaire à l’écriture, laquelle désillusion n’a rien à voir avec le désenchantement du monde ni le déprimisme nihiliste, qui est une des justifications psychologisantes du Nouvel Ordre moral.
Vous m’avez donc précédé dans le monde, et je suis né trop tard pour l’expérience dite révolutionnaire, mais comprenant assez vite que les seules révolutions susceptibles de m’intéresser sont intérieures, et d’abord la littérature, dont, en prononçant le mot, il me semble évoquer une exigence aujourd’hui à peu près oubliée, sinon perdue, ayant fait mes études à Vincennes, université alors éminemment littéraire, la seule qui ait pu me permettre de devenir ce que je suis, encore que ce fût par défaut, ayant été, à Vincennes, comme je le serais partout, un être distant, et non un clandestin, comme je m’apprêtais à l’écrire, selon un lieu-commun qui dit en vérité non pas une qualité de dissident mais celle d’un poisson tout à fait à l’aise dans les eaux tièdes du Bien. J’étais seul. Je n’ai pas l’expérience des grands hommes, comme vous avec Barthes, Lacan, Derrida, Foucault et bien d’autres. J’ai toujours été seul, sans amis, sans appuis, pénétré de ce sentiment de l’obscur, de l’échec, et de la vanité de toute chose qui est au fond de mes actes les plus éclatants. Sans doute n’ai-je pas aimé Tel Quel comme il l’aurait fallu, cherchant à l’époque tout autre chose, ce que, sans être spiritualiste, on pourrait appeler une voie, ou, comme vous, une « expérience des limites », la littérature ne requérant absolument, vous le savez, que fort peu de personnes, et ce qu’on appelait la « vie littéraire » ne m’intéressant guère : Tel Quel en aura été d’une certaine façon l’ultime manifestation, et ce qu’on appelle aujourd’hui ainsi, en France, n’existant plus que comme « scène littéraire », le Spectacle, qui a remplacé la vie, appelant pour une fois les choses par leur nom. Sur cette scène, vous savez mieux que moi vous jouer de l’ennemi, ayant d’emblée choisi ce beau pseudonyme romain dont l’ignorance contemporaine ne sait même pas qu’il signifie l’habileté, non pas celle du débrouillard, de l’opportun, du courtisan, mais celle du joueur, dont vous avez tracé le portrait, et de l’homme de goût, au sens où le goût est objet de guerre, et son moyen, vous et moi nous rencontrant donc sur le goût et sur la guerre.
Tel Quel , comme toute avant-garde ou travail de groupe, me paraissait loin de mes préoccupations, à moi qui demeurais solitaire, dans la lecture des classiques, cherchant en eux ma langue dans le temps même où vous la réprouviez, au début de 1970, par exemple en déclarant Vauvenargues le parangon d’une bibliothèque désormais inutile, et appelant à lire les poèmes de Mao Tsé-toung. J’avais dix-neuf ans, quand j’ai lu cette déclaration, évidemment provocatrice, m’assurez-vous, publiée dans un journal qui fait profession de me haïr, et je me souviens de ce début d’après-midi ensoleillé, heure et temps pour moi toujours nauséeux, sur le cours Marigny, à Vincennes, près de la statue d’un général d’Empire unijambiste, et où je ne comprenais pas que le doux Vauvenargues vous parût inutile, heurté par ce refus de la bibliothèque classique, alors que les ennemis étaient ceux qui prostituaient au roman néo-zolien, ou anglo-saxon, la langue des 17e et 18e siècles dans laquelle je cherchais à inventer mon style. Vauvenargues me paraissait plus intéressant que les poèmes de Mao, et ne pas mériter le sort que vous lui réserviez, quoiqu’il m’intéresse en vérité bien moins que Chamfort, Sade, ou encore Joubert, dont on ne sait pas assez qu’il a travaillé avec Diderot avant d’être, parcours très singulier, l’ami de Chateaubriand.
Je vous lisais, nonobstant ; et non seulement Drame, Nombres, mais aussi Logiques, notamment les études sur Dante, Bataille et James : un des livres de vous que je préfère, avec Théorie des exceptions et L’Intermédiaire, livre méconnu et que j’aime parce qu’inclassable autant que pour les textes qui le composent, en particulier la Lecture de Poussin, Bras de Seine près de Giverny, Images pour une maison, et la très ironique Introduction aux lieux d’aisance, récits et essais composant pour moi un « paysage » qui a quelque chose du bonheur que j’attribue aux années 1960, en France, L’Intermédiaire ayant paru en 1963, alors que je vivais à Beyrouth et cette période de mon enfance étant la seule que je puisse dire heureuse, parce que ma mère l’était, et que ce qu’elle lisait alors (Duras, Robbe-Grillet, Butor, et le Sollers du Parc) reste pour moi, et sans trop de surinterprétation, le miroir de son bonheur.
Je n’ai pas publié dans Tel Quel, mais j’ai lu le Mécrit de Roche et Stanze de Pleynet (dont j’aime les livres et avec qui je me flatte aussi, signalons-le à la rumeur, d’entretenir des rapports amicaux), livres qui m’ont fait renoncer à la mauvaise poésie que j’écrivais, alors, sous l’influence de Bonnefoy et de Du Bouchet, ce qui m’a permis d’en venir à la prose — au roman et au récit. J’ai en revanche publié à trois reprises dans L’Infini, le dernier texte, sur Bataille, en 2009 — ce qu’ignorent bien sûr les ennemis. C’est dire si, loin de vous haïr, j’entretiens avec vous, et depuis fort longtemps, un vrai dialogue, celui d’un écrivain avec un autre, qui est l’aîné du premier.
Si nous avons les mêmes ennemis, nos amis ne sont sans doute pas tous les mêmes. Je vois d’ici les indignés, les prudes, les vigilants : « Comment Sollers peur-il accueillir Millet dans sa revue ! » Et d’autres, ombrageux faux amis, tenants d’un académisme post-blanchotien : « Comment Millet peut-il estimer Sollers ? » D’autres encore, envieux, aigris, hystériques : « Voilà bien deux apparatchiks : deux donneurs de leçons, deux dissidents rémunérés par la plus grande maison d’édition française ! » Je ne suis pas un homme d’appareil. J’aime l’humilité de ma condition de lecteur, chez Gallimard, maison dans les livres de laquelle j’ai appris à lire. J’aime servir, comme certains moines-soldats autrefois rencontrés à Beyrouth. Je me suis toujours avancé à visage découvert, n’ayant rien à perdre, puisque je n’attends rien de personne, ayant toujours confié ma vie à l’écriture, et ne me souciant pas de ma réputation, laquelle ne peut dès lors qu’être mauvaise, mais ayant trop guerroyé pour ne pas me rappeler qu’un ennemi doit être achevé, si l’on en veut pas risquer de mourir bêtement, mordu par un serpent dont on n’a pas écrasé la tête — et sachant donc tuer.
Nous sommes, vous et moi, les écrivains les plus détestés [2] de la « scène » littéraire française. Dans cette haine il entre, je crois, beaucoup de notre rapport au catholicisme, et ce que vous avez dit du merveilleux Jean Paul II et du très mozartien Benoît XVI n’est pas de nature à vous concilier les belles âmes, en un temps où la haine de l’Église romaine est l’objet d’un consensus quasi parfait qui me conduit à penser que ce sont les mêmes qui haïssent l’Église et la littérature. J’aime pour ma part l’Église dans laquelle je suis né. Et je suis un écrivain. Le catholicisme et la littérature : deux formes d’universalités, à quoi j’ajouterai la musique, sans laquelle je ne puis vivre.
Vous avancez en joueur, moi en guerrier solitaire, ce qui est au fond la même chose. C’est dire mon instinctif dégoût de toute idéologie, de tout parti, de tout militantisme — du social qui hante le roman contemporain, jusque dans le narcissisme : le social comme mauvaise conscience du narcissisme, laquelle ne peut que déboucher sur l’humanitarisme, le progressisme, l’antiracisme, etc. On ne peut être que soi, indéfectiblement, qu’on soit retiré, invisible, ou exposé : la publication est toujours une surexposition, et ce surplomb une souveraineté, plus qu’un point de vue, ce qui suppose des contradictions, des volte-face, des reniements, des changements, tout ce qui permet d’approcher la vérité en un tournoiement infini, n’est-ce pas, comme on combat au coeur d’une ville en se déplaçant avec des pas de danse, la kalachnikov activée en mode rafale, ou encore de la façon dont les derviches s’ouvrent à Dieu en tournoyant sur eux-mêmes.
Il faut cependant, pour comprendre ce que sont vraiment nos ennemis, quitter le terrain social pour aller sur celui du Diable, sur lequel vous vous êtes notamment risqué dans votre conférence au collège des Bernardins, en novembre 2009. J’ai souvent remarqué que ceux qui clament l’inexistence de Dieu ont plus de mal avec le Diable. C’est qu’ils en sont les suppôts, souvent à leur insu, car c’est par négligence qu’on l’accueille en soi, ou en se trompant de vigilance. Mes ennemis, ceux qui me « diabolisent », j’ai tenté de les circonvenir dans un livre, L’Opprobre, sous-titré Essai de démonologie, et je n’ai bien sûr pas été entendu, la surdité volontaire étant, nous le savons, une ruse du démon.
Le Diable ? Il existe, et partout, étant légion, comme son nom [3],

- Cahors, le Pont Valentré (dit aussi Pont du Diable)
- Cahors à droite. Sortie du pont (sur la gauche de l’image). Le sentier GR10 grimpe à flanc de colline vers St Jacques de Compostelle.
La légende veut que le diablotin accroché dans l’angle supérieur de la tour centrale du pont rappelle un pacte avec le diable passé par le maître maçon pour venir à bout des difficultés de construction, en échange de son âme. Mais le maître maçon s’avéra plus malin que le diable, sut détourner le pacte à son profit, ne perdit pas son âme, et en immortalisa ainsi le souvenir.
et nous écoutant, particulièrement là où le Programme, diriez-vous, voudrait non pas nous réduire au silence (le silence n’existant plus dans le monde contemporain, vu qu’il est un élément d’exorcisme, comme le secret, la prière, l’écriture), mais que nous écrivions des romans sociaux, de la poésie ludique, de vertueux traités — que nous sortions de la juste battue du temps qu’est la littérature, dont l’essence, rappelons-le, est musicale. Céline disait que le Diable est né d’une indiscrétion, d’un mot de trop, autrement dit du bavardage, de ce qui advient à la parole dès lors qu’elle est hors du sens, superflue, semblable à ces piaillements d’oiseaux où les Grecs voyaient la barbarie des autres langues. La plupart des romans contemporains sont pris dans le vertige de l’indiscrétion, et innombrables comme ces pierres du désert que le Diable suggérait à Jésus de transformer en pains. Nous ne mangeons pas de ce pain-là.

- La tentation sur la montagne par Duccio (v. 1310)
- Matthieu 4:1 - 11 : « Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu... »
Nous ne nous prosternons pas non plus devant Satan pour obtenir les richesses. Nous ne nous précipitons pas dans le vide pour quêter l’aide des anges. [4]. Nous écrivons : nous attendons les anges. Nous savons qu’ils sont terribles et que dans ce terrible réside leur sourire.
Quant au Diable, pour en risquer une imparfaite définition (l’imparfait étant son apanage jusque sous l’apparence de la perfection), il est l’origine incompréhensible du mal : cela même que je ne puis contempler fixement, comme le soleil, comme la mort ; c’est le soleil et la mort confondus l’un dans l’autre, et roulant sur eux-mêmes dans le vertige de l’absence de sens. Qu’il puisse apparaître, se personnifier, s’incarner, voilà le plus terrible. Le terrible de l’ange, en sa déchéance infinie. Le beau, le laid, le banal ; il est tout cela : Lucifer comme le charretier de Sous le soleil de Satan ; mon prochain aussi bien que qui me trahit ou me hait : la somme de mes adversaires, c’est-à-dire l’Adversaire, qu’on l’envisage comme pure contingence ou bien comme programme nihiliste.
Écrire, c’est vivre, seul, dans l’attente de l’ange, celui-ci venant sous forme de musique, le plus souvent, dans l’intervalle entre le coeur et l’esprit, dans cet empan qui s’ouvre entre l’esprit et la parole. Nul ne comprend plus aujourd’hui le sens de notre solitude, aussi insupportable à l’hédonisme régnant que la guerre et la maladie. C’est dans cette solitude que nous écoutons, lisons, prions, écrivons, rendons proche le lointain et rejetons le trop proche du faux : le Diable, donc, et ses légions de mauvais écrivains qui prétendent à la puissance, ici bas, et à qui Jésus aurait pu répliquer, comme à ceux qui l’accusaient d’avoir guéri un possédé avec l’aide de Béelzébul : « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l’êtes ? Car c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle. » (Matthieu, 12, 34) Paroles magnifiques, extraordinairement véhémentes et douces : l’abondance du coeur contre le sifflement des serpents, et qui vient, dans ce même passage de saint Matthieu, après l’implacable démonstration par laquelle Jésus dit aussi : « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même ; comment son royaume subsisterait-il ? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » (traduction de Segond) Quels pires juges que de mauvais écrivains, n’est-ce pas, l’inacceptable étant de ne pas savoir sa langue, comme dans cette version de Matthieu par un des traducteurs de la Bible dite de Jérusalem, et qui me fait songer qu’un solécisme est un signe du démon, surtout dans ce passage où Jésus guérit un démoniaque gérasénien : « ... et les gens vinrent pour voir qu’est-ce qui s’était passé. » (Matthieu 5, 14). Oui, quels pires fils, que ceux qui refusent les pères, l’héritage, la transmission ! À quoi une autre parole de Jésus fait écho, si célèbre qu’elle est devenus dicton, ce qui est regrettable, car elle est, elle aussi, d’une implacable beauté dans le contexte où se joue le combat de l’Esprit contre le Démon : « Qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui qui n’amasse pas avec moi disperse. » Et justement, nous sommes à l’ère de la grande dispersion : celle du sens.
La plupart des écrivains d’aujourd’hui sont contre nous, parce qu’ils ne sont pas avec nous : ils ne sont pas des écrivains ; c’est dire qu’ils pèchent contre la langue, laquelle seule importe, d’une certaine façon — contrairement à celle dont ces écrivains veulent exister : en oubliant la langue, en faisant comme si elle n’existait pas, ou qu’elle soit un simple outil de communication : autant dire qu’ils s’oublient eux-mêmes, puis-je avancer, notant cela tandis que le soleil se lève, devant moi, entre l’îlot du Grand Ré, où est enterré un des plus grands artiste de notre langue, et Saint-Servan, à droite, où gît la femme qui l’a mis au monde : angle magnifique dans le compas solaire de l’amour filial et de la langue, dans ce nombre d’or de l’écriture, qui constitue la véritable sépulture de Chateaubriand, lequel repose dans le soleil levant dont sa langue a reçu la semence. Les mauvais écrivains, eux, dispersent au lieu de bâtir dans la lumière, et ils écrivent d’une main desséchée, que rien ne guérira. Qu’ils se haïssent les uns les autres, cela semble une loi du milieu littéraire, la plus basse, avec les serpents qui gardent le temple du Nouvel Ordre moral. Elle n’a pas de sens pour nous. Le désert du sens croît. Diviser les justes, multiplier les méchants, voilà à quoi travaillent nos ennemis, multipliant les pierres en lieu et place du pain, et nous reprochant, à vous comme à moi, de trop publier, c’est-à-dire d’exister. Ils voudraient que notre royaume se divise ici-bas et que nous n’atteignions pas au Royaume du Père. Ils prétendent que nous nous haïssons. Je suis pour ma part dépourvu de haine, mais non d’armes. Ils nous prétendent des imposteurs pour faire oublier qu’ils prêchent le faux. Je n’ai pas de posture d’écrivain : j’écris. La guerre n’est pas une posture mais un acte, comme l’écriture. Elle seule me définit, ou me vouera à l’oubli. Du moins serai-je resté fidèle à la douceur terrible de l’ange qui est en moi.
Richard Millet
Dinard, août 2010
Crédit : L’Infini N° 113, Hiver 2011.
Face-à-face/ Millet-Beigbeder - Le croisé et le rusé
Par Olivier Le Naire
L’Express, publié le 23/05/2005
A force d’entendre des réquisitoires contre la littérature contemporaine, on finirait par ne plus y faire attention. Sauf quand un écrivain éminent, exigeant et d’ordinaire discret — qui plus est membre du comité de lecture de Gallimard — saisit l’occasion d’un livre d’entretiens autour de son oeuvre pour annoncer la mort prochaine de la littérature française. Politiquement incorrect, Richard Millet — 52 ans et auteur d’une trentaine de livres, dont La Gloire des Pythre et Ma vie parmi les ombres — n’y va pas par quatre chemins. Dans Harcèlement littéraire, il attaque Jean Rouaud, Jean Echenoz, Michel Houellebecq, suspectés de trahir le style et la syntaxe, s’en prend aux auteurs « nothombesques », mais aussi aux éditeurs, aux médias... Pour L’Express, Frédéric Beigbeder, écrivain (il vient de publier L’Egoïste romantique), mais aussi éditeur et critique, a accepté de lui donner la réplique.
Depuis plus de cinquante ans, de Julien Gracq à Pierre Jourde, on n’a cessé d’attaquer la littérature contemporaine ! Qu’aviez-vous à ajouter ?
Richard Millet : Nous sommes entrés dans l’ère du postlittéraire. Les deux mille ans de civilisation qui ont fait ce que nous sommes s’écroulent et il faut cesser de faire semblant de penser que la littérature va toujours exister. Nous vivons une époque intéressante, violente, qui pose des questions à chaque écrivain. La langue bascule dans l’inconnu, l’enseignement ne remplit plus son rôle. On est dans l’ère de la non-transmission, dans l’ère du faux. A quelques exceptions près, ce qui se publie aujourd’hui n’est que de la fausse monnaie. Or jamais on ne l’a autant prise pour de la vraie. L’inflation de livres est une dérive démocratique où s’installe dans l’esprit des gens l’idée que chacun peut écrire et même doit écrire.
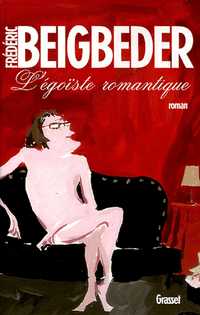
Frédéric Beigbeder : D’accord, la littérature est menacée. Mais, au lieu de vous en prendre à de vrais écrivains comme Jean Echenoz ou Michel Houellebecq, qui secouent le style, remuent des idées et, comme par hasard, vous font de l’ombre avec leur succès, vous feriez mieux de chercher de nouvelles façons de la défendre, cette littérature. Regardez Kundera ! Dans Le Rideau, à partir d’un constat similaire, lui au moins propose des pistes...
Quand Richard Millet attaque la littérature spectacle, vous sentez-vous visé, Frédéric Beigbeder ?
F. B. : Oui ! Et je suis fier d’être assimilé aux dangereux destructeurs de la langue française. Il faudrait même que j’aggrave mon cas ! Plus sérieusement, nos projets, nos tons, nos univers sont différents. Je ne vais pas vous reprocher, Richard Millet, de faire des livres ennuyeux, et vous n’allez pas m’attaquer parce que je donne dans le réalisme.
R. M. : La question n’est pas là ! Le problème, c’est qu’il n’existe plus de hiérarchie des valeurs littéraires, mais une espèce d’aplatissement général où l’on voudrait, par une perversion de l’idée démocratique, que tout se vaille ! Or tout ne se vaut pas et la langue est bel et bien en danger. Bientôt, ce sera tellement plus efficace d’écrire en anglais ! C’est ce qui me gêne chez vous, l’usage des anglicismes, de l’argot branché, de jeux de mots dignes de Libération ou des Inrockuptibles, bref, de la sous-culture.
F. B. : L’écrivain n’a pas qu’un rôle esthétique. Avec mon style syncopé, je décris mon temps, un peu dans la lignée de Stendhal, pour qui le roman est un miroir que l’on promène le long des chemins.
R. M. : Face à l’affadissement général, je préfère, au contraire, adopter le ton le plus éloigné possible du langage courant. Il faut s’insurger par le style, par le déploiement de subordonnées complexes, tout en restant lisible. Voilà ma manière à moi d’affronter la Bête. Je ne suis pas sûr que vous la terrassiez, avec votre espèce de sociologie de l’éphémère.
Le succès de Beigbeder lui permet d’amener la littérature là où elle n’a plus sa place, non ?
R. M. : Aujourd’hui, pour exister, un écrivain a besoin d’une figure, de faire du spectacle. Je n’appartiens à aucune minorité sexuelle ou ethnique, je ne pose pas nu à la télé. Je suis désespérément français dans une France qui n’existe plus, donc je ne suis rien. J’existe uniquement par mes livres.
F. B. : On sent un arrière-goût d’aigreur. Pourtant, si Anna Gavalda ou moi n’existions pas, vos livres ne se vendraient pas plus, hélas pour vous !
R. M. : Je ne suis pas aigri et mes livres ont leur public. Par ailleurs, les gens dont vous parlez ne sont pas pour moi des écrivains, mais des auteurs...
F. B. : Pas d’accord. Par exemple, Gavalda s’inscrit dans une espèce de filiation avec Françoise Sagan...
R. M. :... Oui, c’est-à-dire rien !
F. B. : Votre critère c’est le style, mais le charme, l’émotion comptent aussi, à moins que vous ne preniez cela pour des fariboles journalistiques !
R. M. : Un écrivain, un vrai, met sa vie en jeu au sens où il n’existerait plus s’il n’écrivait pas. Sa quête est presque spirituelle. On est loin des questions de charme ! Sagan, Gavalda et leurs avatars nothombesques sont de la sous-littérature. Ça n’existe pas comparé aux authentiques écrivains. Il n’y a pas deux types de littérature. Il y a la littérature — qui se réduit à quelques noms par siècle — et puis le reste. Le roman est devenu un instrument de promotion sociale comme le rap dans les banlieues !
F. B. : C’est ce qui me gêne à la lecture de votre livre. Ce désir de pureté...
R. M. : Ce mot semble aujourd’hui plus scandaleux que le mot pédophile ! Il y a dans ce pays une telle haine du catholicisme que les termes qui le véhiculent sont considérés comme obscènes. C’est intéressant. La déchristianisation m’amène pourtant, en tant qu’écrivain, à soulever cette question de la pureté.
F. B. : Mais il faut aussi une place pour une littérature d’espièglerie, de liberté. A vous la lourdeur, la pureté, à nous la satire et la frivolité ! Je revendique la futilité comme une valeur essentielle. Au fond, vous voudriez être un écrivain maudit, une sorte d’Antonin Artaud champêtre, mais populaire comme Alexandre Dumas !
R. M. : Je ne cherche pas à être populaire. Je revendique l’élitisme.
F. B. : Pour vous, un écrivain est un résistant dans un bunker, à la manière de Maurice Blanchot ou de Salinger. Mais, si on n’a pas l’ambition de porter son travail devant le public, on risque de contribuer à la disparition de la littérature. Il y a une autre façon de faire, qui joint l’utile à l’agréable, en défendant la place de l’écrit au sein du monde des images. La refuser, c’est se résigner de manière hautaine et puritaine à disparaître comme un dinosaure qui accepterait son sort. Moi, je considère qu’il faut y aller, au risque du ridicule.
R. M. : Les livres, les oeuvres cheminent lentement. Ou on choisit l’immédiateté, avec le danger de perdre son âme, ou on fait le pari du temps. Avec de rares exceptions, comme Philippe Sollers, qui parvient à concilier les deux. Aujourd’hui, tout le monde veut devenir petit-bourgeois, comme chez Balzac. Du coup, le roman contemporain est un roman du XIXe siècle qui se pérennise, qui s’éternise, qui se réplique. On n’en sort pas. Artaud ne pourrait plus vivre et publier en 2005 !
La critique littéraire aussi est condamnée, écrivez-vous...
R. M. : Il n’y a plus de grand prescripteur, de grand critique lecteur à l’image de Roland Barthes par exemple, ni de place dans les journaux pour cela. Nous sommes, avec quelques-uns, les derniers écrivains, et nous vivrons cela de manière héroïque, peut-être même en riant.
F. B. : Dans Voici, j’arrive à parler de Georges Bataille ou de Mikhaïl Boulgakov derrière une couverture sur Steph de Monac’. J’essaie d’être pédagogue et j’en suis fier, quel que soit le nom que l’on donne à cet exercice. Je mets de la littérature partout où c’est possible. C’est ma façon de me battre.
Crédit : http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-croise-et-le-ruse_820531.html
Richard Millet, éléments biographiques

Richard Millet est né en 1953, à Viam, en haute Corrèze. Il a vécu de l’âge de sept à quatorze ans au Liban, pour ensuite rentrer en France, à Paris. Son écriture rend hommage à sa terre natale mais aussi à son pays d’adoption. Il a enseigné les lettres pendant vingt ans avant d’y renoncer pour se consacrer entièrement à l’écriture. Sa carrière littéraire a débuté avec L’Invention du corps de saint Marc, publié en 1983 chez P.O.L Éditeur. Son livre Le sentiment de la langue a obtenu, en 1994, le Prix de l’essai de l’Académie Française. Richard Millet est l’auteur d’une vingtaine de romans, dont Dévorations (2006) et Le goût des femmes laides (2007). Il est également éditeur chez Gallimard , où il a notamment joué un rôle décisif dans la publication du Prix Goncourt 2006, Les Bienveillantes de Jonathan Littell.
En 2005, dans Le Dernier Écrivain et Harcèlement littéraire, il critique une grande partie des écrivains français contemporains qui méconnaissent et bafouent les règles de la langue française. En septembre 2007, la publication de Désenchantement de la littérature, où il fustige une nouvelle fois les manquements des auteurs français contemporains, mais aussi la perte du sentiment religieux en Europe, a suscité de nombreuses critiques dans le monde littéraire. Richard Millet a répondu à ses détracteurs dans un livre paru en mars 2008, L’Opprobre, lui aussi critiqué, qui se présente comme une suite de fragments où l’auteur développe une critique du monde contemporain.
Son oeuvre se construit autour des thèmes du temps, de la mort, de la langue, et n’est pas sans évoquer la démarche proustienne. Son style se veut l’héritier de la grande prose française « de Bossuet à Claude Simon
Crédit : http://auteurs.contemporain.info/richard-millet/
http://www.biographie.net/Richard-Millet
[1] Le Figaro 05/02/2011.
[2] Bernard-Henri Lévy, Michel Houellebecq disent la même chose (note pileface).
[3] Sollers utilise des mots voisins (note pileface).
[4] Matthieu 4:1 - 11 (suite) : Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores. Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. »




 Version imprimable
Version imprimable

 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ? +
+



6 Messages
Le père Arturo Sosa, supérieur général des jésuites, a estimé dans la presse italienne que Satan était une « réalité symbolique ». L’Association internationale des exorcistes s’en est émue, rappelant que l’Église enseigne que le diable est une créature bien réelle.
Gauthier Vaillant,
La Croix, le 23/08/2019
Un détail représentant le jugement des âmes menées en enfer, sur la façade occidentale de Notre-Dame de Paris. Corinne SIMON/CIRIC
ZOOM : cliquer l’image
Qu’a dit le supérieur général des Jésuites ?
En marge du meeting de « Communion et libération » à Rimini, grand rendez-vous annuel des catholiques italiens, le père Arturo Sosa, supérieur général des jésuites, a accordé une interview à l’hebdomadaire catholique italien Tempi, publiée mercredi 21août. Le religieux vénézuélien venait de prononcer une conférence intitulée « Apprendre à regarder le monde avec les yeux du pape François ». L’entretien porte sur divers sujets, les vocations, les migrants, le populisme ou encore le prochain synode des évêques sur l’Amazonie.
La dernière question, beaucoup moins liée à l’actualité, détonne dans l’entretien : « Le diable existe-t-il ? » Une question à laquelle le jésuite répond notamment : « Les symboles font partie de la réalité et le diable existe en tant que réalité symbolique et non en tant que réalité personnelle. »
Ce n’est pas la première fois – et c’est sans doute pour cela que la question lui a été de nouveau posée – que le père Sosa affirmait que le diable n’était qu’un symbole. En mai 2017, dans un entretien au quotidien espagnol El Mundo, il avait ainsi déjà déclaré : « Nous avons créé des figures symboliques, comme le diable, pour exprimer le mal. »
Qu’ont répondu les exorcistes ?
Cette fois, dès le lendemain, jeudi 22août, l’Association internationale des exorcistes a réagi vivement aux propos du père Sosa. Dans un communiqué, cette association fondée dans les années 1990 et approuvée par le Vatican en 2014, qualifie de « graves et déroutantes » les déclarations du supérieur des jésuites, qui se situent « en dehors du magistère » de l’Église.
« La véritable existence du diable, en tant que sujet personnel qui pense et agit et qui a choisi la rébellion contre Dieu, est une vérité de la foi qui a toujours fait partie de la doctrine chrétienne », poursuivent les exorcistes.
À l’appui de cette affirmation, ils citent la Bible, le concile de Latran IV, ou encore des textes officiels du Vatican. Surtout, ils citent le pape François lui-même. De fait, celui-ci prend l’exact contre-pied du père Sosa, notamment dans son exhortation apostolique Gaudete et exsultate, où il écrit à propos du diable (n°161) :
« Ne pensons donc pas que c’est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher l’attention et à être plus exposés. Il n’a pas besoin de nous posséder. Il nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l’envie, par les vices. Et ainsi, alors que nous baissons la garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles et nos communautés, car il rôde “comme un lion rugissant cherchant qui dévorer”. »
Comment expliquer ces divergences ?
Les Écritures et la tradition de l’Église ont constamment enseigné l’existence réelle du diable, « ange déchu », être spirituel (non corporel), personnel, immortel, doté d’intelligence et de volonté. Mais il est vrai qu’après des siècles de craintes entretenues par un imaginaire d’épouvante, la modernité et les progrès de la science ont largement contribué à démythifier le diable, au point que certains catholiques aujourd’hui ont du mal à y voir davantage qu’une expression ou un symbole.
L’Église elle-même a d’ailleurs un peu délaissé la figure de Satan à l’époque contemporaine. « Aujourd’hui, même chez les catholiques, on parle peu ou mal de Satan, car on le situe immédiatement dans les domaines de la superstition ou de la magie », déclarait en 2016 à La Croix le père Jean-Pascal Duloisy, exorciste des diocèses d’Île-de-France.
Mais le pape François, depuis le début de son pontificat, a largement réactualisé la figure de Satan qu’il mentionne très régulièrement dans ses écrits et ses discours. En France, les catholiques s’étaient vus brutalement confrontés à ce nom qui avait pu leur sembler désuet au moment de l’assassinat du père Jacques Hamel par deux terroristes islamistes, en juillet 2016. « Va-t’en, Satan ! » furent en effet les dernières paroles lancées par le prêtre de 86 ans à ses agresseurs avant de mourir. Lui rendant hommage, le pape François avait d’ailleurs qualifié sa mort de crime « satanique ».
Crédit : La Croix
Littérature. Pour un article publié en début d’année, l’écrivain-éditeur a été convoqué par Gallimard en vue de son licenciement.
Par Jérôme Béglé
Le Point.fr, 02/03/2016
Richard Millet est sous le coup d’une procédure de licenciement pour une critique de la littérature francophone. © DR
Peut-on être licencié pour avoir écrit une critique littéraire ? Selon nos informations, Richard Millet a été convoqué par le directeur des ressources humaines de la maison Gallimard pour un entretien préalable. La lettre recommandée invoque même des faits graves qui justifieraient de le mettre à pied. Et donc de le priver de salaire ! Quel est donc l’objet du délit ?
Début janvier, Richard Millet, éditeur majeur de la maison – à qui l’on doit notamment la publication des Bienveillantes, de Jonathan Littell, et de L’Art français de la guerre, d’Alexis Jenni, tous deux prix Goncourt –, publie dans La Revue littéraire des éditions Léo Scheer un texte dans lequel il pourfend les écrivains qu’il considère comme les fausses valeurs de notre littérature. Sa cible préférée est Maylis de Kerangal, romancière éditée chez Verticales, maison appartenant au groupe Gallimard. Mais il s’attarde également sur la littérature dite francophone, en distribuant bons et mauvais points. Le texte de Millet est violent mais brillant, et souvent drôle. LePoint en publie quelques jours plus tard de larges extraits. Et ouvre ses colonnes en février à l’écrivaine Leïla Slimani, qui répond vertement à l’éditeur en l’accusant de misogynie.
« Je suis stupéfait par le procédé, moi qui suis habitué aux débats d’idées et qui ai donné la parole à des auteurs très divers, comme en témoignent les livres que j’ai publiés chez Gallimard, les textes que je sélectionne pour La Revue littéraire, ainsi que ma participation au Point », s’indigne Richard Millet. Fataliste, il poursuit : « Cela fait trois ans que je suis dans le viseur de certains, et je suis fatigué. »
Car on assiste selon lui au second acte d’une pièce commencée en août 2012. Richard Millet publie alors Langue fantôme. Essai sur la paupérisation de la littérature. Il attaque au lance-flammes les auteurs contemporains et affirme déjà que la littérature française n’est plus que l’ombre d’elle-même… Son livre contient un second texte : Éloge littéraire d’Anders Breivik, du nom de ce terroriste norvégien d’extrême droite qui a perpétré l’été précédent des attentats qui ont fait 77morts et 151blessés.
Hypocrisie
À l’invitation d’Annie Ernaux, 120 écrivains – dont Maylis de Kerangal – signent alors un texte, intitulé « Le pamphlet fasciste de Richard Millet déshonore la littérature » et paru dans Le Monde, qui crucifie l’éditeur. Pêle-mêle, on accuse Millet de « faire miroiter la supériorité performative du fusil sur la plume », d’avoir écrit « un pamphlet fasciste qui déshonore la littérature » et n’est qu’« un acte politique à visée destructrice des valeurs qui fondent la démocratie française ». Bref, on prononçait l’excommunication publique du nouveau diable. Des plumes sensibles ne veulent plus cohabiter avec celui qui les a pourtant éditées, aidées et protégées… Gallimard cède et exfiltre Millet de son prestigieux comité de lecture, où il était entré en 2004. Mais comme l’homme a du talent, il continue de lire et de redresser des manuscrits pour le compte de son employeur. Mais de chez lui ! Cette hypocrisie prend donc fin de la plus contestable des manières : par la volonté de le licencier…
Joint au téléphone, Sébastien Abgrall, le DRH de Gallimard, confirme qu’une procédure est en cours contre Richard Millet. « On le regrette, et nous essaierons avec son concours de trouver une sortie honorable. » Quand on lui objecte le droit à la critique, M. Abgrall tient à différencier la critique éditoriale de celle qui vise l’employeur. Et de rappeler que tout salarié a « un devoir de loyauté à l’égard de son employeur, qu’il ne peut ni le dénigrer ni avoir d’intention malveillante à son encontre »
Un détail, mais Biblique néanmoins : le fameux solécisme que mentionne Richard Millet n’appartient pas à l’évangile de Saint Matthieu mais à celui de Saint Marc ! La référence numérique est en revanche exacte. Ainsi, ceux qui ne croyaient pas l’école biblique et archéologique française de Jérusalem capable de laisser passer une aussi grossière erreur pourront aller vérifier que c’est bien le cas... Il est infiniment dommage à mes yeux que l’imprimatur romain ait rendu cette traduction sacro-sainte à la majorité des catholiques du temps : il en existe de si belles, que nul à présent ne lit plus. Sauf peut-être Richard Millet.
En décembre 2007, Le Magazine littéraire s’entretenait avec Richard Millet qui venait de publier Désenchantement de la littéraire et L’Orient désert et Philippe Sollers ses Mémoires et Guerres secrètes. Nous l’avions signalé dans une courte note (voir ici). Le dialogue était amical, mais les points de divergence étaient évidents. Le thème était :
Quel avenir pour la littérature ?
Le Magazine littéraire : Richard Millet, qu’avez-vous pensé des critiques parfois virulentes qui ont accueilli Désenchantement de la littérature ?
Richard Millet : On a attaqué ce texte de façon unanime, en diabolisant et indexant quelques passages pour les monter en épingle. En réalité, si on le lisait bien, on verrait qu’il s’agit d’un texte d’angoisse, qui se projette dans un avenir assez proche — vingt ans, disons. J’expose mes inquiétudes pour l’avenir de la littérature française, qui me paraît menacée. D’abord parce qu’il y a une déperdition linguistique révélatrice d’une crise extrêmement violente. Ensuite parce qu’il y a une coupure historique entre des écrivains de ma génération (ou celle qui précède) et la nouvelle. Nombre de jeunes écrivains utilisent le roman comme instrument de promotion sociale. Qu’un écrivain ait envie d’être connu et lu, c’est une chose tout à fait légitime. Mais nous avons basculé dans l’ordre de la performance — il n’est plus question de faire une oeuvre ou même de se faire remarquer mais de rentrer dans un processus de starification. Le livre est devenu un produit ! À l’époque du XIXe, ce n’était pas le roman qui était un instrument de reconnaissance, mais la poésie, ou le théâtre. Aujourd’hui, c’est le roman qui dévore toute la littérature. C’est pour cela qu’il ne m’intéresse plus - il n’invente plus rien, sauf sa propre perpétuation, illusoire et euphorique.
Et vous, Philippe Sollers, l’accueil de Désenchantement vous a-t-il surpris ?
Philippe Sollers : Je crois que Richard Millet a eu un tort, celui de mêler à ses considérations sur la littérature des idées politiques, et des idées politiquement incorrectes. Elles ont permis à l’opinion, surtout l’opinion militante, se voulant extrêmement engagée, de l’accuser, avec des mots injurieux, d’être révisionniste et d’avoir écrit une immondice ; allant jusqu’à s’en prendre aux éditions Gallimard en s’exclamant : « Comment avez-vous pu publier une chose pareille ?! » Cette immédiateté de la réaction inquisitoriale, et je dirais même stalinienne, m’amène à dire que désormais, n’importe quelle interprétation peut avoir lieu sur des motifs « politiques » - je mets des guillemets - où on accuse d’emblée l’autre de racisme, d’ antisémitisme, etc., et je trouve que ça commence à bien faire. Pas vraiment parce que ça m’indigne « personne ne ment davantage qu’un homme indigné », a dit Nietzsche - mais parce qu’il y a une volonté d’éviter le débat de fond, c’est-à-dire ce que Richard Millet voit comme un désenchantement, un effondrement, une dévastation de la littérature, et sur quoi je suis en partie d’accord. Les réponses que j’ai à donner à ce sujet ne sont pas du même ordre, mais il y a débat, et je crois que tout le monde a intérêt à éviter ce débat, parce qu’on parlerait enfin de littérature.
De fait, Richard Millet, dans Désenchantement de la littérature, vous parlez — en mal — de la démocratie ou de thèmes tels que le métissage. Vous n’hésitez pas à clamer : « Faut-il rappeler que la France est non pas un pays métis ni une société multiculturelle, comme voudraient le faire croire diverses incantations, mais une société de race blanche, de culture chrétienne, avec quelques minorités extraeuropéennes ? »
R.M. : Pourquoi ne devrais-je pas parler de démocratie. Henry James, l’un des auteurs que j’admire le plus au monde, s’est interrogé en tant qu’Américain — c’est-à-dire issu du Nouveau Monde — fasciné par l’ancienne Europe, sur cette question. Tocqueville a fait de même, comme tous les grands réactionnaires, c’est-à-dire au fond les gens les plus intéressants pour la pensée, comme l’a avancé Antoine Compagnon dans Les Antimodernes... Est-ce que le nombre, le système démocratique, n’est pas un danger pour la littérature ? C’est une question qui mérite d’être posée ! Quant au métissage, pourquoi emploie-t-on ce mot, qui est une réalité raciale, à propos de la culture ? J’ai été élevé dans un pays, le Liban, où dix-sept confessions religieuses coexistent, où les gens viennent d’Iran, d’Égypte, d’ex-Républiques soviétiques, et j’ai toujours accepté l’écriture comme n’étant ni identitaire, ni monolithique, ni fermée, mais existant au contraire comme un dialogue avec la totalité de ce qui peut-être vu, lu et entendu dans le monde. Cela posé, je ne vois pas pourquoi on m’obligerait à croire dans cette espèce de nouvelle religion qui serait le métissage, avec cette métaphore raciale qui me déplaît, non en tant que telle, mais parce que c’est devenu une idéologie ! Je n’aime pas qu’on me dise ce qu’il faut que je pense, et je ne comprends pas d’où vient cette hystérie dès qu’on emploie le mot « race »... Que faut-il dire ? Ethnie ? Peuple allophone ? Par ailleurs, d’un point de vue historique et sociologique, la grande majorité de la France est blanche et chrétienne, contrairement au Brésil, par exemple. C’est un fait, je ne porte aucun jugement là-dessus, et la preuve en est qu’on parle de « minorités visibles », pas de métissage. J’appelle un chat un chat, je suis clair. On parle de « France métissée », eh bien non, elle n’est pas métissée, ou en tout cas, elle ne l’est pas encore, c’est tout. Voyez-vous, je viens d’une génération qui n’a pas été formée, intellectuellement, par les mots d’ordre et les diktats du politiquement correct, mais par la raison.
Ph.S. : Mais pourquoi posez-vous, cher Richard, que la littérature dépend de la société, de l’état de la société, de l’état de la nation, alors qu’il s’agit de l’aventure parfaitement individuelle, réfractaire, singulière, et qui résiste à tout ?
R.M. : Mais je ne dis pas autre chose !
Ph.S. : Inutile d’en avoir après la société ou la mondialisation, il faut s’accuser soi-même... Arrêtons de nous plaindre et passons à l’attaque !
R.M. : C’est ce que je fais, mais avec d’autres armes que vous.
Ph.S. : Je vais vous citer : « Nous errons sur une terre saccagée, à peine bruissante... » et je vais renverser la proposition, suivant une technique chère à Lautréamont : figurez-vous que je persiste à vivre dans une terre enchantée, très bruissante, habitant réel de mon propre pays et sûrement pas en proie au doute !
De fait lorsqu’on compare ces deux livres en forme d’autoportrait que vous publiez, L’Orient désert pour Richard Millet, et ces Mémoires, pour vous, on voit que si l’un suit un chemin de croix, l’autre est plutôt dans le mouvement perpétuel. Vous n’êtes pas un admirateur de Nietzsche pour rien...
Ph.S. : Dans L’Orient désert, Richard Millet parle avec émotion et souffrance du désastre libanais qu’il connaît bien, sur fond de crise existentielle et amoureuse. Dans mes Mémoires, c’est exactement le contraire. Je parle, à partir de Bordeaux, d’une enfance parfaitement enchantée, que je perpétue dans la littérature avec une apologie amoureuse. Je crois d’ailleurs que la littérature en elle-même, en tant que désir fondamental d’existence exprimé dans le langage, tient absolument dans cette affirmation amoureuse, et voluptueuse. Richard Millet, quant à lui, est un chrétien doloriste. (sourire) Il se trouve dans un entre-deux, un enfer romantique ; c’est un nihiliste qui ne va pas jusqu’au bout du néant. J’en veux pour preuve la façon dont il recourt au « nous » rhétorique, voire même à des notions comme celle de « nation », qui m’est profondément étrangère. Je n’aime pas le mot « national » Parce que c’est un mot qui repose sur des malentendus parfaitement mortifères, y compris le très récent « ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale ». Richard Millet a tort, à mon avis, de désespérer de ce qui serait la nation, le pays, la langue même. Le problème n’est pas là. Pour moi, la langue française est belle en ceci qu’elle est contradictoire. Il n’y a pas un seul pays qui ait produit une littérature aussi contradictoire, où vous ayez à la fois Claudel et Voltaire, Sade et la marquise de Sévigné. Les autres nations ont des socles : Shakespeare, Goethe, etc. La France est ce pays admirable dont la splendeur tient à la dialectique qui parcourt sa littérature, et elle est en difficulté parce que s’organise une sorte de pensée unique, militante, inquisitoriale. Or vous êtes en danger d’existence lorsque vous n’êtes plus dans des contradictions. Il faut les affirmer.
R.M. : Il me semble néanmoins que, par exemple, sur la question de l’enseignement qui ne transmet plus ...
Ph.S. : Excusez-moi, mais je n’ai jamais appris à écrire dans l’enseignement ! ou alors ça voudrait dire que les gens sont élevés pour devenir écrivains. C’est le contraire. Ils sont élevés depuis toujours pour ne pas devenir écrivains. Puis vous savez, très franchement, je n’ai jamais rien appris de l’enseignement, alors qu’il était encore très respectable dans ma jeunesse. Et je crois que c’est une illusion totale de croire qu’un écrivain vient de l’enseignement. Il vient de lui-même.
R.M. : Bien sûr. Seulement je ne parle pas des écrivains mais des lecteurs, de la menace qui pèse sur le lectorat du fait de l’absence de transmission.
Ph.S. : La littérature a toujours été très peu lue. C’est comme pour l’art. Quand Cézanne dit que l’art s’adresse à un nombre excessivement restreint d’individus, il énonce une vérité profonde. La littérature, comme toute forme d’art, n’est jamais attendue, jamais voulue, jamais acceptée sur le moment.
R.M. : Vous sous-entendez qu’on ne lit pas ; moi je me demande si dans vingt ans, on saura encore lire... Qui sait si le corpus contradictoire et magnifique que vous évoquez ne sera pas évacué ? C’est ce que j’ai constaté, ayant enseigné en collège durant des années. Il n’y a plus grand référent littéraire. Je n’ai jamais cru en un ressourcement dans le passé ; en revanche, je crois à la contemporanéité du passé. J’ai toujours pensé qu’Homère, Dante, Montaigne, Pascal, étaient nos contemporains véritables beaucoup plus que certains « contemporains » au sens strict du terme. Ce qui se dessine peu à peu, dans la non-transmission, c’est que les écrivains d’aujourd’hui n’ont plus ce dialogue avec cette contemporanéité. On prétend tout inventer — quelle illusion ! Peut-être la crise est-elle passagère. Il y a eu à la fin du XVIIIe siècle une crise de la poésie telle que pendant cent ans, il n’y a pas eu de poésie, rien entre La Fontaine et Chénier. J’espère que ce qu’on traverse est du même ordre, mais de fait, ce que je lis dans la jeune littérature me semble indigent, stylistiquement, intellectuellement, référentiellement, spirituellement.
Pour vous, Richard Millet, un écrivain d’aujourd’hui ne peut être à la fois sous la lumière des projecteurs, et dans le même temps construire une ?uvre. Vous pensez que l’écrivain doit être dans une solitude essentielle, tandis que vous, Philippe Sollers, vous n’hésitez pas à utiliser les médias, suivant une stratégie que vous qualifiez de guerrière...
Ph.S. : Pensez à l’esprit des Lumières. Vous n’allez pas me dire que les Lumières se cachaient, sauf ce magnifique fou qu’a été Rousseau, reclus dans sa barque ? S’ils en avaient eu la possibilité, Voltaire et Diderot seraient allés à la télévision pour transmettre leur pensée, quand bien même peu de personnes seraient à même de la saisir ! Dans une émission où il y a, disons, deux millions de spectateurs, je cible les dix mille, ou les deux mille, ou peut-être même la dizaine qui va écouter un propos. Je ne crois pas aux grands silencieux... Hommage du vice à la vertu, n’est-ce pas. (Sourire) C’est d’une hypocrisie glaçante, ou du moins, c’est comme ça que je le ressens.
Pour autant Richard Millet, je ne pense pas que vous alliez rejoindre la stratégie guerrière de Philippe Sollers.
Ph.S. : Non, parce que ça ne lui convient pas !
R.M. : Voilà. IL y a d’autres manières de faire la guerre.
Alors quelle est votre manière de faire la guerre ?
R.M. : J’écris. (Silence). C’est tout.
Vous écrivez et dénoncez ce que vous nommez un « post-humanisme »...
R.M. : Je pense que la période des grands référents gréco-latins — médiévaux aussi, si vous rajoutez Dante et quelques autres — est morte. Or, à partir du moment où vous coupez une culture de sa source, où vous coupez une langue de son référent étymologique sensible, un gouffre s’ouvre. Corneille, Racine, sont aujourd’hui illisibles dans les banlieues ! Je ne parle pas de l’intelligence des élèves, mais du fait que la France a abandonné son héritage en termes de langue et de culture. Dès lors, vous sortez de la verticalité, et vous entrez dans l’horizontalité. Le refus des Humanités, l’affaissement de la syntaxe est, comme disait Orwell, un signe d’ affaissement politique ; d’où l’aplatissement des valeurs, leur confusion, l’évacuation programmée de la littérature...
Ph.S. : Mais non... Vous dites que nous sommes des héritiers sans descendance, que nous sommes seuls, que nous ne sommes pas de vrais pères ? Eh bien, si ! Nous n’avons plus d’autorité sur la langue, nous n’avons plus d’autorité sue la jeunesse, il n’y a plus de hiérarchie des valeurs ? Bien sûr que si ! Nos écrits sont probablement voués à l’oubli ? Pas du tout ! L’Université ne nous sauvera pas ? Mais si, ou du moins ce qu’il en reste ! Vous parlez d’effondrement, je vous rétorquerai que cet effondrement sert nos plans. Vous citez dans votre livre Heidegger — ce qui est courageux — et vous avez raison. Je le citerai à mon tour : « Là où le péril croît, croît aussi ce qui sauve. » L’ouverture du passé — et non le retour vers — l’ouverture du passé vers le présent et l’avenir n’a jamais été aussi grande. Évidemment, il faut une focale plus large, un système nerveux étendu pour s’en apercevoir, mais personne n’a eu une possibilité telle de faire la verticale dans le temps. Tout est à notre disposition, et personne ne sait quoi en faire, voilà le paradoxe.
R.M. : Je dirai même que personne ne veut rien en faire !
Ph.S. : Bien sûr, il reste qu’il y a un danger réel qui tient à des mutations technologiques extraordinairement puissantes. Les conséquences directes font que l’être humain est neurologiquement astreint à ne plus faire ni l’effort de mémorisation des connaissances, ni même celui de la lecture. Si bien que nous affrontons une mutation Technique avec un grand T, pas seulement technologique... C’est là le fond du débat, car un écrivain, c’est d’abord un lecteur, un lecteur permanent, un lecteur essentiel. Écrire et lire, c’est la même chose.
R.M. : La situation est alarmante, vous le dites à votre façon, je la dis à la mienne ; mais c’est sur ce fond-là qu’il faut s’affirmer. Cela dit, je précise que je n’aurais pas écrit Désenchantement de la littérature si je n’avais aucun espoir ; C’était pour moi une manière d’activer la négativité pour entrer dans un processus dialectique... Mais j’ai envie d’entendre chanter des voix, je crois qu’il y en a, et je les attends.
Propos recueillis par Minh Tran Huy, Le Magazine littéraire n° 470, décembre 2007.
De son côté, en mai 2010, Marcelin Pleynet déclarait à La Vie Littéraire :
La Vie Littéraire : Sur le plan de la littérature et ce qui pourrait soulever vos enthousiasmes dans la littérature contemporaine, nous en sommes où ?
Marcelin Pleynet : Ah il y a très peu de monde : il y a Sollers. Et à part lui je ne vois personne.
LVL : C’est vrai ?
MP : Vous savez je travaille chez un éditeur qui publie chaque année un nombre de volumes considérables, et qui arrivent sur mon bureau de L’Infini. Je les consulte, très vite. Il n’y en a pas un pour sauver l’autre.
LVL : A ce point ?
MP : Oui, ce qui vaut pour la peinture vaut pour la littérature implicitement.
LVL : Il y a aussi un certain nombre d’écrivains qui tiennent ce type de discours, au sein même de Gallimard. Richard Millet dit la même chose que vous.
MP : Oui, mais si vous regardez leur littérature, vous vous apercevez qu’elle, ne dit pas cela. La littérature de Millet est très défaitiste au fond. C’est un bon ami, je le connais bien, il va même me publier un livre et m’a invité à faire une conférence sur mon journal intime. Donc je m’entends bien avec Millet. Mais si vous le prenez au sens où je l’entend, c’est une littérature qui est plus opportuniste et défaitiste que réalisatrice. Il n’y en a qu’un qui ne soit pas dans ce cas, c’est Sollers. (La Vie littéraire)
Divergences ou pas, la revue L’Infini a publié aussi Une profanation de Richard Millet dans son numéro 107 (été 2009). Je l’avais signalé le 6 juillet 2009.
Au moment où j’écris ces lignes, Richard Millet est sur le plateau de Ce soir ou jamais. Le débat porte sur l’actualité politique (la Grèce, DSK, les primaires socialistes, pour ou contre le vote blanc, etc.). Décalé, inclassable, s’ennuie-t-il ? Il "avoue" : « je n’ai jamais été inscrit sur les listes électorales, je n’ai jamais voté ». Pessimiste ? désenchanté ? "défaitiste" ? Réfractaire.
« le théâtre d’Artaud est celui du cri » dit-on. Comme le vôtre, il me semble, celui que vous pratiquez en duo avec Jean Marc MUSIA, sur les planches ou via l’expression vidéo, en comédienne ou en réalisatrice. Est-ce un hasard si vos compagnies ont pour nom « Attila », « Terribilita » - la force, le pouvoir et l’esthétique -, si vous vous êtes intéressés au livre testament d’Antonin Artaud « Van Gogh le suicidé de la société », jusqu’à en tirer un monologue interprété par votre duettiste favori, « Van Gogh qui peignait [...] des choses de la nature en pleine convulsion » dit Artaud... Un hasard si vous vous êtes intéressés à Sade, etc., et si votre compagnie « Terribilita » programmait l’été 2010 « Suicide de Sénèque et empoisonnement de Claude »
Vous auriez sans doute à nous dire beaucoup plus sur Artaud que le cri écourté de votre message et nous espérons vous relire dans les pages de pileface.
Pour ce qui est de la publication d’Artaud, on peut quand même noter que quinze ?uvres ont été publiées de son vivant (cf. Wikipedia) et il n’a a pas été complètement absent du théâtre (voir ici - document pdf -). Mais ce qu’il n’a pas obtenu au cours de sa vie, la postérité tend à le corriger, la BnF ne lui consacrait-elle pas une exposition de novembre 2006 à février 2007 (voir ici).
_ Une reconnaissance à laquelle bien des publiés avec notoriété de leur vivant, n’ont pas droit à titre posthume, oubliés par le temps.
Côté psychanalyse, on peut éventuellement lire : « Antonin Artaud et la psychanalyse : pulsion de mort et "tropulsion" - document pdf -, une conférence donnée dans le cadre de la même expostion.
manuscrit présenté à l’exposition BnF
ZOOM, cliquer l’image
"Artaud ne pourrait pas vivre et publier en 2005 " (Millet) - Il n’a pas pu vivre, ni mettre en scène, ni publier à son époque ! Et d’ailleurs Lacan - le fameux Docteur L. gloussant de la glotte - n’y est pas pour rien, mais ça tout le monde s’en fout à cette heure, sauf moi et mon amant.