


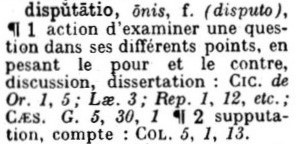
- Félix Gaffiot, Dict. latin-français, p. 542.


Théâtre et politique
VOIR SUR PILEFACE
Il est pour le moins singulier que nous ne nous interrogions pas sur le fait, non moins inattendu qu’inquiétant, que le rôle de leader politique soit à notre époque de plus en plus assumé par des acteurs : c’est le cas de Zelensky en Ukraine, mais la même chose s’était produite en Italie avec Grillo (éminence grise du Mouvement 5 étoiles) et plus tôt encore aux États-Unis avec Reagan. Il est certainement possible de voir dans ce phénomène la preuve du déclin de la figure du politicien professionnel et de l’influence croissante des médias et de la propagande sur tous les aspects de la vie sociale ; cependant, il est clair en tout cas que ce qui se passe implique une transformation de la relation entre la politique et la vérité sur laquelle il convient de réfléchir. Que la politique ait quelque chose à voir avec le mensonge est en fait une évidence ; mais cela signifiait simplement que l’homme politique, pour atteindre des objectifs qu’il considérait de son point de vue comme vrais, pouvait sans trop de scrupules dire une fausseté.
Ce qui se passe sous nos yeux est différent : il n’y a plus d’utilisation du mensonge à des fins politiques, mais, au contraire, le mensonge est devenu en lui-même la fin de la politique. C’est-à-dire que la politique est purement et simplement l’articulation sociale du mensonge. On comprend alors pourquoi l’acteur est désormais nécessairement le paradigme du leader politique. Selon un paradoxe qui nous est devenu familier de Diderot à Brecht, le bon acteur n’est pas, en effet, celui qui s’identifie passionnément à son rôle, mais celui qui, gardant son sang-froid, le tient pour ainsi dire à distance. Il apparaîtra d’autant plus vrai qu’il dissimulera moins son mensonge. La scène théâtrale est donc le lieu d’une opération sur le vrai et le faux, où le vrai est produit par l’exhibition du faux. Le rideau se lève et se ferme précisément pour rappeler aux spectateurs l’irréalité de ce qu’ils voient.
Ce qui caractérise aujourd’hui la politique — devenue, comme on l’a dit, la forme extrême du spectacle — c’est un renversement sans précédent du rapport théâtral entre la vérité et le mensonge, qui vise à produire du mensonge à travers une opération particulière sur la vérité. La vérité, comme nous avons pu le constater au cours des trois dernières années, n’est en effet pas cachée et reste même facilement accessible à qui veut la connaître ; mais si auparavant — et pas seulement au théâtre — la vérité s’obtenait en montrant et en démasquant le faux (veritas patefacit se ipsam et falsum), désormais le mensonge est produit en montrant et en démasquant la vérité (d’où l’importance décisive du discours sur les "fake news"). Si le faux était un moment du mouvement de la vérité, la vérité ne compte plus que comme un moment du mouvement du faux.
Dans cette situation, l’acteur est pour ainsi dire chez lui, même si, par rapport au paradoxe de Diderot, il doit en quelque sorte se dédoubler. Aucun rideau ne sépare plus la scène de la réalité, qui — selon un expédient que les metteurs en scène modernes nous ont rendu familier, en obligeant les spectateurs à participer à la pièce — devient le théâtre lui-même.
Si l’acteur Zelensky est si convaincant en tant que leader politique, c’est précisément parce qu’il est capable de mentir encore et encore sans jamais dissimuler la vérité, comme si cela faisait partie intégrante de son jeu.
Il ne nie pas, comme la plupart des dirigeants des pays de l’OTAN, que les Russes ont conquis et annexé 20 % du territoire ukrainien (d’ailleurs abandonné par plus de douze millions de ses habitants), ni que sa contre-offensive a complètement échoué, ni que, dans une situation où la survie de son pays dépend entièrement de financements étrangers qui peuvent cesser à tout moment, ni lui ni l’Ukraine n’ont de véritable chance. Le fait que Zelensky, en tant qu’acteur, vienne de la comédie est déterminant à cet égard. Contrairement au héros tragique, qui doit succomber à la réalité de faits qu’il ignorait ou qu’il croyait irréels, le personnage comique fait rire parce qu’il ne cesse de montrer l’irréalité et l’absurdité de ses propres actions. L’Ukraine, autrefois appelée Petite Russie, n’est cependant pas une scène comique, et la comédie de Zelensky se transformera finalement en une tragédie amère et bien réelle.
19 janvier 2024
Giorgio Agamben


La boue et les étoiles
- Eugenio Montale en 1965
Tout le monde se souvient de l’anecdote, racontée par Socrate dans le Théétète, de la servante thrace, "spirituelle et gracieuse", qui rit en observant Thalès qui, le regard fixé sur le ciel et les étoiles, ne voit pas ce qu’il y a sous ses pieds et tombe dans un puits. Dans une note du Quaderno genovese, Montale justifie quelque peu le geste du philosophe en écrivant : "Celui qui traîne les pieds dans la boue et les yeux dans les étoiles, c’est le seul héros, c’est le soleil vivant". Que le poète de 21 ans résume et anticipe dans cette note l’essence de sa future poétique n’a pas échappé à la critique ; mais il est tout aussi important que cette poétique, comme toute vraie poétique, implique, pour ainsi dire, une théologie, bien que négative, qu’un érudit attentif a drastiquement résumée dans la formule "théologie de la mie" ("Seul le divin est total dans la gorgée et la mie" — nous lisons dans Rebecca, "Seule la mort le vainc s’il demande la portion entière").
La théologie dont il est question ici, comme le montrent déjà le dualisme "boue/étoile" de la note de jeunesse et les "forces obscures d’Arimane" évoquées dans un discours de 1944, est assurément gnostique. Comme dans tout gnosticisme, il y a deux principes — ou dieux —, l’un bon et l’autre mauvais, l’un absolument étranger au monde et un démiurge qui, au contraire, l’a créé et le gouverne. Dans les courants gnostiques les plus radicaux, le dieu bon est tellement étranger au monde qu’on ne peut même pas dire qu’il existe : selon les Valentiniens, il n’est pas existant, mais préexistant (proon), pas principe, mais pré-prince (proarche), pas père, mais pré-père (propator). Et de même qu’il est étranger au monde, il est aussi étranger au langage, comparable à un abîme (bythos) intimement lié au silence (sige) : "Le silence, mère de tout ce qui émane de l’abîme, dans la mesure où il ne pouvait rien dire de l’ineffable, se taisait ; dans la mesure où il le comprenait, il le qualifiait d’incompréhensible". La théologie négative ou apophatique, chère à Montale dès les Ossi ("Ce n’est qu’aujourd’hui que nous pouvons vous dire / ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne voulons pas") n’est, en ce sens, que l’autre face de la gnose. Le dieu préexistant nomme en effet, selon toute évidence, le stade antérieur à la révélation et l’événement de langage qui définit la condition humaine (anthropogenèse).
Le christianisme tente de s’accommoder du dualisme gnostique en identifiant le dieu bon, le Père, avec le créateur, mais, pour s’accommoder de l’élément maléfique supprimé, il doit alors assumer l’incarnation dans un fils qui, en tant que Christ, c’est-à-dire Messie, a pour tâche de sauver et de racheter le monde.
Le grand thème gnostique, dans la mesure où il nous concerne encore, montre qu’il y a dans l’homme un élément étranger et un élément terrestre, un principe bon et un principe mauvais, et que la vie humaine est donc déterminée du début à la fin par le conflit et la réconciliation possible de ces deux éléments opposés. Il s’agit d’une tâche ardue et onéreuse, car les deux principes — la boue et les étoiles — sont si intimement liés dans l’existence terrestre qu’il est pratiquement impossible de les démêler. Selon la théologie gnostique, dont le christianisme hérite au moins en partie sans bénéfice d’inventaire, le monde est le résultat d’une déjection ou d’un jet (katabolé ou probolé) de la sphère céleste supérieure vers la sphère matérielle inférieure. Origène, reprenant les traditions gnostiques, précise qu’"en grec katabolé signifie plutôt jeter (deicere), c’est-à-dire rejeter. Les âmes ont été jetées contre leur gré de la sphère supérieure dans la sphère inférieure et "revêtues de corps plus épais et plus durs (crassioribus et solidioribus)" et c’est pourquoi "toute créature nourrit l’espérance d’être libérée de la corruption" (référence à Rom.8,20 8,20 : "la créature a été soumise à la vanité sans le vouloir"... et attend, en gémissant et en espérant, d’être libérée de la corruption) ; mais pour le gnostique, la libération ne peut consister qu’à recueillir patiemment les étincelles et les parcelles de lumière divine qui ont été mélangées dans les ténèbres, à les séparer une à une de la fange et à les ramener dans leur patrie céleste.Le fait que la culture moderne, dont le gnosticisme montalien n’est ici qu’un cas exemplaire, soit traversée et entremêlée de motifs gnostiques est évident dans le fait que même le chef-d’œuvre de la philosophie du XXe siècle définit la condition humaine par le terme Geworfenheit (être jeté), qui, selon toute évidence, n’est rien d’autre qu’une traduction du katabolé d’Origène et du probolé des Valentiniens. Mais un motif gnostique était également présent dans une certaine mesure dans la philosophie platonicienne, non seulement dans l’image des deux chevaux différents qui rendent la conduite du char de l’âme inconfortable et douloureuse dans le Phèdre, mais aussi dans l’anecdote du Théétète avec laquelle nous avons commencé et dans le mythe de la caverne dans la République. Le problème est toujours pour l’homme de concilier des éléments incompatibles, le noir et le blanc, la boue et les étoiles, l’obscurité de la caverne et la splendeur du soleil. Le bien, en effet, est toujours mêlé au mal et ne peut se donner que comme une parcelle, un interstice ou une miette de lumière confondue dans l’obscurité : comme un iris dans la boue, selon l’image perspicace de l’un des poèmes suprêmes de Montale, L’anguille. Non seulement, comme l’anguille (qui est d’ailleurs une parfaite anagramme de "la langue"), "l’étincelle" ou "le bref iris" du bien n’existe que "filtrant / entre des gorges de vase", entre "la sécheresse et la désolation", mais le risque ici est que le gnostique, qui doit séparer les étincelles de lumière emprisonnées dans la vase, finit par transformer en idole les ténèbres qu’il a dû fuir.
En effet, à l’origine du dualisme du bien et du mal et de leur confusion, aucun des deux principes n’est en mesure de s’accommoder de l’autre. L’étincelle de lumière s’est tellement empêtrée dans la boue qu’elle ne peut s’en détacher entièrement, pas plus que la boue ne peut se défaire entièrement de l’iris qui l’entoure si affectueusement. Dans le paradigme gnostique, ils forment, comme on dit, un système, et l’imprudent qui s’efforce de les ramener à leur prétendue séparation originelle ne peut que se retrouver les mains vides. Ainsi, le poète aux pieds dans la boue, qui tente héroïquement de garder les yeux fixés sur les étoiles, n’est plus en mesure de les séparer de la boue, dont elles ne sont qu’un iris ou une lueur. Il n’est plus capable de s’extraire de la fosse dans laquelle, comme Thalès, il a glissé. Zanzotto a eu raison de définir l’univers de Montale en écrivant que pour lui "la destinée humaine est de "s’enterrer", de se réduire à un sédiment, à "moins que ce / t’ha rapito la gora che s’interra", c’est de se découvrir comme inertie visqueuse et douloureuse... dans la matrice effrayante d’une vérité toute et seulement terrestre...". En fait, on devrait dire qu’il est "terreux", comme est terreux l’homme de Montale, fait d’une boue qui germe presque par hasard dans la vie, mais qui a toujours tendance à retomber en elle-même. L’ange qui devrait racheter cette vie enfouie n’est plus, comme dans le poème éponyme de 1968, qu’un "ange noir", "ni céleste ni humain", "de cendres et de fumée" ou, comme dans un poème ultérieur, une "coquille inexprimable". Et il est significatif que la motivation du prix Nobel décerné au poète en 1975 mentionne expressément "une vision de la vie dépourvue d’illusions" — l’illusion en question étant que les étoiles puissent jamais être séparées de la vase. Peut-être qu’en inversant la devise de la jeunesse, il aurait mieux valu pour le poète — comme pour tout homme — garder les pieds dans les étoiles et les yeux dans la boue.
L’évocation du "pauvre Nestorien perdu" dans Iris, le poème qui ouvre la section Silvae de La Bufera, nous permet de préciser la nature particulière de la "gnose" de Montale, qu’il nous intéresse de définir plus précisément ici. Les disciples de Nestor, patriarche de Constantinople de 428 à 432 et condamné comme hérétique au concile d’Éphèse (431), affirmaient la présence dans le Christ de deux natures, la divine et l’humaine, mais niaient leur union hypostatique, c’est-à-dire ontologique, en une seule personne (ou ypostasis). Contrairement aux monophysites, qui ne reconnaissaient que la nature divine dans le Christ, Nestorius affirmait, comme son adversaire Cyrille, patriarche d’Alexandrie, le diphysisme, mais ne comprenait pas l’union des deux natures, selon le modèle que Cyrille parvint à imposer à Rome, kath’ypostasin, c’est-à-dire ontologiquement en une seule essence, mais seulement au sens moral, pour ainsi dire, à travers la personne (prosopon) du Christ, à la différence de l’ypostasis. La dualité l’emporte donc en quelque sorte sur l’unité, qui, confiée uniquement à la personne morale du Christ, est en quelque sorte affaiblie ; c’est pourquoi les nestoriens ont été accusés à tort de professer deux personnes dans le Christ.On comprend alors la fascination de Montale pour le "pauvre Nestorien" : l’union entre l’humain et le divin, la boue et les étoiles, ne s’accomplit jamais une fois pour toutes, mais seulement, instantanée et imparfaite, "dans la gorgée et dans la mie". Dans l’Entretien imaginaire de 1946, Montale l’affirme sans réticence en commentant la figure féminine d’Iris, "continuatrice et symbole de l’éternel sacrifice chrétien" : "Celui qui la connaît est le nestorien, l’homme qui connaît le mieux les affinités qui lient Dieu aux créatures incarnées, et non le spiritualiste stupide ou le monophysite rigide ou abstrait. L’affinité n’est pas une union hypostatique, par essence et par nature, mais une affinité difficile et jamais définitive "dans la nuit du monde", "parce que", conclut le poème, défini dans l’entretien "en clé, terriblement en clé", "Son œuvre (qui dans la vôtre / se transforme) doit être poursuivie". La rédemption, la reconnaissance et le retour à l’origine des étincelles de lumière mêlées à la boue ne se terminent jamais, elles doivent être sans cesse reprises. Du moins jusqu’à ce que, à partir de Satura, le poète abandonne sa théologie gnostique et avoue ouvertement son scepticisme, voire son désespoir. S’il y a un Dieu, c’est un Dieu "qui ne conduit pas au salut parce qu’il ne sait / rien de nous et évidemment / rien de lui-même".
C’est pourquoi les théologiens reportent astucieusement, mais non sans une bonne dose d’hypocrisie, leur détachement définitif au paradis à venir, lorsque le corps ressuscité, devenu spirituel, montrera sa gloire et que l’iris ne sera plus qu’une auréole autour de ce qui fut le limon de la chair. Il ne s’agit pas ici d’un manque de foi, ce dont les hommes sont toujours coupables. Si la foi est, selon l’apôtre, "l’existence des choses qu’on espère", le poète, comme peut-être tout homme, ne croit pas assez aux choses qui semblent ne pas exister et qui sont au contraire plus réelles que celles qui semblent exister et, comme le suggèrent les théologiens, doit reporter les choses espérées à un autre monde.
Contre cette impossibilité pour la gnose d’assumer son dualisme irréductible, il faut d’abord soulever une objection politique. Et si la stratégie doit être politique, un premier mouvement tactique consistera à déplacer ici et maintenant tout ce que les théologiens renvoient au futur paradis. Si le corps glorieux exhibe tous ses organes, y compris ceux de la reproduction et de la défécation, au paradis, alors il convient d’arracher cette gloire hypothétique au futur et de la ramener à sa seule place possible : notre corps, ici et maintenant. Le corps glorieux n’est pas un autre corps, c’est le corps lui-même, libéré du sort qui le sépare de lui-même, qui sépare la boue des étoiles, la lumière de l’obscurité. Tout, comme l’enseignent les Chassidim, peut être une étincelle de divinité et, comme le suggère le langage cru et moqueur du Talmud, "trois choses anticipent le temps à venir, le soleil, le shabbat et le tashmish", un mot qui signifie à la fois l’union sexuelle et la défécation.
VOIR SUR PILEFACE
Si le bien est mélangé au mal, si l’iris ne peut être séparé de la boue, cela ne signifie pas qu’ils n’existent que négativement. Au contraire, l’iris et la boue sont tous deux des modes ou des modifications de Dieu, chacun exprimant — différemment, mais de la même manière — sa substance. Le dualisme gnostique se ruine et s’anéantit dans la formule Deus sive natura, dans laquelle sive n’efface pas la différence, mais la transforme en tâche politique, pour ainsi dire. Sive est étymologiquement lié à la conjonction sic, qui signifie "ainsi" (d’où le "sì" italien comme expression de l’assentiment). Sive est le "ainsi" de la substance divine, son simple don de soi, sa con-sentence à elle-même. Mais le lieu de ce sive, de ce "ainsi" et de cet assentiment, est en chaque homme, qui seul peut donner existence ici et maintenant aux choses espérées. Dieu est la nature, les étoiles sont la boue, non par une identité absurde, impossible, mais parce que l’homme leur offre le lieu de leur consentement mutuel, de leur accord ardu mais simple. Les ténèbres — comme l’a suggéré un autre poète — sont l’œuvre de la lumière et rien de ce qui se passe dans le monde ne peut se passer de leur collaboration, dont chaque homme est l’hôte et le halfling. Il faut relire dans ce sens le précieux Piccolo testamento qui conclut La bufera et qui contient peut-être le témoignage le moins insaisissable, bien que contradictoire, du credo politique de Montali. Si l’iris est ici le "témoignage / d’une foi pour laquelle on s’est battu, / d’un espoir qui a brûlé plus lentement / qu’une bûche dure dans l’âtre", alors il ne peut être vrai, comme le poète semble aussi immédiatement le suggérer, qu’"une histoire ne dure que dans les cendres / et que la persistance n’est que l’extinction". Dans les vers qui concluent le testament, Montale trouve en effet, pour la première et peut-être la dernière fois, la colonne vertébrale d’une affirmation explicitement politique : "Chacun reconnaît les siens : l’orgueil / n’était pas un vol, l’humilité n’était pas / vile, la faible lueur frottée / en bas n’était pas celle d’une allumette".
29 janvier 2024
Giorgio Agamben


L’expérience de la langue est une expérience politique
Comment serait-il possible de changer véritablement la société et la culture dans lesquelles nous vivons ? Les réformes et même les révolutions, tout en transformant les institutions et les lois, les relations de production et les objets, ne remettent pas en question les couches plus profondes qui façonnent notre vision du monde et qu’il faudrait atteindre pour que le changement soit vraiment radical. Pourtant, nous faisons l’expérience quotidienne de quelque chose qui existe d’une manière différente de toutes les choses et institutions qui nous entourent et qui les conditionnent et les déterminent toutes : le langage. Nous avons avant tout affaire à des choses nommées, mais nous continuons à parler à voix basse et au fur et à mesure, sans jamais nous demander ce que nous faisons lorsque nous parlons. Ainsi, c’est précisément notre expérience originelle du langage qui nous reste obstinément cachée et, sans que nous nous en rendions compte, c’est cette zone opaque à l’intérieur et à l’extérieur de nous qui détermine notre façon de penser et d’agir.
La philosophie et le savoir de l’Occident, confrontés à ce problème, ont cru le résoudre en supposant que ce que nous faisons quand nous parlons, c’est mettre en œuvre une langue, que le mode d’existence de la langue, c’est une grammaire, un vocabulaire et un ensemble de règles pour composer des noms et des mots dans un discours. Il va sans dire que tout le monde sait que si nous devions à chaque fois choisir consciemment des mots dans un vocabulaire et les assembler tout aussi consciencieusement dans une phrase, nous ne pourrions pas parler du tout. Pourtant, au cours d’un processus séculaire d’élaboration et d’enseignement, la langue-grammaire nous a pénétrés et est devenue le puissant instrument par lequel l’Occident a imposé son savoir et sa science à la planète entière. Un grand linguiste a écrit un jour que chaque siècle a la grammaire de sa philosophie : l’inverse serait tout aussi vrai et peut-être plus encore, à savoir que chaque siècle a la philosophie de sa grammaire, que la façon dont nous avons articulé notre expérience du langage dans une langue et dans une grammaire détermine aussi fatalement la structure de notre pensée. Ce n’est pas un hasard si la grammaire est enseignée à l’école primaire : la première chose qu’un enfant doit apprendre, c’est que ce qu’il fait lorsqu’il parle a une certaine structure et qu’il doit conformer son raisonnement à cet ordre.
Ce n’est donc que dans la mesure où nous parviendrons à remettre en question ce postulat fondamental qu’une véritable transformation de notre culture sera possible. Il faut essayer de repenser ce que nous faisons quand nous parlons, entrer dans cette zone opaque et nous interroger non pas sur la grammaire et le vocabulaire, mais sur l’usage que nous faisons de notre corps et de notre voix quand les mots semblent presque sortir tout seuls de nos lèvres. Nous verrions alors que ce qui est en jeu dans cette expérience, c’est l’ouverture d’un monde et de nos relations avec nos semblables, et que, par conséquent, l’expérience du langage est, en ce sens, l’expérience politique la plus radicale.
16 février 2024
Giorgio Agamben


Le crépuscule de l’Occident ?
VOIR SUR PILEFACE
Dans les textes publiés dans cette rubrique, il est souvent question de la fin de l’Occident. Il convient ici de ne pas se méprendre. Il ne s’agit pas de la contemplation résignée — quoique lucide et amère — du dernier acte d’un coucher de soleil que Spengler et d’autres pseudo-prophètes annonçaient il y a trop longtemps. Ils ne s’intéressaient à rien d’autre qu’à ce coucher de soleil, ils en étaient d’ailleurs complices et même suffisants, car dans les havresacs et les coffres-forts de leur esprit, il n’y avait plus rien du tout, c’était pour ainsi dire leur seule richesse, dont ils ne voulaient à aucun prix être spoliés. C’est pourquoi Spengler pouvait écrire en 1917 : "Je souhaite seulement que ce livre puisse être placé à côté des exploits militaires de l’Allemagne sans en être tout à fait indigne".
Pour nous, au contraire, la mort de l’Occident est l’utopie heureuse, quelque chose comme la glèbe brisée et le désert de sable, dont notre espérance a besoin non pas pour y trouver quelque nourriture, mais pour y reposer ses pieds, en attendant de la jeter aux yeux de nos adversaires à la première occasion. La mort de l’Occident nous a privés de tout ce qui est vivant et essentiel, et la nostalgie n’est donc pas de mise. Et l’espoir ne nous intéresse que comme voie d’accès à quelque chose que nous connaissons déjà, parce que nous l’avons toujours eu et que nous ne voulons pas y renoncer. C’est le rayon de lumière vertical qui surgit de l’horizon plat et morne de l’Occident. Mourir ici ne peut être que pour ceux qui étaient déjà morts, vivre que pour ceux qui ont toujours vécu.
19 février 2024
Giorgio Agamben
Article précédent : Les années 30 sont devant nous
[1] Concernant le premier texte, « Théâtre et politique », je le dis sans plus attendre : on peut regretter qu’Agamben, si ironique à l’égard de Zelinsky, n’ait pas eu un mot contre le tyran Poutine (qui entend mettre la main sur la « Petite Russie ») et que sa voix se soit inquiété, à juste titre, du sort de l’Arménie (cf. Un autre silence
 ), mais se soit tue aussitôt après le pogrom antisémite perpétré le 7 octobre 2023 en Israël par les terroristes du Hamas. A moins que cela m’ait échappé. La profondeur de ses analyses mérite, cependant, une lecture serrée.
), mais se soit tue aussitôt après le pogrom antisémite perpétré le 7 octobre 2023 en Israël par les terroristes du Hamas. A moins que cela m’ait échappé. La profondeur de ses analyses mérite, cependant, une lecture serrée.




 Version imprimable
Version imprimable


 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


