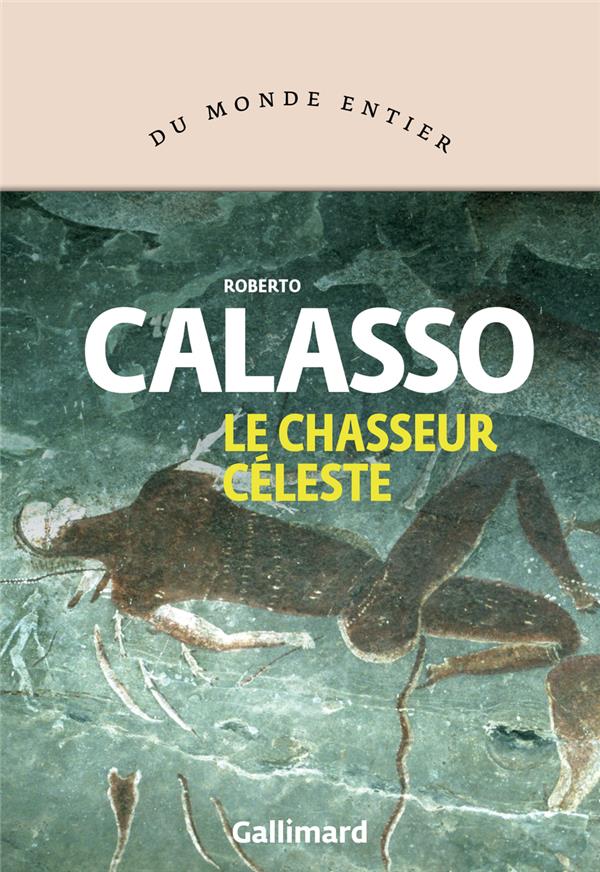
Du divin et des dieux
« Le dernier dieu est nouveau en ce sens qu’il ne ressemble à aucun autre. Ce n’est pas un retour des Dieux grecs. Les pauvres, ils sont exilés très loin et j’en souffre d’ailleurs personnellement. Surtout les déesses, dont on ne parle jamais, et pour cause… Le dernier Dieu ça serait donc quelqu’un… quelqu’un… disons une présence telle qu’elle s’imposerait à celui qui la perçoit.
Il y a un livre extraordinaire dont personne ne parle évidemment, Le chasseur céleste de Roberto Calasso qui connaît parfaitement cette affaire. Il est d’une érudition fabuleuse concernant les dieux grecs et latins. Je compte republier dans la revue l’Infini le dernier chapitre qui s’appelle Retour à Éleusis. Voilà, il faut savoir réinterpréter les Dieux anciens. Avec un dernier dieu tout à fait nouveau et imprévu, vous pouvez passer à travers tout le divin possible et imaginable, que ce soit le dieu hébraïque ou l’extraordinaire fourmillement des Vedas etc. Autrement dit, il faut quand même ouvrir un jour ou l’autre — ou écouter, en lisant — Paradis 1 et Paradis 2 [1]. »
J’ai présenté il y a deux ans l’essai de Roberto Calasso L’innommable actuel [2], neuvième partie d’une oeuvre commencée il y a plus de trente-cinq ans avec La ruine de Kasch (La rovina di Kasch, 1983 - Gallimard, 1987). Les éditions Gallimard ont publié il y a quelques mois la huitième partie : Le chasseur céleste. Comme pour l’essai précédent, peu de critiques dans la presse française [3]. En attendant la publication, dans un prochain numéro de L’Infini, de Retour à Éleusis, le dernier chapitre du Chasseur céleste, voici, si vous n’avez pas déjà le livre, les extraits des premiers chapitres que nous permettent de découvrir les éditions Gallimard. Mais, en préparant cet article, j’ai découvert une vidéo du 29 mars 1988 qui me parait une bonne introduction au sujet puisqu’il y ait question des bibliothèques et de la lecture.
A propos de la bibliothèque idéale
1988. Sont réunis au centre Georges Pompidou, autour de Pierre André Boutang (producteur de l’émission Océaniques) : Michel Serres, Philippe Sollers, Roberto Calasso, Gilles Lapouge, Emmanuel Le Roy Ladurie, Christian Bourgois et Alain Jaubert. Ils donnent leur conception de la bibliothèque idéale, parlent des grandes bibliothèques qui ont marquées l’histoire, de la lecture et des types de lecteurs, du plaisir de lire.


Le Chasseur Céleste est la huitième partie d’une œuvre en cours commencée avec La ruine de Kasch (Du monde entier, 1987). Chez Gallimard :
I – LA RUINE DE KASCH
II – LES NOCES DE CADMOS ET HARMONIE
III – KA
IV – K .
V – LE ROSE TIEPOLO
VI – LA FOLIE BAUDELAIRE
VII – L’ARDEUR
VIII – LE CHASSEUR CÉLESTE
IX – L’INNOMMABLE ACTUEL

Roberto Calasso
Le chasseur céleste
[Il cacciatore celeste]
Trad. de l’italien par Jean-Paul Manganaro
Collection Du monde entier, Gallimard
Parution : 12-11-2020
Il fut une époque où, si l’on rencontrait d’autres êtres, on ne savait pas avec certitude s’il s’agissait d’animaux ou de dieux ou de seigneurs d’une certaine espèce ou de démons ou d’aïeux. Ou simplement d’hommes. Un jour, qui dura plusieurs milliers d’années, Homo fit quelque chose que nul autre n’avait encore jamais tenté. Il commença à imiter ces animaux qui le poursuivaient : les prédateurs. Et il devint chasseur. Ce fut un long processus, bouleversant et irrésistible, qui laissa des traces et des cicatrices dans les rites et dans les mythes, ainsi que dans les comportements, se mêlant avec quelque chose qui, dans l’ancienne Grèce, fut appelé « le divin », tò theîon, différent mais présupposé par le sacré et par le saint et précédant même les dieux. De nombreuses cultures, éloignées dans l’espace et dans le temps, associèrent quelques-uns de ces événements, dramatiques et érotiques, à une zone du ciel, entre Sirius et Orion : le lieu du Chasseur Céleste. Ses histoires sont tissées dans ce livre et se déploient dans de multiples directions, du Paléolithique à la machine de Turing, en passant par l’ancienne Grèce et l’Égypte et en explorant les connexions latentes à l’intérieur d’un même territoire impossible à circonscrire : l’esprit.
Roberto Calasso est né à Florence et vit à Milan, où il dirige les Éditions Adelphi. Son œuvre est traduite en français aux Éditions Gallimard, notamment, dans la collection « Du monde entier », La ruine de Kasch (1987), Les noces de Cadmos et Harmonie (1991), prix du Meilleur Livre étranger, Ka (2000), K. (2005), Le rose Tiepolo (2009), La Folie Baudelaire (2011), prix Chateaubriand, L’ardeur (2014) et L’innommable actuel (2019).


« Qu’est-ce que le dieu ? Qu’est-ce qui n’est point le dieu ?
Qu’y a-t-il entre ces deux termes ? » Euripide, Hélène


AU TEMPS DU GRAND CORBEAU

Au temps du Grand Corbeau, même l’invisible était visible. Et il se transformait continuellement. Les animaux, alors, n’étaient pas nécessairement des animaux. Il pouvait se trouver qu’ils fussent des animaux, mais aussi des hommes, des dieux, les seigneurs d’une espèce, des démons, des ancêtres. Ainsi les hommes n’étaient pas nécessairement des hommes, ils pouvaient être aussi la forme transitoire de quelque chose d’autre. Il n’y avait pas de procédés pour reconnaître qui apparaissait. Il fallait déjà le connaître, comme l’on connaît un ami ou un adversaire. Tout avait lieu à l’intérieur d’un flux unique de formes, des araignées aux morts. C’était le règne de la métamorphose.
Le changement était continu, comme cela n’arriva par la suite que dans la caverne de l’esprit. Choses, animaux, hommes : des distinctions jamais nettes, toujours provisoires. Quand une vaste partie de l’existant se retira dans l’invisible, il ne cessa pas pour autant d’avoir lieu. Mais il devint plus facile de penser qu’il n’avait pas lieu.
Comment l’invisible pouvait-il redevenir visible ? En animant le tambour. La peau tendue d’un animal mort était la monture, était le voyage, le tourbillon doré. Elle conduisait là où les herbes rugissent, où les joncs gémissent, où même une aiguille ne pourrait s’enfoncer dans l’épaisseur du gris.
Quand elle commença, la chasse ce n’était pas un homme qui poursuivait un animal. C’était un être qui poursuivait un autre être. Personne n’aurait pu dire avec certitude qui était qui. L’animal poursuivi pouvait être un homme transformé ou un dieu ou simplement un animal ou un esprit ou un mort. Et un jour, à leurs nombreuses inventions, les hommes en ajoutèrent une autre : ils commencèrent à s’entourer d’animaux qui s’adaptaient aux hommes, alors que durant un temps très long c’étaient les hommes qui avaient imité les animaux. Ils devinrent sédentaires — et déjà quelque peu moisis.
Pourquoi tant d’hésitation avant d’entreprendre la chasse à l’Ours ? Parce que l’Ours pourrait être aussi un Homme. Il fallait se montrer prudent quand on parlait, car l’Ours entendait tout ce qu’on disait de lui, quand bien même on en fût éloigné. Même quand il se retirait dans son antre, même quand il dormait, l’Ours continuait à suivre les événements du monde. « La terre est l’oreille de l’Ours » disait-on. Quand on se rassemblait pour décider de la chasse, l’Ours n’était jamais nommé. Et en général, si on parlait de l’Ours, on ne le nommait jamais par son nom : c’était « le Vieux », « le Vieux Noir », « le Grand-Père », « le Cousin », « le Vénérable », « la Bête Noire », « l’Oncle ». Ceux qui se préparaient à la chasse évitaient d’ouvrir la bouche. Prudents, concentrés, ils savaient que le moindre bruit suffirait à mettre en péril l’entreprise. Si jamais l’Ours surgit de façon inattendue dans la forêt, il est préférable de s’écarter, d’ôter son chapeau et de dire : « Va ton chemin, très honorable ». Ou alors, ils essaient de le tuer. Tout dans l’Ours est précieux. Son corps est un médicament. Quand ils parvenaient à l’abattre, ils s’enfuyaient aussitôt, à toute vitesse. Puis ils réapparaissaient là, un peu par hasard, comme s’ils étaient en train de se promener. Et ils découvraient stupéfaits que l’Ours avait été tué par des inconnus.
Le premier être divin dont on interdit de prononcer le nom fut l’Ours. De ce point de vue, le monothéisme ne fut pas une innovation, mais une reprise, un raidissement. C’est dans l’interdiction des images que résida la nouveauté.
Ils parlaient avec l’Ours avant de l’attaquer — ou immédiatement après —, sachant que l’Ours comprenait chacune de leurs paroles. « Nous n’y sommes pour rien » disaient certains. Ils remerciaient l’Ours parce qu’il se lais-sait tuer. Souvent ils s’excusaient. Certains allaient jusqu’à dire : « Je suis pauvre, c’est pour cela que je te chasse ». D’autres chantaient, en tuant l’Ours, afin que l’Ours, en mourant, pût dire : « J’aime cette chanson ».
Ils suspendaient le crâne de l’Ours aux branches d’un arbre, parfois avec du tabac entre les dents. Parfois orné de galons rouges. Ils lui accrochaient des rubans, enfermaient ses os dans un ballot et les suspendaient à un autre arbre. Si un os était perdu, l’esprit de l’Ours tenait le chasseur pour responsable. Le nez finissait dans quelque lieu secret, dans la forêt.
Quand ils capturaient un Ourson, ils l’enfermaient dans une cage. Il était souvent allaité par la femme du chasseur. Il grandissait ainsi, jusqu’au jour où la cage était ouverte et « le cher petit être divin » invité à la fête où il serait sacrifié. Tous dansaient et battaient des mains autour de l’Ours. La femme qui l’avait allaité pleurait. Alors, un chasseur adressait quelques mots à l’Ours : « Ô toi divin, tu as été envoyé dans le monde pour que nous te chassions. Ô toi précieuse petite divinité, nous t’adorons ; écoute notre prière. Nous nous sommes donné beaucoup de peine pour te nourrir et t’élever, parce que nous t’aimons. À présent que tu es devenu grand, nous allons te renvoyer chez ton père et ta mère. Quand tu arriveras chez eux, dis du bien de nous et dis-leur combien nous avons été attentionnés ; s’il te plaît, reviens chez nous et nous te sacrifierons ». Puis, ils le tuaient.
La pensée la plus ancienne, celle qui pour la première fois ne ressentit pas la nécessité de se donner sous la forme d’un récit, se manifesta sous celle des aphorismes sur la chasse. Ils se sont transmis comme un murmure, comme des comptines, au milieu des tentes et des feux :
« Le gibier est semblable aux êtres humains, il est seulement plus saint ».
« La chasse est quelque chose de pur. Le gibier aime les hommes purs ».
« Comment pourrais-je chasser, si d’abord je ne dessinais pas ? ».
« Le plus grand des dangers de la vie c’est que la nourriture des hommes est entièrement composée d’âmes ».
« L’âme de l’Ours est un Ours en miniature logé dans sa tête ».
« L’Ours pourrait parler, mais il préfère s’en abstenir ».
« Qui parle avec l’Ours en l’appelant par son nom le rend doux et inoffensif ».
« Un incapable qui sacrifie prend plus de gibier qu’un chasseur habile qui ne sacrifie pas ».
« Les animaux qu’on chasse sont comme des femmes qui font les coquettes ».
« Les femelles des animaux séduisent les chasseurs ».
« Toute chasse est chasse d’âmes ».
Au commencement, ce à quoi servait la chasse demeurait vague. Comme un acteur sur la scène qui essaie d’entrer dans son personnage, ils essayaient de devenir des prédateurs. Mais certains animaux couraient plus vite. D’autres étaient imposants et circonspects. Tuer, qu’était-ce après tout ? Pas très différent de se tuer. Si l’homme devenait l’Ours, c’est lui-même qu’il frappait quand il le tuait. Et plus obscur encore était le rapport entre tuer et manger. Qui mange fait disparaître quelque chose. Cela était même plus mystérieux que tuer. Où va ce qui disparaît ? Il va dans l’invisible. Lequel finit par grouiller de présences. Rien n’est plus animé que l’absence. Comment se comporter dès lors, vis-à-vis de tous ces êtres ? Peut-être fallait-il faciliter leur passage vers l’absence, les accompagner un bout de leur voyage. L’acte de tuer était comme une salutation. Et comme toute salutation, elle exigeait certains gestes, certains mots. Ils commencèrent à célébrer des sacrifices.
La chasse naît comme acte inévitable, elle s’achève comme acte gratuit. Elle élabore une séquence de pratiques rituelles qui précèdent l’acte de tuer et lui succèdent.
L’acte ne peut être circonscrit que dans le temps, comme la proie dans l’espace. Le cours même de la chasse est innommable et immaîtrisable, comme le coït. On ne sait pas ce qui se passe entre le chasseur et la proie quand ils s’affrontent. Mais il est certain que, avant la chasse, le chasseur accomplit des gestes de dévotion. Et qu’après la chasse il ressent la nécessité de se décharger d’une faute. Il accueille dans sa cabane l’animal tué comme un hôte noble. Devant l’Ours qu’il vient juste de dépecer, le chasseur murmure une prière très douce, qui donne le vertige : « Permets-moi de te tuer encore à l’avenir ».
La proie exige la focalisation : le regard qui isole, qui restreint le champ visuel en un point. C’est une connaissance qui procède par césures successives, en découpant des figures sur un fond. En les circonscrivant, elle les isole comme cible. Le geste qui les découpe est d’ailleurs déjà le geste qui les frappe. Sinon la figure ne naît pas. Les mythes sont, à chaque fois, une superposition de profils coupés. En poussant à l’extrême cette modalité de la connaissance, en accumulant les profils, on retisse la toile de fond d’où ils furent arrachés. Telle est la connaissance du chasseur.
Avec l’élevage du bétail et l’agriculture, l’animal ne fut plus qu’animal, à jamais séparé de l’homme. Pour les chasseurs, au contraire, l’animal était encore un autre être, ni animal ni homme, chassé par des êtres qui n’étaient ni animaux ni hommes. Quand eut lieu l’événement qui fut l’événement de toute histoire avant l’histoire, quand s’accomplit le détachement vis-à-vis de quelque chose qui s’appellerait animal de la part de quelque chose qui s’appellerait homme, nul ne pensa que la sagesse — la vieille et la nouvelle sagesse — pût se rencontrer sinon en quelqu’un qui participât des deux formes de vie. Dans les grottes du Pélion, Chiron le Centaure devint la source de la sagesse, celui qui plus que tout autre pouvait enseigner la justice, l’astronomie, la médecine et la chasse. C’était alors à peu près tout ce que l’on pouvait enseigner.
Pour les héros élevés par Chiron, la chasse fut le premier élément de la paideía. Mais cette « éducation », cette première épreuve de l’aretḗ, de cette « vertu » qui allait par la suite être si souvent évoquée, se déroulait entièrement hors des frontières de la société. Et elle n’était d’aucune utilité. La chasse pratiquée par les héros ne servait pas à nourrir la communauté. C’était un exercice sanglant et soli-taire, pratiqué sans autre finalité. Dans la chasse, l’animal se retourne contre lui-même et tente de se tuer. Avant d’être les protagonistes de tant d’histoires de métamorphoses, les grands chasseurs furent eux-mêmes le résultat d’une métamorphose. Avant de tuer le loup ou les rats, Apollon fut loup et rat. Avant de tuer les ourses, Artémis avait été ourse. Le pathos de la chasse, la complicité entre chasseur et proie, remonte à l’origine, quand le chasseur était lui-même l’animal, quand Apollon était le général d’une armée de rats et le chef d’une meute de loups. Le fondement de la chasse fut une découverte de la logique : l’œuvre de la négation. Cette découverte fondatrice et enivrante exigeait d’être perpétuellement confirmée, revécue. Pendant que la vie de la ville palpitait, une autre vie — parallèle — lui correspondait sur les montagnes. Infatigables et solitaires, Apollon et Artémis, et même Dionysos, continuaient à chasser. L’énergie qui se dégageait de leurs gestes était le sous-entendu nécessaire, la charpente cachée derrière les échanges du marché, le sommeil des familles, la peine dans les champs. Rien de tout ce qui constituait la vie de la ville n’aurait pu subsister sans ces courses, ces embûches à travers les montagnes, sans ces flèches décochées et ce sang. À croire que la société ne s’est jamais sentie suffisamment vivante, et peut-être réelle, sans cette vie parallèle et superflue, errante, des dieux chasseurs perdus dans les bois. Comme l’oraison du moine, la course silencieuse des dieux chasseurs faisait tenir debout les remparts qui ceignaient la ville : ou plutôt, c’était cette course qui la ceignait, comme un tourbillon perpétuel.
C’est au cours de la chasse que les hommes devinrent des animaux métaphysiques. L’agriculture ne devait ajouter à la pensée qu’une donnée essentielle : le rythme, l’alternance entre fleurir et flétrir. En revanche, elle allait ample-ment contribuer à la pression de la société sur l’homme. Les grandes villes sont les héritières de ces lieux où furent pour la première fois conservées des réserves de nourriture dans les grandes jarres des entrepôts. Les chasseurs ne pouvaient qu’ignorer les réserves. Ils n’eurent ni inventaires ni annales.
À Rocky Hill, au centre de la Californie, le paléoanthropologue Jean Clottes découvrit une paroi rocheuse ornée de peintures. Hector, un Indien Yokut, gardien du lieu, le guidait. Clottes se concentra sur une figure qui le faisait penser à un chaman avec son tambour. « C’est un ours » dit Hector. Surpris, le paléoanthropologue répliqua : « J’aurais cru qu’il s’agissait d’un homme ». « C’est la même chose » dit Hector — et il se tut.
L’un des signaux du détachement vis-à-vis de l’animal fut le camouflage d’une bande d’hommes en une meute de loups : finalement interchangeables, égaux, comme les rayons d’une roue. L’ivresse fut double et simultanée : celle de l’animal chassé qui se transforme en prédateur — une ivresse de la puissance et de la métamorphose, bien que maintenue dans les limites du cercle animal ; et celle de l’être qui découvre l’égal, la substitution, l’équivalence — une ivresse de la connaissance, que ne dévoile nul signe visible mais qui trace une césure dorénavant infranchissable. Les premiers égaux furent les loups et les morts. Ces meutes, dont chacune semblait être une duplication de l’autre, accomplirent un pas décisif vers l’abstraction : à partir de là, le sceau de l’identité s’imprima sur le monde. Ce fut leur étendard invisible. Sa domination se révélait dans une figure multiple, errante, omniprésente.
Le premier artifice qui permit de rompre avec la continuité animale fut le masque, le travestissement. Cette meute de loups qui rôdait à travers la forêt était composée des premiers hommes, des premiers qui se sentirent si irréparablement hommes qu’ils voulurent se camoufler en loups. Quand l’homme ne fut plus qu’homme, un ultime rideau pouvait le soustraire au monde : un petit masque de soie ou de velours, qui laissait la bouche découverte. En français, cela s’appelle un loup : parce que certains loups portent déjà dessiné sur leur museau un masque, comme s’ils invitaient l’homme à les imiter, en se masquant en loup.
Sans le tambour, il n’y a pas de chaman. Mais seul le chaman sait animer le tambour. Au début, le tambour est nu, une peau d’animal tendue et entourée d’un cercle de bois. Avec le temps, il s’enrichit de parties métalliques, petites figures accrochées qui résonnent. Il se surcharge, de plus en plus. La partie en bois est taillée dans un tronc de bouleau ou de mélèze. Les parties métalliques : il est préférable qu’elles soient vieilles. C’est encore mieux si elles viennent d’autres chamans. Le premier son du tambour est comme le bourdonnement d’une nuée d’insectes et un lointain grondement de tonnerre. Quand il s’anime, il devient cheval, puis aigle. Si deux chamans se battent, du sang suinte du tambour du vaincu. À la mort du chaman, ils suspendent son tambour aux branches de l’arbre le plus proche.Le chaman était contraint d’agir dans un monde qui échappait aux autres. Là, s’il luttait avec un autre chaman, il battait le rappel des troupes d’esprits auxiliaires. Il avait un regard ardent, qu’il voilait souvent à l’aide d’un bonnet à franges. Le tambour était au chaman ce qu’était l’arc pour le chasseur. L’arc permettait au chasseur de se transformer en un animal au bond foudroyant, à la prise mortelle. Le tambour était le lac où le chaman s’enfonçait pour entrer dans un monde que les autres ne voyaient pas. Avant toute autre chose il fallait retrouver le tronc d’où avait été extrait le cercle du tambour. Le chaman animait le tambour en racontant l’histoire de cet arbre. Et la peau du tambour parlait elle aussi. Elle racontait comment elle avait vécu, jusqu’à ce qu’un chasseur l’eût transpercée. Le tambour est l’arbre et l’animal qui ont été tués. Le chaman devenait cet arbre et cet animal. C’est alors que le tambour commençait à guider le chaman. C’était une plume, une monture. Le chaman s’accrochait au tambour comme à la crinière d’un cheval.Les mondes sont au nombre de trois et, communément, les hommes occupent celui du milieu. Les chamans, par contre, occupent les trois. Parfois ils apparaissent la tête dans un monde, mais les pieds dans un autre. Les trois mondes recèlent la même quantité de vie, d’herbe, de gibier, de feuilles. Les esprits sont parfois plus petits que les moustiques. D’autres fois, vus de loin, on dirait des montagnes.
Pour chasser, il fallait d’abord imiter. Danser le pas de la perdrix, de l’ours, du léopard, de la grue, de la zibeline. Pour devenir prédateur, il fallait se couler dans les gestes du prédateur et de la proie. Aussi l’imitation introduisait à l’acte de tuer. Et, cachée dans l’acte de tuer, on retrouvait l’imitation. La proie était attirée et envoûtée parce qu’elle se sentait appelée dans sa langue. C’est à ce moment-là que le chasseur la frappait. Le chasseur et le chaman sont les êtres liés par les affinités les plus profondes. Ils parlent souvent le même langage secret, qui est d’ailleurs celui des animaux. Le chaman les évoque pour qu’ils le protègent et l’aident, le chasseur pour les approcher et les tuer. L’une et l’autre de ces activités sont sacrées — et elles s’éclairent réciproquement. Là où elles se rencontrent se produit une profonde commixtion. Éveline Lot-Falck ne voulut pas s’engager plus avant : « Dans quelle mesure le langage du chasseur se confond-il avec celui du chaman, c’est ce qu’il est difficile à dire. Une partie du vocabulaire [...] est probablement commune au chasseur et au chaman et peut avoir été enseignée par celui-ci à celui-là. Reste à savoir jusqu’à quel point le chaman ne se réserve pas le monopole de cette science ». Même s’il est indispensable pour que l’entreprise ait du succès, le chaman ne participe pas à la chasse et il n’y assiste même pas. De même qu’il n’en tire aucun avantage. Son rôle est la connaissance.
Le mot « chaman » apparut pour la première fois en russe, dans la Vie de l’archiprêtre Avvakum, écrite entre 1672 et 1673. Mais le mot est toungouze — et vient d’une aire immense, désolée et isolée, de Sibérie. L’origine du mot est on ne peut plus controversée. « Certains ont voulu rat-tacher ce terme toungouse au chinois cha-men, d’autres au pali samana, transcription du sanscrit sramana ». Enfin, Berthold Laufer faisait remonter le mot au turc kam. Éveline Lot-Falck rappelait que Paul Pelliot l’avait rencontré dans un document jurchen de 1130 (et les Jurchen étaient les ancêtres des Toungouzes). De plus, au fil de ses recherches, elle avait découvert qu’« il existe en toungouze trois autres séries de termes exprimant l’action de chamaniser, la première liée à l’idée de prière au feu, la seconde à celle de parole et la troisième à celle de force sacrée ». Différents termes désignant l’acte de chamaniser furent par la suite isolés par Éveline Lot-Falck dans des langues turques, altaïques, mongoles. Et il y avait un grand nombre de connexions avec des significations supplémentaires. Mais la sèche conclusion de la recherche fut la suivante : « L’étymologie dégagée pour les termes toungouses et yakoutes met en lumière l’idée de mouvement, d’agitation corporelle. C’est donc à juste titre que tous les observateurs du chamanisme ont été frappés par cette activité gestuelle qui donne son nom au chamanisme ».
Habent sua fata verba, aurait pu dire Brichot. Né dans une population minuscule et perdue, le mot « chaman » est devenu le passe-partout d’une sorte d’espéranto religieux. Et tout cela en quelques décennies, à partir du livre de Mircea Eliade, qui date de 1951. Évidemment, le monde ne disposait plus de mots en mesure de désigner un voyage à la fois physique et psychique, un état — ce qu’on appellera « chamaniser » — où les limites entre visible et invisible ont tendance à s’effacer, où la parole et le son du tambour, le mouvement du corps et la gageure de l’esprit se super-posent et se fondent. L’intensité du besoin et du manque de ce mot devait être telle que son expansion fut irrésistible et indifférenciée. Il a récemment circulé en Californie un tract où l’on pouvait lire : « La finance chamanique c’est : intégrer l’argent et l’esprit ». En fin de compte, il est devenu ardu de définir ce qui n’est pas chamanique. Quant aux chamans, soit ils ont disparu soit ils font en sorte de ne pas être reconnus.
Certains ont considéré les chamans sibériens comme de pauvres malades mentaux, affligés de ce mal mystérieux nommé « hystérie arctique » qui s’aggrave au fur et à mesure que l’on va vers le nord. D’autres ont pensé qu’eux seuls étaient capables de guérir les malades, parce qu’ils savaient, parce qu’ils avaient vu l’autre monde qui se déploie derrière ce qui est pour les autres l’unique monde existant et qu’eux seuls étaient capables de traiter avec les esprits et les morts. Ces doutes ne concernaient pas unique-ment les chamans sibériens. Avec les transpositions et les modulations qui s’imposent, ils pouvaient être appliqués à Empédocle ou à saint Paul. Ou à Nietzsche.
Les chamans sibériens se différencient des autres qui savent, dans d’autres parties du monde, tout d’abord parce que leur monde visible est réduit au minimum. Il n’y a ni villes ni royaumes ni richesses ni échanges. Seulement la taïga, les animaux, le gel. Pour accéder à l’invisible, il fallait, en premier lieu, s’habiller, se charger de tout le peu de palpable que peut avoir un pouvoir. Les vêtements des chamans sibériens pouvaient peser jusqu’à trente kilos. Mais ceux qui les portaient savaient mouvoir leurs pas avec légèreté.
Dans le Ṛgveda on parle des muni aux longs cheveux, qui chevauchent le vent, enveloppés dans des « haillons rouges crasseux ». Ils laissaient « entrer les dieux en eux », regardaient d’en haut deux océans, à orient et occident, comprenaient l’esprit des Nymphes, des Génies et des animaux sauvages. Ils buvaient dans une coupe une boisson dont nous ne savons rien, hormis que ce pouvait être de la drogue ou du poison. On l’appelait viṣá, elle leur venait du dieu Rudra et ils la rendaient à Rudra. Ils furent la première apparition des ascètes, des yogin, des sādhu, qui sans cesse ont traversé l’Inde, depuis les temps védiques jusqu’à aujourd’hui.
« Extase », « possession », ces mots accompagnés, selon les lieux et les temps, de connotations positives ou négatives désignent, l’un comme l’autre, la connaissance métamorphique, cette connaissance qui transforme celui qui connaît au moment où il connaît. Le présupposé commun : un esprit perméable, soumis aux flux et aux reflux d’éléments qui, au début, peuvent sembler étrangers mais qui ont aussi la capacité de s’immiscer comme des hôtes pérennes. Là où, par contre, apparaît un Moi pourvu de compartiments étanches et que l’on présume maître de son enceinte, ni l’extase ni la possession ne sont plus admissibles. Mais dès lors, la surface du connaissable — ou même simplement de l’expérimentable — se restreint considérablement. Beaucoup s’en enorgueillirent, mais leurs motifs demeurent incertains. Sauf un : ils eurent une vie plus tranquille, moins soumise aux secousses, comme s’ils s’étaient mis des œillères — et cela leur paraissait appartenir à l’ordre naturel des choses.
Apollon vole vers les Hyperboréens emporté par des cygnes blancs, comme Abaris vers la Grèce depuis les Hyperboréens en chevauchant une flèche d’or. Voyages chamaniques. Dieu de la lumière, du mètre, des loups et des rats, Apollon.
Le ciel était le lieu du passé. Allongés sur le dos, tandis qu’ils fixaient dans la nuit ces pointes d’épingles tremblantes, ils retrouvaient ce qui s’était passé : une toile ténébreuse et indifférente, rayée par de minuscules entailles de lumière. Il ne restait que cela, parmi la multitude des événements, des gestes, des êtres. Cela seul avait été élu pour garder une signification et une forme qui se ranimaient tous les soirs. Quel que fût le lieu d’où ils observèrent le ciel, ils rencontrèrent le Chasseur. La chasse fut l’ordalie de la mémoire. Le ciel, le premier ordre mnémotechnique. La voûte devint la maison du passé, musée intact. Les histoires indispensables étincelaient vaguement toutes les nuits — ou restaient provisoirement occultées derrière un vélarium de nuages. Et la surface de la caverne fut un autre ciel, comme le ciel lui-même était la face intérieure de l’immense caverne cosmique. Pour pouvoir chasser, il est nécessaire de dessiner.
Un jour, un jour qui ne dura pas moins de vingt-cinq mille ans, les hommes du Paléolithique supérieur commencèrent à dessiner. Quoi donc ? La question du choix ne se posait même pas : les animaux étaient le seul objet possible. Les animaux étaient la puissance en mouvement, qui frappait ou qu’il fallait frapper. Il ne s’agissait pas de magie, comme le penseraient malencontreusement les modernes. On se transformait en l’animal, on échappait à l’animal en se transformant. L’animal et qui le dessinait appartenaient au même continuum de formes. Ce fut le moment où la pression des puissances imposa la discipline esthétique la plus sévère : la ligne, pour être efficace, devait être juste. Ingres les aurait approuvés. Si la ligne n’était pas juste, la puissance n’était pas évoquée. Par moments, au fond de boyaux de roche où seule une personne pouvait se faufiler, celui qui dessinait dans la première camera obscura observait le prodige de la forme qui affleurait de ses mains, à peine visibles.
Longtemps ils préférèrent dessiner les animaux les plus imposants et redoutables, qui n’étaient que rarement chassés. Les dessiner constituait un premier expédient habile pour les imiter et en circonscrire la puissance. En revanche, les figures humaines dessinées sur les roches demeurèrent longtemps marginales et occasionnelles. La manière la plus habituelle, immédiate et compréhensible pour se représenter soi-même consistait, pour les hommes, à se dessiner sous la forme d’animaux composites, entourés d’autres animaux. Un grand nombre d’années furent nécessaires pour que, en passant par bien des détours et des voies de traverse, l’art statuaire grec parvienne à représenter la figure humaine seule — et, qui plus est, nue.
En même temps que les animaux, la géométrie avait fait son apparition. D’innombrables figures qui accompagnaient les animaux ou se détachaient isolées sur les parois rocheuses. Toutes ont gardé leur secret. Mais elles avaient toutes une caractéristique en commun : être la négation du monde tel qu’il se manifestait, tout comme ce fut le cas du premier mur dressé parfaitement perpendiculaire au terrain. Elles étaient un autre monde, qu’il n’était possible d’inférer qu’en reliant par des traits quelques petits points lumineux dans le ciel.
De ceux qui vécurent durant le Magdalénien et peignirent des parois rocheuses en Dordogne, nous ne pouvons sans doute pas dire grand-chose. Mais au moins ceci : ils savaient dessiner avec une stupéfiante justesse, rarement égalée durant des millénaires. À l’improviste — et partout : en Égypte, au nord de l’Espagne, en France, en Angleterre : à Creswell, l’extrême limite avant les masses de glace. Pourquoi cela eut-il lieu ? Il serait hasardé d’y répondre. Mais si le dessin est un acte de l’intelligence, celle des Magdaléniens devait être très grande. Et peut-être possédaient-ils quelque chose en commun avec les baleiniers qui, avant de partir, attendent de voir une baleine en rêve. Si elle ne leur était pas apparue, ils n’auraient jamais pu la rencontrer dans la réalité.
L’homme du Magdalénien, durant des milliers d’années, ne manqua jamais d’avoir recours à deux signes élémentaires, l’un vertical et l’autre courbe : le javelot et la blessure. Le javelot était l’arme avec laquelle le monde était frappé sans être atteint : une hampe, le signe le plus simple. La blessure était un cercle, un anneau ensanglanté.
Si la constellation est un lieu arbitraire où s’ancrent les histoires, de la même manière que les significations s’arriment aux sons, il ne sera pas facile d’expliquer pourquoi dans le même secteur du ciel, non seulement en Grèce, mais en Perse, en Mésopotamie, en Inde, en Chine, en Australie et même au Surinam, pendant des millénaires on a constamment vu les exploits d’un Chasseur Céleste qu’on ne se lassait pas de contempler.
L’invisible est le lieu des dieux, des morts, des ancêtres, du passé tout entier. Il n’exige pas nécessairement un culte, mais il pénètre dans toutes les anfractuosités de l’esprit. Semblable à une corde métallique, il peut aussi ne pas vibrer et rester inerte. S’il vibre, son intensité peut devenir paroxystique. L’invisible ne doit pas être cherché loin. En revanche, on peut ne pas le rencontrer parce qu’il est trop proche. L’invisible finit dans la tête de chacun.
Où il est encore plus difficile de le distinguer, protégé par une cage d’os. Et où il se mêle à tout le reste dans un amalgame qui peut l’étouffer.
Avant l’invention de l’écriture, il était impossible de fixer sous forme d’histoire ce qui arrivait. Mais « de tous les besoins de l’âme humaine, il n’y en a pas de plus vital que le passé ». Ainsi le sacrifice, du moins sous certaines de ses formes (les Bouphonies d’Athènes, les cérémonies du soma dans l’Inde védique), servait aussi à rappeler et raviver le passé. Pendant quelques millénaires, et sous des formes multiples, ces rites ont résumé ce qui s’était passé entre l’homme et les animaux — et ce qui continuait à avoir lieu entre l’homme et l’invisible. Aucune histoire n’aurait pu être aussi efficace, aussi éloquente que ces séquences de gestes. Tueur et adorateur : ces deux traits étaient apparus comme irréductibles, après des péripéties qui avaient duré des centaines de milliers d’années. Avec ces traits il fallait composer une forme — et cette forme fut le sacrifice. La messe est, elle aussi, le souvenir d’un jour passé. Et tout sacrifice est le souvenir d’un jour qui a duré aussi longtemps que des ères lointaines du passé. Tuer ne suffisait pas, il fallait adorer. Adorer ne suffisait pas, il fallait se rappeler que l’on tuait.
Voici ce qu’Aua l’Esquimau raconta à Knud Rasmussen : « Bien que toutes dispositions eussent été prises avant ma naissance, avec l’aide d’autrui. Mais en vain. Je m’en fus chez de célèbres chamans et leur apportai des cadeaux qu’ils s’empressèrent de donner à d’autres personnes. Car s’ils les avaient gardés, leurs enfants seraient morts. Ensuite je recherchai la solitude et devins bientôt très mélancolique. Je me sentais malheureux et pour un rien je fondais en larmes. Puis, changement brusque ! Une joie immense, inexplicable, s’emparait soudain de moi, et je me mettais à chanter à tue-tête. C’est au milieu de cette joie débordante et énigmatique que je devins sorcier, sans savoir comment.
Ce qui est certain, c’est que je l’étais. Je voyais et entendais d’une façon toute nouvelle. Tout sorcier véritable trouve en lui-même une flamme qui lui donne la force de voir, les yeux fermés, dans l’obscurité, de pénétrer les choses mystérieuses, les secrets d’autrui et l’avenir. Je me rendis compte que j’étais en possession de cette puissance merveilleuse ».
La vocation de l’homme de la connaissance était un appel. Il venait d’un monde d’êtres puissants, que les autres étaient incapables de percevoir. Cet appel agissait comme une séduction, un remous dans l’invisible — et, en même temps, une invitation à la lutte. Soit l’homme de la connaissance acquérait le savoir au cours de cette lutte, soit il succombait. Il n’était plus alors qu’un pauvre être malade. Et il savait que presque toutes les maladies étaient un vol d’âmes. Mais s’il sortait victorieux du combat invisible, alors il devenait, lui, capable d’évoquer les esprits, comme il avait été naguère appelé par eux. C’est lui qui les attirerait dans la solitude, qui les rassemblerait autour de lui, lui qui les ferait agir. Voilà l’échange qu’il lui fallait accomplir durant son existence. Mais il fallait d’abord que son corps fût recréé. Un organe après l’autre, son unité physique était désarticulée. Le cœur, les poumons, le foie, les yeux : rien ne pouvait être utilisé tel quel. La connaissance implique un écartèlement, une décomposition des éléments, une transformation de leur substance. Des cristaux de roche s’insinuaient dans des endroits dominants, les jointures se réarticulaient après que les os eurent été maintenus enveloppés dans une écorce de bouleau. C’était une torture qui avait lieu dans la solitude, ignorée par tout le monde. Mais la scène grouillait de présences : les chamans morts accouraient autour de celui qui devait devenir l’un des leurs. Avec de longs couteaux ils détachaient sa chair des os. Mais cela ne suffisait pas. La chair devait être cuite, pour qu’elle mûrisse, pour qu’elle se perfectionne. Les chamans morts œuvraient en silence, frénétiques. Après avoir dressé sur ses pieds le nouvel élu comme un poteau, ils s’éloignaient et le transperçaient de flèches. Puis ils se rapprochaient, extrayaient les os de son corps et ils se mettaient à les compter, comme des usuriers. Si le compte n’était pas bon, l’élu n’était plus qu’un torchon à jeter. Sa vocation n’était pas véritable. C’était un pauvre diable. Souvent la tête du candidat était accrochée au sommet d’une cabane. De là, il pouvait observer comment le reste de son corps était mis en pièces. Il était indispensable que le futur chaman reste conscient et puisse observer, seconde après seconde, ce qui se passait. L’aspirant ne pouvait devenir un jour chaman que s’il possédait cette capacité de se contempler lui-même. En outre un vrai chaman devait, disait-on, se laisser mettre en pièces au moins trois fois. Il devait aussi regarder de quelle manière ses os étaient nettoyés et lustrés. Les chamans morts étaient avides. Il arrivait qu’après avoir jeté un organe quelconque de l’aspirant chaman sur les pistes des maux, qui sont nombreuses et aux multiples bifurcations, ils exigeassent un tribut pour que l’organe puisse revenir : ils réclamaient la mort d’un parent ou seulement une maladie grave. C’était une période risquée pour tous ceux qui avaient des liens avec l’aspirant chaman, qu’ils subissaient en silence. Dix personnes payèrent de leur vie le rachat des os du crâne d’un aspirant chaman. Parfois les chamans se lassaient des esprits. Et les esprits se lassaient des chamans. Alors, ils changeaient de chemin et il pouvait arriver qu’ils ne se rencontrent plus.
Être chaman c’était une autre vie, qui supposait l’offrande et la décomposition de son propre corps, une décomposition très semblable à celle que subissaient les animaux sacrifiés. De fait, les chamans n’étaient que les derniers de ces animaux. Chaque chaman possédait un animal-mère qui réapparaissait et l’approchait deux ou trois jours avant sa mort. Si le chaman laissait certains esprits mastiquer sa chair, ces esprits étaient ensuite obligés de lui répondre. Ils ne pouvaient plus rester sourds. Le chaman était devenu chair de leur chair. Solitaire parmi les modernes, Artaud a dessiné et raconté ce qui se passait dans ce genre de cas.
Toute pensée se mesure avec les morts. L’autel des morts est né d’une « petite fantaisie » d’Henry James : il a imaginé « un homme dont la noble et belle religion est le culte des Morts ». Celui-ci « est frappé de voir la manière dont ils sont oubliés, profanés, point honorés, négligés, chassés loin des regards ; voués à une mort plus grande encore que celle à laquelle le sort, en les surprenant, les a destinés. Il est frappé par le climat glacial, brutal, qui entoure leur mémoire ».
À Sungir, à environ 180 kilomètres à l’est de Moscou, on a fouillé un site qui date de vingt-sept mille ans. Parmi les pièces, figure une tombe avec deux adolescents : un garçon couvert de rangs de petites perles, 4903 en tout, avec à la taille une ceinture de plus de 250 canines de renard arc-tique. Près du corps, divers objets en ivoire, parmi lesquels une lance trop lourde pour être utilisée. La jeune fille était couverte de 5274 petites perles.
Selon Adolf Loos, l’architecture a puisé son origine dans les tombes. L’ornement, que Loos désapprouvait, apparut lui aussi aux côtés des morts. Ou, du moins, nous le rencontrons pour la première fois auprès des morts. Il n’était pas fait pour être vu. Mais pour les accompagner dans ce « climat glacial, brutal » qui, sinon, entourerait leur mémoire.
Ces inconnus qui vécurent à Sungir des dizaines de milliers d’années avant Henry James le savaient.
Simulacres, amulettes, idoles, talismans, fétiches, de toutes sortes de formes et de matières : ils les appelaient šajtan, entre la taïga et la toundra. Le même mot signifiait « démon » pour les musulmans, « satan » pour les chrétiens. Ils les transportaient entassés sur de grands traîneaux. Les femmes ne devaient pas s’approcher. Les rennes qui tiraient ces traîneaux étaient sacrés. Ils ne pouvaient être utilisés pour aucun travail, ni vendus, ni tués. Mais d’autres rennes étaient tués et les šajtan étaient enduits de leur sang.
Les autorités soviétiques exigeaient qu’on leur remette les tambours. Quand ils les eurent rendus, ils se sentirent sans défense, exposés aux attaques des esprits. Ils avaient peur qu’ils les étranglent. Quelques-uns essayèrent de remplacer les tambours par des branches, des arcs et des flèches, des fouets, des bonnets. Et même des couvercles de casseroles et des louches. D’autres dessinaient des tambours sur des bouts d’étoffe et les manipulaient en silence. Ou bien ils utilisaient des coupons de tissu, sans aucun dessin, et les faisaient osciller dans les airs.
Éveline Lot-Falck, l’historienne la plus pénétrante des chasseurs sibériens, écrivait avec sobriété et précision. Tout autant qu’eux, elle visait la cible, l’essentiel : « Rien ne doit rappeler la vie journalière, avec laquelle le chasseur a rompu. Il n’y a point place dans la forêt pour aucun des objets domestiques. Par une fiction du langage, ils s’adaptent aux lieux, se fondent dans l’environnement. Les intentions du chasseur sont enveloppées du mystère indispensable à la réussite de ses projets. [...] Ainsi mis à couvert par de multiples interdits, ayant rompu ses attaches avec la vie ordinaire, la vie profane, pour pénétrer dans le domaine de la chasse, son identité déguisée, protégé par son anonymat comme par un bouclier, le chasseur va affronter les forces mystérieuses de la forêt [...] Dans la forêt, dans le domaine des vieilles forces ancestrales, le chasseur échappe à la juridiction de l’Église officielle et évite de dévoiler sa qualité d’orthodoxe, de bouddhiste ou de musulman ». Par rapport à la forêt, toutes les autres croyances sont quelque chose de récent, de postiche. Leurs liturgies obsédantes, ronflantes doivent être interrompues à la lisière de la forêt — et de son silence.
Il était difficile de sortir de la chasse. Comme le corps de la femme sur l’homme, la forêt laissait une trace odorante sur le chasseur. Voilà pourquoi certains chasseurs mâchaient des écorces d’aulne, faute de quoi la maladie de la forêt les aurait contaminés. Qui avait tué un ours ne pouvait être honoré pour son exploit qu’après avoir passé trois jours dans une tente préparée pour cette occasion. Lentement, prudemment, les chasseurs parvenaient à « dénouer les liens qu’ils s’étaient forgés eux-mêmes, à se dissocier du domaine dans lequel ils avaient pénétré, où ils avaient réussi à se maintenir et d’où ils sortent comme d’un autre monde, avec la crainte d’être poursuivis ». Cette crainte de représailles ne fut pas que le sentiment tenace de quelques chasseurs sibériens. Quiconque a franchi ou continue de franchir la limite qui le sépare de l’invisible — même et surtout si l’invisible n’est pas reconnu comme tel — vivra la condition de qui, à chaque moment, s’attend à être attaqué. En sachant parfaitement d’où vient l’attaque — même s’il est parfois le seul à le savoir.
Le chasseur se préparait pour son expédition comme pour un bal. Le corps devait être pur, parfumé. À chaque animal pourchassé correspondait un parfum différent. Avoir eu affaire au sexe avant la chasse était interdit. Car la chasse était le sexe. Et les animaux étaient jaloux, ils s’en rendaient compte immédiatement. En faisant ses premiers pas, le chasseur entamait une longue cour.
Ce qui se passait quand deux chamans se rencontraient n’apparaissait jamais clairement. Ils pouvaient se tenir l’un près de l’autre, sur un banc, échanger quelques mots à voix basse ou même se taire en regardant le vide. Mais il ne fallait pas s’y fier. Chacun d’eux était lié par un invisible lacet de cuir à un renne, souvent très éloigné. Et tandis que le renne errait dans la toundra, le lacet s’étirait de plus en plus, sur des milles et des milles. Les rennes des deux chamans pouvaient se rencontrer — et même s’affronter dans des duels féroces, sans témoins. Pendant ce temps, les deux chamans sur leur banc mâchaient du tabac en échangeant de rares propos. Les rennes, eux, continuaient à se battre. Si l’un d’eux était tué, le chaman qui était lié à cet animal sentait un coup sec à son lacet. Il se levait et s’éloignait en silence. Il allait bientôt mourir. On parlait aussi d’un « fleuve de la misère et de la ruine », dont les berges devaient être renforcées avec les cadavres de la parentèle du chaman, utilisés comme des poteaux. « Car la vie des chamans est rachetée par sa parentèle ».
Pour guérir un malade, le chaman Narzalé reçut en lui la maladie. Pour la transpercer, il se transperçait. Le malade guérit. Puis le chaman prit congé, inchangé par rapport au moment où il était arrivé. Bientôt parvinrent de ses nouvelles. On disait que Narzalé était allé couper du bois dans la forêt et que l’ours l’avait déchiqueté. Et on expliquait ainsi ce qui s’était passé : « L’ours l’a déchiré parce qu’il avait donné son âme pour le malade. Il avait dit : Toi, kat-cha [esprit de la maladie], prends mon âme, à la place du malade. Voilà pourquoi il est mort. Comment un ours aurait-il pu autrement sortir, en hiver, de sa tanière et le déchirer ? ». Éveline Lot-Falck conclut que « le narrateur et les intéressés ne manifestent pas un étonnement ou une reconnaissance excessifs, d’abord parce que, chez ces populations, on est économe de paroles et de démonstrations et puis parce que, si Narzalé a fait ce que peu de chamans font, après tout, il a seulement bien rempli ses engagements et sa mission ».
Un malade de nerfs était enfermé dans une chambre condamnée. Ses parents cherchèrent pendant cinq ans un chaman capable de le guérir. Enfin, arriva le chaman Küstäch. Un homme ivre entrait et sortait en l’insultant. Le chaman restait impassible, il ne se souciait que de ses esprits auxiliaires. À un moment donné il dit : « Quand le plus puissant de mes esprits auxiliaires descendra en moi, retirez aussitôt le verrou ». C’est ce qu’ils firent. Le malade se jeta immédiatement sur le chaman qui tendit la poitrine, se plia en arrière et lui souffla au visage. Le malade s’évanouit. Le chaman lui effleura le front avec les baguettes du tambour et dit : « Lève-toi. Et maintenant, veux-tu boire du thé ? Voulons-nous nous asseoir à une table ? ». Ils s’assirent et burent le thé.
Les chamans vivent dans un grand arbre, un mélèze, sur plusieurs étages. Les chamans les plus puissants nichent aux étages les plus élevés ; les autres plus bas. C’est sur cet arbre que sont élevés les chamans du monde entier. Ils ont pour éducateur le Corbeau qui passe de branche en branche. Quand un chaman a été vaincu par un autre chaman, il vient se réfugier sur l’arbre où il a grandi. Parfois, un chaman qui se bat avec un autre chaman essaie de détruire le nid de son adversaire. Les chamans ne meurent jamais de mort naturelle. Ils succombent toujours lors d’un combat avec un autre chaman qui les avale.
Le khan Ögödei ordonna qu’on lui installe un siège au sommet de la colline. De là, il dominait une étendue qui se perdait dans l’Occident brumeux. Un territoire de chasse illimité. Et, tandis qu’il fixait son regard sur le lointain, les bêtes de toutes les espèces sortirent de leurs tanières et de leurs cachettes et s’avancèrent jusqu’au pied de la colline, en regardant vers les hauteurs, vers le trône d’Ögödei. On entendit alors une plainte monter de la terre. Toutes les voix des bêtes s’unissaient, semblables aux lamentations de ceux qui implorent justice.
Ils disaient que le monde est essentiellement composé de cristaux de roche hexagonaux, aussi — et d’ailleurs surtout — là où il est le plus sombre et informe, dans les espaces qui s’ouvrent au-delà de la Voie Lactée. Ces mêmes cristaux hexagonaux forment des alvéoles dans le cerveau, là où fleurissent les images. Et la commissure centrale de l’encéphale, les deux serpents entrelacés, se retrouve dans la Voie Lactée.
D’autres disent que la Voie Lactée est le lieu des visions et la voie de passage entre le ciel et la terre, mais aussi un lieu terrible, parce qu’y convergent tous les maux. C’est comme un vaste amas de déchets. Là se cachent les vautours, car ils y trouvent leur nourriture. La Voie Lactée est donc un lieu hautement dangereux. Ceux qui s’y aventurent doivent le savoir.
« Todos los adornos son escrituras » disait Bonifacio Bautista Aragón, gardien de Mitla, près d’Oaxaca. Sa maison, un petit antre sombre, se trouvait à côté des ruines. Il en sortait quand le demandait l’un des visiteurs, immobiles face à une muraille rose, couverte d’ornements. Incrustés « au cœur du mur » ajoutait Bonifacio. Puis il revenait à sa phrase sur les « adornos ». Rares étaient les visiteurs qui la comprenaient, se disait-il : « Los modernos se creen... ». Les modernes pensaient que c’étaient des décorations, au même titre que les cotillons de carnaval. Les modernes croient bien des choses qui ne sont pas. Alors Bonifacio répétait sa phrase : « Todos los adornos son escrituras ». Qu’il n’eût jamais déchiffré ces écritures était sans importance. Sa tâche consistait à répéter cette phrase.
Le Souverain des Animaux est malicieux et luxurieux. Il épie les femmes, suit les fillettes le long du fleuve, sous la forme d’un lézard. Tout en les regardant, il fouette l’air de sa queue. S’il parvient à les posséder dans leur sommeil, elles se réveillent souvent hébétées — et meurent rapidement de consomption. Alors, tout autour, pendant quelque temps, on perçoit un remue-ménage inhabituel.
Le Souverain des Animaux est curieux et jaloux de tout ce qui touche au sexe. Il lorgne depuis les fissures des murs. Il négocie avec les chasseurs le nombre d’animaux qu’il autorise à tuer. Et il demande en échange les âmes des morts, qu’il loge dans de vastes remises dans les montagnes.
Le Souverain des Animaux suit pas à pas les chasseurs qui ne se sentent jamais seuls. Ils savent qu’ils sont surveillés. Ils s’arrêtent parfois au pied d’un arbre et y gravent des images sur l’écorce. Un escargot, une flûte. Toujours afin de distraire le Souverain des Animaux, émerveillé à la vue de ces signes. Alors le chasseur avance, temporairement libre.
Il n’y avait pas qu’un seul Souverain des Animaux. On en connaissait plusieurs qui gouvernaient différentes parties de la forêt. Ils apparaissaient sous la forme d’« images composites d’humain et d’animal, de proie et de prédateur », parfois semblables à des hommes à plumes, inquiétants Papagenos. Si lors de la chasse trop d’animaux étaient tués ou si les règles n’étaient pas observées, leur colère se manifestait par des lumières jaunâtres au coucher du soleil et un grondement incessant de tonnerre. Il était indispensable de suspendre aux arbres de la forêt les têtes des animaux tués au cours de la chasse. Faute de quoi, le Souverain des Animaux se mettrait à chasser les hommes. C’est ainsi que le racontait Patakuru : « Le gibier chassé par le seigneur de la forêt ce sont les êtres humains. Son aspect est semblable à celui des humains. Il est comme nous. Aussi grand que nous. Certains sont mâles, d’autres femelles. Le seigneur mâle de la forêt baise les femmes et baise les hommes. Car il se montre trompeusement homme ou femme. Lui ou elle prend l’apparence de notre mari ou de notre femme, comme les faucons méchants. Si nous la baisons ou s’il nous baise, nous sommes comme morts. Après que tu as été baisé, tu ne t’en souviens plus. Tu oublies ce qui est arrivé, mais ensuite tu meurs. Seuls certains esprits auxiliaires des chamans peuvent découvrir ce qui s’est passé et nous soigner, de sorte que nous ne mourrons pas ».
Tuer impliquait un risque permanent de représailles. Le Souverain des Animaux pouvait à tout moment traquer les hommes comme du gibier, tout comme ces derniers avaient poursuivi des proies dans son royaume. Il suffisait de frapper leur esprit, à certains endroits précis et vulnérables. Alors le Souverain des Animaux lançait la chasse, suivi par les cochons sauvages et les casoars, de même que les hommes partaient à la chasse accompagnés de leurs chiens. C’était ça l’équilibre, c’était ça la loi. C’est pour cette raison que chasser ne suffisait pas, il fallait sacrifier.
Avec qui le chasseur pouvait-il se lier d’amitié ? Par exemple, avec Mai-kaffo. Dans les temps anciens, Mai-kaffo était le chef des buffles. Mais ce n’était pas un buffle. Mai-kaffo avait quelque chose du buffle et quelque chose de l’homme. Quelque chose de l’oiseau et quelque chose de l’antilope. Il avait des cornes. Il vivait dans la brousse, sur un tamarinier. Un chasseur le rencontra et ils se mirent à parler ensemble. Le chasseur dit : « Nous n’avons pas de médicaments contre les esprits ». Mai-kaffo dit : « Ne t’inquiète pas. Les buffles m’appartiennent ». Un jour, le chasseur apporta du miel à Mai-kaffo. « C’est étrange, la brousse m’appartient, personne ne peut prendre de miel sans que je le sache » dit Mai-kaffo. Le chasseur lui raconta des histoires pour expliquer comment il s’était procuré le miel. « Il est bon, pourtant » dit Mai-kaffo, la bouche pleine de miel. « Tu m’as apporté quelque chose de bon. Tu es un ami. Je te fais cadeau d’un buffle. Tu peux le tuer ». Le chasseur tua donc le buffle et le rapporta au village. Dès lors le chasseur fut honoré. De temps en temps il appelait Mai-kaffo, en sacrifiant un animal à la peau noire, comme cela plaisait à son ami. Alors Mai-kaffo se présentait dans le village, avec son fils Mekirabo. Mai-kaffo et le chasseur parlaient ensemble longuement, surtout de médicaments. Pendant ce temps Mekirabo se retirait sous la tente avec la femme du chasseur et flirtait avec elle.
Soudain une biche apparut. Derrière elle s’étendait le marais, l’immense Marais Méotide, pareil jusque-là à un océan. La biche regarda tranquillement les chasseurs. Puis elle fit volte-face vers le marais et se mit à courir. Quand elle se détachait trop des chasseurs, elle s’arrêtait. De son museau elle effleurait les arbustes et la fange glacée. Les chasseurs la rejoignirent ainsi à plusieurs reprises. Et, à chaque fois, à peine s’étaient-ils rapprochés, que la biche reprenait sa course légère en tournant un instant la tête vers eux, comme pour les inviter à la suivre. Hunor et Magor chevauchaient et chevauchaient, ils ne pensaient qu’à la biche. Ils oublièrent les autres. En regardant derrière eux, ils s’aperçurent qu’ils étaient seuls. Ils n’échangèrent pas un mot et continuèrent à chevaucher. Ce marais, dont ils avaient entendu dire dans leur enfance qu’il était sans limites et se poursuivait dans le ciel, leur apparaissait à présent comme une plaine glacée et livide qui se confondait avec l’horizon. Par moments, la biche était un petit point noir et mobile, par moments, elle était si proche d’eux qu’ils croyaient la caresser. Leurs regards ne la quittaient jamais. Ils ne s’aperçurent même pas qu’ils ne chevauchaient plus sur la glace, mais sur une nouvelle terre, souple et douce, différente de la steppe où ils avaient vécu. La nuit tombait et la biche les maintenait de plus en plus à distance. Ils virent le point noir se mêler à l’immensité noire qui les entourait. La biche avait disparu. Mais ils continuèrent à chevaucher. Et bientôt, ils pensèrent qu’ils étaient entrés dans un rêve. Ils reconnurent une lueur de feu dans l’obscurité. Ils virent des ombres qui bougeaient. Cachés derrière une tente, toujours cramponnés à leurs chevaux, ils épièrent la scène. Autour du feu des hommes et des femmes dansaient. Le tumulte de la musique les ravit. Deux vieux se tenaient au centre, immobiles. Les yeux d’Hunor et de Magor se fixèrent sur deux jeunes filles qui frétillaient comme deux lézardes, des femmes d’une autre race, plus grandes et plus blanches que celles qu’ils avaient connues jusque-là. On aurait dit que les deux filles menaient la danse. Ils les suivirent longtemps du regard, comme ils avaient suivi la biche. Le feu étincelait sur leurs fines chevilles et sur leurs pieds nus, lorsque, par moments, on les devinait entre les robes sombres, longues et plissées.
Hunor et Magor firent alors irruption dans le cercle et les danseurs virent deux démons qui saisissaient les deux jeunes filles à la taille. Ils disparurent dans la nuit, en serrant ces deux corps moites contre leurs casques en peau de rat. Quand ils revinrent chez les leurs, après avoir traversé le marais sans limites comme si c’eût été l’ultime pointe de la steppe, ils dirent qu’ils avaient enfin trouvé la terre, la terre cherchée depuis toujours, dont ils avaient entendu parler à voix basse depuis leur enfance, la terre propice aux animaux et à la nourriture. Ce fut ainsi que les Huns s’avancèrent vers l’Europe.
Comme la biche des Huns, l’animal est proie et guide. Tandis qu’il poursuit l’animal, en tentant de fixer son regard sur un point unique, le chasseur ne se rend pas compte qu’il est en train de s’enfoncer dans l’inconnu. C’est ainsi que la découverte a lieu : on suit l’appel d’un autre être, toujours en fuite devant nos yeux, sans jamais le rejoindre. Alors que ce que l’on découvre est déjà là autour, est déjà là derrière — et on ne le voit presque plus.
Il y a deux proies : celle qui est tuée (et le lieu où elle est tuée devient le lieu de la fondation) et celle qui disparaît (et cause la mise à mort des chasseurs). De temps en temps l’animal-guide veut être rejoint, il accepte de devenir proie. Il doit en être ainsi, si l’on veut que la ville soit fondée. La ville est le lieu où l’animal-guide est abattu. Éphèse fut fondée par celui qui avait obéi aux mots de l’oracle : « Un sanglier indiquera la voie ». Et, là où le sanglier tomba
transpercé par un javelot, « se dresse aujourd’hui le temple d’Athéna ». Aujourd’hui, là, est Éphèse.
Celui qui écrit suit l’animal-guide. Dans l’œuvre il le frappe — et le tue : là où il a été tué, surgit l’œuvre. Ou bien il découvre que l’animal-guide a disparu. Et l’animal se transfère dans l’étendard. Différence entre les œuvres où l’animal-guide est tué et celles où il disparaît. Chez Balzac : l’animal est tué. Chez Baudelaire : il avance sur l’étendard. On écrit un livre quand s’est précisé en nous quelque chose que l’on doit découvrir. On ne sait ni ce que c’est ni où c’est, mais on sait qu’on doit le trouver. Alors commence la chasse. On commence à écrire.
Les étendards naquirent en Égypte, le lieu des choses reculées dans le temps. Après avoir été vaincus à plu-sieurs reprises en raison d’un certain désordre au sein des troupes, les Égyptiens « eurent l’idée de placer des étendards devant les diverses troupes. En conséquence, disent-ils, les commandants façonnèrent des figures des animaux qu’ils révèrent et qu’ils affichent sur leur lance, ainsi chacun pouvait reconnaître quelle était sa place ». Les animaux servent à instaurer le « bon ordre », qui se révèle précieux dans la bataille. Mais pas seulement. Les hommes tournaient leur regard vers les animaux comme vers l’ordre qu’ils avaient violé — et que parfois, quand l’angoisse les saisissait, ils auraient désiré retrouver. Ou que, du moins, ils auraient voulu appeler à l’aide, pour qu’il les protège.
Aussi, « voulant témoigner leur gratitude, ils instituèrent l’usage de ne tuer aucun des animaux dont ils avaient façonné l’image, mais de leur prodiguer respect et dévotion en tant qu’objets de culte ». C’est pourquoi les animaux qui figuraient sur les étendards étaient la plupart du temps sauvages, soustraits aux sacrifices, non comestibles.
Les Picéniens s’appelaient ainsi parce qu’« un pivert montra le chemin à leurs ancêtres ». Quand ils partirent à la guerre, on vit que « sur leurs étendards figurait le pivert ». Ils ne furent certainement pas les seuls. Sur les étendards des troupes romaines, au temps de la République, on reconnaissait aigles, loups, taureaux, chevaux, sangliers. Puis Marius, au cours de son second consulat, imposa une réforme : l’aigle serait désormais le seul animal à la tête des légions. « Les autres étendards étaient laissés dans les campements ». Marius avait, semble-t-il, préfiguré l’Empire, qui est justement cela : un seul animal. Mais auparavant nombreux avaient été les animaux — et ils le redeviendraient. La désagrégation de l’Empire fut annoncée, accompagnée et suivie par l’apparition d’autres animaux sur les étendards barbares : sangliers pour les Gaulois, corbeaux pour les Normands, serpents pour les Lombards, lions pour les Saxons, taureaux pour les Cimbres. L’étendard est ce qui est devant, ne serait-ce qu’à un pas. Les troupes qui le suivent, ses fidèles, sont les chasseurs qui autrefois suivirent les traces de l’animal-guide sans jamais le rejoindre. Mais cette pour-suite donna forme à leur vie, elle la composa. Il n’y a pas de rapport plus intime que celui de l’étendard et du guerrier. La poursuite continue, même si l’étendard ne les dépasse plus qu’à peine et que ses fidèles ne sont plus des chasseurs, mais des soldats. Quand ils étaient vaincus, l’animal de l’étendard restait « quietissimus totoque corpore demissus », « totalement immobile et tout son corps affaissé ». Mais lorsqu’ils étaient victorieux, l’étendard claquait au vent. Le Corbeau redéployait ses ailes et s’élançait dans les airs.

LA SOUVERAINE DES ANIMAUX

La Souveraine des Animaux, dont de nombreuses statuettes ont été exhumées à travers l’Europe, s’imposait par son immobilité. Ses larges fesses, sa lourde poitrine, ses jambes jointes dissimulaient à peine qu’elle avait été autre-fois un arbre. Alors qu’à présent elle ne pouvait qu’être enchâssée dans la cavité d’un tronc. Les animaux, tous les animaux, tout ce qui naît : c’étaient ses dévots. La déesse les observait, immobile. Elle soutenait les créatures comme un tronc puissant soutient même les branches les plus éloignées. L’ensemble formait un cercle bourdonnant autour d’elle. Chacun était une de ses frondaisons.
Soudain, la déesse allongea un bras, puis l’autre. Ses mains se refermèrent en une prise ferme sur la nuque de deux panthères — ou de deux oiseaux aquatiques. Ou bien elle saisit deux daims par les pattes, les renversa et les souleva en l’air — ou encore deux lions. Elle s’offrait comme un majestueux épouvantail. Puis vint le moment le plus mystérieux, celui que personne n’osa raconter, la césure dans la vie de la déesse : lorsqu’elle fit son premier pas, qui fut tout de suite une course. Elle évita les villes et les hommes. Elle cherchait les lieux inaccessibles et solitaires, que le ciel accablait. Ou les marais où bruissaient les roseaux. Ou les clairières qui s’ouvraient dans la forêt, jamais foulées par une empreinte humaine. Elle était la déesse de l’intact. Elle courait et poursuivait la bête invisible. Même le puissant taureau s’inclinait devant elle. Tous les animaux craignaient sa course. Ils savaient tous que le dard de la déesse les rejoindrait. Mais quand elle se reposait, un faon sortait du fin fond de la forêt et lui léchait les mains.
La Souveraine des Animaux était le support d’une garde-robe mobile : la nature. Les animaux s’agrippèrent au manteau de la déesse et s’y engluèrent. Dans le simulacre d’Éphèse seuls le visage, les mains tendues et les pointes des pieds n’étaient pas cachés par les robes surchargées. Et sa peau était noire d’huile, qui coulait d’orifices oints avec le nard. De cette immobilité forcée, de ces imposantes figures, s’esquiva, comme en se dévêtant d’un geste agile et en quittant un fourreau, Artémis, la déesse la plus légère, qui fonce et frappe, tandis qu’un court chiton ondoie au-dessus de ses genoux.
Ayant quitté sa gaine asiatique, n’étant plus oppressée par les protomes animaux ou par les lourds testicules de taureau qui durant des siècles auraient été échangés contre de multiples mamelles, à moitié nue et luisante dans son épiderme tendu, Artémis évoqua, dans sa course, un autre qui fût l’autre, l’envers même de la nature, dont elle était rassasiée. Un autre qui, comme elle, sût frapper la nature mais auquel la nature n’aurait jamais pu visqueusement adhérer. Un autre qui connût avant tout le détachement. Jamais Artémis ne le toucherait, le contact entre eux serait une superposition pérenne et invisible. Elle évoqua un jumeau : Apollon
Artémis courait comme un homme — et chez les hommes il n’y eut pas de désir plus aigu pour une femme que celui pour Artémis qui court. Artémis courait comme un homme tant qu’elle savait qu’elle pouvait être vue. Mais elle entrait dans l’eau comme une femme, parce qu’alors personne ne pouvait la voir, excepté ses suivantes et compagnes de chasse. La pièce d’eau au centre du locus amoenus est le lieu secret par excellence, le lieu où la déesse revient s’immerger dans la moiteur de son corps, le lieu où elle accepte que sa silhouette impérissable s’efface partiellement dans le flux d’où elle a surgi. Ses compagnes la regardent alors — et là réside le secret auquel elles seules participent. Mais qui sont ces compagnes ? Elles sont Artémis réfractée et multipliée, délicatement variée, dispersée. Artémis ne se montrait pas seulement à ses compagnes, elle se montrait aussi à ses animaux. C’est la raison pour laquelle Actéon enveloppa sa tête et ses épaules d’une peau de cerf. Derrière un rocher de mousse les cornes se détachaient à peine, telles des branches au milieu des feuilles. Sa faute ne fut certainement pas la faute, très grossière, consistant à vouloir violer la déesse, mais à vouloir la dévisager avec le regard de l’animal. Il n’est pas de faute plus grave que celle-là, qui contraignait la déesse à se remémorer l’âge reculé où elle-même avait été l’animal, la biche prodigieuse qui fuit. Mais les déesses, plus encore que les dieux, n’ai-ment pas être contraintes à se souvenir.
Éros est un « chasseur prodigieux », « thēreutḕs deinós ». C’est ce que Diotime dit à Socrate. Et en même temps Éros « emploie à philosopher tout le temps de sa vie ». Depuis Platon, chasse et connaissance sont des termes qui se poursuivent et se superposent. Dans cette connexion, un certain caractère assassin de la connaissance est implicite, car en atteignant son objet elle peut le tuer. Mais y est également sous-entendue l’idée opposée : que le chasseur qui a rejoint sa proie puisse être béatement contaminé par elle, au point de devenir lui-même proie. C’est ainsi que le chasseur Actéon devient la proie de son regard et se laisse dévorer par ses chiens qui ne cherchent qu’à lui obéir. Ce qui arriva alors fut raconté ainsi par Giordano Bruno : « Car le but ultime et dernier de cette chasse est la capture de cette proie fugitive et sauvage, capture où le ravisseur devient proie, le chasseur gibier ; car en toute autre espèce de chasse, où l’on poursuit des choses particulières, c’est le chasseur qui capture l’objet, qui s’en saisit, qui l’absorbe par la bouche de son intelligence ; mais en cette chasse divine et universelle, sa prise est effectuée de telle sorte que nécessairement c’est lui qui reste pris, absorbé, uni. Si bien que de vulgaire, ordinaire, civil et populaire qu’il était, il devient sauvage, tel un cerf, un habitant des solitudes ; il vit divinement sous ces hautes futaies, dans les cavernes des montagnes, demeures qui ne doivent rien à l’artifice ; là il admire les sources des grands fleuves, vigoureux comme une plante, intacte et pure, affranchi des convoitises communes ; là il converse librement avec la divinité à laquelle ont aspiré tant d’hommes qui, dans leur désir de goûter sur terre la vie céleste, ont crié d’une seule voix : Ecce elongavi fugiens, et mansi in solitudine. Alors les chiens, pensées des choses divines, dévorent cet Actéon, si bien que mort au vulgaire, à la multitude, délivré de l’entrave des sens perturbés, libéré de la prison charnelle de la matière, il ne voit plus sa Diane par des trous, par des fenêtres, mais, toute muraille renversée, il est tout œil face à tout horizon ».
La découverte de la chasse, de ce que la chasse impliquait une fois séparée de toute utilité alimentaire, et surprise dans la pureté et la dureté de son geste, dans la mise en scène toujours répétée d’un être humain qui poursuit et d’un animal poursuivi, d’une flèche décochée et d’une blessure qui s’ouvre, cette découverte devait totalement absorber en elle un être divin, le détourner de sa souveraineté œcuménique sur toute forme animale et végétale. Le passage de la plus grande extension à la plus grande intensité. De la surface de la terre à la pointe de la flèche. C’est ce que fut Artémis. Après avoir replié ses ailes, congédié ses vêtements somptueux et asiatiques et abandonné toute fixité frontale, elle s’élançait parmi les arbres sans en détruire les rameaux — et recommençait sans cesse à exercer cette activité violente qui ne servait à rien. Les dieux ne se nourrissent pas de sang et les humains n’ont jamais pu manger ou sacrifier les proies d’Artémis. La chasse est une tautologie, l’exercice qui s’affirme lui-même. Et, ensevelie dans son passé, nous rencontrons la négation : l’animal qui se nie lui-même. Tautologie, négation : n’est-ce pas là le cercle de la pensée ? Artémis, enchantée, ne voulut plus sortir de ce cercle. Mais ce cercle effleurait d’autres cercles. Parfois, en s’effleurant, ils s’enflammaient. Jamais le désir érotique ne fut aussi aigu qu’autour d’Artémis, que chez Artémis, qui niait le sexe — et abhorrait tout contact. En le niant, elle l’exaltait. Artémis était en tout l’égale de son jumeau Apollon, excepté le sexe : « solusque dabat discrimina sexus ». C’est la raison pour laquelle elle voulait nier le sexe, abolir cette unique discrimination pour se rendre identique à son unique amant, l’amant innommable : Apollon — et être séparée, avec lui, de tout le reste.
Apollon se redressa sur les mains de sa mère. Un arc apparut des bras de Léto. Le petit dieu s’y appuyait comme sur un parapet. Artémis, blottie dans l’autre creux des bras de Léto, regardait son frère. Puis elle regarda en face d’elle et vit une immense montagne tachetée, jaune et verte. Cette montagne se gonflait lentement, puis elle se rétractait. C’était une montagne palpitante. Léto continuait à grimper, avec peine. Les taches se rapprochaient. Le buste d’Apollon était tendu, luisant. Dans le silence il pointa une flèche. C’était le premier geste de sa vie. Artémis voyait ces gestes pour la première fois et elle les connaissait déjà. La flèche vibra dans l’air, seul son. Artémis la vit s’enfoncer dans une petite tache délicate, centrale. La montagne haleta. Pendant un instant il sembla qu’elle allait se fendre et déferler, en les engloutissant. Puis elle se contracta. Une nouvelle couleur apparut près de l’endroit où la flèche s’était enfoncée. Un liquide opaque, noir, coulait lentement. La mort. Tandis que plus haut, là où les anneaux du serpent, maintenant immobiles, laissaient à découvert une lézarde de la montagne, commença à jaillir une eau claire et pérenne. Un jour, elle fut appelée source Castalie.
Éros et chasse sont incompatibles parce que trop semblables. C’est un inceste. C’est encore une fois s’exposer à la nature, sur toute la surface du corps et de l’esprit, en risquant d’y être réabsorbé. Mais si cette exposition est double, si chasse et éros coexistent, la tension finit par paralyser et précipite dans la ruine. C’est pour cela que les premières et les plus intenses histoires érotiques sont des histoires de chasseurs et de chasseresses, c’est pour cela que ce sont des histoires d’amours impossibles qui s’achèvent toujours dans le malheur.
On s’interroge depuis toujours sur le pourquoi de l’interdit de l’inceste. Et plus les explications sont détaillées et convaincantes, plus ce fait semble élusif et fuyant. Pourquoi le sentiment devrait-il répondre, toujours et partout, avec autant de précision, à l’exigence du respect des règles des systèmes de parenté ? Ou peut-être les systèmes de parenté eux-mêmes se réfèrent-ils à quelque chose d’autre, qui n’est pas nommé mais qui nourrit d’une énergie inépuisable le sentiment qui impose le respect de l’interdit ? Et qu’est-ce que cet autre non nommé ? La communion avec les animaux. De cet état de faute pérenne, de cette indistinction métamorphique surgit l’interdit imprescriptible de tout ce qui est trop intime. Au temps du Grand Corbeau, quand l’homme était chassé et chassait, quand il n’était pas l’homme mais aussi un animal ou un esprit ou un dieu et qu’il chassait un autre être à la nature tout aussi incertaine et changeante, en ce temps-là régnait l’inceste avec l’animal. Tout autre temps devait se détacher de ce temps-là s’il devait être le temps d’une histoire d’hommes. Mais quand, par un jeu cruel, par pur plaisir, Artémis saisit son arc et part à la chasse, nous sommes à nouveau enveloppés dans l’aura de l’inceste, nous sentons à nouveau que l’on viole un interdit que, sans cela, personne n’ose violer. Et une seule devise continue à se déployer dans les airs, sans raison apparente : la chasse est l’inceste.
On perpétuait la parenté avec l’animal en revêtant sa peau. Le héros portait sur lui la peau de l’animal qu’il avait tué. Il ne la quittait jamais, de même qu’Athéna ne se montrait pas sans l’égide, scellée par le visage de Méduse. Et la tête d’Héraclès se montrait entre les crocs du lion de Némée. L’expression d’Héraclès et d’Athéna était toujours double. L’expression mobile de leur visage était accompagnée de celle, figée, du mort qu’ils portaient sur eux. Mais pour les nombreux anonymes, il suffisait de se ceindre d’une peau animale. De loup, d’ours, de panthère, de lynx. Imprégnées de sueur et de poussière, elles leur garantissaient une promiscuité intacte. Scortum, « peau », « cuir », est le mot le plus commun pour dire « putain ». Le contact avec la peau d’un animal mort permettait de communiquer avec toutes les espèces d’animaux. C’était la langue franche de la métamorphose. Tout cela ne pouvait qu’être mal vu par tous ceux qui étaient en train d’inventer une humanité au profil net, irréversible. Tout comme ils appelaient scortum cette partie du corps féminin « qui subit l’injure du coït », ils assimilèrent à une prostituée quiconque adhérait à une autre peau. Ils savaient que ces lambeaux écorchés témoignaient d’une promiscuité persistante avec le royaume des esprits.
À Sparte, les garçons étaient des loups ; à Athènes, les petites filles étaient des ourses. Les manuels répètent que l’initiation juvénile servait à introduire à l’ordre de la cité. Il s’agissait au contraire de tourner son regard vers un point du passé, vers un état de commixtion avec l’animal dont les hommes s’étaient détachés en devenant loups et ours — avant de devenir ceux qui tuent les loups et les ours. L’initiation était une invitation au souvenir. Un jour, à une certaine époque, on étudierait l’histoire. Et là, on découvrirait ce qui avait eu lieu avant toute histoire : on devenait pendant quelque temps loups et ourses.
À Sparte, aller à la chasse était un devoir du citoyen ; à Athènes, cette décision était laissée au choix individuel. Il y avait à Sparte des chiens de chasse d’État à la disposition de tout le monde. Les enfants étaient peu nourris pour être contraints à chasser. Et pourtant l’utilité matérielle de la chasse était secondaire. La chasse ne débutait qu’après qu’eurent été entonnées des louanges à Artémis.
Pour quelle raison Artémis, belle parmi les belles, la déesse enveloppée de l’aura érotique, au point qu’Aura est l’un de ses noms et l’une de ses figurantes, voulut-elle d’emblée la virginité, comme premier désir d’une enfant ? La virginité est le signe de la séparation, de la distance impossible à combler. Le monde ne peut faire irruption en Artémis, alors qu’Artémis décoche ses flèches sur le monde. Et Artémis ne veut même pas conquérir le monde, qui lui appartient déjà, en tant que souveraine des fauves, des marais et des lieux inviolés. Artémis veut seulement transpercer le monde, elle choisit tour à tour un de ses fragments, un corps qui fuit. Elle l’atteint de loin — et le ramène à elle, dans le sang. Qui frappe, connaît. L’esprit se détache de l’enchevêtrement naturel, il l’observe, l’épie, en détache à son tour une partie et se joint à nouveau à lui à travers le lien le plus intime, la mort, qui ravit son souffle à la proie et l’isole pour toujours. Cette modalité de la connaissance, qui devint ensuite la modalité habituelle de la connaissance, fut à l’origine un effort immense, un arc-boutement de la nature contre elle-même. L’histoire a fini par attribuer ce geste à Apollon. Mais ce fut sa jumelle, Artémis, née juste avant lui, qui fut sa sage-femme. Ce fut Artémis qui fixa dans ce geste le centre de leur vie, obsédant, toujours répété, inépuisé. Elle n’eut même pas besoin d’épingler à ce geste le cartouche avec le mot « connaissance ». Pour elle, c’était la chasse, uniquement la chasse. Pour Apollon, la chasse devint connaissance. Le passé le plus sombre, repoussé désormais vers la steppe, redevint le point focal du regard, mais avec une torsion de la signification si brusque qu’il pouvait apparaître comme une excision du souvenir. Artémis écarta ses parements chargés de dépouilles animales et se glissa dans un chiton relevé jusqu’au-dessus du genou. Il n’était plus question d’endosser la nature, mais de la pénétrer de loin. Le corps d’Artémis, que personne jusqu’alors n’avait vu, était découvert plutôt que nu, tandis qu’elle courait ignorant autour d’elle tout ce qui n’était pas sa proie.
Artémis abandonna à son jumeau Apollon les privilèges de la connaissance qui se proclame comme telle. Dans ses sanctuaires il n’y avait pas de prêtres sévères, maîtres du syllogisme hypothétique, mais des petites filles-ourses et des bourreaux d’étrangers ou des adolescents ensanglantés par les coups de fouet. Mais la pensée n’était pas pour autant absente. Simplement recouverte d’un rideau opaque. La plus semblable à Artémis parmi ses protégées, Iphigénie, se rebella avec fureur contre « les sophismes de la déesse ».
Que les rapports entre Artémis et Apollon ne fussent pas seulement fraternels c’était évident pour Érophile, la plus ancienne des Sibylles de Delphes et la « première femme qui chanta des oracles ». Les Déliens rappelaient l’un de ses hymnes, dans lequel Érophile disait être aussi Artémis, et en tant que telle « femme et parfois sœur et puis fille » d’Apollon. Quand Érophile composa cet hymne elle était bien entendu « délirante et possédée par le dieu », mais ses délires étaient précis : elle avait aussi prédit qu’« Hélène serait élevée à Sparte pour la ruine de l’Asie et de l’Europe et que pour elle les dieux détruiraient Troie ». Pour un dieu, avoir beaucoup de noms est le premier des désirs. Artémis le revendiqua quand elle n’était encore qu’une enfant, assise sur les genoux de son Père. À la requête de la virginité éternelle elle associa la polyōnymíē, la « capacité d’être appelée de plusieurs noms ». Ne serait-ce que pour batailler et rivaliser avec son jumeau Apollon. Chaque nom est un pan de ce qui est, sur lequel s’étend la souveraineté du dieu. Lequel est un singulier absolu, mais qui exige d’être à chaque fois appelé par le nom juste, par un seul de ses nombreux appellatifs. Là réside l’angoisse perpétuelle du dévot polythéiste : non seulement reconnaître le dieu singulier, mais le nom juste avec lequel l’évoquer en telle occasion, en tel lieu. Angoisse ignorée des fidèles des religions du Livre.
Hypostases, épiclèses, appellatifs : aucune autre divinité grecque n’en a accumulé un nombre équivalent autour d’elle. Les noms deviennent pour Artémis comme les animaux de toute sorte qu’elle portait accrochés à son simulacre d’Éphèse. Les chercheurs sont dubitatifs : qu’est-ce qui rassemble ses histoires ? Comment la mère asiatique aux nombreux seins, immobile, peut-elle devenir la fillette vierge qui fuit dans la forêt, le chiton relevé ? Mais Artémis ne fut jamais mère pas plus qu’elle n’eut de nombreux seins. C’est la plus ancienne des équivoques qui l’entourent. Elle ne fut jamais multimammia , ainsi que la nommaient les auteurs chrétiens. Tout au plus pouvait-on la prendre pour un très jeune garçon, de ceux qui suivaient Apollon ou étaient poursuivis par lui.
Telle qu’Artémis la conçut, la chasse fut le modèle de l’action gratuite, irréductible à toute fonction. L’animal chassé n’était pas ensuite sacrifié — ni même mangé. Certainement pas par Artémis, qui se nourrissait d’autre chose. Ni même par ses suivantes, qui ne furent jamais représentées au cours d’un banquet. En dehors de la chasse, le bain était leur seule activité commune. Et nécessaire, car la chasse entraînait des impuretés, elle mêlait la sueur, la poussière et le sang.
La pureté apparaît avec la chasse et avec Artémis : hagné, « pure », ce mot évoque la déesse par excellence (seule Perséphone a droit à la même appellation chez Homère). Mais qu’est-ce que la pureté ?

- Artémis multimammia du type d’Éphèse
IIe siècle AEC, musée de Selçuk.
LA SUPERSTITION DE LA SOCIÉTÉ
Roberto Calasso est un écrivain italien traduit dans le monde entier ; il dirige les Editions Adelphi, à Milan. Ses essais, d’une très grande érudition, témoignent de sa quête des origines sacrées de la culture humaine. De La Ruine de Kasch (1987), méditation sur la légitimité et les liens de sang, à K. (2005), son livre sur Kafka, en passant par Les Noces de Cadmos et Harmonie (1991), La Littérature et les dieux (2002) et plus récemment La Folie Baudelaire (2011), Roberto Calasso se révèle un penseur inclassable. Son style et ses thèmes de prédilection (le sacrifice, la mythologie, la modernité européenne) le situent à l’intersection de la philosophie, de la science des religions, de l’histoire et du roman. Son prochain livre : L’ardeur (2014).
René Girard et Roberto Calasso : deux écrivains en dialogue
René Girard et Roberto Calasso ont mené depuis plus de trente ans un dialogue très riche autour de leurs travaux respectifs qui touchent tous deux aux origines sacrées de la littérature et de la culture en général. La fondation « Imitatio » a souhaité ainsi rendre hommage à Roberto Calasso, en l’invitant dans le cadre des « Conférences René Girard ». Roberto Calasso donna une conférence intitulée « La superstition de la société » à Paris, le 5 juin au Centre Pompidou (Paris), et à Stanford, le 5 novembre 2014.
« La société sécularisée, devenue dominante aujourd’hui, s’attache à étudier des centaines de sociétés du passé, qu’il s’agisse de tribus ou d’empires, qui toutes se sont définies et décrites dans leur relation à quelque chose d’invisible et d’inconnu, parfois habité par des dieux et incluant ce qu’on nomme aujourd’hui la nature. Au contraire, la société sécularisée se définit, se décrit et fonctionne uniquement par rapport à elle-même, puisqu’elle se juge autosuffisante et seule productrice de sens. Les implications et les origines de ce changement seront l’objet de ma conférence. » (Roberto Calasso [4])
1. PRÉSENTATION (Jean-Pierre Dupuy)

2. LA CONFÉRENCE DE CALASSO

3. LE DÉBAT
Dans le débat qui suit la conférence, interventions de Jean-Pierre Dupuy (sur Girard et Durkheim) et de Jacqueline Risset (sur Bataille et Mallarmé).

Crédit : https://www.rene-girard.fr/
[1] Cf. Le grand entretien : Philippe Sollers, la littérature absolue. Je renvoie également à : La mutation du divin — Sur les dieux grecs — Dieu ou la nature - le dieu nouveau, l’extrême — Planète.
[2] Cf. mon article du 12 mai 2019.
[3] Une exception : Roberto Calasso monogrammiste des temps antérieurs et futurs.
[4] Cf. Sur « la société sécularisée » : L’INNOMMABLE ACTUEL.




 Version imprimable
Version imprimable


 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



1 Messages
L’anar du ciel en de beaux draps à prime la cloche sonne un rouge effroi.
1. A la bonne aventure, 18 avril 2021, 14:03, par Albert Gauvin
Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire.