Cahiers de Colette Librairie
Lecture intégrale de Eden, Eden, Eden de Pierre Guyotat à l’occasion du 50ème anniversaire de sa parution le 9 septembre 2020

Il y a cinquante ans, en septembre 1970, Pierre Guyotat, décédé dans la nuit du 6 au 7 février 2020, publiait Éden, Éden, Éden, un des livres les plus subversifs de la littérature du XXe siècle dont Philippe Sollers pouvait dire : « le texte que signe Pierre Guyotat ne s’est pas produit par hasard en France, 1968 », « rien de tel n’a été risqué depuis Sade », ou encore : « un texte placé sous interdiction sexuelle cite la loi à comparaître au déchiffrement de son ressort inconscient : LA LOI EST PORNOGRAPHIQUE ».
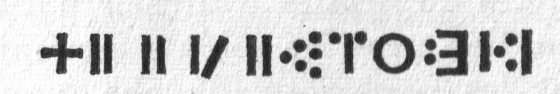
- Et maintenant nous ne sommes plus esclaves
- la phrase tamacheck en caractères tiffinagh qui ouvre Eden, Eden, Eden.
Août 2018. Pierre Guyotat publie Idiotie, récit dans lequel il revient sur ses années de jeunesse et son passage à l’âge d’homme (1957-1962). Dans un entretien du 6 septembre 2018, évoquant les années qui ont suivi, années de "militantisme", communiste, puis gauchiste, Guyotat déclare : « c’est une époque qui m’est chère ». Nous sommes autour de mai 68. Alors qu’aujourd’hui, cette période, de tentative d’éradication en commémoration mortifère, peut sembler bien lointaine, n’est-il pas nécessaire de rappeler l’effervescence qui agitait alors la scène politique et "littéraire" ? Je republie, après l’avoir complété, ce dossier que j’avais mis en ligne, d’un seul mouvement, le 22 mars 2010.

Pierre Guyotat publie un nouveau livre, Arrière-fond (Gallimard, mars 2010). En attendant d’y revenir [1], l’occasion nous est donnée de faire retour sur la période — si lointaine, si proche — où les préoccupations de cet écrivain d’une exigence rare rencontraient celles de Tel Quel, notamment celles de Jacques Henric et de Philippe Sollers. Il y a quarante ans donc...
Guyotat 1967-1972
 Octobre 1967 : parution de Tombeau pour cinq cent mille soldats. Le livre échappe de peu à la censure : mais le général Massu l’interdit dans toutes les casernes françaises d’Allemagne. Déjà connu et reconnu sur manuscrit, le livre rend son auteur immédiatement célèbre.
Octobre 1967 : parution de Tombeau pour cinq cent mille soldats. Le livre échappe de peu à la censure : mais le général Massu l’interdit dans toutes les casernes françaises d’Allemagne. Déjà connu et reconnu sur manuscrit, le livre rend son auteur immédiatement célèbre.
Michel Leiris écrira : « J’ai dit avoir apporté Tombeau pour cinq cent mille soldats à Picasso, tenant absolument à ce qu’il en prenne connaissance. Cela ne me serait pas venu à l’esprit si je n’avais considéré que ce livre présente un intérêt littéraire assez grand pour qu’un homme engagé aussi constamment dans son travail que l’est Picasso passe quelques heures à le lire ».
Jean Paulhan déclare : « Monsieur Guyotat n’est pas sans génie. C’est un génie quelque peu brutal et systématique, mais qui mérite d’être encouragé ».
Dans Le Nouvel Observateur, l’écrivain et sociologue Jean Duvignaud se fait l’interprète de beaucoup en écrivant : « Voici un livre qui a déjà été discuté avec passion avant même d’avoir été publié [...] il s’agit d’un poème épique en prose, d’un pamphlet lyrique, d’un de ces ouvrages « incasables » qui ne ressemblent à aucun mais bouleversent la littérature... » ; « [...] on rencontre rarement chez un écrivain de vingt-cinq ans une aussi grande maîtrise dans le déchaînement de la violence et le contrôle des cauchemars — sauf chez Miller ou chez Lawrence. » ; « [...] il y faut le talent (disons le talent par pudeur) pour contrôler cette fantastique hystérie de la violence et du désir [...] » ; « [...] les jeux de la sophistique critique sont réduits à néant quand paraît une oeuvre comme le Tombeau. »
 1967-1968 : nouveau voyage de Pierre Guyotat dans le Sahara jusqu’au Niger. Rapprochement de Tel Quel.
1967-1968 : nouveau voyage de Pierre Guyotat dans le Sahara jusqu’au Niger. Rapprochement de Tel Quel.
 Mai 1968 : arrêté à deux reprises. Après le discours du Général de Gaulle désignant et menaçant le P.C.F., il adhère à ce parti, qu’il quittera en 1971 [2].
Mai 1968 : arrêté à deux reprises. Après le discours du Général de Gaulle désignant et menaçant le P.C.F., il adhère à ce parti, qu’il quittera en 1971 [2].
 De l’été 1968 au printemps 1969, rédaction d’Éden, Éden, Éden.
De l’été 1968 au printemps 1969, rédaction d’Éden, Éden, Éden.
 Février 1969 : publication, dans Tel Quel n° 36, d’un extrait du roman sous le titre de Bordels Boucherie (écrit du 13 au 18 août 1968).
Février 1969 : publication, dans Tel Quel n° 36, d’un extrait du roman sous le titre de Bordels Boucherie (écrit du 13 au 18 août 1968).
 Septembre 1970 :
Septembre 1970 :
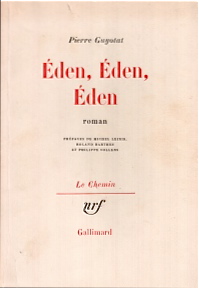
- 1ère édition, septembre 1970.
parution chez Gallimard d’Éden, Éden, Éden avec trois préfaces de Michel Leiris, Roland Barthes et Philippe Sollers. Sollers : « Éden, Éden, Éden : rien de tel n’a été risqué depuis Sade. » Le 7 septembre, Michel Foucault écrit dans Le Nouvel Observateur un article prémonitoire : « Il y aura scandale, mais... »
Un mois après sa parution, le livre est, par arrêté du Ministre de l’Intérieur signé du Directeur de la Police Nationale, frappé d’une triple interdiction : affichage, publicité, mineurs. Une pétition internationale à l’initiative de Jérôme Lindon, directeur des Éditions de Minuit [3], est signée par Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Pierre Boulez, Michel Leiris, Dionys Mascolo, Claude Mauriac, Nathalie Sarraute, Jean-Paul Sartre, Claude Simon, Michel Butor, Jean Cayrol, Jacques Derrida, Marguerite Duras, Michel Foucault, Claude Ollier, Roger Pinget, Marcelin Pleynet, Alain Robbe-Grillet, Maurice Roche, Philippe Sollers, Paule Thévenin, Jean Thibaudeau, François Wahl, Kateb Yacine [4] ; une question orale de François Mitterrand à l’Assemblée Nationale, une intervention écrite du président Pompidou auprès de son ministre de l’Intérieur, Raymond Marcellin, restent sans effet.
Le livre suscite de très vives polémiques dans la presse française, européenne et américaine : les avant-gardes, qui le soutiennent, seront très influencées par ce livre dont Michel Foucault déclare dans une interview au Japon : « Guyotat a écrit un livre dans une langue d’une totale nouveauté. Je n’ai jamais lu quelque chose de semblable dans aucune littérature. Personne n’a jamais parlé comme il parle ici. »
 Claude Simon (prix Médicis 1967 pour son roman Histoire) démissionne du jury du prix Médicis, qui, à une voix près, n’a pas couronné Éden, Éden, Éden. « Il m’a été fait violemment grief de mon intention de donner ma voix à Pierre Guyotat pour son roman Eden, Eden, Eden, que je considère comme une œuvre littéraire rigoureuse, austère même, et de tout premier plan. [...] Je trouve, moi, étonnant et pour le moins regrettable qu’une assemblée d’écrivains [...] ne saisisse pas l’occasion qui lui était offerte, en couronnant un ouvrage pratiquement interdit par une mesure administrative parfaitement arbitraire, de manifester ainsi son attachement aux plus élémentaires libertés d’expression. »
Claude Simon (prix Médicis 1967 pour son roman Histoire) démissionne du jury du prix Médicis, qui, à une voix près, n’a pas couronné Éden, Éden, Éden. « Il m’a été fait violemment grief de mon intention de donner ma voix à Pierre Guyotat pour son roman Eden, Eden, Eden, que je considère comme une œuvre littéraire rigoureuse, austère même, et de tout premier plan. [...] Je trouve, moi, étonnant et pour le moins regrettable qu’une assemblée d’écrivains [...] ne saisisse pas l’occasion qui lui était offerte, en couronnant un ouvrage pratiquement interdit par une mesure administrative parfaitement arbitraire, de manifester ainsi son attachement aux plus élémentaires libertés d’expression. »
 « Affaire dans l’affaire, a-t-on pu écrire,
« Affaire dans l’affaire, a-t-on pu écrire,
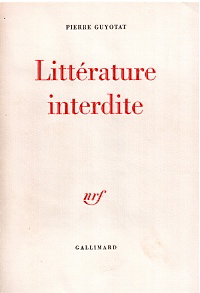
- 1ère édition, mars 1972
(puisque Guyotat passe à côté du Médicis comme Louis-Ferdinand Céline était passé à côté du Goncourt pour son Voyage), qui se double d’une crise dans une crise, entre Tel Quel et Les Lettres françaises, toutes deux d’obédience communiste. Pierre Guyotat, encore membre du parti à cette époque, est violemment dénoncé par Les Lettres françaises, hebdomadaire dirigé par Louis Aragon et Pierre Daix, comme « un obsédé de l’acte sexuel, un maniaque délirant ou un "truqueur" ». À noter toutefois que la presse communiste est divisée, puisque L’Humanité prend la défense du livre, et que La Nouvelle Critique ouvrira alternativement ses colonnes à ses opposants et à ses détracteurs. » [5].
 Octobre 1971 : Maurice Blanchot évoque dans L’Amitié : « [...] l’interdiction qui a frappé Éden, Éden, Éden de Pierre Guyotat, livre non pas scandaleux, mais seulement trop fort. » [6].
Octobre 1971 : Maurice Blanchot évoque dans L’Amitié : « [...] l’interdiction qui a frappé Éden, Éden, Éden de Pierre Guyotat, livre non pas scandaleux, mais seulement trop fort. » [6].
 Février 1972 : Pierre Guyotat et Jacques Henric démissionnent du PCF.
Février 1972 : Pierre Guyotat et Jacques Henric démissionnent du PCF.
 Mars 1972 : Littérature interdite présente un dossier relatif à l’interdiction d’EEE (essentiellement des entretiens de Guyotat et des articles suscités par le roman) [7].
Mars 1972 : Littérature interdite présente un dossier relatif à l’interdiction d’EEE (essentiellement des entretiens de Guyotat et des articles suscités par le roman) [7].
 Après le colloque de Cerisy consacré à Artaud-Bataille où il lit Langage du corps (juillet 1972) [8], Pierre Guyotat s’éloignera de Tel Quel.
Après le colloque de Cerisy consacré à Artaud-Bataille où il lit Langage du corps (juillet 1972) [8], Pierre Guyotat s’éloignera de Tel Quel.
 Avril 1973 : Bond en avant, pièce de théâtre de Pierre Guyotat est mis en scène par l’auteur et Alain Ollivier à La Rochelle. Silence de Tel Quel [9].
Avril 1973 : Bond en avant, pièce de théâtre de Pierre Guyotat est mis en scène par l’auteur et Alain Ollivier à La Rochelle. Silence de Tel Quel [9].
 En 1975, à la sortie de Prostitution, Sollers écrira un nouvel article sur L’effet Guyotat dans Le Nouvel Observateur. Il y écrit : « il n’y a aucun moyen de parler de Prostitution avec rigueur si ce n’est dans la perspective analytique » / « Ce n’est pas un livre que vous avez à lire : c’est une question sur votre inconscient. »
En 1975, à la sortie de Prostitution, Sollers écrira un nouvel article sur L’effet Guyotat dans Le Nouvel Observateur. Il y écrit : « il n’y a aucun moyen de parler de Prostitution avec rigueur si ce n’est dans la perspective analytique » / « Ce n’est pas un livre que vous avez à lire : c’est une question sur votre inconscient. »
 Mars 1977 : des extraits de Cassette 33 longue durée sont publiés en mars 1977 dans la revue Minuit (n° 23) [10].
Mars 1977 : des extraits de Cassette 33 longue durée sont publiés en mars 1977 dans la revue Minuit (n° 23) [10].
 30 décembre 1981 : l’interdiction d’Eden, Eden, Eden est levée.
30 décembre 1981 : l’interdiction d’Eden, Eden, Eden est levée.
 1983 : Guyotat publie A la sueur de mon sexe dans L’Infini n° 1 (Hiver 1983) et Le Livre (extraits) dans L’Infini n° 2 (Printemps 1983).
1983 : Guyotat publie A la sueur de mon sexe dans L’Infini n° 1 (Hiver 1983) et Le Livre (extraits) dans L’Infini n° 2 (Printemps 1983).
Eden, Eden, Eden
Les trois préfaces
Trois fois dit, comme pour mieux enfoncer le clou, le mot « éden » annonce — dès le seuil de ce livre — que ce n’est pas un enfer, non plus d’ailleurs qu’un paradis, que Pierre Guyotat se propose de faire visiter.
Maints lecteurs, certes, seront rebutés par ce qu’un pareil livre a d’abrupt et (si l’on veut) de choquant, vu les règles de savoir· vivre littéraire auxquelles notre société reste soumise, en dépit de bien des entorses ! Mais n’est-ce pas, justement, par son absolu défaut de concessions — soit d’un côté soit de l’autre - qu’un tel ouvrage fait tache sur la quasi-totalité de la production d’aujourd’hui ?
Maniaquement, estimeront les plus sévères, l’auteur suit son idée ou, plutôt, s’engage à fond dans l’infini d’un discours qui ne prétend rien démontrer, ne cherche pas à « raconter », mais vise simplement à montrer ou, plus exactement, à piéger le lecteur par le moyen d’un compte rendu minutieux, qui dénote chez Pierre Guyotat — quelque opinion qu’on puisse avoir de son œuvre — à tout le moins une capacité d’halluciner à quoi n’atteignent que fort peu d’écrivains.
De ce texte, dont la note presque exclusive est un érotisme exacerbé, cartes sur table au point qu’il peut paraître aussi sordide qu’un étalage de pièces à conviction sur un bureau de magistrat ou de policier, il est certain qu’une poésie sans complaisance se dégage. Cela, parce que les choses y sont prises sur un mode auquel les nuances psychologiques sont étrangères et qu’on ne peut même pas qualifier de « biologique » (ce qui serait trop restrictif et risquerait en outre de suggérer un vitalisme tout proche du panthéisme), mode qui est en vérité celui du contact pur et nu — exempt de toute interprétation faisant écran — avec des corps vivants et les objets fabriqués qui constituent leurs coques ou leurs appendices.
Mis en jeu de façon égalitaire ou peu s’en faut, êtres et choses sont, en effet, donnés ici pour rien de plus que ce qu’ils sont dans la réalité stricte de leur présence physique, animée ou inanimée : hommes, bêtes, vêtements et autres ustensiles jetés dans une mêlée en quelque sorte panique, qui évoque le mythe de l’éden parce qu’elle a manifestement pour théâtre un monde sans morale ni hiérarchie, où le désir est roi et où rien ne peut être déclaré précieux ou répugnant.
Poésie implicite, que relaye parfois une poésie explicite : ces moments où, au-dessus du magma qu’agite seule la quête d’assouvissement que mène chacun des protagonistes, une parole humaine se fait jour, d’autant plus émouvante qu’elle semble émerger — comme par miracle — d’une couche d’existence où toute parole est abolie.
Michel Leiris.
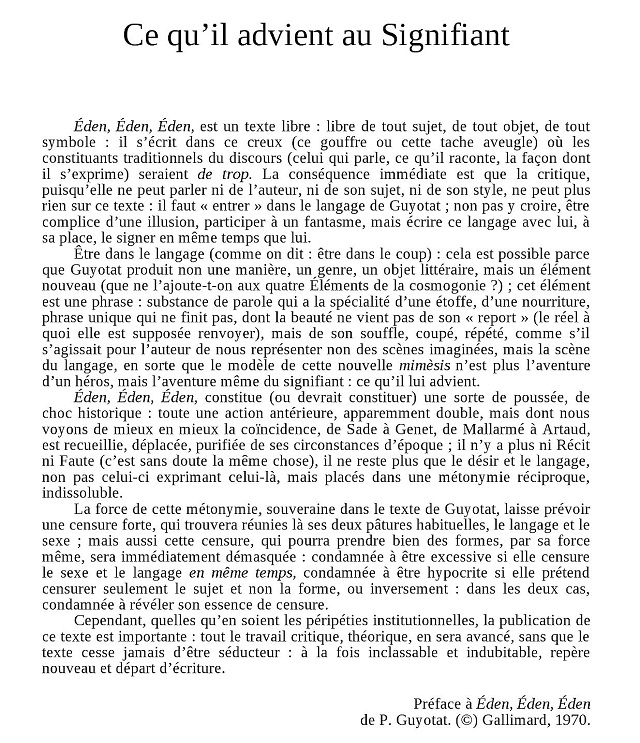
Roland Barthes.
ZOOM : cliquer sur l’image

17.. / 19..
(suggestions)
« rien n’est plus beau, plus grand que
le sexe et, hors du sexe, il n’est point de salut. »
Sade, Lettre à sa femme
(Vincennes, 25 juin 1783).
0. — Paris, 1969 : le règne de la bourgeoisie, encore provisoirement dominante, pourrit ; son idéologie est clôturée de partout. La lutte n’en sera pas moins longue, complexe.
1. — Éden, Éden, Éden : rien de tel n’a été risqué depuis Sade. Ce qui veut dire : la possibilité existe maintenant dans l’histoire de lire entièrement Sade ; une autre histoire s’ouvre que celle où Sade aura désigné un point d’aveuglement radical ; il faut lire Éden, Éden, Éden autrement qu’en rapport avec Sade.
2. — Nous pouvons proposer des dates : elles nous donneraient les premiers éléments d’une histoire analytique de la façon dont le sexe a pu commencer à s’écrire découpant ainsi le revers de tous nos discours. Par exemple, 1783, en exergue, signifie pour nous à la fois l’invisibilité du bouleversement révolutionnaire bourgeois et l’écriture enfermée, ineffaçable de Sade. Mais qui, à ce moment, est présent pour en penser l’articulation ? Personne.
Or il s’agit ici de suggérer que si la place où ces lignes se manifestent aujourd’hui (1970) n’est pas nécessairement occupée par une prévision infaillible, pourtant, et du fait même de la continuité discontinue de la révolution au travail — cette fois devenue celle, sans sujet, des masses — et d’une écriture matérialiste qui la double de plus en plus consciemment, nous sommes à nouveau, mais de manière transformée, en période d’imminence historique. Le texte de Sade serait ainsi à situer sur reb9rd immédiatement antérieur d’un anneau temporel en train de se refermer. Autre exemple : on peut considérer que la lecture de Sade a seulement été assurée en 1931, lorsque Maurice Heine écrit : « Il faut plaindre ceux qui, de cet effort exemplaire vers la plus féroce analyse de l’être ne peuvent ou ne veulent retenir que des obscénités à leur taille. Certes la brutale clarté projetée sur les replis les moins avoués e ce qu’il est convenu d’appeler l’âme, doit leur paraître plus insupportable encore que la lumière tamisée des conceptions psychanalytiques. » Cette phrase, naturellement, a vieilli. Nous devons éviter tout ce qui pourrait renvoyer une écriture à « l’être ». Par ailleurs, la psychanalyse est devenue, ou redevenue, l’enjeu d’un combat fondamental. Cependant qui, aujourd’hui, face à Éden, Éden, Éden, devrons-nous plaindre ?
3. — Autre illustration. Blanchot écrit, plus près de nous :« Avec Sade - et à un très haut point de vérité paradoxale - nous avons le premier exemple (mais y en eut-il un second ?) de la manière dont écrire, la liberté d’écrire, peut coïncider avec la liberté réelle quand celle-ci entre en crise et provoque une vacance d’histoire. » Ici, nous ajouterons simplement pour qui veut comprendre : le texte que signe Pierre Guyotat ne s’est pas produit par hasard en France, 1968.
4. — L’entrelacement histoire / écriture (et non pas, abstraitement, « l’écriture »). Sa base : le matérialisme historique. La lutte des classes et le sexe comme fils rouges permettant de le déchiffrer. 1869 : Les Chants de Maldoror. 1871 : La Commune de Paris. 1884 : L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, où Engels note : « Nous marchons maintenant à une révolution sociale dans laquelle les fondements économiques actuels de la monogamie disparaîtront tout aussi sûrement que ceux de son complément :la prostitution. » Cet entrelacement appelle sa science.
5. — Ne pas oublier ceci, que n’oublie pas une seconde la force surprenante gouvernant Éden, Éden, Éden : « la radicale inadéquation de la pensée au sexe, à laquelle il faut se tenir, sous peine d’être victime de ce dont Freud menaçait Jung : à savoir "le flot de fange de l’occultisme" » (Lacan).
6. — Récuser simultanément la censure et la contre-censure, l’une morale, l’autre psychologique. C’est-à-dire l’exploitation de la représentation sexuelle ( la sexualité au lieu du sexe). Empêcher de manière obstinée, en se répétant autant qu’il faudra, toute sublimation et en particulier celle qui croit pouvoir se présenter sous une pseudo-nudité. Censure : refoulement au premier degré. Contre-censure : refoulement au second degré (préciosité, érotisme).
7. — Affirmer sans relâche la base matérialiste. Or le matérialisme est encore dominé et ne peut par conséquent s’indiquer que sous le masque d’une monstruosité dont personne n’a encore idée car elle n’est, finalement, plus monstrueuse : d’une évidence complète, au contraire, comme l’infinité même de l’univers. Comme l’ébranlement appelé, en son temps, dionysiaque :« Vêtu de la nébride sacrée, il recherche le sang des boucs agonisants, avec un appétit glouton pour la chair crue » (Euripide). Mais sans aucun mythe, sans aucun dieu. Dans un retour sans fin d’animal. Dans la seule explosion désertique écrite.
8. — Prendre en charge le meurtre généralisé de toute sexualité, propre ou impropre, dans sa revendication limitée : accepter telle ou telle sexualité, c’est croire à l’adéquation, impossible, de la pensée au sexe. Contre tout ce qui veut se montrer en restant caché, contre tout ce qui veut se cacher en croyant se montrer. Meurtre contre la jouissance sur fond de propriété.
9. — Étendre les pouvoirs d’une seule phrase au fourmillement matériel, divisé, emporté par une pulsion incessante. Mécanique organique et céleste, biologique, chimique, physique, astronomique. « Les sciences de la nature engloberont plus tard les sciences de l’homme de même que les sciences humaines engloberont les sciences naturelles, en sorte qu’il n’y aura plus qu’une seule science. » (Marx). Dès la première page d’Éden, Éden, Éden, voici ce théâtre inouï : silex, épines, sueur, huile, orge, blé, cervelle, fleurs, épis, sang, salive, excréments... Voici l’espace d’or des matières et des corps, indéfiniment transmutables, rythmiques.
10. — Donc : « Les soldats, casqués, jambes ouvertes, foulent, muscles retenus, les nouveau-nés emmaillotés dans les châles écarlates, violets : » [11]
Eden, Eden, Eden
Extraits
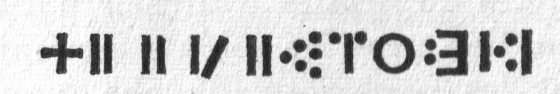
- Et maintenant nous ne sommes plus esclaves
- la phrase tamacheck en caractères tiffinagh qui ouvre Eden, Eden, Eden.
« / Les soldats, casqués, jambes ouvertes, foulent, muscles retenus, les nouveaux-nés emmaillotés dans les châles écarlates, violets : les bébés roulent hors des bras des femmes accroupies sur les tôles mitraillées des G.M.C. ; le chauffeur repousse avec son poing libre une chèvre projetée dans la cabine ; / au col Ferkous, une section du RIMA traverse la piste ; les soldats sautent hors des camions ; ceux du RIMA se couchent sur la caillasse, la tête appuyée contre les pneus criblés de silex, d’épines, dénudent le haut de leur corps ombragé par le garde-boue ; les femmes bercent les bébés contre leurs seins : le mouvement de bercée remue renforcés par la sueur de l’incendie les parfums dont leurs haillons, leurs poils, leurs chairs sont imprégnés : huile, girofle, henné, beurre, indigo, soufre d’antimoine — au bas du Ferkous, sous l’éperon chargé de cèdres calcinés, orge, blé, ruchers, tombes, buvette, école, gaddous, figuiers, mechtas, murets tapissés d’écoulements de cervelle, vergers rubescents, palmiers, dilatés par le feu, éclatent : fleurs, pollen, épis, brins, papiers, étoffes maculées de lait, de merde, de sang, écorces, plumes, soulevés, ondulent, rejetés de brasier à brasier par le vent qui arrache le feu, de terre ; les soldats assoupis se redressent, hument les pans de la bâche, appuient leurs joues marquées de pleurs séchés contre les ridelles surchauffées, frottent leur sexe aux pneus empoussiérés ; creusant leurs joues, salivent sur le bois peint ; ceux des camions, descendus dans un gué sec, coupent des lauriers-roses, le lait des tiges se mêle sur les lames de leurs couteaux au sang des adolescents éventrés par eux contre la paroi centrale de la carrière d’onyx ; les soldats taillent, arrachent les plants, les déracinent avec leurs souliers cloutés d’autres shootent, déhanchés : excréments de chameaux, grenades, charognes d’aigles ;[…] »
« /le mirador surplombe la palmeraie calcinée ; la sentinelle peuhl, iris jaune glissant sur le globe bleu, laine crânienne ensuée, bascule le projecteur : le faisceau fouaille les chairs ensuées des soldats arc-boutés sur la femme ; la sentinelle broie son membre dans son poing, tourne le projecteur : le faisceau traverse le lit asséché de l’oued, saisit une vibration, sous le zéphir, des lauriers-roses empoussiérés : une troupe de chacals y déchire une charogne d’âne […] ; la sentinelle roule le projecteur sur le châssis, le faisceau arde les seins qui palpitent, pubescents, semés de sucre sous les pans encrassés du treillis […] ; la sentinelle, du poing, fait pivoter le projecteur vers la stratosphère… »
« …sous le surplomb du roc, les soldats soufflent sur un feu de branches dressé sur la bouche ouverte d’une femme morte […] ; je frotte ma poitrine à la toison de son sexe, une alouette y est prise ; à son cri, chaque fois que ma poitrine pèse sur le corps, jaillissent des larmes sur mes yeux ; un sang chaud ruisselle hors de mes oreilles ; la pluie d’excréments éclabousse le rocher ; les sangs, dans la vasque, brûlent, bouillonnent ; un jeune rebelle, ses pieds nus enduits de poudre d’onyx, ses lèvres de farine, sort de terre, se penche sur la vasque, plonge sa tête, ses poings […] ; au camp, les femmes pèsent sur les barrières, le sexe des soldats se tend vers leurs mères, venues de métropole, sur ordre de l’État-major, pour les Fêtes du Servage ; ma mère, je l’emporte dans ma chambrée de bambou, je la couche sur la litière de paille empoisonnée ; tête, épaules plongées sous sa robe, je mange les fruits, les beignets d’antilope sur son sexe tanné tandis qu’elle, fatiguée par le voyage en cale, en benne, s’endort ; à l’aurore, elle s’est échappée de dessous mon corps ; étreinte par les soldats sous le mirador où je veille éjaculant, leurs genoux la renversent sur le sable… »
A propos d’Eden, Eden, Eden vous trouverez ci-dessous l’article de Michel Foucault du 9 septembre 1970, les entretiens de Pierre Guyotat publiés dans la revue Tel Quel à l’automne 1970 et dans la revue Promesse au printemps 1971, ainsi que la longue analyse parue dans le numéro 290 de Critique en juillet 1971 sous le titre La matière et sa phrase [12]. Ce qui frappe dans tous ces textes est l’accent mis sur la sortie de la "représentation" et du sujet "psychologique", sur le matérialisme, le corps, le sexe et sur le rôle primordial assigné au lecteur.
Guyotat parle de Michel Leiris
Mais auparavant il faut revenir sur la rencontre de Pierre Guyotat avec Michel Leiris — écrivain aujourd’hui trop méconnu (anti-spectaculaire). Cette rencontre se situe au milieu des années 60. Guyotat en parlait avec Alain Veinstein le 22 janvier 2009 [13]. Il évoque le voyage à Cuba de 1967. La personnalité discrète et attachante de Leiris, son rôle important, mais aussi celui de Sollers, au moment de la publication d’Eden, Eden, Eden, et, surtout, le très grand écrivain qu’était Leiris, notamment à travers L’Afrique fantôme et les volumes de La règle du jeu [14].
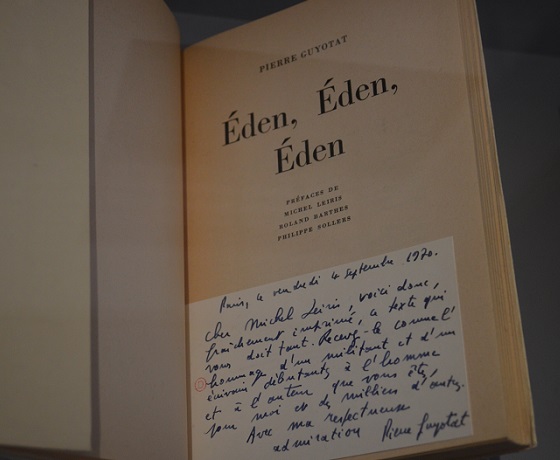
- Exposition Leiris & Co. Centre Pompidou-Metz.
Paris, ce vendredi 4 septembre 1970
Cher Michel Leiris, voici donc, fraîchement imprimé, ce texte qui vous doit tant. Recevez-le comme l’hommage d’un militant et d’un écrivain débutants à l’homme et à l’auteur que vous êtes, pour moi et des milliers d’autres.
Avec ma respectueuse admiration. Pierre Guyotat
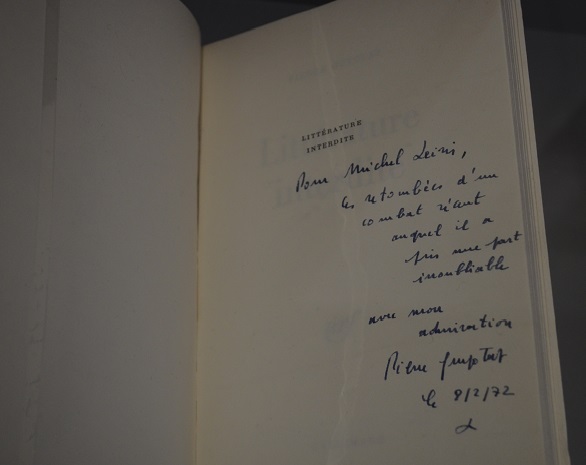
- Exposition Leiris & Co. Centre Pompidou-Metz.
Photos A.G., 09-09-15.
Pour Michel Leiris,
les retombées d’un combat récent auquel il a pris une part inoubliable
avec mon admiration
Pierre Guyotat le 9/2/72.
« Il y aura scandale, mais... »
par Michel Foucault
 Ce livre, vous le savez bien, sera moins facilement reçu que le « Tombeau ». Il y manque ce bruit de guerre qui avait permis à votre premier roman d’être entendu. On veut que la guerre ne soit qu’une parenthèse, le monde interrompu ; et à cette condition on admet que tous les extrêmes s’y rencontrent. Je me demande si le « Tombeau » n’est pas passé à la faveur d’une fausse dramatisation ; on a dit : c’est l’Algérie, c’est l’occupation, alors que c’était le piétinement de toute armée, et le brouhaha infini des servitudes. On a dit : c’est le temps où nous étions coupables, nous nous y reconnaissons, nous voilà donc innocents, alors que ces coups, ces corps, ces blessures dans leur nudité, loin d’être une image de la morale, valaient pour le signe pur de la politique. A l’abri de la grande excuse guerrière, ce que vous racontiez nous parvenait allégé comme un chant du lointain. Votre triple « Eden » reprend le même discours, mais à la plus petite distance possible, au-dessous des limites de l’accommodation. On ne peut plus voir, on ne peut plus imaginer le lieu où vous parlez et d’où nous viennent ces phrases, ce sang : brouillard de l’absolue proximité.
Ce livre, vous le savez bien, sera moins facilement reçu que le « Tombeau ». Il y manque ce bruit de guerre qui avait permis à votre premier roman d’être entendu. On veut que la guerre ne soit qu’une parenthèse, le monde interrompu ; et à cette condition on admet que tous les extrêmes s’y rencontrent. Je me demande si le « Tombeau » n’est pas passé à la faveur d’une fausse dramatisation ; on a dit : c’est l’Algérie, c’est l’occupation, alors que c’était le piétinement de toute armée, et le brouhaha infini des servitudes. On a dit : c’est le temps où nous étions coupables, nous nous y reconnaissons, nous voilà donc innocents, alors que ces coups, ces corps, ces blessures dans leur nudité, loin d’être une image de la morale, valaient pour le signe pur de la politique. A l’abri de la grande excuse guerrière, ce que vous racontiez nous parvenait allégé comme un chant du lointain. Votre triple « Eden » reprend le même discours, mais à la plus petite distance possible, au-dessous des limites de l’accommodation. On ne peut plus voir, on ne peut plus imaginer le lieu où vous parlez et d’où nous viennent ces phrases, ce sang : brouillard de l’absolue proximité.
Le « Tombeau », malgré l’apparence, était hors chronologie : on l’a méconnu en essayant d’y inscrire une date. « Eden » (par définition) est hors lieu ; mais je pense, bien qu’on essaiera de le réduire en lui trouvant une patrie : ce sera le corps (le corps, c’était, dans la pensée d’hier, une élégance « matérialiste » pour sauver le sujet, le moi, l’âme). Pourtant c’est d’en deçà du corps que votre texte nous arrive : surfaces, éclatements, ouvertures - blessures, vêtements et peaux qui se retournent et s’inversent, liquides blancs et rouges, « ruissellement du dehors éternel ».
J’ai l’impression que vous rejoignez par là ce qu’on sait de la sexualité depuis bien longtemps mais qu’on tient soigneusement à l’écart pour mieux protéger le primat du sujet, l’unité de l’individu et l’abstraction du « sexe » : qu’elle n’est point à la limite du corps quelque chose comme le « sexe », qu’elle n’est pas non plus, de l’un à l’autre, un moyen de communication, qu’elle n’est pas même le désir fondamental ou primitif de l’individu, mais la trame même de ses processus lui est largement antérieure ; et l’individu, lui, n’en est qu’un prolongement précaire, provisoire, vite effacé ; il n’est, en fin de compte, qu’une forme pâle qui surgit pour quelques instants d’une grande souche obstinée, répétitive. Les individus, des pseudopodes vite rétractés de la sexualité. Si nous voulions savoir ce que nous savons, il faudrait renoncer à ce que nous imaginons de notre individualité, de notre moi, de notre position de sujet. Dans votre texte, c’est peut-être la première fois que les rapports de l’individu et de la sexualité sont franchement et décidément renversés ; ce ne sont plus les personnages qui s’effacent au profit des éléments, des structures, des pronoms personnels, mais la sexualité qui passe de l’autre côté de l’individu et cesse d’être « assujettie ».
En approchant de ce point vous avez été contraint de dépouiller ce qui rendait le « Tombeau » accessible ; il vous a fallu faire éclater toutes les formes et tous les corps, accélérer toute la grande machinerie de la sexualité et la laisser se répéter sur la ligne droite du temps. Vous vous promettez, je le crains (j’allais dire : je l’espère, mais c’est trop facile quand il s’agit d’un autre) bien de l’opposition... Il y aura scandale, mais c’est d’autre chose qu’il s’agit.
Michel Foucault, Le Nouvel Observateur du 7 septembre 1970.
Septembre 1970.
Crédit : Ph. Forest, Histoire de Tel Quel.
ZOOM : cliquer sur l’image

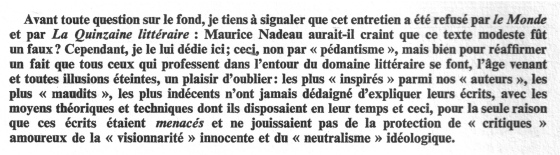
QUESTION : Dès les premières lignes de votre texte, Eden, Eden, Eden une violence égale à celle de Tombeau pour cinq cent mille soldats éclate : d’abord violence guerrière et sexuelle, puis peu à peu d’autres formes de cette violence : prostitution, servage. La violence sous toutes ces formes, on la trouvait dans Tombeau ; cette violence en son temps, a frappé, elle a choqué, voire écoeuré. Avec Eden, Eden, Eden, quelque chose, et d’importance, a changé : le prestige des préfaciers, Michel Leiris, Roland Barthes et Philippe Sollers, en témoigne. Quel est le rapport de ce texte à Tombeau ? Comment d’emblée lire ce texte ? Que répondriez-vous aux tenants d’une littérature "tranquille" ?
RÉPONSE : Eh bien, j’ai donc écrit un texte après Tombeau, ceci n’est pas une lapalissade : pour un certain nombre de personnes irresponsables, mêlées de trop près au travail de l’auteur (cette foule interlope de névropathes, ratés du grand journalisme, de l’édition, de la littérature, de la politique, de l’enseignement, de l’administration et de toute église, ratés retraités du trotskysme, ratés retraités du stalinisme, ratés retraités du sionisme : "directeurs" littéraires usurpant le dur travail de lecteurs sous-payés, critiques "favorables" ou non, oubliant tout égard dû à un travail de préparation, de rédaction, de défense qui engage non pas l’ "être" mais le corps tout entier en lui portant des coups indélébiles ), un livre, surtout fort, peut tenir du "miracle" ; on craint donc que le "miracle" ne se reproduise plus, on espère au mieux qu’il se reproduira sous la même forme ; mais quand le "thaumaturge" change de main... !
Un livre n’est pas un miracle, l’auteur n’est pas un thaumaturge, Eden, Eden, Eden (terminé dès avril 1969) est une suite logique à mon travail de Tombeau. Il est évident que les événements de mai 1968 en durcissant la situation politique, ont durci aussi les textes et le combat qui se mène autour d’eux. Il n’y a du reste que les médiocres pour un parler d’"inféodation" à un parti ou à une théorie : Eden, Eden, Eden, qu’on se plaît aujourd’hui à présenter comme une aggravation de Tombeau jugé en son temps comme mausolée à l’anarchie et au lyrisme, a pourtant été écrit après mon adhésion progressive d’une part au communisme, d’autre part aux thèses de Tel Quel. Il faut, justement, sans cesse réaffirmer la scientificité du texte, pour prévenir, dès aujourd’hui, d’éventuelles — mais bien improbables, à considérer l’extrême gravité avec laquelle les problèmes de la relation du politique au culturel sont aujourd’hui traités par les militants — tentatives d’oppression bureaucratique. Tout le reste est "littérature". De toute façon, il y a eu assez fortement malentendu sur Tombeau, c’est, me semble-t-il, le "lyrisme" de ce livre qui en a entraîné et forcé la lecture alors que sa performance était d’ordre textuel : une énorme quantité de syntaxe y était brassée.
Ce "lyrisme" au premier abord, paraît absent de Eden, Eden, Eden ; d’où un nouveau malentendu possible sur ce texte. Non. Eden, Eden, Eden, texte, succède à Tombeau pour cinq cent mille soldats, texte, et non une " absence de chant " à un " chant ".
Eden, Eden, Eden doit — devrait — être lu hors de toute notion de représentation ("Littérature" opposée ou mêlée, selon les cas d’urgence idéologiques, à la "Vie" ...), de toute menace d’écoeurement — les tenants de la "littérature tranquille" fantasment sur la notion de représentation. Je n’ignore pas que ce texte peut troubler , mais la mesure la plus salutaire dans cet ordre de choses, serait de replacer dans ses limites historiques, dès le primaire, le concept de représentation, donc de rendre au texte ce qui appartient au texte et d’en produire l’analyse la plus rigoureuse. La censure, fatalité liée à la fatalité de la représentation , se trouverait alors déplacée. La scientifisation progressive du texte, rendra progressivement illégitimes voire illégales, censure et critique traditionnelles, toutes formes de l’oppression idéologique de la classe dominante. De toute manière, la "monstruosité" de Eden, Eden, Eden annule, devrait annuler, d’emblée, tout réflexe de représentation, ou toute pause permettant une résolution organique limitée du fantasme représentationnel, effet de la tentative d’appropriation du texte.
Q. : Vous faites donc une relation entre la littérature et la science. Comment fonctionne cette relation ? Ne craignez-vous pas qu’elle amenuise la spécificité de la poésie, encore que vos préfaciers signalent sans réserve la puissance poétique d’Eden, Eden, Eden ?
R. : En premier lieu, je travaille un matériau, une matière première : ma langue maternelle — ce qui constitue déjà psychanalytiquement un acte scientifique. A cette langue prise à un stade historiquement donné, 1970, je fais subir sa poussée historique, produite par un bouleversement simultané de la syntaxe, de la sémantique et de la ponctuation, mises en oeuvre d’abord expérimentalement. Pourquoi ce bouleversement ? Parce qu’au niveau du sens, une trop grande masse de formules lexicales et syntaxiques participe encore d’un niveau scientifique périmé, — perpétuées jusqu’à nous par les nécessités de la valorisation idéaliste — : comment expliquer qu’aujourd’hui encore, quatre siècles après Copernic, on utilise officiellement des termes aussi inexacts et anthropocentristes que "coucher du soleil", "lever du soleil" etc. ? C’est pourquoi la totalité des faits de ce texte est provoquée matériellement — en deçà du niveau psychologique — et explicable, me semble-t-il, par les sciences ethnographique, géographique, biologique, économique et même linguistique (par exemple les symptômes tuberculeux du nomade et les phrases-paroles construites sur le modèle tamacheck).
Cela dit, ce niveau de scientificité le plus évident n’est pas le plus important ; en effet, ce qui fait que ce texte n’est pas un manuel spéculatif, mais un texte littéraire , à charge émotionnelle, c’est le processus de double osmose, si je puis dire, entre le niveau des sens du mot et celui de ses constituants phonétique, alphabétique etc., entre le signifié et le signifiant du mot dans la phrase — Vous voyez que le lieu du contrôle le plus rigoureux du texte est aussi celui de la plus intense poésie . Quant au reproche qui me sera sans doute fait — qui le fut pour Tombeau — de " monotonie ", il est une fois de plus motivé par ce même réflexe de représentation et d’analogie qui a longtemps, par exemple, interdit une lecture émancipée, non névrotique du texte de Sade. Il n’y a pas deux figures semblables dans ce texte ; pourtant, la totalité de Eden, Eden, Eden développe un seul acte, l’acte sexuel, pris ici dans sa forme générique. Jacques Derrida écrit de cette "monotonie" qu’elle est "inépuisable".
Q. : Votre texte en effet libère une masse abondante, toujours liée au sexe, de faits socio-économiques et médicaux bien précis, et géographiquement localisés. L’allusion que vous faite au dialecte tamacheck laisse penser que votre zone d’action est touarègue. Pouvez-vous expliciter le rapport de ce lieu au texte ?
R. : Cette relation est, en apparence au moins, directement produite par un fait biographique — non pas hasard, mais contrainte historique : conscription et guerre d’Algérie —. Depuis lors, quand le texte est écrit, et que, surtout, sa défense est assurée, dans la mesure de mes moyens je retourne vers ces zones sub-désertiques et désertiques. Ces zones, je les ai traversées d’une part comme semi-esclave (deuxième classe soumis au bon vouloir des officiers, jusqu’à l’interrogatoire et l’emprisonnement) ; d’autre part comme "nomade" non-citoyen des lieux qu’il parcourt. Ces deux conditions d’irresponsabilité relative, constituent le lieu mental à partir duquel a pu être osé un discours inouï : l’acte sexuel est, ici, écrit, traité, cela dit, à un niveau moins immédiat, il est certain qu’ "une écriture qui prend immédiatement tous ses risques", n’a pu être produite qu’à partir d’un terrain lui-même risqué — Il est à noter que Eden, Eden, Eden s’achève, s’interrompt, se dissout en un lieu de géographie générale : approches de la steppe, où, lors de mon dernier voyage jusqu’au Sahara nigérien, le moteur de mon véhicule s’est lui-même "interrompu" (rupture de berceau...).
Ce qui montre bien que ce n’est ni un décor, ni une documentation ethnologique que je prends pour le texte, dans ces voyages, mais plutôt une motricité. J’écris comme je voyage (comme je conduis, même), dans la mesure où il s’agit là des deux lieux (syntaxe et biologie) où se vide la névrose. Mais aucun événement vécu n’est reproduit dans le texte puisqu’il ne peut en être que le support, le pré-texte. En outre, la phrase tamacheck en caractères tiffinagh qui ouvre Eden, Eden, Eden, signifie : " et maintenant, nous ne sommes plus esclaves " : c’est dire que le texte se développe sous d’autres signes que ceux d’un exotisme saharien traditionnel.

- Et maintenant nous ne sommes plus esclaves
- la phrase tamacheck en caractères tiffinagh qui ouvre Eden, Eden, Eden.
Q. : Cet exergue ne pourrait-il pas aussi figurer au début de Tombeau pour cinq cent mille soldats [15] ; une même problématique marque en effet tous vos textes, celle du rapport maître à esclave, en particulier dans sa figuration sexuelle.
R. : Oui, mais cette figuration se radicalise dans Eden, Eden, Eden. Notez d’emblée qu’elle se développe toujours sur un corps social, multiracial, déterminé — féodaux (nomade, maître de foutrée, maquerelle), petite bourgeoisie (boucher), soldats (troupe et responsables), prolétariat (foreurs et leurs femmes, dattier, mécanos, graisseur, commis boucher), bergers et khammès, paysans regroupés et otages, prisonniers, putains mâles et femelles, chômeurs, serf (akli), enfants et bébés, animaux (chiens, singe, cérastes, insectes, ovins etc.). Il est donc impossible d’y déceler la moindre figure dite "érotique", l’"érotisme" n’étant qu’une déviation de l’acte sexuel, pratiquée par la grande bourgeoisie et " singée " par la petite bourgeoisie (le boucher ne produit qu’un seul acte sexuel : le double meurtre de sa deuxième femme et de son fils d’un premier lit), ni la moindre figure dite " contre-nature " (— et, pour ce, naguère, en bien des lieux, punie de mort —) : pas de travestis, pas d’invertis, pas de névrose en somme. Dans la mesure où chaque corps (excepté le boucher), n’est mû que par -sa motricité matérielle, physiologique. L’idéologie, seule, produit la névrose, la psychologie.
Il n’y a pas, ici, "désir’’, il y a envie : le mouvement est exclusivement économique ; il n’y a pas "amour", mais scripto-séminalo-gramme , si j’ose dire, au sens de électro-cardiogramme.
En même temps, les relations entre les figurants s’échangent dans une économie élémentaire non parodique. Il est donc logique qu’une grande part de l’échange sexuel se produise sous le signe de la prostitution et de l’esclavage, deux formes extrêmes du commerce des corps. Ceci est prouvé par l’état de chacun des corps ; en effet, ils ne sont affectés que des marques de l’exploitation (malnutrition, absence d’hygiène, de soins, accidents du travail), et pourtant, par de multiples notations à ne pas oublier, la jeunesse de ces corps et leur beauté sont signifiées tout au long du texte. Ces marques sont, de plus, signalées avec force, le plus souvent comme excitants de l’envie sexuelle et de l’oppression de classe — Ce qui détruit à l’avance, d’une part toute accusation de monstruosité, d’autre part toute tentative de valorisation dans le sens d’un archangélisme voyou.
En outre, la fréquence de l’acte excrémentiel, tandis qu’il manifeste ce niveau économique et sexuel du texte, s’ajoute à la masse de ces processus d’excitation et d’oppression. Il y a là, non pas réhabilitation magnifiante des fonctions dites "basses", mais leur émancipation par ré-insertion dans le mouvement sexuel.
L’affleurement permanent de la pulsion économique dans le tissu du texte, renforce le "neuf" de ce tissu. La parole du maître à l’esclave et aux usagers du corps de celui-ci surtout, renforce la radicalité de l’acte sexuel.
S’il y a violence dans ce texte, elle est donc violence de classe , du premier au dernier mot — et cette violence de classe est souvent signifiée par les termes d’une violence d’espèce à espèce (voir vocabulaire et gestuelle bestialisants concernant putains et serfs : c’est la nécessité de l’éclatement de la psychologie, qui m’a d’ailleurs obligé à observer les "phénomènes" humains, sous l’angle bestial et sexuel) je ne pouvais du reste opérer contre la psychologie qu’en exaspérant cette figuration bestiale et sexuelle — il y a trop de psychologie dans une "personne", pour qu’on ne soit contraint d’observer presque exclusivement la bête). Ce qui approfondit la problématique matérialiste posée dans le texte, en détruisant même la scène "corporelle" de l’idéalisme. Le "corps" chrétien étant rejeté, l’ "acte" sexuel disparaît, ou peu s’en faut, sous la masse des processus que la seule présence de ses organes engendre ; d’où, il y aurait erreur "capitale" à considérer le texte — "par le trou de la serrure" — sous l’angle de la performance sexuelle (quantité et qualité des "positions" etc.). Eden (trois fois), travaillant simultanément, et sans en privilégier aucun, dans trois lieux élémentaires de la sexualité, du SEXE (homme, femme, bête), il y aurait erreur également à l’utiliser à des fins petites-bourgeoises de scandale ou de revendication limitée à la pratique d’une sexualité particulière — ce qui revient au même. Vous noterez par exemple que dans la grande séquence centrale, foreurs, épouses des foreurs, putains mâles, chienne et même arbre en fleur, figurent, d’un bord à l’autre de la claie qui enclôt le bordel mâle, les points limite de cette combinatoire sexuelle. "Il n’y a pas d’acte sexuel."
Q. : Dans Eden, Eden, Eden, le texte se ressent de cette radicalisation, de ce travail de sape. II semble qu’il propose un modèle d’écriture matérialiste possible, ou un modèle de phrase : la phrase peut-être. Quels sont les moyens mis en oeuvre pour la produire ?
R. : De même que, dans la figuration, tous les gestes — en cours de paralysie — de la bourgeoisie, et leurs accessoires progressivement improductifs, sont abolis au profit d’une gestuelle organique élémentaire, d’une nudité vraiment nue, et d’une mise en jeu d’accessoires de travail , de même le texte rejette hors de sa syntaxe et de son lexique, toutes les formes, désormais vidées, de la rhétorique idéaliste, au profit d’une phrase génétique, épurée, « archaïque ». En effet, notez que même, il y a, le plus souvent dans le sens homme libre —> homme soumis, relation du geste professionnel au geste sexuel : le dattier et le fruit qu’il cueille, le foreur et l’outil dont il maîtrise l’ébranlement, le mécano et le moteur dont il contrôle la marche, le commis boucher et la bête qu’il abat, le nomade et son piquet de tente, la sentinelle et son fusil chargé, le graisseur et les orifices qu’il graisse etc... Cette relation fournit même la matière de maintes paroles, dans le texte (« paysan, jette tes outils dans le fleuve... tu as ton sexe... ouvrier, tu as ton sexe... »), la matière de maintes gestuelles spécifiques.
Ceci s’inscrit dans une motricité générale à laquelle participe une opération non négligeable : l’utilisation immédiate dans la rédaction du texte, des phénomènes biologiques simultanés du corps écrivant à moins que ce ne soient les nécessités du texte qui les provoquent (exemple : pour dactylographier, station assise dans fauteuil pliant, toile moulant les fesses —> figuration fessière très fréquente dans le texte ; exploitation immédiate, dans le texte, des divers maux de tête, d’estomac, de reins, des mouvements du sang et de l’air du corps écrivant).
Il est à peu près certain que de nouvelles formes d’économie impulseront mes textes à venir. Je pense à un texte qui ne serait constitué que des répercussions d’un travail donné (exemple : abattage de la canne à sucre selon ce que j’ai pu voir à Cuba en 1967), dans l’appareil sexuel — texte que j’imagine dès aujourd’hui débarrassé de tout l’appareil relatif et possessif de notre langue .
Le travail, considéré de cet angle, ne figure-t-il pas le lieu de la nudité économique, comme Eden, Eden, Eden est produit, pour sa plus grande part, à partir du lieu économique et sexuel de la nudité prostitutionnelle et désertique (Plus sensible dans la séquence finale où agissent des figurants dont la nudité historique et sociale est flagrante (singe : anté-humain, bébé : anté-conscient, akli : anté-social) : on pourrait ici produire une analyse anthropologique de ce triple Eden.
Vous voyez que nous sommes, s’il était besoin de le prouver encore, bien loin ici et d’un texte innocent, et d’un texte nocif ; c’est dire qu’il s’agit d’un texte « inscrit » : le texte met en place une série de termes, soit néologiques (« ensué » etc.), soit techniques (« atlas » « axis » « dokkala » « almouz » « râles crépitants » etc) soit des formulations moins anthro-pocentrique- (« ténèbre foulée » au lieu de « nuit— descendue » etc.), soit des archaïsmes (« icelui », « arde » etc.), qui nécessiteront, de la part du lecteur, peut-être, un effort de recherche simultané (dans les dictionnaires par exemple) qui ne peut qu’approfondir, préciser sa lecture et inscrire le texte dans sa mémoire, le lui faire signer , en somme, avec l’auteur.
Cette notion d’inscription recoupe, du reste, celle de motricité du texte : il n’est pas un geste ou un fait qui n’y soit motivé, une matière ingérée qui n’y soit digérée, déféquée, un mot qui n’y soit amené et traité jusqu’à épuisement. La motricité est ici polyvalente, généralisée : les formulations syntaxiques et lexicales qui fixent un état, un "être" ou un "avoir", qui assignent une limite à des énumérations, qui tendraient à abstraire ou à valoriser un fait, à le métaphoriser, qui seraient seulement utilisées dans le but de communiquer Un Sens, sont évacuées . Les auxiliaires du discours sont abolis au profit de verbes actifs, participes présents et passés de ces verbes actifs remplacent les adjectifs ("englué" au lieu de "gluant"), adjectifs, et préfixes redoublant de ces verbes actifs remplacent l’adverbe ("vif" au lieu de "vivement", "se réassoupir" pour "s’assoupir à nouveau", etc.), suppression de la conjonction "et", de l’alinéa et du point, tout au long du texte, au profit de la virgule (signe final du texte), du point-virgule et de la barre, abolition intégrale de tous les termes psychologiques, humanistes, métaphysiques — le terme "souillé" imprimé en italique, recouvre une signification concrète en dépit de son usage largement valorisant, et doit être pris ici, à partir du sens étymologique de "succulus", latin de "porc" ; ce terme étant utilisé ici pour désigner, à cette page 74 du texte, la souillure particulière — graisse de porc —, sur le vêtement d’un jeune mécanicien "venu du Nord", donc ayant pu goûter par défi à cette viande interdite), au profit de formulations plus scientifiques : (" stratosphère " au lieu de "ciel" — au lieu de "crépuscule", ceci : "le feu, sur l’horizon qui se relève, attouche, incandescence diaprée, la stratosphère, l’enflamme" — au lieu de "nuit descendue", "ténèbre foulée" ; la ténèbre, zone gazeuse que les rayons du soleil n’atteignent plus ou pas encore, foulée par la rotation de la terre, ou bien particules d’obscurité foulées par les jambes des soldats (phonétiquement le t, le n, le br de "ténèbre", accrochant le f, l, de "foulée"). Ce niveau phonétique est plus particulièrement sensible dans la grande séquence désertique où les é, les i des participes passés par exemple, s’intercalent dans le mouvement des bijoux.
Ce texte repose sur un travail incessant, et double, de ma langue maternelle : au niveau du réseau des sens d’un mot, et au niveau du réseau de la phonétique de ce même mot. Cette recherche scientifique, génétique, au niveau du langage, n’en "déplaise" à ceux dont la sottise n’est descriptible qu’à l’aide d’une terminologie que je me refuse à utiliser, s’est faite, se fait, se fera inéluctablement sans que la "poésie" ait jamais à abdiquer de sa spécificité ( spécificité retrouvée par ceux-là mêmes qui sont accusés de la détruire ). La phrase de mon texte n’est pas la seule possible-, d’autres textes, majeurs (« Nombres » de Sollers, « Archées » d’Henric, entre autres) fondent cette écriture matérialiste dans l’éclat d’une poésie que personne ne songerait sérieusement à contester.
Q. : Une question doit être posée ici, dans la mesure où vous êtes engagé politiquement aux côtés de la classe ouvrière, c’est celle de l’accessibilité de votre langage. Que pouvez-vous dire à ce sujet, ici et maintenant ?
R. : D’abord, ce texte est-il tellement accessible à la bourgeoisie ? Les premières attaques, les premiers malentendus sur Eden, Eden, Eden viennent de la bourgeoisie. La bourgeoisie perd en ce moment le monopole de l’avant-garde.
Ensuite, vous savez bien que la grande majorité des lecteurs en France est à chercher dans la petite bourgeoisie : c’est vers la petite bourgeoisie que le réseau d’édition, de distribution, de critique propage nos textes — vers la petite bourgeoisie individualiste, remuante, tourmentée, avide de compenser son inefficacité politique par une série de lectures contradictoires.
Ici, donc, il serait également indécent, soit de prétendre que " les ouvriers " sont, sur-le-champ, plus aptes à comprendre de pareils textes, ce qui est faux et empoisonne tout le processus " culturel " contemporain, soit d’exiger d’un chercheur que, d’une part, pour de prétendues raisons d’efficacité sociale et politique immédiates, il abdique son rôle de chercheur, d’autre part et partant qu’il rejette les acquis les plus récents du langage littéraire. Non, c’est justement en poursuivant sa recherche que l’homme d’écriture peut donner à la classe ouvrière (écartée du pouvoir, donc, de la culture) une meilleure idée de ce que fut autrefois l’écriture — fournir une analyse plus scientifique du processus littéraire ancien, récent ; donc la préparer rationnellement [16] à la compréhension du nouveau, sur une base analytique matérialiste, par réinsertion de ce processus spécifique dans une histoire que désormais, elle est seule à pouvoir vivre enfin à fond.
Pierre Guyotat, Tel Quel n° 43, automne 1970.
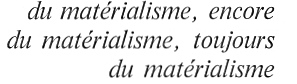

Extraits
[...] Quelle relation établis-tu entre la pratique révolutionnaire et l’écriture d’« Eden » ? Plus précisément : comment penses- tu le rapport d’un tel livre à la lutte des classes ? Est-ce au niveau de son contenu ? Ou au niveau de son insertion dans la lutte idéologique ou « culturelle » ?
P.G. — Je voudrais d’abord dire qu’il faut tenir compte d’une chose : « Eden » est un livre d’avant-garde, qui met en jeu, aussi radicalement qu’il est possible aujourd’hui, certaines méthodes, certains processus. Or, dialectiquement, c’est peut-être cette radicalité qui le rend accessible. L’effet « d’avant-garde » est d’autant plus fort qu’il s’agit ici d’un matériau linguistique concret, non refoulé, qui ne revient pas sur ce qui a été écrit. Il y a là un phénomène d’évidence, d’éclat, qui fait que le texte frappe . Je veux dire que l’impact du livre n’est pas simplement lié à sa « thématique » sexuelle. Pour la plupart des gens qui peuvent quotidiennement toucher, utiliser « les objets du délit », ce n’est pas à ce niveau-là que le texte est subversif (il y a aussi des « blasés », comme M. Nadeau, qui « en » veulent : leur réflexe critique n’opère jamais au-delà de ce qui, dans un texte, est encore considéré comme la part du témoignage). Mais je me suis aperçu, avec les lettres de lecteurs, que c’est surtout ce qui est appelé « le style » qui frappe, que c’est là où son caractère d’avant-garde est visuellement accessible.
Ce qui est marxiste, dans « Eden », à mon sens, c’est, autant que possible, ma pratique de la langue, c’est le texte dans sa matérialité. L’idée même de « contenu » est pour moi désuète, et par là la question du « contenu politique » est réduite à néant. Je crois que l’apport de ce livre au marxisme est dans la manifestation d’un drame textuel, d’une dialectique (un tel travail n’a pas été assez souligné dans les articles, trop rares, qui ont rendu compte du livre d’Henric, « Archées »). Si on refuse le texte comme texte, on fantasme immédiatement sur le « contenu ».
Il y a drame de l’écriture, lutte entre les mots, ce qui n’est pas du tout, bien entendu, un drame de l’ « art pour l’art ». Cette dernière terminologie renvoie à une « esthétique » idéaliste signifiant, chez ceux qui l’utilisent encore dans la polémique, une méconnaissance fondamentale de la matérialité du texte ; comment exiger d’un texte fait de mots qu’il « signifie » — et travaille — en dehors de ceux-ci ? « Eden » est, autant que possible, matérialiste, en ce sens que n’y figurent plus les mots ou les formulations qui ont servi à la religion, à l’idéalisme, au sommeil de classe. Il n’est pas indifférent de constater qu’« Eden », texte qui démystifie le sexe au sein même de l’écriture, a été rédigé l’année même où les deux lieux métaphoriques de l’idéalisme le plus éculé, le coeur et la lune, ont été définitivement dépossédés de leur inviolabilité. Il ne s’agit pas, dans « Eden », d’une « peinture » de quelque chose, mais le fait, par exemple, que des mots idéalistes y soient supprimés au profit de mots matérialistes, témoigne de la lutte qui s’y joue. Samuel Lachize [17] a pu parler, récemment, d’« exercice de style » : voilà bien une sotte appréciation ; malgré son souci d’attaquer la censure, elle ne fait qu’accentuer la non-compréhension du livre. « Eden » n’est pas un « exercice de style », il n’y a ni « exercice », ni « style ».
Ne pourrait-on pas dire qu’à travers « Eden », c’est un certain rapport à la LANGUE et à la « normalité » culturelle que notre société réprime ? La question essentielle que pose « Eden » semble être celle de la « lisibilité » ; « Eden » semble bien interdire toute lecture « innocente », orientée vers une « représentation » pure et simple. On peut dire que ce texte JOUE la représentation pour la périmer, qu’il interdit toute lecture qui se bornerait à une simple fonction de compensation sexuelle. L’important est que cette lecture « déjouée » se fasse sous le signe d’une excès sexuel, aux limites de l’insoutenable, qui ne peut qu’INTERROGER sans fin le lecteur dans son inconscient, sa sexualité, son idéologie, ses limites. Comment faut-il lire « Eden » ?
P.G. — Je retiens le mot « interroger ». « Eden » interroge le lecteur, en effet (tout texte d’avant-garde se définit par rapport à cette interrogation, et à ses différentes modalités : c’est pourquoi deux textes différents dans leur spécificité, « Eden » et « Nombres », peuvent s’articuler dialectiquement). « Eden » est un livre qui, sans arrêt, et dès le départ , détruit toutes les « illusions », secrète au fur et à mesure ses lois, ses règles. Pour l’éditeur, et par rapport à « Tombeau », « le lyrisme est abandonné ». En fait, c’est tout ce qui fait la rhétorique, le choix d’un « beau » terme, d’une « belle » formule, c’est tout cela qui est brisé, et on le sent , on le voit (mais M. Nadeau, trop occupé à placer son stéréotype « franc-maçonnerie », fait semblant de ne pas le voir, et désigne petitement Eden (Quinzaine Littéraire du 1er au 15-1-71) comme « un bel exercice de rhétorique ». « Ça » parle.).
Je ne me suis jamais posé, en l’écrivant, la question de l’excès . Il faut noter que ce livre a été écrit pendant six mois, jour après jour ; « Eden », c’est surtout le fonctionnement écrit d’une corporalité pendant six mois. Il faudrait pouvoir le lire pendant le même temps que son écriture ; à cette condition, la question de l’excès se pose tout à fait différemment que s’il est lu en six heures, par exemple.
En fait, la lecture d’« Eden » est métonymique : elle ne laisse aucune place pour le rêve. Barthes dit très bien qu’il faut « entrer » dans ce langage, l’écrire en même temps qu’on le lit ; il disait aussi récemment, que le livre est « irrésumable ». Les yeux rivés aux mots, le lecteur est obligé de subir une série d’orgasmes, très vite. Le texte ne ménage pas de pause dans l’envie sexuelle.
Mais n’y a-t-il pas « aussi », ou « en plus », dans Eden, des phénomènes de représentation, liés dialectiquement au processus sexuel du livre ? Pensons à la façon dont on est « frappé », par exemple, par les paysages algériens, désertiques, « décrits » avec une force très neuve...
P.G. — En fait, dans ce livre, chaque processus, chaque mouvement, est toujours lié à un mot. Cette liaison est peut-être ici plus forte, plus critique, plus simultanée...
On peut penser à la façon dont les paysages sont directement liés à la figuration sexuelle...
P.G. — Il y a bien entendu un problème de figuration. C’est lié au problème que pose la rhétorique : depuis que j’écris, j’ai toujours refusé le « laisser aller », le vague, j’ai toujours voulu remplir tous les « blancs ». Ecrivant une figuration, il était logique que j’y insère, de façon rythmique , toute une figuration végétale, ou minérale. Le texte est une dialectique permanente, à tous les niveaux. On ne peut pas séparer végétal, minéral et humain dans le livre.
J’ai toujours voulu assumer tout le texte que je signe. Entendons-nous bien sur cette formulation : on ne trouve dans ce texte aucun plagiat, aucune transcription même paraphrasée de telle définition scientifique (voir dans mon entretien du n° 43 de Tel Quel l’explication de mon travail à partir des formulations scientifiques). Mais aucun texte n’est vierge : il faut s’interroger — et cela se fait en ce moment — sur la quantité de processus différenciés (écho de syntaxes anciennes, visions traumatiques, etc.) que l’inconscient charrie dans le texte. Tout discours est matériel, la distinction entre abstrait et concret se dissout dans le processus irréversible de la matérialité du texte. Il ne faudrait surtout pas voir ce qui accompagne les processus sexuels humains comme un « décor » (la trombe, la grenade, ne sont pas des « symboles », mais sont insérées dans des processus d’économies atmosphérique et marchande ; les grands phénomènes climatiques sont annoncés plusieurs pages à l’avance, etc.), mais comme un élément rythmique, la manifestation d’une volonté de tout intégrer, et aussi comme un refus de tout anthropocentrisme générateur d’idéalisme. « L’homme » y est inséré dans le reste matériel, avec sa spécificité, son avance historique, certes, mais il est inséré. Dans le prochain texte, il faudra même que l’homme, le corps de l’homme, n’y soit détectable que le plus tard possible. Déjà, dans Eden, processus internes (ceux qui manifestent le plus souvent la « profondeur psychologique ») et processus externes s’inscrivent au niveau d’une formulation égale, sereine, dans un mouvement qui exclut toute possibilité de privilégier.
Peux-tu nous parler du processus d’écriture d’« Eden » comme pratique, comme travail ?
P.G. — Il y a d’abord une liasse de notes , écrites avant et en même temps que le texte, qui sont à la fois des notes « techniques » sur la partie du texte qui vient d’être écrit (syntaxe, lexique, archaïsmes, néologismes, projets de suppression définitive de conjonctions, de prépositions, d’adverbes, essais de formulation non-anthropocentrique, « figuration » pressentie pour la suite du texte en rapport avec une intention politique précise, mais abandonnée sitôt écrite au profit du mouvement irrépressible de l’inconscient , exclamations exaltant le travail accompli, l’essai mené à son terme, la tentative réussie, le mouvement particulièrement paroxystique d’une séquence où tous les niveaux jouent plus intensément qu’ailleurs, répercussions « organiques » de ces succès, réactions prévisibles de ceux qui liront ce qui vient d’être écrit, inquiétude ou certitude quant à la réception, moyens de défense mis au point pour faire face aux réactions négatives, etc.) et aussi une sorte de recueil de « preuves », d’approches, d’hypothèses : série de notations de corps, d’attitudes physiques (corps mâles et femelles vus partout, le matériel qui les revêt, qui les harnache, déformations de ces corps et de ces vêtements dans le mouvement, élongations des membres, bourrelets, plissages, salissures, déteinte des tissus, coloration des joues, influence de l’atmosphère et de la température sur l’épiderme et sur le vêtement, déhanchements, bustes penchés sur motos, éclat des chevelures, de la bave, des larmes, de la sueur, tension ou lâché des vêtements sur le membre, nombre et épaisseur des couches de vêtements, vêtements plissés dans un travail, éclaboussés par les matières de ce travail ; échancrures, boutonnières, coutures ; timbre, tessiture, volume des voix, mouvements organiques — bouche, yeux, joues, gorges — que ces voix provoquent). Ces « notations » peuvent s’intégrer ensuite dans le texte, par exemple dans une motricité prostitutionnelle.
« Eden » est le produit d’une envie sexuelle permanente, rendue encore plus aiguë au fur et à mesure de l’accumulation textuelle (voyez le système moteur/batterie) selon un processus cyclique, indestructible. Le texte est une confrontation à la langue de ma faim organique dont il épouse la plupart du temps la ligne (c’est, comme je le dis dans le n° 43 de Tel Quel [18], un « scripto-séminalo-gramme » ).
« Eden » représente sans doute une expérience, historiquement sans précédent, d’effacement de la sublimation. Rien d’autre à lire ici que la langue et le sexe, qu’un certain travail sur la langue et le sexe. Par exemple, le paragrammatisme du texte ne renvoie pas à un « dehors » du texte, à un « autre » texte, mais à sa force sexuelle propre, intacte, multipliée. L’inconscient du lecteur est donc sans cesse ramené à ce qu’il lit, dans une pratique redoublée de la langue et du sexe : travail de la langue sur le sexe, travail du sexe sur la langue. Peux-tu nous parler de cette articulation, à partir de ton travail d’écriture ?
P.G. — Si le livre est effectivement contrôlé de bout en bout, cela ne veut évidemment pas dire que tout y est conscient. Le niveau anagrammatique n’a pas été traité de façon contrôlée, mais ceci dit, il y a dans les notes un appareil technique très net ; la part phonétique du texte est, elle, très consciente. Dans « Eden », j’ai osé des rapports phonétiques inconnus, inouïs. Cela, au niveau de la dissonance sur le plan musical. Par exemple, tout le travail sur les allitérations, qui sont très nombreuses dans le texte, surtout dans la séquence finale, et qui participe aussi d’une volonté que le texte soit « plein » de bout en bout.
Quant au travail sur le sexe, il faut noter qu’à cette « envie » sexuelle dont je parlais, correspond un autre double du texte (en plus de ce « double » qu’est le texte de notations) : il s’agit d’un texte argotique, prostitutionnel, dont les éléments refoulés ont ensuite été expurgés. Ce texte « sauvage » est écrit en parallèle à l’acte sexuel, on peut même dire que l’acte sexuel est une perte de texte . L’écriture de ce texte sauvage est liées à la masturbation, ses séquences étaient interrompues par l’orgasme. Là, l’envie d’écrire est directement liée à l’envie sexuelle, l’envie d’éjaculer EST l’envie d’écrire ( le titre de ce texte sauvage est « L’autre main branle »).
Il s’agit d’un texte aigu, argotique, de moins en moins rhétorique. Sur le plan graphique, il correspond à une écriture tremblée ; ce texte sauvage a permis d’expulser tout un matériau argotique, (la « parole », en somme, qui, dans Eden, s’éteint) avec une scénographie plus prostitutionnelle que sexuelle (scènes d’interpellation, d’appels, de marchandages). Chronologiquement, la dernière forme de ce texte tendait vers une exculsive du dialogue, dans le même temps que la « parole » s’amenuisait, jusqu’au silence, dans le texte « savant », dans « Eden ». Cette exclusive dans le texte sauvage se radicalise au moment même où la grande séquence « muette » du dernier tiers d’« Eden » (nomade, femme, singe, akli, bébé, désert) s’écrit.
L’activité sexuelle elle-même était très peu notée. Sans doute, ce niveau « sauvage » de préparation pour un prochain texte sera-t-il plus contrôlé, plus scientifique, moins fébrile. J’imagine même que ce texte argotique, défoulant, ne sera plus écrit. Il est déjà abandonné ; ce qui reste, c’est le texte de notes. Il faut dire aussi qu’actuellement, l’interdiction d’« Eden », la polémique incessante autour de ce texte et de cette interdiction m’imposent une nouvelle forme de texte, texte d’interventions, d’interviews, d’explications, de polémiques en cours.
Eden, Eden, Eden, et après ?
P.G. — Depuis plusieurs mois, l’image d’un nouveau-né sorti sans calotte crânienne du ventre de sa mère, et dont la masse cervicale est ainsi en contact direct avec l’extérieur, baigne toute ma réflexion sur ce prochain texte.
Pour en revenir à « Eden », il y a donc trois niveaux : confrontation du texte sauvage à l’appareil des notations, puis au travail sur la langue. Une simple notation, par exemple, peut provoquer une séquence entière, comprenant ces trois niveaux. Le texte s’est écrit comme une lutte contre l’échéance de l’orgasme et contre l’obstacle de la langue, de la rhétorique. Les trois textes (les notations, le texte « sauvage » et le texte « savant- », « Eden ») sont parallèles, imbriqués (parfois la séquence savante ne fait qu’épurer le matériau argotique du texte sauvage, etc.).
La lecture d’« Eden » produit des effets organiques précis, déterminés par ce que l’on pourrait appeler une écriture « pulsionnelle » : scansion, effets dialectiques de souffle, rythmes matériels, accumulations, répétitions, écarts. Peux-tu nous parler de ton travail à ce niveau ?
P.G. — A partir des deux autres textes (texte de notes expulsant l’anxiété sexuelle d’une journée, avec une part très théorique, consciente ; texte sauvage qui expulse la matière elle-même, le refoulé), le troisième texte, « Eden », correspond à tout un travail sur la langue : parti-pris sur le plan phonétique, etc. Il faut noter que ce travail peut aussi être lié à des expériences extérieures : la motivation du rejet de certaines formulations, l’exploitation fréquente de la même couleur (tout est en rouge, ou en rose) peuvent avoir des raisons organiques, internes et externes en même temps. Le texte est très lié aussi à la voix, à ma voix, aux voix qui m’entourent, à la voix des gens proches, à leur timbre, etc. Il est aussi très lié à la musique : j’ai pratiquement toujours écouté de la musique en écrivant « Eden », sauf à des moments paroxystiques (fin de la séquence du bordel, de la séquence finale) où cela m’était impossible, où les répercussions phonétiques de ce qui venait d’être écrit suppléaient à l’excitant musical. Certaines séquences ont été écrites en lutte, en compétition, avec des séquences chantées de Monteverdi (phrases écrites en même temps, à la même vitesse) ; des séquences entières sont calquées sur ces rythmes ; plusieurs substantifs accolés peuvent « s’étaler » à la fin d’une phrase, en douceur, avec des phénomènes de ralenti, de chuintements, l’emploi de termes précieux, rares ; il y a aussi des phénomènes d’attraction, d’aimantations phonétiques, d’accumulations, avec allitérations, souvent dissonantes, des phénomènes de baisse ou d’augmentation de volume, de compressions vocaliques ; tout cela, absolument nécessaire, correspond au mouvement musical.
Mais cela correspond surtout aux nécessités du refus de la rhétorique . Les ruptures de souffle, les brutalités pulmonaires, proviennent avant tout d’une nécessité d’écriture : il faut que l’écriture adhère de plus en plus aux processus réels, à leur mouvement scientifique , non analogique. Au niveau syntaxique : qu’un participe passé précède un verbe, par exemple, provient non d’un effet de « style », mais d’une volonté scientifique d’atteindre ainsi la « profondeur » (vitesse, espace) matérielle du processus.
On peut se demander si cette volonté n’est pas génératrice de bouleversements beaucoup plus radicaux et beaucoup plus critiques que ceux que je peux d’ores et déjà imaginer. Elle peut nous porter loin en arrière, aux origines de notre langue (c’est le mouvement et l’espace de mon travail actuellement). Le mouvement de dévoilement de la langue correspond au mouvement de dévoilement des processus sexuels.
Dans « Eden », avec ses torsions, ses poussées très matérielles, sont inachèvement aussi, c’est, hors de toute sublimation, une lecture non-spéculaire — ou plutôt post-spéculaire — qui doit être risquée. En ce sens, « Eden » est un texte dangereux pour tout sujet qui l’aborde, un peu comme un miroir qui ne renverrait pas de reflet. Peux-tu parler du travail sur l’inconscient qui permet ce fonctionnement ?
P.G. — Je crois qu’avec « Eden », je participe à cette inauguration d’une sorte de psychanalyse de la langue. Il me semble que révéler les articulations relatives, possessives, etc., c’est en quelque sorte faire ressurgir le refoulé de la langue. Il y a chez moi refus de l’anthropocentrisme, bousculement de la syntaxe au profit des processus réels, contre l’anthropocentrisme, c’est-à-dire justement contre la rhétorique, qui part toujours de 1’« homme » comme centre. La psychanalyse ne travaille-t-elle pas elle aussi dans ce refus de l’homme comme « centre » ? L’inconscient est ici travaillé aux trois niveaux du texte. Je dis cela pour ceux qui réduisent « Eden » à un texte névrotique : c’est un texte à plusieurs divans .
Je pense cependant qu’il y a plusieurs possibilités de lecture d’« Eden », qu’il n’y a pas de lecture idéale ; que personne n’est à l’abri de la « représentation » concernant ce texte. En fait, les questions de « communication » sont pour moi de faux problèmes ; tout dépend de chaque lecteur, de ses capacités organiques d’assimilation. Mon travail participe d’un ensemble de luttes auxquelles j’ai adhéré, et dont l’acuité correspond presque exactement à celle de ma pratique rédactionnelle. En cela, sa lisibilité est assurée chez ceux-là même, « intellectuels » ou non, qui ne dissocient aucun des niveaux de notre lutte. Le pouvoir ne s’y est pas trompé ; non plus que, objectivement, les liquidationnistes irréductibles des Lettres Françaises, qui, de l’index du Père, m’indiquent le chemin ; mais cela est une autre affaire, une autre histoire .
Janvier 1971
(1) Décidément, cet article de Bouret ne peut être effacé. Il juge, en tout cas, celui, si « prestigieux » soit-il de son vivant, sous l’autorité duquel opèrent de tels coupe-jarrets [19].
Février 1972, rue Jacob. De gauche à droite : Marcelin Pleynet, Ph. Sollers, Denis Roche, Pierre Guyotat
(archives Denis Roche). Crédit : Ph. Forest, Histoire de Tel Quel.
ZOOM : cliquer sur l’image
« En juillet [1971], sous le titre de « La matière et sa phrase », Philippe Sollers publie dans Critique un long article consacré au roman de Guyotat. Le texte frappe par son exigence et son assez confondante difficulté ; il déplace salutairement et tactiquement le débat du terrain de la "pornographie" à celui de l’analyse textuelle. » [20]
Philippe Forest, Histoire de Tel Quel, 1995, p. 374.
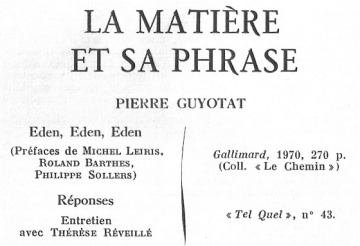
- Critique 270, juillet 1971
Archives A.G.
« Entendras-tu enfin la leçon de ta gluante
racine ou de ton marécage de sang. »
GEORGES BATAILLE.
1. — Un texte placé sous interdiction sexuelle cite la loi à comparaître au déchiffrement de son ressort inconscient : LA LOI EST PORNOGRAPHIQUE [21]. De même que l’investissement fantasmatique dont elle est la cause, elle a pour fonction de masquer la contradiction productive entre pratique d’écriture et champ d’analyse, la nécessité, pour un texte écrit, d’être pensé comme coextensif à sa doublure traduite en discours. La pratique d’écriture, saisissable à travers l’écrit qui, rendant cause de la parole, découpe la langue, impose une stratification dialectique de tous les niveaux du langage, logique plurielle dont l’un des aspects, seulement, peut être dit syntaxique ou grammatical. C’est ainsi que l’inconscient se joue dans le texte et du texte, ce qui explique qu’une simple formalisation ne suffira jamais à en rendre compte, pas plus qu’un glissement mimique et hystérisé produit dans la nuit d’une sexualité déniée remise dans sa machine à mythes, le mythe étant la formation de compromis faisant passer la loi d’une pratique spécifiable à une autre, c’est-à-dire renvoyant indéfiniment les pratiques à leur lieu illusoire de conciliation. « Il n’y a pas de métalangage » : la réécriture divisée qui permet cette vérité doit marquer l’irréductibilité de la série de négations qui étaye et déploie le langage. La pratique discontinue et hétérogène du texte moderne en ouvre l’accès.
C’est pourquoi, dans la tentative qui va suivre, les concepts analytiques (freudiens, lacaniens) seront introduits comme éléments d’une mise en scène visant à creuser leur lieu d’émergence indissolublement sexuelle et signifiante redoublé d’une pratique qui les déplace « d’elle-même » (c’est-à-dire sans avoir nécessairement à le savoir). Si « le langage est la condition de l’inconscient », le texte répond à et de cette condition. « Les constellations formées par les aberrations sexuelles prennent par rapport à l’infini homogène une valeur telle qu’au point de vue de la pensée humaine rien d’autre ne leur apparaît comparable » (Bataille). « Ce que nous pensons des choses sur les points principaux est comme le totem d’une indiscutable grammaire qui scande ses termes mot par mot » (Artaud).
2. — Pour autant qu’Eden, Eden Eden se donne à lire sous la forme hyper-cohérente d’une musique en langue en tableau, nous pourrons y discerner comment le désert, l’âge d’or, la phase orale — suceuse et cannibalique — liée à une incessante activité sexuelle — l’inconscient en émulsion — peuvent être lus comme des déplacements-transformations de la première floraison infantile auto-érotique soumise à la séduction précoce et imaginaire des géniteurs, eux-mêmes conçus comme pratiquant à jamais, de façon répétitive — sur l’axe traumatique de la scène primitive —, un coït oral-anal permanent. Du quantum d’affect investissable par un sujet, le « tableau » — surdéterminant le fantasme — ne sait rien ou plutôt n’a rien à savoir. Le sujet, mobilisé en affect, forme ici un envers externe : forclos à l’intérieur du tableau et de sa grammaire, il reste en-deçà de toute représentation : la répétition de la verbalisation sexuelle a lieu pour forclore le sujet et la jouissance. Si la jouissance comme telle entrait dans le tableau, celui-ci ne fonctionnerait plus comme tableau, c’est-à-dire comme cogitation inconsciente et rempart organique de la représentation contre la menace de castration inscrite en chacun de ses noeuds, de ses poches, et c’est pourquoi il en est de la phrase reprise et continuée par la vague pulsionnelle comme de la nappe verbale qui contre-investit un quantum d’affect (décharge) qui ne peut se trouver, comme sujet, que hors du tableau. Le tableau est d’autant plus plein que son sujet (comme jouissance) est plus évacué de sa syntaxe apparente : la phrase. L’autre du tableau — la jouissance — fait retour sous forme de racine de la symbolisation, « vagin indécouvrable » à l’intérieur du système représentatif, trou interne retourné, comblé. L’autre du tableau — la mère interdite — est la répétition vide que vient remplir sans arrêt la répétition des représentants de pulsions. Un seul corps, en état de transformation continue, est ainsi l’enjeu découpé du texte.
3. — Dès les premières lignes, l’équation bébé-sein-pénis-excrément, annoncée à travers « lambeaux », joue son rôle d’axe aimanté du glissement signifiant. Les haillons, les ordures, les déchets, les caillots, les éclats seront produits comme autant de relais permettant de faire porter à égalité l’objet hallucinatoire sur la proximité de la bouche et du sexe. Regard, toucher, voix vont ainsi surgir dans l’entrelacement répété des strates physiographiques. Entre « l’oeil violacé scrutant le montage des tentes » (rappel déformé de scène primitive) et le « gland violacé attouchant la mousse rosée par le raisin », s’inscrit le plus court chemin vers la saisie auto-érotique, celle qui s’enlace à elle-même dans le sillage traumatique du viol (réel ou fantasmé), dans l’intimité tactile et colorée, nouée et retournée sur sa propre nappe, des muqueuses « à fond violet ». En même temps, il faut comprendre que le flot verbal, initialement consonantique, roulant les « clicks » de la langue est creusé par les voyelles comme si la contraction anale consonnait avec la béance orale dans la « bouche bleuie par l’enserrement du torse ». Depuis l’anus, bouche primitive reportée par la suite à l’extrémité de l’intestin et lieu de conversion des pulsions — le stade anal étant marqué par la dentition et le développement des muscles, la relative maîtrise du sphincter —, jusqu’à la bouche édentée du nourrisson, en passant par la muqueuse stomacale qui a la propriété de se digérer elle-même, passe à l’envers la reproduction et la torsion des signifiants de pulsions. Ainsi sont retrouvés, dans le ventre comme dans la gorge, les « gargouillis préludant au viol ». Le vagin, lui, « loué à l’anus », cloisonné par rapport à l’intestin, sera pointé comme « intérêt » par le sol érotico- anal, et c’est pourquoi toute défécation peut être comprise, selon Freud, comme une « figuration de la naissance ». D’abord conçu comme oral (« lèvres flétries du sexe » / « la fillette aspire la viande retenue dans les joues du bouclé brun ») — c’est-à-dire comme trou muni de sa viande à langue — ; puis comme anal — habité par la gaine fécale —, le vagin deviendra asymptotique à son décalage négatif et vide, tout se passant comme s’il restait indescriptible au même titre dynamique que la castration. Tout au long de ce trajet exploratoire, le pénis va proliférer comme une seule phrase, le sexe devenant la matrice de phrase de la matière appendue à gage, l’autre appareil par rapport à la langue et non-vu comme organe symbolique à cause de la surimpression localisée de la fonction de jouissance et de celle de reproduction.
Un seul corps, morcelé, mobilisé par la castration, se transforme donc entre les deux scènes du langage qui se dialectisent intégralement du double sexe à la langue en passant par le rejet et la conversion de l’anus : sa cohérence provisoire est celle de son érection répétée en phallus.
Le corps-phallus, unité de ce morcellement atomique, est constitué par un mouvement incessant de transfert du bas vers le haut (« ils marchent, cuisses écartées, talons allégés, salive séchant au menton »), et du haut vers le bas : le sexe de la femme est aussi bien une bouche qu’une main broyeuse. Un des mots les plus répétés dans le texte, indiquant cette double fermeture ramassée est : poing. La phrase sans points est aussi un seul poing, et quant au sexe féminin qui s’y loge dans son négatif, il se construit comme une main orale, une bouche manuelle qui représente la forme retournée de la bouche au sein : « l’écume brille à travers leurs lèvres gonflées, elles découvrent leurs seins, les poings des bergers creusent le grillage, entre leurs cuisses les haillons s’écartent sous la poussée du sexe ». Les poings (posture du nourrisson), les doigts, les lèvres : autant de bordures de ce « sexe » initial, enveloppe de la verge toujours rechargée de sperme (mieux que le sein, de lait) [22]. L’une des premières séquences marque ainsi l’agression, dans le dégagement du pénis pris et retourné en poignard, du bébé coincé dans la naissance et le gland coiffé du prépuce : « trace avec la pointe de la lame recourbée (comme le sexe était « arqué » ; comme les soldats étaient « arc-boutés » sur la femme) à l’éventrée sur la paroi d’onyx, un demi-cercle autour du sexe de la femme, plonge la lame dans la chair muette (ici, marquage a contrario de la voix, de la gorge), déchire, écorche, taille tous les muscles, les nerfs qui règnent sur le sexe de la femme (cordes vocales), lacère l’entour flasque gainant (poignard) son sexe garotté : le membre, redurci, au contact des chairs remuées, jaillit, coiffé de chair sanguinolente ». On touche en ce point une sorte d’envers de la circoncision rituelle, série d’éventrements (de césariennes) qui tendent à extraire et à récupérer les nombreux pénis contre-vocaux paternels enfouis dans le corps de la mère. L’approche des abords de la question traumatique posée par le « sexe de la femme » — et, en même temps, par le puits de la langue — déclenche d’ailleurs l’animation interne des références par recours immédiat à l’animalité, au déchet ; chacals, sphexs, sbots, mouches dites excrémentielles, vomissures (rimant avec commissures), les « déjections raisinées », la merde sanglante revenant à l’anus et à ses lambeaux (hémorroïdes). Ici, l’« aspirant » n’est pas seulement un soldat (c’est-à-dire un pénis protégé ou casqué), mais réellement ce qui aspire et ramène au même, comme ce « vol d’alouettes » qui sort de la scène pour refaire entendre le voile, le viol de la chair violette. Le « boucher » qui exécute sa femme et son fils « d’un premier lit » n’est pas seulement un coupeur de viande mais aussi ce qui comble, le père qui bouche la mère, qui coupe la voie de l’inceste. C’est encore l’opérateur de la voix buccale, celui qui remplit la bouche matricielle en creux et dérobe le plein du sein. Autrement dit, le couteau de l’interdit qui va programmer, pendant la majeure partie du texte, les échanges homosexuels mâles, avant de laisser passer la longue scène finale au plus près de l’inceste, souligne la figure paternelle, d’abord criminelle (castrante), puis, de plus en plus primitive et joueuse, pré-humaine, singée.
Le texte est ce « feu de branches dressé sur la bouche d’une femme morte », quand le sexe des « soldats », armés et dressés pour la branlée, sa gâchette, sa décharge, « se tend vers leurs mères ». Mère avec laquelle l’identification orale permet de passer du sein femelle au téton mâle — piqué par des guêpes qui sont autant de miniaturisation du dard anal. De même que l’excrément est un représentant du pénis (« le gourdin excrémentiel »), la gorge se retrouve, réduite, sur le membre mâle ; « la petite gorge formée à la racine du membre pressé où prennent les membranes liées ». Le méat est aussi un oeil qu’une bouche, et si le sein est oculairement globuleux, la verge non-circoncise appelle le « cou d’oie », le coup de la voix qui se fait entendre dans le nom tranché de Wazzag. L’usine sexuelle entraîne la fonction des « mécanos », des « foreurs », des « graisseurs » ; tandis que son côté cuisine implique les « sauciers », les « dattiers », etc. Un bordel-garage-caserne dans le désert, tel est l’appareil en vase clos (à l’inverse du château sadien en pleine montagne) chargé de figurer la mécanique inconsciente dans son partage et sa répétition branchée en circuit fermé.
Derrière un grillage, ou plus souvent une claie (mot carrefour), sont d’abord parquées les femmes : pendant les deux tiers du texte, les deux communautés, mâles et femelles, seront ainsi séparées, ne communiquant qu’à travers des putains des deux sexes (la ou le putain). Cette indétermination sur les corps et leur mot d’échange marque la situation initiale de l’indétermination quant au vagin : sa doublure par le point de fuite du phallus maternel. C’est pourquoi le figurant fondamental de l’avant-scène, le bébé — sexualité « homogène » et non gouvernée, fond cannibalique —, est indiqué d’entrée pour revenir, à la fin, en posture insistante, centrale. « On bat un enfant » : cette matrice du scénario fantasmatique — qui n’est autre qu’une transcription de la masturbation du pénis en état d’immaturation ou, mieux, du clitoris — est à la base simultanée de la réitération et de l’insatisfaction définitive de l’alimentarité et de l’onanisme (de toute « sexualité »). Dès la première phrase (« Les soldats, casqués, jambes ouvertes, foulent, muscles retenus, les nouveau-nés, emmaillotés dans les châles écarlates, violets »), il est déchiffrable que les pénis érigés et coiffés du prépuce (« casqués »), refoulent, comme leur sol commun, ce clitoris-pénis-bébé logé entre les lèvres du vagin maternel, dans sa chatte voilée et écartelée. Telle est la raison pour laquelle le corps-nourrisson — l’immaturation béante en apprentissage de la fluidité des pulsions — encerclera le texte de sa mesure insondable : dans la machine pulsionnelle, il représente l’en-deçà et l’autre côté, le générateur sourd, caché, qui fonctionne comme « carburant » hallucinatoire. Les femmes, elles, sont tatouées des rappels de la castration : « leurs poignets, leurs bras, sont marqués de cicatrices, d’entailles violettes : morsures de couleuvres, coups de faucilles, coupures aux djérids ». Une micro-séquence de l’auto-confrontation du corps morcelé sera donc réglée par la série femme-enfant-bouche-phallus, soit, de façon condensée : « élevant le bébé, elle lui fait toucher du bout des lèvres l’extrémité violacée du sexe du soldat ». La seule ouverture qui puisse alors apparaître dégagée comme telle est bien, à revers, l’anus, et c’est pourquoi il doit être l’objet d’un si long travail dramatique (d’une aussi chaotique analyse).
4. — Le trauma est un lieu désert. Déserté par la jouissance et le sujet de l’énonciation, et, par définition, surexposé à l’altération économique. C’est une « afrique » couverte d’un océan négatif, autrement dit du sable qui est le fond de la mère [23].
Sable : corps poudroyant, volume indéfiniment divisé, multiplicité effondrée, d’un fond de civilisation disparu, d’un âge d’or, d’un éden effacés, océan de plaisir à sec, clos en grains, en coquilles ; temps des âges de la préhistoire du sujet — du nourrisson —, matière du clivage. Talon : réduction du crâne, grossissement du pénis, pont entre tête et sexe (« pied enflé », talon d’Achille). C’est aussi le « pays » où l’on peut le mieux voir surgir ce leitfossil (Freud) de la castration qu’est la circoncision, à travers les corps voilés, vite découverts : pierre au fond de la mer. La femme est voilée (visage, vagin, voix) comme le membre mâle est coupé de son voile (prépuce). Derrière son voile, la femme devient le phallus dégagé par la circoncision du bout de pénis : « le paysan adolescent sort de l’eau son sexe retréci, il remonte vers la haute ville, son visage moulé dans le voile ». D’autre part, le sexe à nu dans le « désert » a pour fonction de réordonner les différents éléments matériels selon des traînées de forces et d’accrochages condensés qui exposent la loi inconsciente de l’équivalence de toutes les substances du corps : sur fond de sable (négatif inorganique, pulsion de mort : la plus pulsionnelle des pulsions), les vagues sexuelles sont ici l’enchevêtrement réitéré des postures tournantes en l’absence radicale de la mer, de la mère à la jouissance interdite : ce qui est une façon de la marquer comme toute-présente dans sa lacune. La liaison de sexe — liant l’énergie traumatique non-liée — est simultanément organique et signifiante [24], « langage d’organe », soumis au renversement, au retournement - passage de l’activité à la passivité, inversion du contenu, changement d’objet. « On pourrait, écrit Freud, décomposer la vie de toute pulsion en vagues isolées, séparées dans le temps, homogènes à l’intérieur d’une unité donnée de temps et ayant entre elles à peu près le même rapport que des éruptions successives de lave. » Ainsi de la dévoration, de l’incorporation orales et de l’organisation prégé-nitale sadico-anale que Freud — en marquant ainsi sa zone d’arrivée musculaire — qualifie de « poussée à l’emprise ». Dans E.E.E., le refoulement travaille essentiellement sur l’affect tandis que la sublimation s’encadre et se creuse dans le tableau répétitif de la représentation scénique d’organe. Ainsi, par clivage, vient s’exposer, dans une surface venue de plus loin que son déploiement, le dessin phallique : « Sa main, doigts agités par le cauchemar, dessine au sang, sur le bois de la porte, un sexe d’homme. »
Le poing masturbatoire du texte conjoint la main fermée sur ses veines et le sexe tendu dans son érection.
5. — Le travail continu du, et sur, le lieu de « conversion » des pulsions (l’anus) doit mettre en scène une énergétique où le sperme est censé passer incessamment à travers les queues mâles, les pénis (ressorts du fantasme) étant conçus comme sans fin réarmés. L’orgie mâle — pénienne, orale, anale — torsadée — le « dos » mâle remplaçant à l’envers le « devant » femelle - est un repas totémique régressant vers une sauce, ou bouillon, primitifs : à la limite, il s’agit d’une tête enfoncée dans un seau où marinent des quartiers de viande : « Sa langue sort de sa bouche dans le même temps qu’un étron sort de son cul. » La langue est à la bouche ce que l’étron est au cul, le sein aux lèvres et le pénis à tout orifice, le vagin, à l’horizon voilé, étant, selon Freud, ce qui « recueille l’héritage du sein maternel ». Le circuit de résistance à la castration — le courant le plus profond où elle reste forclose — implique l’insistance de l’objet « baladeur » prenant la forme du crachat, des cartilages, des boyaux, etc. Dans la fosse cloacale, venant à la place du dehors vaginal qui, indécouvrable, irreprésentable, la creuse de l’extérieur vagin que les femmes cachent en plaquant sur lui des galets (des pierres) flottent ensemble les excréments rougis, « les lambeaux de viande rose », les « glands grenats ». Tout se passe comme si la machinerie orale était analysée depuis son « report » anal à travers sa « poche » sexuelle, et l’on peut remarquer ici la fréquence des possessifs culminant dans le s apostrophe (s’), au plus près du battement introjection / expulsion. La multiplication des verbes — scarifications du discours — entraîne celle des organes des substances : LA MATIÈRE SOUS VERBES PASSE PAR LA RÉPÉTITION QUE COMPORTE SA CONTRADICTION. Série : soulever, écarter, resserrer, contracter, couvrir, écraser, bourreller, étouffer, cracher, passer, frapper, élever, pisser, plaquer, détecter, jeter, -branler, empoigner, serrer, soupirer, refouler, ôter, envelopper, ahaner, baigner, chauffer, goudronner, regrossir, arquer, ouvrir, enfouir, détendre, accoter, refroidir, faufiler, expulser, éclabousser, retirer, s’écrouler, caler, crêper, ensuer, brûler, éclater, s’égoutter, glisser. Série « à l’emprise » qui prend en écharpe et « broie » l’anatomie comme placée sur une orbite périodisée : fesse, visage, yeux, veines, lèvres, mains, talons, aine, cuisse, ventre, vessie, verge, crâne, bouche, jambes, peau, membre, cul, gorge, croupe, têtes, joues, reins, épaules, chevilles, front, nuque, aisselles, nerfs, oreilles, hanche, plèvre, bronches, poumons, vertèbres, coccyx, pharynx, etc., avec ses sécrétions spécifiques : salive, bave, urine, sueur, sperme, vomissure, merde, morve, etc. L’extrême précision du morcellement et de son vocabulaire (qui empêche toute unification corporelle et maintient durement le texte sous le régime du verbe moteur) est la garantie de la prise en charge de chaque tracé de pulsion qui, dans le « paysage », va se fixer provisoirement sur tel ou tel animal (crapauds, (chiennes, tarentules, serpents). Les embrayeurs — représentants exotiques et pluriels du sujet dans le tableau — seront placés comme à l’intersection du verbe et de l’organe, huilé par son émission substantielle, les noms ou les surnoms du sujet condensant la disjonction dynamique du verbe et du substantif : le maître de foutrée, le putain, le dattier, le tôlier, le boucher, le berger, l’apprenti, l’adolescent, le nomade, le pied-bot, le foreur, le rasé, le bouclé, le blond, le brun, le crépu, le garçon, Wazzag, Hamza, Khamssieh. D’où l’obtention de séquences de montage (« le passage d’un fessier monté sur épaules voile la lumière ») saturant la syntaxe du fantasme depuis une force d’écriture qui surdétermine son déploiement. Chaque possibilité de trou est immédiatement bouchée par un représentant phallique, venant circonscrire le vide. Vide : la mort et le soleil peuvent parfaitement se regarder en face, la scène primitive — porteuse de la non-tête de Méduse de la castration —, jamais. Vide qu’implique, pour le tiers exclu et clivé, le coït qui le boucle dans sa provenance : « aux bruits de halètements cloisonnés, son sexe tressaille ».
Crédit : art press 364, février 2010.
ZOOM : cliquer sur l’image
6. — A côté du bordel mâle où se joue, dans un « dos de face », la machinerie sadico-anale, les femmes, à l’écart, de loin, jouent le rôle de relance et de rappel de l’excitation traumatique — pouvant amener la reconnaissance de la castration — quand le « ramollissement » risque de la découvrir. Elles sont, en général, accroupies, affaissées, assoupies, se redressant à moitié par rapport à cet effondrement de base : « les femmes, vautrées sous l’épineux, redressent le buste ». Elles ne peuvent que représenter une moitié de phallus ou, au repos, le dérobement, sous la croupe ou les fesses, du pénis de la fille : littéralement, par rapport au sein, le pis qui doit se trouver sous elle. C’est aussi pourquoi le mot claie, qui les divise au regard de la circulation des autres signifiants du texte, est une des clés de leur fonctionnement spécifique. Claie, c’est en même temps clitoris + plaie et cul-plaie avec, en connotation, le click ou le coup glotte qui répond au lait (le violet, le voilé, n’étant rien d’autre que le viol du lait pour la voix qui l’appelle et en forme l’envers modulé). « Ses lèvres vibrent sur la plaie » :
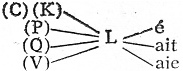
Ce (K)lé se fait entendre dans bouclé, giclée ou caillé. Le clitoris, cicatrice sur le chemin de la castration, renvoie aussi à la luette qui pend au milieu du bord libre du voile du palais, de même qu’au tubercule qui se trouve à la surface interne et inférieure du col de la vessie urinaire. Pénis rabougri, point focal de l’interrogation et de la masturbation infantile, « enfant » battu et rabattu dans l’impuissance originaire qui surmonte la plaie de la coupure faisant surgir l’instrument phallique, le clitoris désigne le vestige fondamental [25], la ponctuation d’où s’est dégagé, insaisissable, le phallus. C’est aussi pourquoi ce qui est originaire n’est pas le « traumatisme de la naissance » mais ce qu’on pourrait appeler à travers la castration (en trouvant là une des clés de la mythologie chrétienne) un trauma permanent de nativité [26]. Pour revenir au transfert du bas vers le haut, du con vers la bouche, on peut dire que le son est dans la voix comme le pénis dans sa gaine en se souvenant que le pénis et la langue sont les seuls muscles attachés à un seul os. Si l’on tient compte ici du sphincter glottique (deuxième sphincter du tube gastrique, haut-parleur de la conversion muette des pulsions dans le transformateur du sphincter anal), on comprendra mieux comment « le babillage, centré sur la reproduction motrice de la succion, est accompagné par une reprise hallucinatoire de l’acte même » ; comment « la palatalisation des consonnes est un phénomène caractéristique de la première période du langage enfantin et s’explique, au moins en partie, par la prévalence de la pulsion orale » [27]. La langue « dirigeant les flux d’air à travers les espaces humides vers l’ouverture buccale » est comme un pénis à l’intérieur de la bouche, tandis que les contractions spasmodiques des muscles laryngés organisent, par exemple, la pulsion agressive contre la chaîne parlée, déchirant ou mettant en morceaux la phrase. Les occlusives sordes (T, K) « empêchent l’air de sortir par la cavité orale, elles interrompent le flux sonore par saccades ». Le G (K doux) renvoie à la contraction pharyngée accompagnant le refus de nourriture. De l’occlusion à l’explosion, c’est tout le jeu du tassement et de la déchirure de l’objet sonore qui se constitue dans l’accumulation de la tension atmosphérique accrue (l’atmosphère, dans E.E.E., est aussi bien un fait de « nature » que la matière même de la langue). De même que les occlusives vélaires sont analement investies, le R apical sera un son érectile (phallique) : creusement et détours du chenal vocal.
7. — La femme est donc, dans un premier temps, la représentation du buste dressé et de l’ « amas » sexuel qui conjoint le vagin et l’anus (Vénus). Le membre au cul est ici lisible : « Les membranes mortes qui bourrent mon cul, pendent à mon membre. » Ou encore : « Son membre, boucles du cul s’enroulant autour de son gland » / « une membrane folle, accrochée par le gland, ballotte au bord du cul. » Membre, membrane, membre-anus : cette série consonne avec celle qui fait de la langue un gland (et aussi un pénis caché dans le con sanglant). « Sa langue débordant, ensalivée, de ses lèvres minces ourlées mauves » / « sa langue balafrée sort d’entre ses dents, d’entre ses lèvres, nez piquant vers les boules, chauffe le bord du cul salé par la suée. » En écho : « La pellicule (cul) de foutre recouvrant en transparence la chair rougie, violacée, du gland, marquée d’empreintes annelées » / « le gland rosit, tourne au violet, les chairs circoncises, dilatées, collent à ses doigts » / « l’arc tendu contre l’arête de son nez, appuie ses lèvres contre les chairs circoncises, les lèche. » Inutile de souligner le rôle de soutien fétiche et phallique tenu par le nez (qu’il faut entendre aussi dans « nouveau-né »). Ou encore : « dans la bouche ouverte (con vers le haut) de la fille rasée (phallus, crâne) la langue mouchetée (bouche cachetée) de mauve, de nacre (dents, mais aussi : foutre) scintille (sein t’il) éclairée par un rayon filtrée dans le branchage épineux. » La claie, souvent « enjambée » (entre les jambes), le branchage : c’est aussi la toison pubienne de la femme, toison en quelque sorte « barbelée ». Au niveau de l’effet de bouche généralisé (vagin denté), « les deux respirations l’une l’autre s’aspirent dans le même temps que les sexes l’un l’autre se mordent ». Cette représentation archaïque trouve d’ailleurs son représentant de langue dans l’emploi des pronoms vieillis « icelui » et « icelle » qui, par la médiation du pis (variante urétrale et lactée du sein devenu pénis), donnent à la fois pisselui et pisselle où s’annonce, à nouveau, le pénis fantasmé commun aux deux sexes et le recouvrement du traumatisme de la découverte de la castration de la fillette urinant accroupie, c’est-à-dire pouvant cacher son pénis sous elle, voire dans sa croupe, et aussi, bien entendu, pucelle, où se fait entendre le usse de prépuce, d’anus, de pénis-anus, de cu-pénis-elle. Le isse urétral est d’ailleurs verbalisé en : pétrissent, hissent, raidissent, cuisses, pubis, etc. Soulignons aussi « le gland mal circoncis du pied-bot ». Le pied-bot (beau), le pied enflé, Oedipe au talon d’Achille, est bien celui qui — comme nourrisson — aura marché sur le corps de la mère et touché, nu, la terre promise, interdite, aux ruisseaux de lait, son « gazon » et sa toison noire — celui, donc, dont le pied-pénis reste à tout jamais vulnérable sous l’épée de la loi ; dont le gland, comme le pied, à force d’enfler (?dème), de s’ériger, n’en est pas moins fait pour ’être coupé comme les yeux sont sexuellement faits pour être crevés.
Ici, chaque mot est une formation transitoire de l’écriture de phrase (Satzenschrift) [28], ce qui explique, par ailleurs, la possibilité parlée du lapsus — acte « réussi », comme le rappelle Lacan — et que le texte fonctionne aussi comme lapsus généralisé : massé sur le bout de la langue. Chaque mot est un agrégat de lettres et de pulsions contre-investies, c’est une claie , une planche travaillée de noeuds (clefs dans la claie) à travers la portée musicale. Orchestration où peuvent se détacher, atomes discrets et concaténés de la phrase, les « points d’ombilication du sujet dans les coupures du signifiant » (Lacan), sujet massivement hors-de-phrase, point-clé et divisé du fantasme. Dans cette stéréographie, la suite des unités de phrase et des séquences en relief sont comme les fresques du saillant phallique produisant l’espace creusé des séries que les lettres-en-mots viendront remplir par le mot qui n’est que le représentant décalé de l’unité de phrase (d’où la nécessité de ne pas se laisser prendre au mot, encore moins au mot sexuel ou obscène qui est là pour rappeler la fonction de verbe initial qui est la sienne, mot valant en fait pour tous les mots, mot de mimique, mot de geste) [29].
8. — Le corps morcelé, devenu son morcellement transitoire. chirurgicalement « , disjoint de sa jouissance » (Lacan), fournit l’accentuation des lambeaux de phrase où il se distribue dans sa grammaire rigide et mélodiquement réglée. Il est en propres termes l’extension découpée du mot du « lait » qu’il a reçu au départ : il ne peut que ronronner et se moduler dans une « insonorisation » de base : « corps insonorisé, scrute le feu bleu ». Le phallus devient ici l’instrument sourd de cette musique rythmée : « Le putain, salive avalée, palpe la verge à travers l’épiderme (pis + derme) vermeil de sa joue. » Sperme et lait, sein et pénis sont de plus en plus marqués dans leur impossible réciprocité : « Le pied-bot mâche le foutre, la verge, ramollie, s’égoutte vers le haut du sein, le filament s’étire jusqu’au téton. » Comment ne pas entendre, dans « les membres nus des femmes assoupies », l’insistance de ce membre substitutif que serait le pis sous les dessous féminins dénudés ? Et qui, du coup, se reporte en fétiche à l’anus enculé, (en-cu-lait) : « En son cul, la verge du blond, mordue, regrossie, potelée (pot de lait), expulse le restant de foutre éveillé sous les doigts, sous les lèvres du pied-bot. » La « suée », la « foutrée » convergent vers cet élixir ou ce philtre qu’est le lait de la mère absente. Dans « l’aine où la poudre de foutre coule dans le pli », entendre : « le lait en poudre coule dans la pluie de foutre » (envers négatif : le sable). « Le maître de foutrée, claie enjambée, escalade la dune basse (sein, ventre) au versant de laquelle, ombragé à mi-corps par le branchage acéré (toison du pubis), le bouclé (bout/claie, bout/clé, bout/ cu/lait), sa verge happée (à pets, bouche) dans le sexe de la fille rasée (crâne) à demi enfoncée dans le sable », etc. ; glissement de l’aliment et du premier élément de langue : « Un mélange de foutre, de sueur, de sang, s’écoule, ardant la membrane, hors de son cul ouvert dans la lissée des fesses à l’accroupissement. »
La femme, dans la grande séquence finale, n’est pas évidemment pour rien domiciliée, avec son « bébé », « sous un abri de peau ». « L’épiderme ocre-mauve serré dans un tissu violet », « bébé assoupi dans le creux de son aisselle » (selles), elle représente, dans son corps à dépendance d’enfantement, le phallus comportant son supplément de pénis animé, joueur, détachable : « une bave nacrée vibre à la commissure des lèvres du bébé ». Son fétiche sera une « bouteille de graisse blanche bouchonnée (bouche/nez) d’herbe verte ». Face à elle le « nomade », le « garçon » occupe une position passive, fonctionnelle, agrandissement du bébé sous le rappel incessante de la menace de castration (« toux à caillots ensanglantés », (fracture du coude). Symétriquement, se constitue le singe , le sujet du sein, hors-culpabilité, hors-inceste, hors-homosexualité, hors-castration, hors-symbolique qui est, dirait-on, à la fois la figure édénique de la mère phallique ou d’un père désormais adoptif, nourricier, et celle, sous-jacente, du sujet de l’énonciation dans l’écriture. La femme — la mère — est porteuse, elle, d’un sexe-coquille (« coquille bouclée » : bout-clé-claie-cu-lait) tandis que, par rapport à ce bouclage de base, son « haleine lactée, bouche ouverte, baigne l’avant de son visage voilé ». Désormais, le fétiche va être composé-décomposé dans son montage « doublement noué à des contraires » (Freud) (« c’est dans la construction même du fétiche qu’aussi bien le déni que l’affirmation de la castration ont trouvé accès » [30], imbrication du creux et du plein (phallus vide, cavité phallique) obstiné à boucher de façon aussi bien convexe que concave la coupure irreprésentable de la castration, montage, donc, de la différence sexuelle en identité de contraires renvoyant à celle de l’enfant et de la mère. « Le foutre afflue dans la verge encoquillée » / « La coquille enserre à la racine son membre violacé. » La non-disjonction sexuelle, mise en péril, augmente la confusion des espèces — serpents, oiseaux —, et le coït des figures femelles (en train de devenir trou) et mâles, se fait sous le signe d’une cassure, rire mêlé de douleur : « Le sang noircit au pli du coude » / « le poignet paralysé chauffe. » La coquille — cu en couilles, couilles en queue — qui est aussi blasonnée par les bidons shell, est « curée » par la femme « d’un revers de pouce », tandis que la verge (vierge) « encoquillée » (en queue couillée, les couilles étant désignées — comme des seins — par « boules sécrétives ») est aussi, à l’envers, le je accolé au sein : « Le singe, en orgasme, le bébé accolés, roulent dans le sable » / « Le bébé, s’apaisant, ouvre ses lèvres, tette le membre... la semence emplit la joue, déborde sur la langue. » Comme si le texte, dans son fond d’oralité découvert, disait : je suis un sein dont je suce en bébé la queue. Comme si, entre l’âne et le boeuf — ici : le chameau et le singe —, la vierge, munie de sa verge et de son bébé, trouvait son explication détaillée. La « verge encoquillée » est la verge prise dans le sexe féminin dénié en queue négative : la coquille est la localisation sexuelle du poing du nourrisson masturbatoire, de telle sorte que cette verge interne, retirée dans sa coquille, représentée en surface (comme un iceberg) par le clitoris, laisse s’égoutter son « huile », sa « semence aquhuilée » (à cu huilé, à-cu-il-lait), le corps étant d’autant plus multiplement « ouvert » (oreilles, yeux, narines, nombril, cul, pores) et oralisé que le vagin se dérobe davantage à la sanction de coupure dont il est invisiblement la réalité. La coquille, à lèvres, « mord », « happe », « crachouille », « écume », « se clôt », elle est « contractée » comme un con que l’on pourrait traire. Il devient équivalent d’enfoncer « son pied sous le vagin de la femme assoupie » et de retirer « son pied de sous le pénis ». Le garçon, sortant de la femelle, se précipite vers un « affleurement du roc », réassurant son sexe contre le silex (sexe d’il), combattant ainsi le vertige qui se donne comme brusque montée de sève végétale : « Le vert monte dans les tiges » (vertige). La coquille est ou bien le pénis en creux, ou bien fermée comme un crâne. Carapace contenant le mollusque actif, dissimulé, plein de sécrétions « à la rencontre » du pénis — tantôt serrée, tantôt ouverte dans le battement (fort-da) symbolique du fantasme, bouche ou main primordiales (salive, sang, sueur) à langue, formes inverses du sein rebondi, du poing qui pétrit ; « la coquille triture les tissus du conduit du gland ». Le sujet forclos est donc ici, sur l’autre scène du texte, hors de la sa phrase, amené à être à chaque instant le phallus de la mère, soit sorti, soit rentré, soit pénétrant, soit faisant face à ce qui pénètre, arrimage qui n’a rien à voir avec celui d’un foetus, mais qui dépend entièrement de la forclusion de la castration. (L’homme descend du singe en passant par sa provenance de son je au sein, de sa queue à mère, dans le saut qualitatif de l’opération symbolique de la castration comme « cause » du langage distinguant la société du travail divisant la jouissance de l’homme de celle de l’animal.)
9. — L’ultra-vitalisme — l’organicisme —, conséquences de cette posture, impliquent une somatisation incessante ; « poil, corne, épiderme, oeil, lait, sang, suint, urine, circulation de souffle en souffle », dominée par la verge vocale « au cri trillé par le sang » ; « lueur engorgée du feu rose baignant les bouches, filtrées aux membranes transparentes des poumons déchirés ». L’oeil voilé, la voix voilée, les caillots de sein, les étrons d’anus, les pieds en sabots, les cornes en pis, l’arbre et le sable : « Les sabots foulent, amollis, le sable spongieux » / « Le sang, caillots débloqués, recircule dans l’articulation du coude »... Ici interviennent — autour de la non-tête de Méduse absente — un « noeud de tiges », les cérastes, c’est-à-dire les serpents qui développent la présentation du phallus « hors-coquille » et du pénis fécal (« étron rouge, tenant au cul, se lovant dans la cavité tiède ») ; les vipères cornues des sables du désert. On sait que c’était là le surnom des Erinnyes à cause des serpents dont étaient entrelacées leurs chevelures, Kéras voulant dire corne. (Définition : genre de reptiles ophidiens solénoglyphes, famille des vipéridées, renfermant des vipères désertiques à front concave avec des cornes lamelleuses au-dessus des yeux.) Les cérastes circulent entre écailles et caillots, entre veines et venin, entre sable et talon, entre sol et peau cornée. Leur iris est « vertical », la cornée de l’oeil y est une autre corne, de même qu’ils sont la coquille cornée — vagin denté — à l’intérieur déplié. Ils surgissent et se réenfouissent dans le sable, surface indéfiniment et microscopiquement morcelée du bord de la mère d’où sortent des queues hallucinatoires. Les cérastes et les pimélies (insectes) (pis-lait-lit) sont à l’intersection du point de greffe où femme est à garçon ce que serpent est à insecte (agression de la mère phallique). Le caillot (substitut du lait caillé) est renvoyé à la calotte à la fois excrémentielle et pénienne (prépuce) : « La couche de merde fraîche décalottée » / « Les cérastes jaillissent, leurs têtes encaillotées... » Le pénis fécal — n ?ud d’étrons — est aussi un « piquet » fiché dans l’anus (fonction levier — érective — du fétiche), comme le bébé est serré contre la gorge de la femme, la « croupe torsadée » appelant la chevelure féminine serpentée (accentuation des deux grands blasons du fétiche : la lingerie, les poils, qui « auraient dû être suivis du membre féminin ardemment désiré », « dernier moment du déshabillage, pendant lequel on a pu encore penser que la femme est phallique », Freud). C’est ici qu’après la première référence explicite à l’ écrit (le fétiche est toujours aussi grammatical) représenté par la « fiche de paie » (monnaie du fétiche) plaquée sur les corps mâles, va se construire le totem du texte planté à l’horizon de sa clôture, projection de sa grammaire solidifiée et répétitive : « piquet sculpté d’animaux, ailés, palmés, fessus, déglutissant sur leurs seins pansus, hors du bec, oeufs, ovaires, fruits ». Ce totem maternel (auquel il faut ajouter « l’entrelacs des tresses », les « mèches torsadées », les « lourds cheveux beurrés », la « couronne peinturlurée » ; auquel il faut se reporter pour entendre dans « le vert monte dans les tiges » non seulement « vertige » mais aussi le fait que les ovaires sont conçus comme montant dans les pénis érigés) est marqué dans le texte par l’italique sculpté affectant soudain l’énoncé des parties du visage (gorge, oreilles, bouche, narines, yeux, front) prenant en charge leurs correspondants immédiats (dans l’ordre : croupe, bras, seins, chevelure, verge, nuque) (nuque devant être entendu comme anus + queue, la femme « écrivant » dans la nuque du garçon) dans une table de projection de la mère phallique qui ouvre sur le code le plus abstrait, génétique, déposé « au fond » du texte (comme il va l’être en frontispice à travers la phrase en écriture tiffinagh) : « cercles, croix, crochets, carrés striés, triangles ». Ce fond pictographique rythme l’écriture primitive, l’écriture de coït où le régime scandé, virgulé, de la phrase est à la fois moteur de verbe, lapsus et mot obscène, sol de la représentation ensablée.
S’introduit ici « l’étoffe » autour des reins, à la fois déshabillage de la mère et emmaillotage enfantin, la mousseline, la « djellaba toute gonflée d’air violet » (muqueuses encore gonflées par l’attente de la découverte du phallus maternel) qui fait mousser le phallus au dos du mâle (mère retournée), agrandissement des chairs, circoncises du pénis logé dans la coquille ou sous la « chamelle » : « chevelure éparse sur le fessier ombré aux plis ». Le garçon tette le pis comme la femme mord la verge. Quant au coffret du fétiche, « sachet de peau (prépuce) scarifiée bloqué dans un bilon shell (coquille) coupé au niveau du verseur (circoncision) », il contient « des boucles, des colliers, des bagues, des anneaux, des bracelets, des pendentifs ». Le texte marque ici à l’intérieur de lui-même, dans la représentation ponctuelle de sa genèse, comment la découverte historique de l’écriture a été contemporaine de celle des colorants, des maquillages, des parements, eux·mêmes envers de la sépulture. « Sa verge, au travers de la djellaba, attouche triangles, pendentifs, losanges, cercles, rectangles d’argent, d’ivoire. » Le corps-phallus est ainsi fétichisé par inscription directe : « traces, cercles, croix, rectangles sur son front » / « les lèvres remuées par l’accompagnement musculaire de la tressée ». La coquille — d’où surgit Vénus-phallus montant du fond de la mère — est foulée — comme les « nouveau-nés » — par le talon (pénis) « fissuré » : elle « écume ». Plus nettement : « Le pied du garçon tressaille sur le con » / « sa verge se rétracte dans les boucles. » Jouissance versant dans l’ombre du sujet-phallus-de-la-mère : « l’horizon bascule, soleil surplombé — galbe tropical irradié —, verse, masse érectile, dans l’ombre occidentale ». La femme (phallus) est habillée en fétiche (anneaux / seins, collier / cou, diadème / front, pendentifs / lobes), tandis que l’écriture de phrase du coït représente à nouveau son ressort de production tatouée de la fétichisation : « dessine sur le front étale, avec la pointe d’une tresse fardée... une croix pointillée, un cercle... » Simultanément le phallus de la mère s’écrit comme un bijou de déroblement mobile, greffé en consonne, c’est-à-dire en clé, sur les lèvres, clé + lippe = clip : « clip de corne sur le retroussis de la lèvre inférieure du con ; laquelle, révulsée, enfouit le clip dans le friselis d’écume aquhuilé », lèvres de la bouche et de l’anus fermant « l’autre bouche » en corne (licorne). « le clip affleure dans la mousse ; les chairs roses le déglutissent. »
La coquille à bijou, le « cliquetis des bijoux » se renversent dans le spasme respiratoire qui conjoint la quinte de toux et le caillot ensanglanté dans un supplément reporté et substitué. La castration s’exorcise dans l’inversion du plein au creusé : « Le gland attouche, saccadé, chauffé, le con grand ouvert aux lécheries de mèches, baigne, proliférant, dans le dépôt palpitant de semence » / « le con tressaille, presse la verge rétractée, gland baignant, trituré, dans le frais mélange des semences, attouchant le siège de l’enfantement. » La langue dans la bouche, et bouchant la bouche de ses mots fétiches est chargée de la fonction de matrice — et c’est pourquoi elle a ses propres règles : saignement, infection, lambeaux, crachats, etc. —, langue et parole étant ici logiquement décalées comme le sont écriture et écrit : le siège de l’enfantement du langage est touché par le gland, envers de la langue, baignant, trituré, dans le frais mélange (bave, lait, sperme) des semences (phonèmes, lettres), « foutre réattouchant le canduit, gorge resserrée ».
Le tronc cache le trou qu’est le con, enracine le montage du bébé en phallus maternel : « la femme, bouche tapissée de bave nacrée (coquille), s’accroupit, croupe moulée dans l’étoffe humectée d’ozone, mord le tronc, enserre la tête de son bébé — suspendu par ses pieds recourbés au cou de la femme — entre ses cuisses. » « L’amas sexuel engainé dans l’humide lambeau » (langue, pénis) s’édifie à l’envers du « con ensablé », ou encore transféré à l’anus : « du con entrouvert, la semence aquhuilée s’écoule sur le sable ». Toujours à nouveau dans la fixation orale, la bouche recueille la résine sucrée, « l’averse embaumée » : « le pollen (peau, lait, aine, laine), dans l’arbre ébranlé (branler, lait) par les coups de pouce (pénis) de la femme, s’effondre sur le visage renversé du garçon (bébé) ». Le fétiche est un piège à lait, une série de n ?uds imbriqués dont la voix, par la parole, en son fond, mesure l’enveloppe : son langage sonore, s’il en a un, consiste à susurrer (sucer, murmurer). Etant un bout qui consonne avec le vagin dénié, il peut se présenter sous la forme d’un « bouc » qui « geint », ou encore d’un excrément déplacé, comme le « bébé logé dans l’aisselle » (dans les selles). Le con creusé, conçu comme phallus vide, est aussi un cou (« le cou convexe de la femme »), et nous obtenons alors l’équation tronc-trou-con-cou qui culmine dans croupe et se refond dans trombe à la fin du texte. « Les lèvres de la femme... annelées en leur milieu d’un bourgeon de chair lisse, sur les vertèbres du cou levé. » Peu à peu, la multiplication des corps ou plutôt des objets de « l’achose » (Lacan) — eux-mêmes représentants du corps morcelé —, se rassemble dans la conjonction-disjonction du rouage fondamental du fétiche dont le nom exact serait : l’afemme. L’afemme phallicisé est là pour concrétiser la mère interdite ainsi que son phallus absent maintenu. Il (elle) cerne le mouvement par lequel « la verge tressaute dans le con qui la gaine au ras des boules » alors que « les boucles adhèrent au retroussis inférieur du con », « verge engainée dans le lambeau ». La gaine du vagin, verge en creux (que tout tablier pubien a sans doute pour fonction de symboliser dans le réel), laisse apparaître les « boules noires sorties du lambeau ». De ce côté-ci du texte, il faut voir que le sujet de l’énonciation dans l’écriture, se dédoublant dans ses énoncés, en fait se regroupe au point du fétiche qui l’identifie à la mère phallique. « Vénus incandescente », où « sous l’étoffe collée le con palpite, s’entrouvre ». L’afemme protège les « dessous de la femme » où pourraient se présenter l’horreur du trou de la castration. « La femme recule, s’élance, court vers l’abri »... « bébé enfoui sous les écheveaux de laine rouge » (c’est-à-dire aussi les « châles écarlates, violets », muqueuses du vagin). Elle enfouit dans des « sacs » les flacons, les sachets, les boîtes — petite monnaie du fétiche —, tandis qu’un « coup de vent refoule, dresse le sable, face à l’obscurité accrue », c’est-à-dire tandis que se renforce le refoulement sur la mère se dérobant au loin derrière « la palpitation accélérée de Vénus ». Cette « palpitation » de la phrase est l’indice vibrant, mis à distance, déroulé, cursif, de la jouissance sexuelle que tout le texte est dressé, comme une grande muraille obscène, un obélisque de la représentation de sexe, pour contenir et canaliser. Urétralement inversée, elle apparaît pourtant comme averse : « La pluie, portée en colonne de sous la palpitation accélérée de Vénus, gicle, glacée » / « La laine, trempée au ruissellement de l’eau ardente hors des plis de leur vêtement mêlé au niveau des seins, déteint sur le corps du bébé assoupi. » De la bouche au cul, en colonne, par le tronc, en trombe — à savoir en trompe [31] —, la rafale du texte, courant, enfermant sa voix, se retire dans l’inconscient, dans le « vagin loué à l’anus » que marque graphiquement la majuscule V (cinq de la main abrégé dans les aiguilles scellées des jambes) de Vénus lestant symboliquement « voilée ». L’ultime séquence ramasse ce blocage de la tumescence et de la détumescence du sujet au sein de la mère phallique, de la castration décalée (têtes coupées des serpents) et du bouchon de lait dur qui vient aussitôt s’y coller, du contre-coup qui s’ensuit en invagination anale où le fétiche, scandé, sculpté, contradictoire, repart vers sa provenance insaisissable, indiquant aussi bien le pas d’origine animale et matérielle, comme venu d’une autre planète, de la phrase en fresque entièrement suspendue :
« le singe piaule, bras alanguis, guerba ramollie nouée à l’encolure, mufle sanglant, sexe dressé, oeil scrutant Vénus voilée de vapeurs violettes, piétine les cérastes décapités ; la graisse exsudée au bouchon d’herbe, durcit ; la trombe recule vers Vénus, »
Phiippe Sollers, Critique 270, juillet 1971.
Dans un récent entretien avec Jacques Henric, Pierre Guyotat revient sur Tombeau pour cinq cent mille soldats et Éden, Éden, éden...
Une scène « adamique »
[...] Certains, qui ont lu Tombeau ou Éden, n’ont vu sur le moment que ce que j’appelle le « mâle à mâle ». Pourtant Tombeau, déjà plein de femmes, de filles, s’achève sur une scène « adamique » de recommencement « hétérosexuel ». Éden commence et s’achève de la même façon. La scène « mâle à mâle » y est évidemment d’une force nouvelle dans la littérature française. Tellement nouvelle que beaucoup de lecteurs n’ont vu que cela !
Même des gens qui ont étudié de près ces textes. La fin d’Éden, 70 pages serrées, c’est un accouplement entre un homme et une femme, avec bébé et singe. C’est extraordinaire que cela ait été oublié. Pas par tous les lecteurs cependant. À la fin d’une lettre de Jacques Berque, le grand islamologue, de février 1971, à propos d’Eden, ceci :
« Figurez-vous qu’un poète préislamique, fils de roi, exprimait déjà, dans son Arabie du 4e siècle, la scène de vos dernières pages : “ Et toi aussi l’enceinte, l’allaitante, / je te visitai, je t’ai distraite / de l’Ua-an garni d’amulettes / Quand il pleuvait derrière toi vers lui du buste détournais “. » [...]
Pierre Guyotat, entretien avec Jacques Henric, art press 365, mars 2010.
Sur « Prostitution » (Gallimard, 1975) [32]


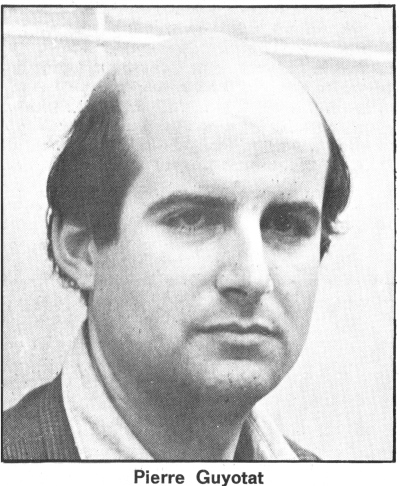
- Photo Gérard Aimé
Il ne faut pas attacher trop d’importance à ce qui se raconte de Pierre Guyotat. Répugnant pour les uns, fascinant ou héroïque pour les autres, il tient le rôle, entre tous ingrat, de l’exhibition « à bout portant » avec son époque. Position risquée, qui tient surtout de ce que personne n’est prêt à accepter facilement la moindre distance avec le symptôme sexuel. Il est toujours plus commode d’interpréter trop vite un cas de cet ordre. Soit en le refoulant, soit en l’emphatisant. Angoisse de la loi, de la plaisanterie ou de l’identification naïve.
Car enfin, soyons sérieux, il n’y a aucun moyen de parler de « Prostitution » avec rigueur si ce n’est dans la perspective analytique. Et c’est bien là l’intérêt (qui risque de passer inaperçu sous les rejets offusqués ou les approbations militantes) de ce livre. Un livre ? Plutôt l’enregistrement inscrit d’une énorme répétition portant toujours sur le même fantasme : l’organe mâle affolé par rapport à l’organe mâle, bouche, pénis, anus. Ecriture compulsionnelle visant, interminablement, à maîtriser un trauma. Lequel ?
L’écriture de Guyotat n’est pas homosexuelle mais, pour reprendre un mot de Duchamp, « mâlique ». Il y a « l’homme » et « le garçon » : dédoublement obsessionnel de l’auteur qui, comme un père et son fils, n’arrête pas de proposer et de reproposer, de marchander, d’ordonner, d’imposer la décharge. Etre enfin la femme mâle de tous les hommes, le prostitué absolu, incessant, qu’est-ce que ça veut dire ? Que le garçon esclave, sous-développé, englué dans la langue du grand colon universel (le père féroce de la petite enfance), rêve d’être à la place de sa mère pendant le coït. Mais être à la place de la mère, dans la perspective enfantine où l’acte sexuel est imaginé comme une agression, un crime à l’arme blanche, un assassinat, c’est se mettre à la place impossible où il faudrait perdre un membre. D’où la répétition, le coinçage au bord de l’aphasie, puisqu’il faut à la fois réitérer la scène primitive et l’empêcher de produire son effet ravageant : le fait que maman aurait un autre orifice que l’anus ou la bouche, un trou quelque part ailleurs. Et plus on s’en doute, et plus il faut le nier dans l’obscénité. Ce qu’on entend, dans « Prostitution » déformé par l’interjection, l’appel tronqué, le patois, l’arabe, tout ce qui peut faire interjection « sale », c’est comme l’agrandissement sonore du halètement parental, incompréhensible, stéréophonique, fantasmé jusqu’aux extrêmes limites de la syllabe et du cri.
C’est un hurlement. De plaisir ? De souffrance ? Le nourrisson-lecteur ne le sait pas. Et c’est ça qui l’horrifie ou le fige. L’effet Guyotat : provoquer (chez lui et, si possible, chez l’autre — et plus l’autre résistera plus il sera pris dans l’opération) une régression intransigeante. Dans cette régression, il y a tout le monde, hommes, femmes, dans la mesure où, pour le bébé, il ne peut y avoir qu’une seule hypothèse sexuelle, la théorie clocale. Si vous ne voulez pas passer par là consciemment, vous n’y êtes pas moins accroché. Chacun à votre manière. Celle de Guyotat est plus acharnée, en relief, c’est tout.
Père et fils
Ce fameux fétiche, sous les jupes de la sacrée mère, est-ce qu’il est là, oui ou non ? Regardez Guyotat multipliant le mot « slip ». Dix fois, cent fois, mille fois, dix mille fois. Avec une obstination et un lyrisme de mineur de fond, qui veut enfin en avoir le coeur net, savoir. Est-ce que le mâle formidable de cette horde primitive, qui n’en finit pas d’éructer son excitation, est dépassable ? Peut-on l’endormir ? La psychanalyse connaissait le drame du président Schreber, l’homme aux loups, l’homme aux rats. Guyotat, lui, s’enfonce dans une « chiennerie » généralisée d’où il vous fait signe. Mais oui, à propos de vous-mêmes, ne vous y trompez pas.
Ce n’est pas un livre que vous avez à lire : c’est une question sur votre inconscient. Question par définition infinie : vous êtes là ou vous n’êtes pas là, en deçà ou au-delà, ici ou à côté, plus loin ou non, peu importe. Il s’agit de vérifier si vous êtes, non hypocritement, sans alibi ni substitution, à la hauteur de l’obsession qui travaille les têtes en silence, souffle coupé, animalement retourné ; basse-fosse, chenil, excréments, gorges, enfer d’inversion tout au fond. Le « slip » et ce qui en sort, c’est le dieu farouche de Guyotat, queue en bouche, queue en cul, décharges, recharges annales du pénis anal qui n’existe pas ; et le père n’en finit pas de baiser son fils, violemment, mécaniquement, comme le mauvais dieu de Schreber descendu dam la « langue fondamentale ». Il fallait que ça ait l’air interminable, que ça paraisse (puisque ça l’est) épouvantable de monotonie.
Phiippe Sollers, Le Nouvel Observateur du 21-07-1975.
CASSETTE 33 LONGUE DURÉE
Pierre Guyotat
Pour Gérard Khan
Je n’ai rien à dire de ce que je pense et de ce que je fais, aujourd’hui, parce que tout cela est déjà écrit, dans des textes récents et anciens de moi, et que j’ai déjà fort à faire avec ceux-ci, c’est-à-dire que dans quelque écrit que ce soit de moi il y a très souvent, trop souvent, une idée juste, c’est-à-dire une idée actuellement juste, pour quelque dix années seulement, prise dans une image fausse, ou dans un ensemble d’images faux, c’est-à-dire impensable, impossible dans le réel actuel, mais dans un réel d’une actualité beaucoup plus longue que la précédente.
Je n’ai rien à dire parce que je suis vraiment ignorant, ignorant du droit, ignorant du sexe, ignorant de la psychanalyse ancienne et moderne, ignorant de la philosophie, ignorant de la science. Je n’ai rien à dire aussi et surtout parce que j’ai peur.
J’ai peur de quelque chose de très précis, qui m’est extérieur et intérieur à la fois, qui me regarde et que je regarde, et qui est la folie. Je pèse le mot et je dis, et j’écris surtout : folie. J’ai peur parce que, aussi profond que j’aille dans moi-même, j’y refrouve toujours la même chose, c’est-à-dire l’homme. J’ai peur parce que je dois manger de la bête tous les jours. J’ai peur parce que mon sexe costaud arqué vers le bas par la coutume de masturbation ne peut convenablement agir dans l’opération sexuelle dite de base, parce que cet organe ne peut pénétrer que plié en deux dans le trou de l’autre.
L’eau casse le bâton. Mon organe ne tient pas les promesses de mon corps, de ma stature. Il tient plutôt de la mamelle paternelle, et beaucoup s’en contentent. J’allaite, j’allaite.
J’ai peur parce qu’avec l’âge les journées d’adulte se font de plus en plus courtes en regard de celles de l’enfance, si longues parce que l’enfant n’a pas de sexe, et ce, quelle que soit la saison. J’ai peur parce que je n’ai de haine ni de mépris pour personne. J’ai peur parce qu’écrire me sépare de la horde. J’ai peur parce que je peux encore tourner par écrit autour de ma folie. J’ai peur parce que j’ai de plus en plus peur de me retourner sur ce que je viens d’écrire, comme si peut-être je craignais de faire disparaître ainsi le seul objet, la seule durée avec lesquels je sache encore tenir le souffle. J’ai peur, mais cela depuis toujours, j’ai peur pour les autres. Peur pour leur sécurité.
Peur quant à la sauvegarde de leur survie organique, juridique, administrative, mentale. Sur ce dernier point je n’ai pas assez progressé dans le respect de la liberté de l’autre. Si je savais enfin pénétrer dans l’autre, le violer, peut-être aurais-je moins peur pour sa vie. Toutes ces peurs ne sont pas des craintes, ce sont des terreurs. Je n’ai peur ni de moi — je l’ai prouvé — ni de ce sexe, ni de ces trous auxquels il devrait se plier, ni de ces bouches qu’il allaite, ni des hommes ni des femmes — je l’ai prouvé —, mais j’ai peur de l’histoire.
Toutes les nuits je rêve d’histoire, très peu de sexe. Fausses conquêtes, faux massacres, faux incendies, faux traités, faux temples, fausses villes, fausses partitions, faux tableaux, fausses sculptures, faux écrits, etc. ; rien n’y fait, fausses mers, faux océans, fausses montagnes, fausses gorges, faux défilés, fausses végétations, faux minéraux, fausses peuplades, fausses nations, faux empires, rien n’y fait, faux sexes, pas de sexe, rien n’y fait... Staline, sur un lit de mort, me disant de Eden, Eden, Eden, que « c’est bien », mais qu’« ilfaut encore aller plus loin dans l’aveu », etc. Rien n’y fait. Rien n’y fait, et dans le rêve lui-même, vers sa. fin, je pense, et je vois, et je dis la fausseté de tout cela. Le pire, c’est sans doute les pages que j’y écris, ou que j’y frappe ; bien que, en état de veille, je lutte de toutes mes forces contre l’emprise de ces cinq ou six heures de dévoiements de l’histoire, d’écriture intraduisible dans le réel de veille.
Je sais que tôt ou tard, ces cinq ou six heures deviendront dix, douze, seize, dix-huit, vingt-quatre heures. Je me prépare chaque jour, chaque nuit, mais comment nommer en deux mots ce qui progressivement n’en fera plus qu’un seul à trouver, je me prépare, donc, non pas à la mort, mais à ce dernier quart d’heure de lucidité. Que progressivement des pronoms, je par exemple, des articles, des lettres même, disparaissent dans mes lettres ou mots fonctionnels humains, et ce après relecture de cela et qu’ils disparaissent dans ces écrits où consciemment je travaille à la fabrication d’une langue nouvelle, que donc dans l’une et l’autre activité, les substantifs, les termes forts se trouvent confrontés face à face, comme dans ces textes dadas sans le savoir que j’écrivais à quinze ou seize ans, peu après la découverte de la poésie, cela n’abolit pas n’amenuise pas pour autant les symptômes de la première activité. Voyelles muettes abolies, consonnes jusqu’à moi muettes renforcées, temps du verbe indistinct, fabrication de nouvelles diphtongues où sont privilégiées pour l’instant les toutes premières voyelles de l’alphabet. Tout cela qui est le symptôme inconscient ou conscient d’une disparition progressive de l’écriture sur la page, en même temps qu’une entreprise, une tentative de réalphabétisation de mon langage, est à faire rejoindre avec cette écriture nocturne, cette écriture écrite dans le rêve sur du feuillet de rêve dont progressivement je parviens à retenir au réveil quelques fragments sur lesquels je fais, à l’état de veille, des variations, au sens musical du terme. Le jour où, de ces fragments de rêve, je ne tirerai plus que quelques variations désarticulées, ou mieux encore peut-être, le jour ou la nuit où cette langue nouvelle de veille sera reconstituée dans son lexique intégral, dans sa syntaxe — à laquelle je n’ai pas encore touché, loin, de là —, le jour, donc, où cette langue sera restaurée en écriture noble dans le rêve, et que peut-être elle formera la totalité de ces rêves, et le rêve, c’est-à-dire la perte du contrôle de ma pensée, même si je dis plus haut que cette fausse écriture dans le rêve même, je sais et je dis qu’elle n’est pas de moi, ce rêve tenant mes os, 24 heures sur 24, ce jour-là, ou cette nuit-là, le tour sera joué. Alors seulement l’histoire ayant cessé de m’empoisonner la nuit et le jour, où sa fausseté de rêve se dépose en vérité sur la langue de mes figures esclaves, alors ces figures, ces bouches sans le contrôle de mon travail et de ma lutte humaine contre la folie, parleront cette langue dont je n’ai pas les moyens historiques, et seulement historiques, d’inventer la musique, et peut-être alors, à l’écoute de cette langue impossible, parfaite, incontrôlée par moi, me met trais-je alors à bander tout droit.
J’ai peur parce que juqu’à aujourd’hui mes écrits ne me font pas arrêter et jeter en prison. J’ai été jadis, mais pour des écrits politiques encore adolescents et autres faits de désertion et de rébellion, interrogé, soldat, en Algérie, et jeté par la Sécurité militaire, 3 mois, dans une cave par le soupirail de laquelle quelques fanatisés d’une unité où j’étais très aimé, s’arrangeaient, par force, pour me passer une nourriture empoisonnée et mêlée de pierres que je devais sous le canon de leurs M. A. T., ingurgiter, pour me criaient-ils, m’ôter à tout jamais l’envie d’écrire et de parler ... mais ma gorge et le reste avaient, dès l’extrême enfance, pris l’habitude de la mort-aux-rats, des cailloux et du reste. J’attends, pour moi, de la Révolution, qu’elle m’y remette. J’ai peur parce que je n’ai pas d’ennemi. J’ai peur parce qu’on me prend pour un semi-fou. Le fou n’a pas d’ennemi. Même les quelques amis psychiatres, psychanalystes auxquels je m’en remets au moment de trop fortes poussées sanguines dans les poumons, aux moments d’étouffement, de suffocation bien réelle, symptômes peut-être eux aussi de cette impossibilité à écrire, à moduler, à chanter cette musique que je veux, même ceux-là, tel est le prestige de l’écriture, me refusent comme patient ordinaire. Je leur ai demandé de m’interner. Surtout après chacun des engagements et traumatismes politiques de sang que j’ai pu subir. Mais aujourd’hui, où trouverait-on un psychiatre, un psychiatre « ordinaire », pour interner un écrivain de renom ? Un écrivain de renom ne peut pas être fou. Ainsi, privé du secours de la religion, dois-je creuser ma fosse hors de la terre analytique. Alors, au train où vont les choses en ce domaine, je ne serai bientôt plus qu’un extra-terrestre ! Peut-être alors devrais-je lire les philosophes ? Mais il faudrait alors qu’on me charcute d’autres yeux . Je n’ai pas lu plus de trois pages de Leibniz, de Hegel, de Sade, de Marx, d’Engels, de Freud, de Mao Tsé-toung, de Lacan. Pourquoi ? Parce que je ne les ai pas écrits. Sophocle, Daniel, Les Passions, Abou Nouwass, Hölderlin, Rimbaud, oui. La science ? Rien de rien. Mais plus tard ce sont les savants qui liront mes livres.
J’ai peur parce que je ne peux pas fréquenter les grands esprits, les grands acteurs, politiques et autres, de mon temps. Quelques-uns des premiers, et non des moindres, me reprochent, je cite, « de ne pas mener une vie sociale correspondant à mon niveau intellectuel ». Pourtant, je ne manque pas d’humour, ni même de drôlerie, dans le privé, — aussi bien qu’en rue, mais j’en parlerai plus tard. Mais je n’ai pas lu leurs livres. Moi, quand je rencontre quelqu’un que je ne connais pas, tout de suite : son état civil, son métier, sa pensée. Alors, pour les esprits, je connais leur métier, un peu leur état civil, mais pas leur pensée c’est-à-dire, leur pensée poétique. J’en ai fréquentés jadis, mais ils causaient toujours métier, et moi le métier ça m’intéresse chez les commis de bar par exemple, parce que, décider ou non de renseigner les flics, ça, ça fait penser. Et puis, ces esprits, ils me désirent trop, je dis : ils me désirent, sexuellement, trop. Raison de plus pour les fuir. Enfin délivrés par le Pouvoir, de cet alibi-carcan : l’étude des horribles Sade, Lautréamont Artaud, Bataille et autre Guyotat qui les empêchait de parler enfin d’amour, ils peuvent tourner la veste politique et resserrer le gilet psychanalytique. Toujours l’alibi, mais pour toujours plus de Pouvoir. Et puis ça, la partouze après la pensée, ça, non ! Cette sagesse bourgeoise : la séparation des devoirs, la division du travail, zut pour toujours ! La jouissance, la dépense, le désir, zéro ! Il n’y a pas de mots pour désigner la sexualité.
Ce qui m’attire d’une raie bien jeanssée c’est ce qu’elle a à déféquer de son propriétaire ou de son locataire-cerveau. Ce qui est beau dans la vraie drague c’est la pensée, c’est le rire, c’est par exemple de se retrouver enculé dans le garage d’une H. L. M. de La Courneuve, et de penser en même temps : « toi qui m’encules, tu seras dès cette nuit, nom, prénom, métier, vêtement, organe, dans mon... paradis ». La vraie drague contraint à toujours plus de poésie. On ne tient avec son partenaire quelques minutes de plus, qu’avec de la poésie, du rire qui lui arrache par saccades toujours plus d’inconnu. C’est, souvent, conjurer, en quelque sorte, le glaive, le couteau, l’opinel ou le rasoir avec toujours davantage de poésie. Et quand il y a eu ceci et cela plus quelques bleus, quelques tabas sages de sang, on se revoit toujours, à cause de la poésie, à cause de la pensée. Chez moi le mécanisme de la pensée, de la poésie est exclusivement déclenché par la sensation de l’esclavage. J’ai commencé ailleurs d’expliquer pourquoi. Que j’aie été à l’âge de sept ans, violé, véritablement violé, bouche, anus et tout le reste, par des garçons semi-esclaves, y est sans doute pour quelque chose. Peut-être me faisaient-ils par là payer le prix d’avoir été mis au monde par mon père. Et me suis-je senti alors l’otage, l’esclave, donc, de ce père. C’est mon père qui a découvert les traces de ce viol. Je n’en avais rien dit. Et c’est mon père qui le lendemain a réglé l’affaire avec les parents . Je n’ai jamais dénoncé qui que ce soit, sauf moi, et pas assez.
Le dernier homme de l’histoire humaine sera un esclave. Il n’y a pas de course aux armements, il n’y a qu’une course à l’esclave. Et c’est à qui, des politiques, en sera le der nier maître. Le sexe ne m’intéresse pas. Je suis un politique, je traque l’esclave absolu. Le dernier homme, le dernier esclave, mourra avec ma langue de fou dans sa gorge. La prostitution, libre ou non, consentante ou non, c’est pour moi toujours et encore de l’esclavage.
Ma folie, c’est cette tentative d’élaboration d’une langue, d’une musique, par laquelle ce dernier homme, ce dernier esclave, pourra dire à son maître, à son politique, qu’il a les moyens d’obtenir la propriété de son corps et de son organe, mais qu’il n’a pas ceux de se rendre propriétaire de sa pensée. La pensée, ça ne s’achète pas, ça ne se vend pas. Aucun maître ne peut être à la fois propriétaire d’un sexe et de la pensée de ce sexe.
C’est pourquoi j’ai de plus en plus de difficulté à vendre ma pensée. Donc, à la produire en clair. Je vends du corps, du sexe. Mais pourquoi ai-je supprimé, dans Tombeau pour cinq cent mille soldats, écrit entre 1963 et 1965, les morceaux très longs, où il n’était question que de prostitution privée, façon drugstore, façon Alain Delon ? Pour quoi ai-je très rapidement élargi mon commerce ? Parce que, me semble-t-il, cette relation, ce commerce, ce petit commerce, entre deux partenaires, m’apparaissait déjà, avant même, en 1963 à peu près, que ce rush théorico-désirant ne nous ait envahi, cette relation, donc, limitée, m’apparaissait comme la base sur laquelle allait se développer beaucoup plus tard, dix années plus tard, toute cette entreprise — dont je ne conteste pas l’efficacité politique immédiate, mais dont je doute qu’elle ait un avenir historique et philosophique — de théorisation de la relation matrimoniale, dans quelque sens que ce soit, et de cette matrimonialité dans le cadre de la folie — entreprise qui va de Psyc’ et Pol’ à Philippe Sollers, grand marieur à longueur de lignes de schizo avec parano, de parano avec hystéro, etc. Parce que donc, convaincu, avant même que cette entreprise ait eu lieu, qu’elle n’était valable qu’à très court terme, j’ai, moi, très délibérément, traité les corps en masse, pour faire sortir d’eux un maximum de nombres, de voix, nécessaires — nécessité d’écriture — pour obtenir, au prix d’un travail et de privations sexuelles limitées correspondant à ce temps de travail, une sorte de polyphonie, non pas composée des voix très largement aujourd’hui poussées, dévoilées, utilisées, de ce qu’on appelle la misère sexuelle, mais une polyphonie des voix de ces corps esclaves, de leurs propriétaires, de leurs pratiques. Une question se pose alors. Cette recherche d’une musique, d’une rythmique de prostitution aboutit à ceci, aujourd’hui : mes prostitués, mes marlous, et mes pratiques (clients), parlent la même langue, ce qui reviendrait à dire que cette langue élabore une réconciliation entre les exploitants, les exploités et les consommateurs. Dans Bond en avant, ce texte de théâtre [33] si décrié alors, placé sous silence par « Tel Quel » (on y parlait alors toutes dénégations dehors de « Bond en arrière »), dans ce texte, qui achève Prostitution, j’avais fait quelques tentatives de différenciation des discours, et cela allait jusqu’à, si je me souviens bien, des transformations de pronoms, « je » remplacé par « ej’ », pronoms ou adjectifs possessifs disparais sant du lexique des prostitués, etc.
Très peu doué pour ce genre de classification, et emporté par cette haine de la littérature, la seule sans doute qui me tienne, emporté par cette nécessité, cette folie, de faire à tout prix de l’écriture une musique, j’ai tranché dans l’écriture traditionnelle, dans celle surtout qui, à mon sens, est la plus belle, celle de l’âge dit pré-classique français, où l’on écrivait dans la même langue, et souvent avec une égale efficacité émotionnelle, à la fois des écrits dits de fiction, des lettres, des adresses, des suppliques, des sentences de mort pour sorcellerie ou sodomie, des commentaires de tragédie, et en même temps des traités de science et de technique. Cette superbe écriture, qui savait prendre ses distances avec son objet, ses objets, je lui tranche ses articulations, inutiles aujourd’hui, et je lui fais ingérer, rétrospectivement, tout ce que, pour des raisons politiques, religieuses, administratives, et autres, elle refoulait, à l’époque, de toutes les langues minoritaires du royaume, et rétrospectivement, je l’accentue avec les éléments phoniques de ce qu’il faut bien maintenant appeler un nouveau parler, celui de l’immigration en France. Le français enceint de la mère, de la sœur, de la femme absente que parlent les Kabyles, les Arabes, les Portugais. Ce parler français immigré est provisoire. Aussi je lui substitue progressivement le lexique et l’accentuation du parlé, qui ne l’est plus, de ma région natale, le franco provençal. Alors seulement, une fois tous ces parlers ces langues, comme je l’ai dit plus haut, sans rigueur —, s’amenuisant, se taisant, dans mon écrit, je pourrai enfin écrire ma propre langue, la langue de ma virginité sexuelle, maintenue telle pour en augmenter le prix de mon corps. Du sens passe dans cette musique, dans cette polyphonie , mais il n’est pas encore bien perçu.
Mais qu’est-ce qui peut faire percevoir le sens dans mes écrits ? Le désir ? Non. La jouissance ? Non. Je ne le sais pas. Mais, dans le meilleur des cas, la nouveauté rythmique, la nouveauté de l’accentuation, d’une ponctuation que je vais faire disparaître peu à peu, oblitère à mon avis ce sens. Un peu semble-t-il comme la censure gouvernementale de Eden, Eden, Eden, qui tient toujours, en a fait oublier, et en fait toujours oublier la force d’écriture. Ce sens est d’une richesse, d’une profusion, d’une ampleur humaine insoupçonnées, le cinéma même, avec ses systèmes de superposition, est très loin du compte. Tant qu’on s’obstinera à ne voir dans mes écrits que du sexe, la musique en restera muette. Et moi, tant que cet état durera, j’accélérerai le rythme de cette figuration et de cette musique. J’accélérerai le nombre des noms, la vitesse des figurations, en même temps que je réduirai leurs signes, leur lexique et leur syntaxe, autant dire que j’en ai jusque pour la fin de mes jours et bien après. Tout un roman de Sade prolétarisé , je le mettrai dans une seule mesure de Webern . Au total, aujourd’hui, cela donne quelque chose comme La chanson de Roland pris dans le réseau récituel des Mille et Une nuits.
Trop peu de temps, trop peu de temps..., et cette immensité de mon ignorance juridique, sexuelle, philosophique, analytique, scientifique, mathématique, acrobatique, face à cette immensité de la misère humaine, actuelle et ancienne... !, cette misère dont il faut que je fasse une Musique ... !,
et cette vitesse cellulaire de ma pensée, cette atrocité comparable à aucune autre. Toutes les souffrances se valent. Cette vitesse cellulaire de la pensée dont depuis l’enfance, l’extrême enfance, je suis contraint de chiffrer mentalement, ou par écrit, les phases.
Et si l’un des doubles, un des triples, un des sextuples, l’un des adjuvants de chacune de ces idées fortes, qui disparaît dans ce nombre, qui y est oubliée, si l’un de ses adjuvants, je le perds, si je perds le numéro trois, ou le numéro quinze, ou le numéro trente-six, toute ma vie organique, sociale, est bloquée pour plusieurs jours, et je traque ce chiffre qui recouvre le plus souvent un adjuvant technique, dérisoire. Je le piste, je recherche les conditions et les lieux où ce chiffre a été pensé. Je refais toute l’histoire de ma pensée. C’est ça ma lutte contre la folie, contre l’oppression.
Ce n’est pas, ce n’est pas l’écriture. C’est par la répression que je lutte contre l’oppression. La psychanalyse a inventé une police, une inquisition : l’auto-analyse. Il faut substituer à toute cette littérature de la névrose une littérature de la psychose. Il faut attendre beaucoup d’un très grand livre qui paraît en ce moment, Fascismass, de Stanislas Ivankow. Beaucoup, beaucoup d’Eugène Savitzkaya. Il faut attendre de Marc Dachy, au moins déjà quant à l’une de ses activités d’écriture : celle d’animateur-révélateur, à travers sa revue LUNA-PARK et sa petite boîte internationale TRANSEDITION, d’une partie de la fiction moderne.
Pour Marc Dachy : Luttes de classes (19 juin 1976)

J’attendais beaucoup de Lois de Philippe Sollers, malgré sa limitation démagogique de classe à un sabir superstructurel, conjoncturel, j’ai défendu ce livre par écrit, dans Le Monde, mais, après ce livre, Philippe Sollers a eu peur, c’est bien normal, et c’est bien dommage. Quant à moi, je ne suis pas unique, ni spécifique, ni ailleurs. Je suis seul. Je suis le seul de cette génération qu’on intègre ici ou là dans ces listes prestigieuses, mortuaires, des grands subversifs littéraires modernes. Je ne suis pas un subversif,— mais alors, qui l’est, ici, et ailleurs, aujourd’hui ? — je suis un musicien, je suis un alphabétiseur.
Remontons au jour. Vous avez devant vous mon corps, un corps diablement désiré mais plutôt comme corps eunuque, médium de conflits sexuels ordinaires.
Je n’ai commencé à pratiquer l’homosexualité qu’à l’âge de trente-deux ans et ce jamais chez les peuples du maghreb. J’ai alors, moi, pratiqué la prostitution. Jusqu’alors, j’avais ajourné ce passage à l’acte. Ajourné. Non pas refusé mais ajourné.
Parce que, depuis l’extrême enfance, c’était l’assassin que j’aimais, qui me faisait souffrir, parce que je voyais en lui celui qui pénétrait dans l’autre autrement que par son sexe.
Le premier assassin que j’ai vu, c’était une femme, avec son mâtru dans ses bras, qui attendait, avec l’arme de son crime dans sa main, un opinel. Cette femme attendait seule sur la grande place d’une bourgade de Haute-Loire. J’avais quatre ans. C’était une femme, elle avait tué son amant dans un cinéma. Le bruit du torrent qui passait sous elle couvrait son hurlement. Toute en noir. En deuil de son mari qu’elle avait empoisonné. Mon père coupait quelque part dans la montagne. Je suppliais ma mère qu’on laisse à cette femme son couteau...
Mon corps vivant in progress que vous avez à portée de main, dont je suis le premier à avoir exposé le nu photographique en complément d’un texte, bafoué « anonymement » par Tel Quel, et où je rendais compte d’un recollage siamois, et de l’injection pour la première fois (hiver 75-76) de drogues dures qui avait aussitôt suivi ce flash orphique : un môme international de dix-huit ans, la moitié de mon âge, un corps avec une pensée, désirant enfin mon corps avec ma pensée.
Mon corps, donc, je le ferai bientôt travailler nu sur scène ou devant la caméra. J’en ai, souvenez-vous, exhibé (à l’expiration d’un gavage matrimonial hétérosexuel : beaucoup de sucre et de sauce, contre beaucoup de mon sperme par écrit mais au théâtre, naguère, dans Bond en avant, les plaies, avec la férocité du mac, et l’entrain du présentateur-propriétaire des catcheurs à la Foire du Trône. Allez-y voir. C’est tout au fond de la foire. La tristesse du kabyle tout en blanc, le slip rouge bien rempli du nègre, le cabotinage du gitan velu adulte, les partenaires « spontanés », toujours les mêmes. L’esclavage est aux portes de Paris.
On ne chie bien que le chaud.
J’ai peur parce que les hallucinations diurnes et sans stupéfiants empirent. Je n’ai point terreur de mourir, mais de l’après-mort : aussi ai-je, autrefois, couché sur un testament, qui tient toujours, qu’on me jette en fosse commune d’une banlieue communiste ou j’ai manqué crever de trop bien manger, pour la première et la dernière fois de ma vie.
Quel corps me délivrera de ce devoir d’écrire..., de cela : qu’un tremblement de ma mère au pas de mon père rentrant avec ses doigts mal lavés d’un sang pris à d’autres corps ait fait bouger mon fœtus, que j’en sois né avec ce bégaiement qui m’a contraint de tout écrire dès la Maternelle, que de cette monstruosité infime je sois contraint de tirer et retirer cette énorme monstruosité de quelques milliers de pages ...
T... Ahmed, 19 ans, de Pigalle, qui voulait me forcer, en frère — j’en ai pissé du sang 15 jours durant — à macquer, avec toi, du mixte, sur la Côte, avec comme mise de fond, le produit de tes casses et de tes jeux en chambres mortelles, plus mes 10, 12 % de droits d’auteur, que tu aurais, clandestinement, fait monter à 20, 50, 85 %..., comme tu avais vu juste !
( A suivre.)
Pierre Guyotat, Minuit n° 23, mars 1977.
Propos recueillis par Dominique Savoye, Denis Jampen et Mathieu Lindon - Hiver 76-77.
Lire également : « La découverte de la logique » in Les cahiers du chemin, n° 29.
Ce texte sera repris dans le volume de Guyotat Vivre, l’un des tout premiers livres édités en 1984 dans la collection L’infini dirigée par Philippe Sollers.

Bond en avant de Pierre Guyotat, mise en scène Pierre Guyotat et Alain Ollivier
photo N. Treatt, La Rochelle, 1973. Zoom : cliquez sur l’image.

Sur Pierre Guyotat
PIERRE GUYOTAT,
52 MINUTES DANS LA LANGUE
Réalisateur : Ludwig Trovato.
Coproduction LA SEPT/ DOC REPORTERS en association avec FR3.
Vidéo, couleur, 52 mn, 1988
Depuis "Tombeau pour cinq cent mille soldats" (1967) jusqu’à "Bivouac", sa dernière oeuvre, Pierre Guyotat occupe dans le monde littéraire une place marginale et singulière. Si nombre de ses écrits ont provoqué un certain scandale, c’est que cet écrivain utilise une langue, une écriture inhabituelle. Pour la première fois, une caméra a pénétré dans l’univers intime de Guyotat, explorant son rapport à l’écriture et ses expériences sur le langage.

Pierre Guyotat est donc mort dans la nuit du 6 au 7 février dans des circonstances aussi soudaines qu’imprévues. Difficile de se résigner à la disparition de celui qui est, sans doute, un des plus grands artistes — il n’aimait pas, on le sait, le terme d’écrivain — des cinquante dernières années. Voici donc Pierre Guyotat vivant tel qu’il apparaît dans le film de Ludwig Trovato réalisé en 1988 et que je mets en ligne avec son amicale autorisation. Comme le dit Jacques Henric dans sa présentation du film, il est rare de voir un écrivain réellement au travail. A cet égard, la longue séquence où l’on voit Guyotat chercher et dicter ses mots à son assistante est merveilleuse : les plans sur l’écrivain, concentré, cherchant le rythme de la phrase, le poing serré, les mains tapant sur la table ou caressant un clavier invisible (« de la pensée accrochant la pensée et tirant », disait Rimbaud dans la Lettre du Voyant) sont parmi les plus beaux qui nous soient donnés à voir. Il fallait un véritable artiste du montage et du cadrage de l’image (et non un simple documentariste) comme Ludwig Trovato pour saisir de tels moments d’intensité et de grâce...


VOIR AUSSI : L’œuvre au vrai, selon Catherine Brun et Pierre Guyotat
Guyotat, l’inaccessible par Catherine Clément
[1] Lire notre dossier Pierre Guyotat, Arrière-fond.
[2] Pierre Guyotat quittera le P.C.F. suite à la création du Mouvement de juin 1971 par la minorité de Tel Quel. Dans un entretien de juin-juillet 1971 publié dans Littérature interdite (1972), il écrit : « Tel Quel doit être réaffirmé comme le seul lieu théorique où un pareil livre a été, et doit toujours être lu. Contre ce travail de Tel Quel (considérable en dix années seulement), contre cette échéance implacable de l’intelligence révolutionnaire, l’entreprise anti-théorie, anti-littérature, anti-science, des Lettres Françaises, dominée, de quelques "coudées" seulement, par les éditoriaux pompiers d’Aragon, ne vaut rien : elle apporte tout au plus un petit appoint d’eau croupie au "moulin" de la réaction. »
[3] Vous lirez ci-dessous l’article de Jérôme Lindon publié dans le journal Le Monde du 8-11-1970.

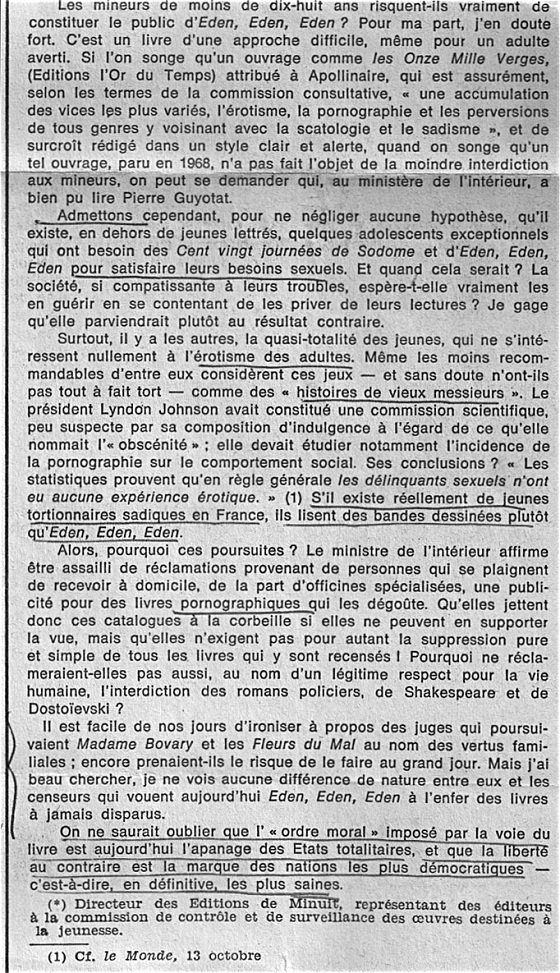
[4] A cet appel, souscriront des centaines de personnes dont notamment Pier Paolo Pasolini, Joseph Beuys, Pierre Dac, Jean Genet, Joseph Kessel, Maurice Blanchot, Max Ernst, Italo Calvino, Jacques Monod, etc.
[5] Cf. Alain Leduc, qui ajoute : « À la fin des années soixante-dix, alors qu’il s’était trouvé en phase au début de la décennie avec une création artistique fertilisée par une vague théorique et politique, Pierre Guyotat fait soudain figure de rescapé. Il y a pourtant eu Bond en avant (voir plus bas), une pièce à la représentation de laquelle dans les locaux de l’université, à Lille, en 1972, un « comité de professeurs » a opposé son veto. Étudiant à Lille, à l’époque, l’auteur de ces lignes aura eu, hélas !, la douleur d’assister à cet humiliant acte de censure. »
Lillois moi-même à l’époque, je n’ai pas eu le loisir de prendre part à ce "débat", le Ministère de la Défense m’ayant affecté à 750 kms pour effectuer mon service militaire ! Par contre, j’avais pu, un an plus tôt, me brouiller définitivement avec certains rédacteurs de La Nouvelle Critique (Joseph Venturini, auteur d’un article calamiteux sur EEE). Après le colloque organisé par cette revue en avril 1970 (Littérature et idéologies) où Tel Quel avait été pris à parti de manière obscurantiste, la coupe était pleine. A.G.
[6] Maurice Blanchot, L’amitié, Gallimard, octobre 1971, note de l’article Les grands réducteurs, p. 79.
[7] On lit dans Le Monde du 6 juin 1972 :
P. GUYOTAT ET LA CENSURE
« A la suite de la publication dans " le Monde des livres " du Monde du 3 mars 1972, page 13) d’une critique de son livre Littérature interdite (Gallimard), critique présentée sur trois colonnes et occupant environ cent vingt lignes, Pierre Guyotat nous a adressé une lettre dont voici l’essentiel :
1) Actuellement, printemps 1972 en France, la quasi-totalité des "responsables" de cette grande presse dite "libérale", "de gauche", peut donc décider de faire le silence autour de la parution d’un livre titré Littérature interdite, qui rassemble des textes et des documents relatifs non seulement à l’une des interdictions qui ont marqué l’année 1970 (interdiction maintenue à ce jour avec taxation supplémentaire du prix de vente de l’exemplaire, etc.), mais aussi et surtout à ce qui, profondément, motive l’interdiction de livres tels qu’Eden, Eden, Eden : la liaison, à renforcer, entre le sexe et le politique ; la netteté de mes déclarations sur ce sujet, dont je pressens qu’il trouvera un jour sa scène historique, me vaut systématiquement de ne point les voir reproduites dans les organes de grande presse qui, rarement il est vrai, acceptent de me "donner la parole".
Je vis ce rapport sexe-politique avec trop d’intensité pour que l’on obtienne de moi que j’en taise ou réduise la "voix". Ou que j’en fasse éclater le noyau dialectique.
Silence donc sur le travail d’élucidation d’un fait "politique" : la censure d’un travail de recherche par l’appareil répressif de l’État bourgeois ; et ce en un moment où cet État renforce sa répression sur tous les fronts (usines, logements, prisons, Université, art, corps immigrés, corps sexuels).
2) Cette censure redoublée permet, encourage, des agressions du type de celle dont j’ai été l’"objet" au soir du 26 avril dernier, à l’occasion d’un entretien-débat organisé par la Maison de la culture de Rennes, et dont rend compte le quotidien Ouest-France du 27 mai sous le titre : "Pierre Guyotat n’a pu parler de Littérature interdite... la censure était dans la salle."
3) Mais en retour cette censure redoublée renforce ce qui la produit : la révolte. C’est dire qu’au lieu de la peur, de la soumission escomptée par tous nos actuels fonctionnaires idéologiques (Juquin et Leroy en tête), c’est l’organisation patiente de la riposte qui se prépare dans mes textes et dans d’autres. Au lieu de la division, l’union : je suis, quant à moi, solidaire de l’actuel Tel Quel et, plus récemment, du travail monumental de Sollers dans Lois.
Solidaire de tout mouvement s’opposant à l’envahissement réitéré de l’obscurantisme en même temps qu’à la montée du social-fascisme. »
Voir aussi, bien sûr, Histoire de Tel Quel de Ph. Forest, Seuil, 1995, p. 371-377. On notera cependant que Ph. Forest qui a eu de nombreux entretiens avec les divers acteurs de cette époque et qui a eu accès à leurs archives privées, ne semble pas avoir rencontré Pierre Guyotat.
[8] Vous pouvez lire le texte de Guyotat dans le volume Bataille.
[9] Pourtant Sollers était présent car on lit dans Le Monde du 14 avril :
« Bond en avant a provoqué, à La Rochelle, une réaction collective intéressante. Le public, invité à se placer dans l’aire de jeu, autour d’une estrade où étaient assis, devant un pupitre, l’auteur et un comédien, se leva après quelques minutes et se divisa en petits groupes ; des conversations particulières se substituèrent au spectacle. Après l’énoncé de quelques données — hommes nus, viandes, langage inconnu... — vint le commentaire immédiat, le plaisir de prendre la parole pour son propre compte. Philippe Sollers décryptait les messages à qui voulait l’entendre, de jeunes penseurs affranchis bouillonnaient devant l’indifférence générale, et de vieux habitants de La Rochelle jetaient des regards de visiteurs de zoo. Il n’y avait d’ailleurs rien à voir ; le texte n’est pas approprié à une mise en scène éclatée qui détruit presque totalement ses qualités rythmiques et musicales. »
[10] Dans Cassette 33 longue durée (lire plus bas) et qui sera repris dans le volume Vivre, l’un des tout premiers livres édités en 1984 dans la collection L’infini dirigée par Ph. Sollers (Denoël), Guyotat évoque la figure de Sollers en « grand marieur à longueur de de lignes de schizo avec parano, de parano avec hystéro, etc. », parle de « Bond en avant, ce texte de théâtre si décrié alors, placé sous silence par Tel Quel (on y parlait alors toutes dénégations dehors de "Bond en arrière") [...] », de son « corps vivant in progress [...] dont [il est] le premier à avoir exposé le nu photographique en complément d’un texte bafoué "anonymement" par Tel Quel » (On pouvait effectivement lire dans une Note du n° 66 de Tel Quel (p. 104) cette phrase : « Bien décevante, les réponses à l’enquête d’Art-Press sur la pornographie. Cooper est contre toute libéralisation, Guattari est angoissé, Pingaud est moral. On attendait Guyotat : la photo du bas de son corps est là, en effet,. Mais pourquoi affaiblir ce document par un texte aussi faible, aussi ampoulé, précieux. « Le gel rive à l’osier le squelette successif de mes positions de classe... » « Qu’ils retournent cette fois le marteau dans la conque ! » Saint-John Perse portait une perruque. Guyotat ose montrer son sexe. Bien. Mais seul l’écrit peut dire qui est nu »). Enfin Guyotat écrit : « J’attendais beaucoup de Lois de Philippe Sollers, malgré sa limite démagogique de classe à un sabir superstructurel, conjoncturel, j’ai défendu ce livre par écrit, dans Le Monde, mais, après ce livre, Philippe Sollers a eu peur, c’est bien normal, et c’est bien dommage. »
[11] On trouvera un exemple des réactions suscitées dans l’article de Piotr Rawicz publié dans Le Monde du 3 octobre 1970 et qui porte sur les préfaces à Eden, Eden, Eden rédigées par Michel Leiris, Ph. Sollers et Roland Barthes :
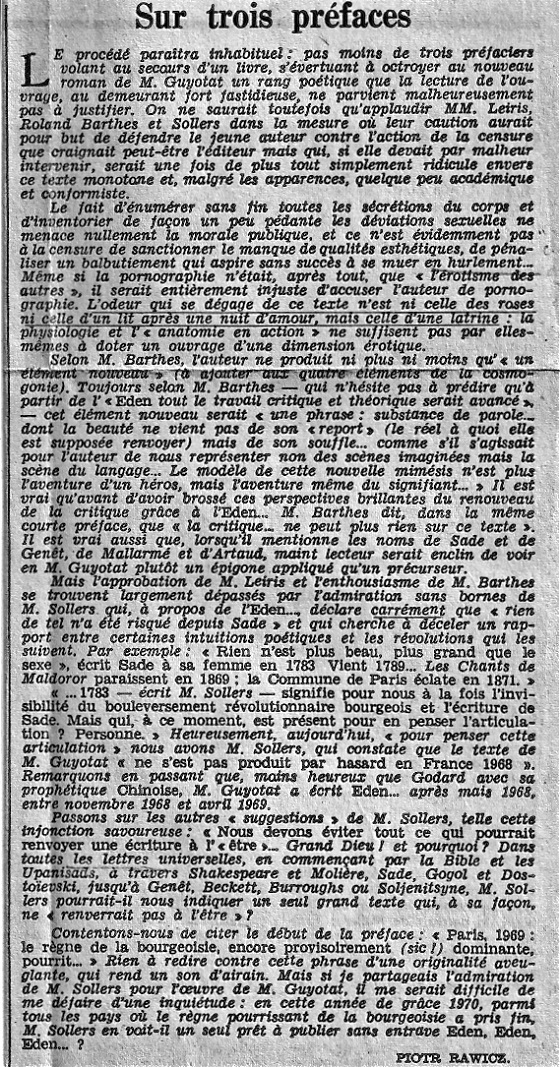
[12] Ce texte, sauf erreur, n’a jamais été repris par Philippe Sollers dans ses nombreux recueils d’essais.
[13] Du 18 au 22 janvier 2009, Alain Veinstein a consacré une série d’émissions à Michel Leiris sur France Culture, P. Guyotat était l’invité de la dernière émission.
[14] Cf. Portraits de Michel Leiris.
[15] Et non pas " Tombeau pour cinq cent mille dollars " (Quinzaine littéraire, 1et au 15 octobre 1970...).
[16] S’opposant de façon ultra-réactionnaire à ce travail urgent et réellement critique, le pire appel à l’obscurantisme de la répression gaulliste-centriste n’est pas venu par hasard des Lettres françaises — organe qui rejette « Dialectique de la nature » comme "inachevé", "dangereux" et « Matérialisme et Empiriocriticisme » comme polémique vieillotte — dans son style Bouret (cf. Lettres françaises du 21 octobre 1970)
[17] Journaliste à L’Humanité. A.G.
[18] Voir plus haut P. Guyotat, Réponses.
[19] Aragon est alors le directeur « prestigieux » des Lettres Françaises. A.G.
On trouve dans le n° 44 de Tel Quel (hiver 1971) cette note :
« A la suite d’une lettre de M. Bouret, publiée par la Quinzaine littéraire, où celui-ci reproche à Philippe Sollers qualifié de "stalinien", de l’avoir traité "d’aliéné mental", Philippe Sollers a adressé la lettre suivante à la Quinzaine :
« Je n’ai jamais traité M. Bouret "d’aliéné mental" mais tout au contraire d’aliéniste en le comparant au professeur Claude, de Saint-Anne, dont André Breton a fait figurer la photographie dans Nadja.
Quoi de plus révélateur, en effet, que la position prise par M. Bouret dans les Lettres françaises. AVANT l’interdiction frappant Eden Eden, Eden : Guyotat s’y voyait déjà traité de "maniaque délirant" et "d’obsédé sexuel".
M. Bouret croit naïvement qu’en agitant le spectre commode de Staline dont il sait bien, pourtant, qu’il se trouve plus près de lui que de moi —, il parviendra à effacer son ouverte complicité objective avec le ministère de l’Intérieur. Sa dérobade le contraint à quelques fantasmes : me prêter (par pulsion inconsciente, sans doute) un "passé trop suave de minet (sic) provincial" et (certainement par peur de n’être plus représenté aux cocktails de l’Elysée) un avenir de président de la République.
Nul n’ignore en effet l’imminence de mon "arrivée au pouvoir". Mais soyons sérieux : l’ennui est que, sous la couverture du dogmatisme à l’envers dont le trait liquidateur caractéristique est de se convulser dès qu’il entend parler de marxisme, M. Bouret exerce un pouvoir, dérisoire, certes, fondé sur des croûtes de peinture, mais réel. Ce n’est pas la moindre contradiction d’une époque où, malgré toutes les intimidations d’où qu’elles viennent, la lumière sur certains trafics finira bien par se dégager. »
Philippe Sollers. »
[20] Le texte de Sollers est strictement contemporain de sa réflexion sur le matérialisme philosophique, "sur la contradiction", la psychanalyse et leurs effets et interactions sur les pratiques de langage. A.G.
[21] « La loi et le désir refoulé sont une seule et même chose. C’est même ce que Freud a découvert » (Lacan). A propos de l’interdiction de Eden, Eden, Eden — qui devrait entraîner, en toute logique, celle des Cinqs psychanalyses de Freud, cf. Jérôme Lindon, L’érotisme et la Protection de la jeunesse (« Le Monde », 8-9 nov. 1970) ; Christine Glucksmann, Littérature et répression (« L’Humanité », 19 nov. 1970) et La Littérature interdite (« Tel Quel », 45).
[22] « Le pénis, à la différence du sein, offre une source intarissable d’immenses satisfactions orales » (M. KLEIN). D’où : « le prototype normal du fétiche, c’est le pénis de l’homme » (FREUD).
[23] « Pour l’inconscient, rien n’est plus distant ni plus insondable que l’intérieur du corps de la mère et, plus encore, l’intérieur de son propre corps » (M. KLEIN).
[24] FREUD : « Les pulsions érotiques tendent à agglomérer toujours plus de substance vivante afin d’en faire de plus grandes unités, les pulsions de mort s’opposent à cette tendance et ramènent la matière vivante à l’état inorganique. »
[25] Pour MÉLANIE KLEIN, le clitoris est le pénis sur la voie du refoulement du vagin (et de l’intérieur du corps) : « La fille croit que le clitoris est la cicatrice ou la plaie laissée par la castration. »
[26] « Il faut recommander instamment l’étude du fétichisme à ceux qui doutent encore de l’existence du complexe de castration ou qui peuvent penser que l’effroi devant l’organe génital de la femme a une autre base : qu’il dérive, par exemple, du souvenir hypothétique du traumatisme de la naissance » (FREUD, Le fétichisme, 1927). Cf. « Nouvelle Revue de psychanalyse », n° 2, automne 1970 : Objets du fétichisme, articles de ROSOLATO, ROBERT C. BAK, MMASUD R. KHAN. Dans ce même numéro, traduction du texte de FREUD : Le clivage du sujet dans les processus de défense (1938).
[27] Cf. IVAN FONAGY, Les bases pulsionnelles de la phonation, « Revue française de psychanalyse », janvier 1970, et ROMAN JAKOBSON, Langage enfantin et aphasie, éd, de Minuit, 1969.
[28] « Les pictographies employées pour faciliter la récitation de textes religieux ou magiques consistent en une succession d’images se rapportant chacune à l’élément saillant d’une phrase ou d’une strophe. d’où le nom « d’écriture de phrase » (Satzenschrift) qui leur est donne » (A. MÉTRAUX).
[29] Cf. FERENCZI, Mots obscènes (Contribution à la psychologie de la période de latence), 1911. La matrice d’EEE est d’ailleurs un texte inédit d’apostrophe argotique. L’autre main branle, écrit ouvertement pendant des séances de masturbation, mêlant sperme et encre dans ce qu’on pourrait appeler un agrandissement décalé de la captation des voix parentales (conçues comme homosexuelles) au cours de la transaction primitive d’échauffement. « On peut considérer la copulation par derrière comme la forme la plus ancienne au point oe vue phylogénique. » (FREUD, L’homme aux loups.)
[30] FREUD, Le fétichisme, 1927.
[31] Trombe : météore consistant en une colonne d’eau conique enlevée par des tourbillons de vent tournant sur elle-même avec une très grande vitesse et produisant les plus grands ravages ; il y a des trombes de terre et de mer — trombes ascendantes et descendantes —, on a dit aussi : trompe.
Trompe : « L’éléphant se sert de sa trompe comme d’une main. De tous les instruments dont la nature a si libé-ralement muni ses productions chéries, la trompe est peut-être le plus complet et le plus admirable ; c’est non seulement un instrument organique mais un double sens » (BUFFON).
— Suçoir charnu, rétractile et protractile de certains insectes diptères (moustique).
— Espèce de coquille de mer en spirale.
— Canal en partie osseux, en partie fibro-cartilagineux, dont une des extrémités se prolonge jusque dans la cavité du tympan, et dont l’autre, plus évasée, s’ouvre à la partie supérieure du pharynx.
— Deux conduits qui naissent chacun de l’un des angles sup-rieurs de la matrice et se portent à l’ovaire correspondant.
[32] Comme le précédent, ce texte, sauf erreur, n’a jamais été réédité par Philippe Sollers.
[33] Textes, photos in « Travail théâtral », n° 12.






 Version imprimable
Version imprimable
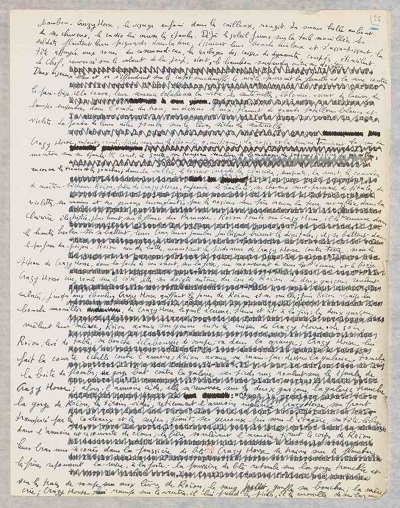



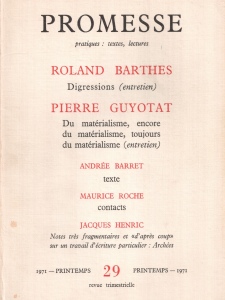





 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



5 Messages
Lecture intégrale en direct de "Eden, Eden, Eden" de Pierre Guyotat à l’occasion du 50ème anniversaire de sa parution au début de cet article.
Demain 9 septembre, 50 ans après sa parution, cinquante lieux de par le monde proposeront cinquante lectures de cette œuvre majeure qu’est « Éden, Éden, Éden ». Une manifestation organisée par l’association Pierre Guyotat, voulue par l’auteur disparu le 7 février dernier.
[...] Pour ce qui est de la France une dizaine de lectures sont prévues. Attention : certaines ne seront pas publiques mais retransmises sur YouTube via le site des établissements. Liste non exhaustive ci-dessous.
Paris, librairie Les Cahiers de Colette live sur YouTube de 15h à 2h du matin se succèderont pour lire Éden, Éden, Éden : Adonis, Marianne Alphant, Colette Fellous, Maël Renouard, Claire Amchin Ollivier, Jean Marc Levent, Niranjani Iyer, Bernard Cerquiglini, Marie Gil, Colette Kerber, Hubert Blanc, Catherine Brun, Anaël Pigeat, Diana Widmaier Picasso, Guilaume Fau, Abd Al Malik, Sofia Falkovitch, Jack Lang, Albert Dichy, Catherine Malabou, Jean Jacques Aillagon, Jacques Henric, Laure Adler, Bernard Blistène, Patrick Bouchain, Aurélien Recoing, Philippe Roger, Antoine Compagnon, Claude Arnaud, Devika Singh, Florence de Comarmond, Gisèle Sapiro, Bernard Comment, Patrick Boucheron, Bernardo Montet, Michaël Fouilleroux, Eric Rondepierre, Thierry Thieu Niang et Anne Alvaro, Emmanuel Pierrat, Ruth Mackenzie, Martine d’Anglejan Chatillon, Alexandra Bordes, Florent Guyotat, Sarah Hamza Reguig, Andrea Aversa, Audrey Leclerc, Christoph Wiesner, Peter Behrman de Sinéty, Nicolas Jalageas et Donatien Grau ;
Toulouse, Librairie Ombres Blanches, lecture par Jacques Bonnafé à 21h ;
Marseille, Vieille Charité, lecture par Pierre Chopinaud à 19h30 ;
Strasbourg, TNS, lecture par Stanislas Nordey ;
Avignon, lecture par Olivier Py ;
Vitry-sur-Seine, MAC VAL, lecture par Abd Al Malik ;
MC93 Bobigny, danse et lecture par Thierry Thieu Niang et Anne Alvaro ;
mais aussi des lectures sont annoncées au Centre Pompidou Metz, à la libraire Mollat à Bordeaux , etc.
Merci à Jean-Pierre Thibaudat.
Pierre Guyotat et la censure
par Emmanuel Pierrat
C’est toujours une joie de recevoir de la part de l’immense Pierre Guyotat ses Divers - Textes, interventions, entretiens 1984-2019 (Belles Lettres) et une marque de son amitié.
Pierre Guyotat y signe un texte intitulé « Courbet au rayon X : contre la loi de censure », paru originellement dans Libération en 1994. Il y défendait Jacques Henric, dont le livre Adorations perpétuelles (Le Seuil) reproduisait en couverture L’Origine du monde, le si célèbre tableau de Courbet, ce qui avait poussé la police, sur intervention de maires désœuvrés et illettrés, à faire retirer l’ouvrage des vitrines de plusieurs librairies françaises.
Pierre Guyotat en parle, hélas, en spécialiste. Il faut encore et toujours redire que, publié en 1970 chez Gallimard et préfacé par Roland Barthes, Philippe Sollers et Michel Leiris, son Éden, Éden, Éden est aussitôt interdit. Raymond Marcellin, ministre de l’Intérieur en prohibe l’affichage, la vente aux mineurs et la publicité. Ni la pétition signée des noms de Maurice Blanchot, Sartre, Genet, Simone de Beauvoir, Pasolini, Pierre Boulez…, ni l’intervention de François Mitterrand devant l’Assemblée, ni l’instruction écrite de Georges Pompidou, alors président de la république, à son ministre de l’Intérieur, ne font revenir celui-ci sur sa décision.
Sorti en 1970, mais écrit dans le contexte de la guerre d’Algérie, le texte de Pierre Guyotat revendique une démarche subversive qui lui vaut d’être condamné pour outrage aux bonnes mœurs. Dans Éden, Éden, Éden, il y a le désert, un bordel de femmes, un autre de garçons, des morts et des vivants violés, des incestes, des larmes, des hommes qui se masturbent…
Trois ans plus tôt était paru Tombeau pour cinq cent mille soldats. Lui aussi prenait pour cadre la guerre d’Algérie, mêlant relations homosexuelles et combats. Le général Massu, commandant en chef des forces françaises en Allemagne, fit interdire le livre dans les casernes qu’il avait sous ses ordres. La censure frappant Éden, Éden, Éden ne sera levée qu’en novembre 1981.
Et, au cours des années 1990, la radio F.G. est condamnée pour avoir diffusé - un dimanche matin ! – un extrait du Tombeau…
La vigilance de Pierre Guyotat est donc justifiée et ses Divers ont, entre autres, le mérite de le rappeler.
Emmanuel Pierrat, Livres Hebdo, 25-10-19.
Divers est un choix de textes, d’entretiens et d’interventions parus dans la presse imprimée de 1984 à 2019.
On peut le lire comme la suite et le complément de Littérature interdite (1972), de Vivre (1984), d’Explications (2000), et d’Humains par hasard (2016).
Les Belles Lettres
Une analyse critique de Michaël Ferrier, utile complément à ce dossier.
« En 1975, les éditions Gallimard publient Prostitution, un texte de Pierre Guyotat si troublant que l’éditeur prend la précaution de l’accompagner d’une mise en garde (p. 365) : « Le vrai problème que ce texte à proprement parler inqualifiable pose jusqu’au malaise est celui de sa lecture. » Dès la première phrase de cet avertissement, insolite autant qu’embarrassé, tout est dit, de l’énorme bouleversement que, cinq ans après Éden Éden Éden, vient à nouveau de provoquer Pierre Guyotat. »
LIRE : « La prose à vif : sur Pierre Guyotat, Prostitution et Littérature interdite »
L’hommage et les dédicaces de Pierre Guyotat à Michel Leiris lors du combat contre l’interdiction d’Eden, Eden, Eden. Voir ici.