Sommaire :
Tchouang-tseu| Le TAO| Le saint
Jean-François Billeter| Philippe Sollers, L’évidence chinoise
Autour de Tchouang-tseu (publications, sites)
(Jean-François Billeter, Jean Levi, Rémi Mathieu, Soun-Gui Kim, Cyrille Javary)

« Lorsque l’oreille écoute clairement et que l’oeil regarde de façon pénétrante, cela s’appelle l’"illumination". »
Huainan zi, Chapitre VII, Des esprits essentiels.
« Trouver une langue ; — Du reste, toute parole étant idée, le temps d’un langage universel viendra ! »
« Cette langue sera de l’âme pour l’âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d’inconnu s’éveillant en son temps, dans l’âme universelle : il donnerait plus que la formule de sa pensée, que l’annotation de sa marche au Progrès ! Énormité devenant norme absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès ! »
Rimbaud, Lettre à Demeny, 15 mai 1971.
« Illuminations. A travers les textes sacrés. », le livre que Philippe Sollers publie en 2003, est explicitement écrit « en hommage à Rimbaud », « le plus grand poète de tous les temps ». Seul, « David... Le plus grand poète de tous les siècles... », « jamais cité comme tel », David, « pour les Juifs un roi divin », avait, dans Femmes (1983), fait l’objet d’une telle appréciation (« creusez le mot appréciation »), c’est dire... l’importance historiale pour Sollers du poète d’« Une saison en enfer » et des « Illuminations ».
Dans les premières pages de son essai Sollers rappelle les « dévotions » dont Rimbaud a fait l’objet : « Shakespeare enfant » (Hugo), « passant considérable », « démon adolescent » , « anarchiste par l’esprit » (Mallarmé), « ange en exil » (Verlaine), « mystique à l’état sauvage » (Claudel), « véritable dieu de la puberté » (Breton). Il rappelle les termes par lesquels Rimbaud s’est lui même défini : un « inventeur », un « musicien même », un « fils du soleil », un « voleur de feu », un « enfant gêneur », un « grand malade », « un opéra fabuleux », un « barbare », un « nègre », une « bête », un « sans coeur » — ni « mage », ni « ange » —, un « paysan »...
On n’a pas suffisamment remarqué, il me semble, que cette énumération — « ce splendide costume d’arlequin » — se termine par cette « question paradoxale : en quoi Rimbaud figure-t-il la sainteté à venir ? » et surtout par « une autre hypothèse, plus radicale, qui consisterait à redéfinir, rétrospectivement, la notion de sainteté à partir de lui ? Car, qu’est-ce qu’un saint, sinon un homme qui sanctifie la vie ? » (p.25).
Illuminations, comme tous les livres de Sollers, est une composition. Il faut le lire et l’entendre comme tel. Ce n’est pas un hasard si le livre se termine par un hommage à Henry Purcell, Alfred Deller et Shakespeare et si la dernière phrase est, à nouveau, de Rimbaud : « la main d’un maître anime le clavecin des prés. » (Soir historique)
Il y a au beau milieu du livre huit photographies. Six d’entre elles sont, successivement, des portraits de Nietzsche, de Lautréamont, de Rimbaud, d’Alfred Deller, de Hölderlin et de Heidegger.
Nietzsche, Rimbaud, Hölderlin, Heidegger sont les « quatre cavaliers », « essentiels à toute tentative de discernement », pour comprendre « l’énorme archive qui parle de Dieu, des dieux, du divin, de sa révélation ou de son style dans toutes les langues » (je souligne). Il s’agit grâce à leurs « visions qui fécondent et foudroient » d’accéder « par paliers successifs aux Textes anciens ».
Sur les photos, nos « quatre cavaliers » sont jeunes, élégants.
La « légende », à chaque fois, est une citation :
« Un jour, ce qu’il y a au monde de plus silencieux et de plus léger est venu à moi. » Nietzsche.
« Je ne connais pas d’autre grâce que celle d’être né. Un esprit impartial la trouve complète. » Lautréamont.
« Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m’ont précédé : un musicien même, qui ai trouvé quelque chose comme la clef de l’amour. » Rimbaud.
« Avec Alfred Deller, c’était comme si les siècles remontaient leurs cours... » (Sollers)
« Tout proche
Et difficile à saisir, le dieu !
Mais aux lieux du péril croît
Aussi ce qui sauve. » Hölderlin.« Non pas le besoin d’une époque, non pas le besoin d’un siècle, mais le besoin de deux millénaires. » Heidegger.
Suivent, logiquement — les siècles remontent leurs cours, la Grèce et la Chine anciennes sont invitées à "dialoguer" — deux autres photographies :
— un Dioscure (fils de Zeus) à côté d’une jument. Citation : « Les cavales qui m’emportent m’ont entraîné aussi loin que mon coeur en formait le désir. » Parménide.
— un Paysage de montagne, Le mont Jingting en automne (1671) de Shitao [1] avec cette citation (qui semble répondre à celle de Nietzsche : « Un jour, ce qu’il y a au monde de plus silencieux et de plus léger est venu à moi. ») :

Pourquoi Tchouang-tseu [2] ? Sollers donne la clé vers la fin du livre : pour comprendre (« littéralement et dans tous les sens » : saisir le sens, admettre et prendre avec soi) ce qui « travaille » depuis toujours l’histoire de l’Occident — des « vieux » Grecs à Rimbaud et à Nietzsche — et qui se donne parfois comme « illuminations », « pensées », « poésies », il est nécessaire de se déprendre de sa métaphysique, il faut faire appel à un certain dehors :
« Toutes les illuminations occidentales que nous avons convoquées sont rendues à la fois plus nécessaires et plus compréhensibles si, nous déprenant de la métaphysique, nous les entendons depuis une enveloppe chinoise. Après avoir été longtemps refoulée, cette approche sera évidente demain. Ouvrons Tchouang-tseu qui, avec Lao-tseu et Li-tseu, est le plus grand penseur de la Chine antique. Quoique né apparemment autour de 300 avant notre ère, il s’approche sans nulle déperdition d’énergie et de vérité de nous, "debout, comme dit Rimbaud, dans la rage et les ennuis." »
Tchouang-tseu « s’approche de nous » doit s’entendre comme Hölderlin s’approche de nous dans « Approche de Hölderlin » (selon la traduction judicieuse qu’on a faite en français du recueil de conférences de Heidegger). Ce qui suppose aussi qu’on ne se méprenne pas sur ce qui, du dedans de l’histoire occidentale — mais comme en marge, à l’écart, dans son « pli », ses « exceptions » — permet de se rendre disponible à cette approche : une certaine expérience poétique. Heidegger écrivait déjà dans Etre et temps (dès 1927) :
« La communication des possibilités existentiales de la disponibilité, c’est-à-dire de la découverte de l’existence, peut être la fin que se fixe la parole qui "parle en poèmes". »
Ce qu’indique clairement Sollers quand il convoque Tchouang-tseu à travers Rimbaud et son Génie :
« il s’approche sans nulle déperdition d’énergie et de vérité de nous, "debout, comme dit Rimbaud, dans la rage et les ennuis". » [3]
Tchouang-tseu « s’approche de nous » et, avec lui, le TAO :
« Qu’est-ce que le Tao, c’est-à-dire la Voie ? La Voie vraiment Voie, nous dit le Tao-tö-king, est "autre qu’une voie constante. Les termes, vraiment termes, sont autres que des termes constants" ».

- Paysage de montagne (Musée Guimet)
« Aucune prise n’est possible sur le Tao. Il est changeant et immuable au même moment. A preuve ce que déclare Tchouang-tseu :
« Les cas de l’affirmation sont une infinité ; les cas de la négation également. Ainsi il est dit : le mieux est d’avoir recours à l’illumination. »
Autre citation :
« Accomplir sans savoir pourquoi, voilà le Tao. »
Vous voyez à quel point ce « sans savoir pourquoi », comme la rose est sans pourquoi [4], choque d’emblée notre passion inquisitoriale, notre volonté de puissance fondée sur le calcul général et la mise en sûreté ou en sécurité de tout. »
Ensuite Tchouang-tseu définit « le saint » :
« Il dose l’affirmation et la négation en se reposant sur le cours du ciel. Cela s’appelle une solidité ambivalente. » [...]
« Comment apprend-on le Tao ?
« Je l’ai appris du fils de l’écriture ; celui-ci du petit-fils de la lecture ; celui-ci de l’illumination ; celle-ci de l’attention soutenue ; celle-ci du travail pénible ; celui-ci du chant ; celui-ci de l’obscurité profonde ; celle-ci du vide suprême ; celui-ci du commencement. »
Que produit sa pratique ?
« Il voit l’obscurité et entend le silence. Lui seul perçoit la lumière derrière l’obscurité ; lui seul perçoit l’harmonie derrière le silence.
Il approfondit sa vision et spiritualise son audition afin de pouvoir pénétrer la création de l’existence et de l’essence. Dans son commerce avec les êtres, il s’établit dans le néant originel et il pourvoit aux besoins de tous. Il sait s’adapter à toutes les circonstances : grand ou petit, long ou court, lointain ou proche. » [...] (Folio, p.188-191)
Puis Sollers revient sur la question de la sainteté dont la définition « chinoise » est, elle aussi, « paradoxale » :
« Conclusion à propos du saint chinois :
« Il s’exprime dans des discours extravagants, dans des paroles inédites, dans des expressions sans queue ni tête, parfois trop libres, mais sans partialité, car sa doctrine ne vise pas à traduire des points de vue particuliers. Il juge le monde trop boueux pour être exprimé dans des propos sérieux. C’est pourquoi il estime que les paroles de circonstance sont prolixes, que les paroles de poids ont leur vérité, mais que seules les paroles révélatrices possèdent un pouvoir évocateur dont la portée est illimitée. Ses écrits, bien que pleins de magnificience, ne choquent personne, parce qu’ils ne mutilent pas la réalité complexe. Ses propos bien qu’inégaux renferment des merveilles et des paradoxes dignes de considération. Il possède une telle plénitude intérieure qu’il n’en peut venir à bout. En haut, il est le compagnon du créateur ; en bas, il est l’ami de ceux qui ont transcendé la mort et la vie, la fin et le commencement. La source de sa doctrine est ample, ouverte, profonde et jaillissante ; sa doctrine vise à s’harmoniser avec le principe et à s’élever à lui. Et pourtant, en répondant à l’évolution du monde et en expliquant les choses, il offre une somme inexprimable de raisons qui viennent sans rien omettre, mystérieuses, obscures et dont personne ne peut sonder le fond. » » (p.195) [5]
Jean François Billeter, sinologue genevois, est l’auteur de plusieurs livres importants sur Tchouang-tseu : Leçons sur Tchouang-tseu et Etudes sur Tchouang-tseu (Allia, 2002 et 2004).
Oublions un instant le mauvais pamphlet écrit en 2006 Contre François Jullien [6].
La polémique ne doit pas empêcher de lire les livres de Billeter, précieux et nécessaires (comme ceux de Jullien ou de Levi) pour qui veut comprendre l’importance de la Chine et de la pensée chinoise d’hier pour relancer la pensée européenne aujourd’hui ou mieux, selon les mots de Rimbaud dans sa Lettre du voyant, l’idée — « toute parole étant idée » — d’une « langue » de « l’âme pour l’âme », « de la pensée accrochant la pensée et tirant ».
L’art chinois de l’écriture (Skira, Genève 1989) est admirable, les Leçons et les Etudes sur Tchouang-tseu sont passionnantes [7].
Sollers a consacré deux articles à ces deux derniers livres.
L’évidence chinoise

Le Monde du 15.02.2002.
Archives A.G. ZOOM : cliquer sur l’image.

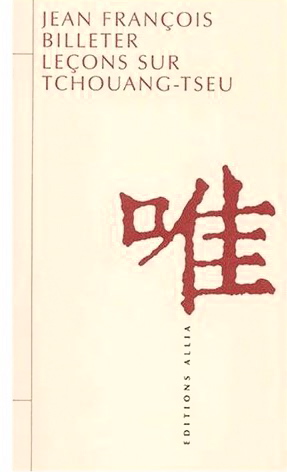
C’est un petit livre, mais on ne s’en lasse pas, on en a pour longtemps à méditer sa fraîcheur, son incongruité, sa justesse. Qui est Tchouang-tseu ? Ce philosophe chinois mort en 300 avant notre ère, cet illuminé taoïste sacralisé par des tonnes de commentaires plus ou moins obscurs, ou bien tout simplement quelqu’un qui nous parle aujourd’hui au plus près de notre expérience la plus commune ?
Jean-François Billeter n’y va pas par quatre chemins : la traduction, rien que la traduction, faisant émerger ce qu’il appelle « l’infiniment proche » ou le « presque immédiat ». Là, ici, tout de suite. Mon corps fonctionne et je ne m’en aperçois pas. Mes gestes me précèdent et me suivent sans que j’y fasse attention. Je me crois une machine, alors que je suis une réserve d’énergie et de forces. Je me laisse réduire, détourner, approprier, classer, user, et le premier coupable n’est autre que moi-même. Je travaille à ma servitude, je pose des questions, j’attends des réponses, au lieu d’éprouver mon autonomie radicale, mon indépendance sans consolation ni soumission.
Tchouang-tseu penseur dangereux pour toutes les habitudes et tous les pouvoirs ? Mais oui, et c’est peut-être un Occidental d’aujourd’hui, mieux qu’un Chinois, qui peut en tirer le meilleur parti, loin de tout exotisme orientaliste ou d’un charlatanisme ésotérique. Un éveil aux choses mêmes, à leur fonctionnement, à leur art.
Tchouang-tseu écrit des récits, souvent dialogués. On y rencontre un dépeceur de viande dont le couteau agit avec une souplesse et une facilité prodigieuses ; un homme qui nage dans des tourbillons mortels comme si de rien n’était et se promène ensuite sur le bord du fleuve en chantant. Ils étonnent les puissants, les sages. Le premier dit sobrement : « Entre force et douceur, la main trouve, l’esprit répond. » Le second se contente de lâcher : « Je suis parti du donné, j’ai développé un naturel et j’ai atteint la nécessité. » Un autre encore dit qu’il progresse en oubliant la bonté, la justice, les rites, la musique et qu’il peut ainsi « rester assis dans l’oubli » : « Je laisse aller mes membres, je congédie la vue et l’ouïe, je perds conscience de moi-même et des choses, je suis complètement désentravé : voilà ce que j’appelle être assis dans l’oubli. »
Qu’on ne s’y trompe pas : il n’y a là nulle apologie du dégagement ou de l’indifférence morale, et pas non plus la moindre désinvolture. Il s’agit d’expérimenter des régimes d’activité différents, de sortir des encombrements du langage et de la conscience agitée, de se reconnaître comme spontané, nécessaire, « entier », « d’épouser les métamorphoses de la réalité », « d’évoluer librement dans le vide ».
Mon corps n’est pas un objet, mais une profondeur de rassemblement et de circulation fluide, je peux voyager en lui et « quand on sait voyager on ne sait plus où l’on va, quand on sait contempler on ne sait plus ce qu’on voit ». Mon esprit, en revanche, me trompe constamment, il réfléchit mal, il est parasité par des préjugés, des on-dit, des opinions bâclées, des ressentiments, des illusions magico-religieuses, des comparaisons hâtives. Mieux vaudrait qu’il soit un miroir sans spéculation. C’est ainsi, dit Tchouang-tseu, que l’homme accompli « ne raccompagne pas ce qui s’en va, ne se porte pas au-devant de ce qui vient, accueille tout et ne conserve rien, et, de ce fait, embrasse les êtres sans jamais subir de dommages ». Il n’écoute plus avec l’oreille ni avec l’esprit, mais avec l’énergie qui est « un vide entièrement disponible ».
Le Ciel, le Vide, la Promenade, l’Oubli : ce que les Chinois appellent le Tao (« la voie ») n’a rien de constant, mais son activité et sa gratuité sont infinies, inlassables. En somme, l’Occidental terminal est trop plein, trop ruminant, trop suffisant, trop préoccupé de bien et de mal, d’ordre ou de désordre ; trop soucieux d’autorité, de justice, de contrôle, de sécurité, d’identité, de rentabilité ; beaucoup trop appliqué, scolaire, employé. C’est un locataire psychologique affairé du faux vide. Au contraire : « Je vais au hasard, je divague, et, dans mon errance, je vois cela qui ne trompe pas. » Billeter finit par comparer les petits récits de Tchouang-tseu à la musique de Bach. Combinaison d’éléments finis, emphase nulle, intérêt constant. Petites fables, grandes visions, rythme soutenu, arrêts brusques. « Le texte, quand il a retrouvé sa jeunesse, dit lui-même tout ce qu’il y a à dire. » Il chasse sans effort des nuées de commentateurs. Il convient étrangement au XXIe siècle.
Billeter n’est pas seulement savant, il est simple, direct, d’une redoutable culture (musique, littérature, peinture), et surtout il sent ce qu’il dit, il raconte une aventure personnelle. Il entre physiquement dans l’évidence chinoise, il l’intériorise dans une exploration du « corps propre », il la comprend à travers l’écriture et la calligraphie, cette « « musique visible » ». L’art de l’écriture, encre, pinceau, méditation, poésie, improvisation, concentration et ivresse, nous mène, à travers les siècles, au « grand surgissement merveilleux ». Nous retrouvons Tchouang-tseu et sa « musique céleste », laquelle, « inaudible, invisible, remplit Ciel et Terre et embrasse l’univers ». Pinceau vertical, vide de l’intérieur de la main, points, gestes, composition, parfois, en « ciel étoilé », le calligraphe capte l’instant où une activité qui était soumise à une finalité extérieure s’émancipe et devient elle-même sa propre fin — où elle se dégage et « vole selon ».
Ici, on reconnaît Rimbaud et son « Alchimie du verbe ». Mais Billeter peut aussi évoquer Mozart, Nietzsche, le jazz, Matisse, Picasso. Nous pénétrons ainsi dans le jeu du carré et du rond, des coudes et des courbes, dans une conception du temps faite de « moments complets qui se succèdent ». Emergences, efflorescences, disparitions : la main et l’esprit sont libérés, le rouleau vit et respire, « la mer déferle, les montagnes se tiennent en réserve ». On reste longuement devant ces chefs-d’oeuvre d’il y a parfois quinze siècles, ils vous prennent en eux, ils se déroulent en vous, vous devinez qu’à travers leur âpreté, leur élégance folle, leur célébration de la longévité ou du bonheur, une érotisation continue d’avoir lieu, une pensée inouïe de la jouissance de soi par une signature. La passion rigoureuse s’écrit, et elle n’est rien d’autre que « nourrir en soi la vie ». « L’énergie est semblable à l’eau, les mots sont semblables aux objets qui flottent sur elle. Une grande eau porte tout, les objets petits et grands, une grande énergie porte pareillement les mots quand elle est à son comble. »
Savoir être une feuille active sur cette eau, tel est le grand art. « Le Sage entre dans les mouvements de la nature et leur obéit tout entier. » Voilà d’ailleurs pourquoi il ne peut être le serviteur de rien ni de personne. « Sage », on le voit, ne veut pas dire ici revenu de tout, au dessus de la mêlée, conservateur, assis ou ranci, mais plutôt aventurier à éclipses, du temps et de l’espace. Un style de calligraphie, particulièrement emporté, s’appelle ainsi « la hardiesse extrême » [8]. L’Empereur Jaune l’apprend à ses dépens. Au lieu de rester dans son palais central immuable, il s’avise un jour de dominer le monde. Aussitôt il perd sa « perle obscure », le joyau auquel il tient par dessus tout. Seul son messager Sans Rien le retrouve. L’Empereur s’en étonne. Il vient de découvrir que Rien est le trésor suprême.
Philippe Sollers, L’Infini 79, été 2002 (Le Monde du 15.02.02)
Entretien avec J.-F. Billeter
Le 29 juin 2002, Jean-François Billeter était l’invité de l’émission Les vivants et les dieux (rediffusion le 24-12-15).
La Chine en direct

Le Monde du 19.03.04.
Archives A.G. ZOOM : cliquer sur l’image.

Récemment, dans ses Leçons sur Tchouang-tseu, Jean-François Billeter se donnait comme horizon « de remettre l’histoire des idées chinoises sous tension, de la remagnétiser. Il pourrait en résulter avec le temps un changement de perspective considérable ».
Et voici un premier résultat d’années de méditation, de traductions, de compréhension intime : Etudes sur Tchouang-tseu, livre admirable et incontournable, comme si la pensée chinoise fondamentale se mettait à vivre là, directement, sous nos yeux. On croyait la connaître, mais non, des tonnes de commentaires nous la cachaient en l’alourdissant, en la recouvrant d’obscurités et de clichés conformistes et intéressés. Tchouang-tseu ? La simplicité, la clarté, la subversion même. Un philosophe ? Sans doute, mais pas au sens où nous l’entendons. « Les interrogations de Tchouang-tseu, dit Billeter, communiquent avec les nôtres sur des points essentiels. » Une méthode nouvelle pour s’approcher de lui ? Oui, « partir du texte, le retraduire et voir où il mène. » Et voilà le grand art : montrer, en français, que ces dialogues, ces mises en scène nous parlent de notre vie la plus quotidienne, de notre liberté en acte, de notre soumission humaine, trop humaine, à la domination de tous les pouvoirs.
Dès le début (IIe siècle avant notre ère), « le Tchouang-tseu » est fragmenté, interprété, vite mis en perspective par ce que Billeter appelle « l’idéologie impériale », laquelle, selon lui, se perpétue dans son aveuglement jusqu’à nous. Un libre discours ne contient aucune justification du pouvoir quel qu’il soit ? Il faut donc le canaliser, le rendre religieux ou métaphysique, idéaliser son auteur, le simplifier, le transformer en conservateur éthéré (pour l’aristocratie lettrée) ou en relativiste sceptique, mystique, subjectiviste réactionnaire (pour les marxistes). Mais le problème n’est pas là. « Dans sa vision des choses, écrit Billeter, le social est en soi un mal inévitable, nécessairement régi par le mimétisme et par le conflit. Tchouang-tseu est pessimiste, mais il n’est pas cynique. Il n’enseigne pas que le prince a le droit, ou même le devoir, d’utiliser à ses propres fins la logique du pouvoir, comme l’ont fait les penseurs « légistes ». En dépit d’un préjugé tenace qu’on nourrit en Chine depuis le début de l’ère impériale, Tchouang-tseu n’enseigne pas non plus l’indifférence à l’égard de ce mal. Il l’étudie au contraire de près parce qu’il estime possible de le défaire ponctuellement, d’abord en soi-même et parfois chez d’autres. C’est tout ce que peut faire l’homme, selon lui. C’est à la fois peu de choses et très considérable. »
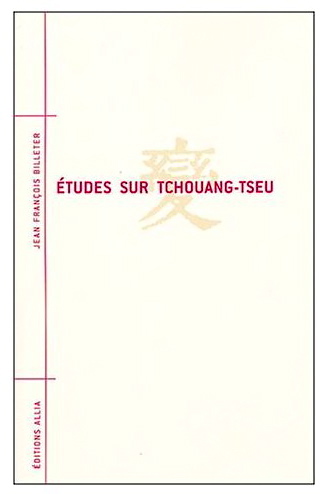
Nous croyons de plus en plus que la société est tout, mais voici un asocial et un marginal actif qui intervient sur un point décisif provoquant un effondrement des illusions totalisantes. C’est bref, illuminant, souvent drôle, toujours imprévu. Le monde humain est contraint, borné, artificiel, mégalomane et calculateur, « il regarde le ciel par un tube de bambou ». L’homme qui suit la Voie, lui, est naturel, nécessaire, spontané. « Il a l’apparence d’un homme, mais il est vide comme le Ciel. » Il est toujours en situation, il agit selon (ici, Billeter, qui est aussi à l’aise avec les Evangiles, saint Paul ou Wittgenstein, renvoie à Rimbaud, Alchimie du verbe dans Une saison en enfer : « Donc tu te dégages/ des humains suffrages/ des communs élans !/ Tu voles selon... » ). On ne peut pas le saisir, le cerner, le fixer. Surtout, il est sans intention préalable, il sait que l’enfer est pavé d’intentions, il peut « rester assis dans l’oubli » pour préparer une action d’autant plus efficace qu’elle surgira d’un vide entièrement disponible. Il peut faire craquer psychologiquement le tyran le plus endurci, provoquer un choc d’évidence chez son interlocuteur, écouter non seulement avec l’oreille et l’esprit, mais surtout avec son énergie unifiée interne.
On comprend qu’il soit redouté par tous les tireurs de ficelles : « Son langage déborde d’imagination, il ne suit que sa propre inspiration, de sorte que les puissants n’ont jamais pu faire de lui leur instrument. » Comme il a interrompu en lui toute servitude volontaire, comme son action, justement, est involontaire (elle ne vient pas de lui mais du Ciel), on peut dire qu’il « vole sans ailes » ou qu’ « il marche sans toucher terre ». Il ne répond pas aux questions, il invente une fiction où la vérité se révèle. Il ne veut que ce que veulent les transformations.
Ainsi respire le vrai Tchouang-tseu, à la fois Ciel et homme, connaissant les deux régimes d’activité et vivant selon. Nul besoin de le définir comme « taoïste » (terme déjà tardif), nul besoin non plus de parler de « confucianisme », de « bouddhisme » (et pas davantage de « christianisme »). Confucius, d’ailleurs, est lui-même une énigme, à l’opposé de sa momification par les différents pouvoirs. Billeter va directement à eux, les imagine, les voit. Grâce à lui, le plaisir de les lire apparaît comme pour la première fois stimulant, frais, intact. Tchouang-tseu : « Redresse ton corps, unifie ta vision et l’accord céleste viendra. Rentre ton intelligence, unifie ta tenue et l’activité merveilleuse viendra se loger en toi. »
La Chine est là, désormais, tout près, elle nous interpelle, elle nous réveille en se réveillant. Ce n’est pas par hasard qu’on observe le même désir de rigueur et d’indépendance chez un Prix Nobel comme Gao Xingjian, louant la souplesse et la sensation musicale de la langue dans Le Témoignage de la littérature (Seuil) : « Quand on pense en chinois, on peut très facilement dépasser définitions, analyses, déductions et raisonnements pour arriver tout droit au jugement et à la conclusion. »
Même éloge de la musique chez Ying Chen, qui fait elle aussi l’expérience d’être des deux côtés à la fois, chinois et français, ce qu’elle raconte de façon très émouvante dans Quatre mille marches : « Je voudrais que chaque phrase, sinon chaque mot, ait un sens double ou ambigu, tout en étant clair et direct. Car c’est ainsi que je perçois la réalité. » Elle vit au Canada, elle repense à Shanghaï, elle écrit directement en français, elle donne envie d’écrire en chinois (concision, rythme, souffle, couleur). Billeter révèle un Tchouang-tseu inconnu des Chinois eux-mêmes, Ying Chen, à l’opposé du déferlement réaliste et naturaliste des romans chinois, lit Proust. Il vous reste, pour continuer un acte de lumière contre tous les obscurantismes violents en cours, à vous immerger dans un volume monumental et déjà indispensable, La Peinture chinoise, d’Emmanuelle Lesbre et Liu Jianlong [9]. On pourra difficilement faire plus complet, plus riche, plus érudit, plus beau. Relations sociales, portraits, peinture de moeurs, peinture religieuse, peinture narrative et littéraire, peinture de paysage, peinture animalière : retrouvez mille sensations enfouies, prenez votre temps. Et admirez, d’entrée, ce détail d’un rouleau vertical attribué à Sun Wei (IXe siècle), une encre et couleurs sur soie : Portrait d’un lettré hautement affranchi. Liberté, décision, calme, audace.
Philippe Sollers, L’Infini 90, " Encore la Chine ", printemps 2005 (Le Monde du 19.03.04)


Autour de Tchouang-tseu
Fictions philosophiques du "Tchouang-tseu"

Présentation de l’éditeur
Ce livre est un essai général sur un auteur tenu par la plupart pour le plus grand philosophe et prosateur chinois, Tchouang-tseu (356-286 avant notre ère), dont l’oeuvre homonyme, le Tchouang-tseu, se situe à l’origine du taoïsme philosophique et religieux. Les thèses audacieuses de Tchouang-tseu, ses vertigineuses leçons métaphysiques, son ironie noire contre toute forme d’autorité s’épanouissent sous la forme de dialogues, fables et historiettes souvent déroutantes, que Romain Graziani traduit, commente et interprète en en dégageant les enjeux, avec le souci constant de tirer, sinon des leçons, du moins un éclairage transversal sur notre condition actuelle.
Le lecteur y trouvera une introduction à l’une des formes de pensée les plus radicales qu’ait produites la Chine, aux antipodes de l’humanisme confucéen, de sa sagesse grise et de sa religion hypocrite de la bonté.
Ce qu’a dit Tchouang-tseu
Réédition d’un monument de la pensée chinoise, traduit et commenté par Romain Graziani.
Par Vincent Roy
En quoi consiste le "jeûne de l’esprit" pour Tchouang-tseu ? A "faire du non-être son crâne". Le philosophe subversif chinois (356-286 avant notre ère), dont l’oeuvre homonyme est à l’origine du taoïsme (terme tardif), explique ainsi qu’il est possible de dérouter la conscience et ses limitations. Romain Graziani, qui traduit et commente superbement ces leçons métaphysiques, ajoute que c’est une façon "de se déprendre du mode d’existence absorbé dans le monde des "formes" constituées".
Principe d’inconnaissance absolue ("la connaissance s’enracine dans l’inconnaissance" relève Graziani), état de non-pensée, souveraineté du vide sur les formes. L’existence serait-elle donc absorbée dans le monde de ces formes constituées, c’est-à-dire institutionnelles, politiques ? Il est important de souligner, au passage, que ce n’est qu’avec Tchouang-tseu que s’impose, dans la Chine de cette période, "une parole qui prend en charge la question de la mort". Et pas seulement.
Car ce qui surprend dans ce texte vaste constitué de dialogues, de récits, de mises en scène, de palimpsestes, de mythes, de fables, de parodies, d’historiettes, de paraboles, "c’est le décalage de ton et de visée", si bien qu’on peut le situer aux antipodes de la sagesse chinoise : apologie du difforme, de l’informe et de l’état d’indistinction, encouragements à transgresser le cognitif et le moral, injonction à délaisser le souci du bien.
Sa singularité tient d’abord au fait qu’il "lance de féroces offensives contre le pouvoir, voire contre toute forme de regroupement social. A l’époque des Royaumes combattants, Tchouang-tseu est sans doute le seul penseur à faire pièce de la conception hégémonique de l’ordre et de la nécessaire soumission de l’ensemble des êtres à une instance unique de commandement" : l’homme libre suit la Voie, il n’est pas domestiqué ni dressé, "il est vide comme le Ciel". Quant au ton, au style employé pour rendre cette pensée dissidente, il "procède selon une intuition de la nature comme puissance d’inventivité féconde, agent de modulations infinies, principe inconnaissable et réfractaire à toute définition". Les différents registres utilisés sont accordés aux formes variées que prend la matière vitale.
Le Tchouang-tseu est un livre politique et poétique : son auteur sait que le langage joue sur le savoir, qu’il "construit et détruit simultanément notre rapport à la réalité". S’il le malmène souvent, comme le souligne justement Romain Graziani, "c’est qu’une telle violence est le seul moyen d’ouvrir une brèche dans l’ordre compact des choses telles qu’elles pèsent de tout leur poids sur l’esprit".
A la suite des essais admirables de Jean-François Billeter et de la très importante traduction de Jean Levi, Romain Graziani interprète quelques textes radicaux du Tchouang-tseu, en dégage la portée avec beaucoup d’acuité et nous montre l’impressionnante actualité de ces fictions philosophiques. Salutaire et remarquable !
Le Monde du 20 juillet 2006.


Propos intempestifs sur le tchouang-tseu
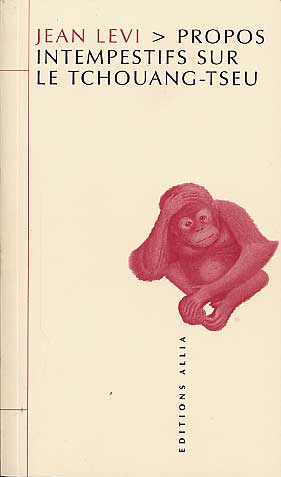
Présentation
Jean Levi est né à Paris en 1948. Sinologue, spécialiste du taoïsme, il s’est intéressé aussi aux théories politiques et à la réflexion stratégique dans la Chine ancienne. Il est l’auteur de romans, d’essais et de nombreuses traductions, notamment celle du Huainanzi dans le volume de la Pléiade consacré aux philosophes taoïstes.
" Pince-mi et Pince-moi sont dans un bateau...", la phrase qui ouvre ces Propos intempestifs donne le ton de l’ouvrage : libre voyage à travers cette ?uvre inépuisable qu’est le Tchouang-tseu, où par le détour de fables, de paraboles, de dialogues, se développent tous les grands thèmes de la philosophie universelle. Deux apologues, "le meurtre de Chaos" et "la révolte des singes", servent de point de départ à une réflexion à la fois philosophique et politique, pour laquelle Jean Levi fait appel à d’autres passages du Tchouang-tseu, mais aussi bien aux penseurs occidentaux comme Machiavel, Bergson ou Levinas, et même aux films de kung-fu.
Citation :
"Telle est la profondeur des fables chinoises. Leur signification se trouve toujours en dehors des mots qui la portent. Elles disent et ne disent pas. Elles suggèrent toujours autre chose que le sens explicite parce que justement elles n’expriment rien d’autre qu’un récit laconique. On peut donc leur attribuer mille significations différentes ; elles suscitent des séries d’images et d’associations qui se répercutent dans la conscience en cercles concentriques, comme des rides à la surface d’une mare après le jet d’une pierre."


Tchouang Tseu - Maître du Tao
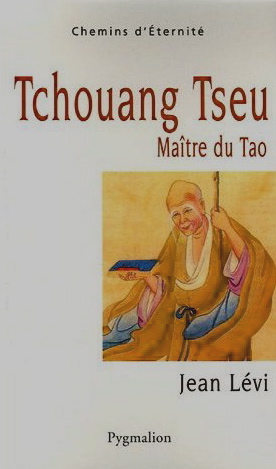
Quatrième de couverture
Tchouang Tseu est le penseur le plus profond et le plus singulier que connut la Chine au cours de sa longue histoire. Il est un des maîtres du taoïsme. Il vécut au IVe siècle avant notre ère dans un monde de bruit et de fureur. Condamnant avec des accents à la Jean-Jacques Rousseau toute autorité, toute hiérarchie, toute vie en société, il en vint à prôner la fusion dans la totalité indivise du monde. De la vie de ce penseur erratique, nous ignorons presque tout. Plutôt que de reconstituer une existence qui ne pourrait être qu’arbitraire, Jean Levi met en scène sept vies, toutes plausibles, toutes rêvées, en s’appuyant sur les plus importants passages de son oeuvre dont il donne une nouvelle traduction.
Avec son exceptionnelle faconde de romancier et sa connaissance de la Chine qui font de lui un des plus éminents sinologues, Jean Levi réussit ce qui n’avait jamais été tenté auparavant : rendre Tchouang Tseu vivant à travers toutes ses facettes possibles.


Sites sur Tchouang-tseu et les livres qui lui sont consacrés
 Tchouang-tseu sur wikipedia
Tchouang-tseu sur wikipedia
 Jean Levi, Propos intempestifs sur Tchouang-tseu : le texte
Jean Levi, Propos intempestifs sur Tchouang-tseu : le texte
 Jean François Billeter, Etudes sur Tchouang-tseu : le texte
Jean François Billeter, Etudes sur Tchouang-tseu : le texte
 Jean Lévi : Propos intempestifs sur Tchouang-tseu ; Jean François Billeter : Leçons sur Tchouang-tseu
Jean Lévi : Propos intempestifs sur Tchouang-tseu ; Jean François Billeter : Leçons sur Tchouang-tseu
 Jean-François Billeter : Les Oeuvres de Maître Tchouang, traduction de Jean Levi, 2006
Jean-François Billeter : Les Oeuvres de Maître Tchouang, traduction de Jean Levi, 2006



Tchouang Tseu, le geste et la parole
Par Lydia Ben Ytzhak et Dominique Costa.
Émission diffusée sur France Culture le 07.11.2004 (Une vie, une oeuvre)
Avec Jean-François Billeter, Jean Levi, Rémi Mathieu, Soun-Gui Kim, Cyrille Javary.

Le père du taoïsme vécut dans la seconde moitié du IVe siècle avant J.-C. Sa pensée philosophique est un chef-d’’œuvre d’un point de vue littéraire : une prose poétique chinoise dont la richesse fait le désespoir des traducteurs. Elle est présentée sous forme de fables, d’apologues, de paraboles, de dialogues entre des personnages réels ou mythiques qui laissent la part belle aux interprétations, comme si leur signification réelle était toujours ailleurs. La notion centrale est celle du « Tao », ce chemin, cette Voie selon laquelle procède toute chose, tous les êtres. Élevé à la hauteur d’un absolu métaphysique, il est l’Un indifférencié auquel se ramènent toutes les différenciations, les déterminations du monde empirique. Métaphysique centrée sur l’homme, comme le veut l’humanisme chinois : à l’homme de faire retour à l’Un absolu par-delà toute relativité, de conformer sa conduite à la spontanéité naturelle du Tao qui nous embrasse de toute part « sans qu’on le voie ». Son œuvre s’envole dans un hymne à la liberté du taoïste parcourant à sa guise l’univers, tel un chamane en randonnée extatique, il s’élève dans le ciel infini d’où il survole le monde, alors que la cigale, la caille ou la tourterelle, lorsqu’elles prennent leur essor, vont se cogner contre l’arbre voisin ou s’abattre parmi les herbes, image du confucianiste attaché aux activités de ce monde. Le taoïste, lui,« embrasse les dix mille êtres en un tout unique » n’agit qu’en ne faisant rien, et,« ne servant à rien, ne pâtit de rien ». Une philosophie qui se poursuit en démontrant la vanité de toutes les opinions opposées, de toutes les oppositions en général, avant de conclure conformément à ce point de vue sur une critique de sa propre pensée.
Pour réécouter l’intervention de Jean Levi, voir Jean Levi 1 et Jean Levi 2.
Voir en ligne : Les éditions Allia
[1] Voir Shitao, l’unique. Alain Jaubert a par ailleurs consacré au mont Jingting en automne une émission de la série Palettes.
[2] La meilleure traduction des Oeuvres de maître Tchouang me semble être celle de Jean Levi (Encyclopédie des nuisances, 2006).
[3] Je m’appuie ici sur les remarques de Marcelin Pleynet qui, dans Situation 2004 (L’Infini 88, automne 2004), s’interroge longuement sur "l’entre deux", le "pli spécifique d’une expérience idéogrammatique propre à l’écriture chinoise, et poétiquement propre à la poésie occidentale."
Pleynet cite en note un extrait du roman de Sollers Nombres (1968) :
" et je me souvenais que nous étions pris les uns les autres dans l’alphabet désormais pour nous dépassé... J’avais maintenant à saisir et orienter des évènements non représentables et qui, pourtant, ne pouvaient être négligés, niés..."
(c’est Pleynet qui souligne mais il est, à l’époque, engagé dans sa propre expérience poétique — l’écriture de Stanze (1973) — et son propre questionnement de ce qu’il en est de la poésie chinoise.)
Expérience poétique dont l’évocation lui paraît manquer à la réflexion de François Jullien :
« Lorsque François Jullien s’arrête, parmi les catégories de la pensée européenne, à l’esthétique... "alors que la pensée chinoise elle est passée par d’autre pli de la pensée ", on pourrait s’attendre qu’il évoque la place du "poétique", tel que l’énonce Heidegger, comme pli en effet très singulier de la pensée européenne. » (p. 36)
et que Jean François Billeter semble mieux percevoir :
« Je suis souvent étonné de constater que ce qu’un penseur découvre de singulier, d’étrangement familier et de dynamique dans la pensée chinoise, ne l’engage pas à questionner ce qui dans sa parole, dans la présence de la parole occidentale, et pour ce qui m’occupe, spécifiquement dans le français, autorise ce questionnement. Il semble que ce soit là, entre autres, l’un des objectifs des éclaircissements de Jean François Billeter, notamment dans L’art chinois de l’écriture, Skira/Le Seuil, 2001, et dans ses Leçons sur Tchouang-tseu, Allia, 2002, même si dans ses références occidentales, tant visuelles que littéraires, il paraît parfois confondre l’exception, la singularité questionnante avec les spéculations modernistes d’école. » (p.37)
Sur J.F. Billeter, voir, plus loin, les articles de Sollers qui sont de la même époque : 2002, 2004.
[4] Lire : Heidegger, « La rose est sans pourquoi », in Le principe de raison (Gallimard, chap. 5).
Le principe de raison veut que « rien n’est sans une raison qu’il faut fournir » : « Rien n’est sans pourquoi ». Mais, écrit Heidegger :
« écoutons maintenant la sentence que voici :
La rose est sans pourquoi, fleurit parce qu’elle fleurit,
N’a souci d’elle-même, ne désire être vue.
Ces vers se lisent au premier livre des poésies spirituelles d’Angelus Silesius, publié sous le titre : Le pélerin chérubinique. Description sensible des quatre choses dernières.
La première édition de l’ouvrage est de 1657. »
Heidegger relève qu’Angelus Silesius avait retenu l’attention de Leibniz et de Hegel, qu’il s’agit ici de mystique et de poésie et, plus loin, que « dans ce domaine, suivant la parole du poète, le principe de raison n’a pas d’autorité. »
Sollers évoque lui aussi Angelus Silesius et Le pélerin chérubinique dans d’autres passages des Illuminations (p.154-155) mais également dans Fleurs (p.37-38) :
« La rose est sans pourquoi, fleurit parce qu’elle fleurit,
N’a souci d’elle-même, ne désire être vue.
Gratuité absolue du Néant, de Dieu, de la Rose : il faudrait vivre selon cette foi, mais ne rêvons pas. »
Et :
« Quelques peintres ont atteint le « sans pourquoi ». Et puis, de temps en temps (mais c’est peut-être toujours le même), un poète. »
[5] Ce saint chinois n’aurait-il pas pu déclarer comme le fera plus tard Georges Bataille (étrangement absent des Illuminations) : « Je ne suis pas un philosophe, mais un saint, peut-être un fou. » (Méthode de méditation, O.C. t.V, p.218. C’est Bataille qui souligne, Bataille qui, bien sûr, n’était pas fou.)
[6] Dans Contre François Jullien, Jean François Billeter reproche à ce dernier d’avoir fait de la Chine « l’autre absolu » empêchant par là de penser ce qui peut nous rapprocher d’elle.
Sollers lui-même est pris à parti (p.106) en raison d’un article qu’il a consacré à la traduction en Pléiade du Houai-nan-tseu . Billeter écrit :
« ils se font de la Chine [...] une sorte d’ailleurs absolu dont c’est le charme d’être incompréhensible. Philippe Sollers leur a donné le ton dans son compte-rendu du Monde : "Lecteur bénévole, improbable et sincère, tu n’as, ces temps-ci, qu’un livre à te procurer d’urgence pour le méditer sans cesse pendant les années à venir : le merveilleux Houai-nan-tseu...". L’ouvrage est intégré à une sorte de pataphysique universelle : "L’harmonie imprègne toute chose ; les affinités électives suivent leur cours. Vous passez de propositions sur le néant et le vide à de petites fables sur ce ce qui s’ensuit dans l’existence". Ce genre d’éloge capricieux n’est pas innocent. Il fait partie d’un discours aujourd’hui répandu qui nie la possibilité même de toute pensée soutenable et affirme que notre monde, marqué par l’échec généralisé des tentatives de changement, est, somme toute, très bien tel qu’il est. Toutes les solutions étant imaginaires, dit ce discours, préférons les plus inattendues, les plus absurdes. »
Difficile pour un non sinologue d’entrer ici dans ce débat (nous doutons fort cependant que Sollers ou Jullien soient à ranger dans la catégorie des gens "qui nie[nt] la possibilité même de toute pensée soutenable" et pour qui "notre monde [...] est très bien tel qu’il est."). La réponse de François Jullien se trouve dans Chemin faisant.... Il y révèle d’ailleurs dès la page 17 qu’il avait invité... J.F. Billeter à son « Centre de recherche, il y a quelques années, pour présenter son travail sur Zhuangzi [Tchouang-tseu] » !
Nous nous contenterons de noter que J.F. Billeter critique aussi la traduction du Houai-nan-tseu, que ce volume de la Pléiade est publié sous le titre générique de Philosophes Taoïstes II et que Sollers note dans ses Mémoires (2007, p.210) que « les taoïstes » sont « à refaire » (visant sans doute la traduction du Tchouang tseu ou du Lie tseu, également traduits en Pléiade)....
On trouvera une présentation et une discussion du livre de Billeter sur le site Question Chine et aussi dans Penser en Chine.
[8] Voir notre article : La hardiesse extrême : Paradis III
[9] Hazan, 2004




 Version imprimable
Version imprimable
 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



1 Messages
Philosophes taoïstes, tome I : Lao zi, Zhuang zi, Lie zi
Collection Bibliothèque de la Pléiade (n° 283), Gallimard
La légende rapporte qu’au retour d’une rencontre avec Lao zi, Confucius le décrivit à ses disciples comme aussi insaisissable qu’un dragon, « chevauchant les vents et les nuées ». On pourrait en dire autant du dao, « la voie » : l’impossibilité à l’appréhender est le gage de sa toute-puissance. Si Confucius employait déjà ce terme, c’est avec Lao zi, Zhuang zi et Lie zi (autrement dit : Lao tseu, Tchouang tseu et Lie tseu) que le dao prend une signification beaucoup plus large pour devenir à la fois un principe et un moteur. Avec eux naît « l’école du dao ». La primauté doctrinale de leurs trois textes ne s’est jamais démentie jusqu’à nos jours. Tandis que le Lao zi peut presque être considéré comme un traité prescriptif, le Zhuang zi propose une œuvre riche en couleurs et en figures fantasques, et le Lie zi un ensemble de récits où le merveilleux côtoie le quotidien. L’influence de ces trois œuvres est immense, y compris en Occident.
Cette nouvelle édition, qui propose des traductions nouvelles ou récentes, se compose de la première version connue à ce jour du Lao zi — elle était jusqu’à présent inédite en français — et de sa version canonique, de la version classique du Zhuang zi en trente-trois chapitres, et du Lie zi intégral en huit chapitres. Ce volume forme désormais un diptyque avec le Huainan zi (tome II des Philosophes taoïstes dans la Pléiade), établi selon les mêmes principes en 2003.