
« Soyez donc résolus à ne plus servir et vous voilà libres. »Etienne de La Boétie.
« Il y a un livre, à mon avis, qu’il faut relire d’urgence, la Servitude volontaire de La Boétie. On y trouve formulé pour la première fois, d’une façon décisive et périodiquement oubliée, l’axiome suivant : "Tout pouvoir ne vit que de ceux qui s’y résignent." On agite toujours le fait que le méchant serait à l’oeuvre, à l’insu des peuples ou contre eux, sans qu’ils participent le moins du monde à ce qui leur arrive : comme si, les intellectuels n’avaient pas décidé de baisser les bras, voire de ne pas se battre. La servitude volontaire insiste pourtant sur le fait que le tyran, quel qu’il soit, si on cessait de le soutenir, s’effondrerait de lui-même. Supposons que ce qu’on a appelé "la gauche", dans toutes ses composantes et ses histoires souvent dramatiques, parfois glorieuses, soit structurée masochistement : le surmoi lui dit à l’oreille de l’inconscient : "Tu jouiras de perdre, car c’est la seule voie qui te soit offerte imaginairement pour jouir." Ça jette une lumière sur ce qui peut arriver dans certaines périodes de l’histoire — à considérer simplement l’hexagone (mais tout est lié). »
Philippe Sollers, Contre le masochisme, Novembre 2002.
« Il y a un petit livre qu’on peut relire ces temps-ci (et je m’étonne qu’il ne soit pas à l’Index) : La Servitude volontaire de La Boétie. »
Philippe Sollers, Pensée, année zéro, L’Infini 82, printemps 2003.
Première mise en ligne le 16 juin 2007.

La servitude volontaire : le livre est connu, son auteur aussi, notamment grâce à Montaigne, son ami, son "frère" ("parce que c’était lui, parce que c’était moi").
De nombreuses éditions existent [1].
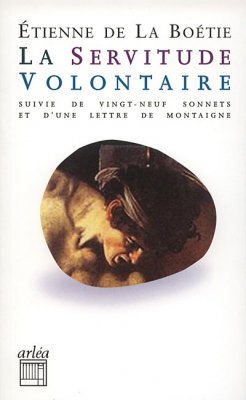 Les Editions Arlea ont eu la bonne idée de le rééditer, suivi de vingt-neuf poèmes [2] et d’une "lettre que monsieur le conseiller de Montaigne écrit à monseigneur de Montaigne, son père, contenant quelques particularités qu’il remarqua en la maladie et mort de feu M. de La Boétie".
Les Editions Arlea ont eu la bonne idée de le rééditer, suivi de vingt-neuf poèmes [2] et d’une "lettre que monsieur le conseiller de Montaigne écrit à monseigneur de Montaigne, son père, contenant quelques particularités qu’il remarqua en la maladie et mort de feu M. de La Boétie".
Cette lettre est magnifique (nous sommes en 1563, La Boétie est malade "d’une forte dysenterie", il va mourir, Montaigne est à ses côtés jusqu’à la fin où le "nommant une ou deux fois, et puis tirant à soi un grand soupir, il rendit l’âme, sur les trois heures du mercredi matin dix-huitième d’août, l’an mil cinq cent soixante trois, après avoir vécu trente-deux ans, neuf mois et dix-sept jours.")
On le sait, c’est dans le chapitre XXVII du Livre I des Essais — De l’amitié — que Montaigne parle de La Servitude volontaire :
« ceux qui l’ont ignoré, l’ont bien proprement depuis rebaptisé, Le Contre Un. Il l’écrivit par manière d’essai, en sa première jeunesse, à l’honneur de la liberté contre les tyrans. Il court depuis longtemps dans les mains des gens d’entendement, non sans bien grande et méritée recommandation : car il est gentil [noble], et plein ce qu’il est possible. Si [pourtant] y-a-t-il bien à dire, que ce ne soit le mieux qu’il pût faire : et si en l’âge que je l’ai connu, plus avancé, il eût pris un tel dessein que le mien, de mettre par écrit ses fantaisies, nous verrions plusieurs choses rares, et qui nous approcheraient bien près de l’honneur de l’Antiquité : car, notamment en cette partie des dons de nature, je n’en connais point qui lui soit comparable. Mais il n’est demeuré de lui que ce discours, encore par rencontre [hasard], et crois qu’il ne le vit jamais depuis qu’il lui échappa : et quelques mémoires sur cet édit de Janvier [3], fameux par nos guerres civiles, qui trouveront encore ailleurs peut être leur place. C’est tout ce que j’ai pu recouvrer de ses reliques (moi qu’il laissa d’une si amoureuse recommandation, la mort entre les dents, par son testament, héritier de sa Bibliothèque et de ses papiers) outre le livret de ses oeuvres que j’ai fait mettre en lumière. Et si [ainsi] suis obligé particulièrement à cette pièce, d’autant qu’elle a servi de moyen à notre première accointance. Car elle me fut montrée longue pièce [longtemps] avant que je l’eusse vu ; et me donna la première connaissance de son nom, acheminant ainsi cette amitié, que nous avons nourrie, tant que Dieu a voulu, entre nous, si entière et si parfaite, que certainement il ne s’en lit guère de pareilles : et entre nos hommes [contemporains] il ne s’en voit aucune trace en usage. Il faut tant de rencontres [hasards] à la bâtir, que c’est beaucoup si la fortune y arrive une fois en trois siècles. »
(version "rajeunie" par Claude Pinganaud, Arlea, 2007)
On lira ci-dessous quelques extraits — intempestifs ? — de La Boétie, de celui dont Montaigne disait aussi « que, s’il eût à choisir, il eût mieux aimé être né à Venise qu’à Sarlat, et avec raison » et qu’« il ne fut jamais un meilleur citoyen, ni plus affectionné au repos de son pays, ni plus ennemi des remuements et nouvelletés de son temps. »

La servitude volontaire, extraits
[La servitude volontaire est présentée ici dans une orthographe rajeunie, les mots et les expressions obsolètes étant suivis de leur équivalents en français moderne [entre crochets et en italiques]. On a procédé aussi à quelques aménagements, pour ce qui concerne la ponctuation et certaines constructions par trop archaïques, au moyen d’inversions, d’incises entre tirets, etc., afin de rendre le texte plus clair.
Claude Pinganaud dans sa Présentation de l’Edition Arléa.]
D’avoir plusieurs seigneurs aucun bien je n’y vois[s] ;
Qu’un sans plus soit le maître, et qu’un seul soit le roi.
Disait Ulysse en Homère [Iliade, II, 204-205], parlant en public,
D’avoir plusieurs seigneurs aucun bien je n’y vois[s]
C’était aussi bien dit que possible. Mais, au lieu que, pour parler avec raison, il fallait dire que la domination de plusieurs ne pouvait être bonne puisque la puissance d’un seul, dès lors qu’il prend ce titre de maître, est dure et déraisonnable, il est allé ajouter tout à rebours :
Qu’un sans plus soit le maître, et qu’un seul soit le roi.
Il faudrait peut-être excuser Ulysse, qui avait sans doute besoin d’user de ce langage, et de s’en servir pour apaiser la révolte de l’armée, conformant, je crois, son propos plus au temps qu’à la vérité. Mais, à parler à bon escient, c’est un extrême malheur d’être sujet d’un maître duquel on ne peut jamais être assuré qu’il soit bon, puisqu’il est toujours en sa puissance d’être mauvais quand il le voudra. Et d’avoir plusieurs maîtres, c’est, autant qu’on en a, autant de foi être extrêmement malheureux.
Pourtant ne veux-je pas pour cette heure débattre cette question tant disputée : si les autres façons de république [formes de gouvernement] sont meilleures que la monarchie. Encore voudrais-je savoir, avant que de mettre en doute quel rang la monarchie doit avoir entre les républiques, si elle doit y en avoir un, parce qu’il est malaisé de croire qu’il y ait quelque chose de public en ce gouvernement où tout est un. Mais cette question est réservée pour un autre temps, et demanderait bien son traité à part, ou plutôt amènerait avec soi toutes les disputes politiques.
Pour ce coup, je ne voudrais sinon entendre comment il se peut faire que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelque fois un tyran seul, qui n’a puissance que celle qu’ils lui donnent, qui n’a pouvoir de leur nuire sinon tant qu’ils ont voulu l’endurer, qui ne saurait leur faire mal aucun sinon lorsqu’ils aiment mieux le souffrir que le contredire. Grande chose, certes, et toutefois si commune qu’il faut d’autant plus s’en affliger et moins s’en ébahir : voir un million de millions d’hommes servir misérablement, ayant le cou sous le joug, non pas contraints par une plus grande force, mais, en quelque sorte, ce semble, enchantés et charmés par le seul nom d’un, duquel ils ne doivent ni craindre la puissance puisqu’il est seul, ni aimer les qualités, puisqu’il est à leur endroit inhumain et sauvage.
La faiblesse d’entre nous, hommes, est telle, qu’il faut souvent que nous obéissions à la force. Nous ne pouvons pas toujours être les plus forts. Donc si une nation est contrainte par la force de la guerre de servir un, comme la cité d’Athènes aux trente tyrans, il ne se faut pas ébahir qu’elle serve, mais se plaindre de l’accident, ou bien plutôt ne s’ébahir ni ne s’en plaindre, mais supporter le mal patiemment, et se réserver à l’avenir à meilleure fortune [chance].
« Encore ce seul tyran, il n’est pas besoin de le combattre, il n’est pas besoin de le défaire. Il est de soi-même défait, à condition le pays ne consente à sa servitude. Il ne faut rien lui ôter, mais ne rien lui donner. Il n’est nul besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu’il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font rudoyer, puisqu’en cessant de servir ils en seraient quittes. C’est le peuple qui s’asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix d’être serf ou d’être libre, quitte [abandonne] la liberté et prend le joug, et, pouvant vivre sous les bonnes lois et sous la protection des Etats, veut vivre sous l’iniquité, sous l’oppression et l’injustice, au seul plaisir de ce tyran. C’est le peuple qui consent à son mal, ou plutôt le recherche. S’il lui coûtait quelque chose à recouvrer sa liberté, je ne l’en presserais point - bien que, qu’est-ce que l’homme doit avoir de plus cher que de se remettre en son droit naturel et, par manière de dire, de bête redevenir homme ? Mais encore que je ne désire pas en lui si grande hardiesse, je ne lui permet point qu’il aime mieux une je ne sais quelle sûreté de vivre misérablement, qu’une douteuse espérance de vivre à son aise. Quoi ? Si pour avoir liberté il ne faut que la désirer, s’il n’est besoin que d’un simple vouloir, se trouvera-t-il nation au monde qui l’estime encore trop cher, la pouvant gagner d’un seul souhait, et qui épargne sa volonté à recouvrer le bien qu’on devrait racheter au prix du sang, et lequel perdu tous les gens d’honneur doivent estimer la vie déplaisante et la mort salutaire ? Certes, comme le feu d’une petite étincelle devient grand et toujours se renforce, et plus il trouve de bois plus il est prêt d’en brûler, et, sans qu’on y mette de l’eau pour l’éteindre, seulement en n’y mettant plus de bois, n’ayant plus rien à consumer il se consume soi-même, et devient sans force aucune et n’est plus feu, de même les tyrans, plus ils pillent, plus ils exigent ; plus ils ruinent et détruisent, plus où leur donne, plus on les sert, de tant plus ils se fortifient et deviennent toujours plus forts et plus frais pour anéantir et détruire tout, et si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits, et ne sont plus rien, sinon que comme la racine n’ayant plus d’humeur, ou aliment, la branche devient sèche et morte.
Les hardis, pour acquérir le bien qu’ils demandent, ne craignent point le danger ; les avisés ne refusent point la peine. Les lâches et engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien ; ils s’arrêtent en cela de le souhaiter, et la vertu d’y prétendre leur est ôtée par leur lâcheté ; le désir de l’avoir leur demeure par la nature. Ce désir, cette volonté sont communs aux sages et aux fous, aux courageux et aux couards, pour souhaiter toutes choses qui, étant acquises, les rendraient heureux et contents. Une seule chose manque, en laquelle, je ne sais comment, nature fait défaut aux hommes pour la désirer : c’est la liberté, qui est toutefois un bien si grand et si plaisant, qu’elle perdue, tous les maux viennent à la file, et les biens même qui demeurent après elle perdent entièrement leurs goût et saveur, corrompus par la servitude. La seule liberté, les hommes ne la désirent point, non pour autre raison, ce semble, sinon que, s’ils la désiraient, ils l’auraient ; comme s’ils refusaient de faire ce bel acquis seulement parce qu’il est trop aisé. »
« Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres. Je ne veux pas que vous le poussiez [le tyran], ni l’ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse à qui on a dérobé la base, de son poids même s’effondrer et se rompre. »
« Mais, à la vérité, c’est bien pour néant de débattre si la liberté est naturelle, puisqu’on ne peut tenir aucun en servitude sans lui faire tort, et qu’il n’y a rien si contraire au monde à la nature, étant toute raisonnable, que le dommage. Reste, donc, que la liberté est naturelle, et par même hypothèse, à mon avis, que nous ne sommes pas seulement nés en possession de notre liberté, mais aussi avec désir de la défendre. »
« On ne regrette jamais ce que l’on n’a jamais eu, et le regret ne vient point sinon qu’après le plaisir, et toujours est avec la connaissance du mal la souvenance de la joie passée. La nature de l’homme est bien d’être libre et de le vouloir être, mais sa nature est telle que, naturellement, il tient le pli que l’éducation lui donne.
Disons donc ainsi qu’à l’homme toutes choses lui sont comme naturelles, à quoi il se nourrit et accoutume, mais cela seulement lui est inné à quoi sa nature simple et non altérée l’appelle. Ainsi la première raison de la servitude volontaire, c’est la coutume. Comme des plus braves courtauds [chevaux à la queue et aux oreilles coupées] qui, au commencement, mordent le frein et puis s’en jouent, et, là où naguère ils ruaient contre la selle, ils se parent maintenant dans les harnais et, tout fiers, se rengorgent sous le harnachement ; ils disent qu’ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont vécu ainsi ; ils pensent qu’ils sont tenus d’endurer le mal, et se font accroire par exemples et justifient eux-mêmes par la longueur du temps, la domination de ceux qui les tyrannisent.
Pour vrai les ans ne donnent jamais droit de mal faire, mais agrandissent le préjudice. Toujours s’en trouvent-ils quelques uns, mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne peuvent se retenir de le secouer, qui ne s’apprivoisent jamais de la sujétion et qui, comme Ulysse, par terre et par mer, cherchait toujours de voir la fumée de sa maison, ne peuvent jamais se retenir de penser à leurs naturels privilèges, et de se souvenir de leurs prédécesseurs et de leur premier être. Ce sont volontiers ceux-là qui , ayant l’entendement net et l’esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme la grosse populace [4], de regarder ce qui est devant leurs pieds, s’ils ne considèrent et derrière et devant, et ne se remémorent encore les choses passées pour juger du temps à venir, et pour mesurer les présentes. Ce sont ceux qui, ayant la tête d’eux-mêmes bien faite, l’ont encore polie par l’étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et toute hors du monde, l’imaginent et la sentent en leur esprit, et encore la savourent. Et la servitude n’est pas de leur goût, pour tant bien qu’on l’accoutre. [5] "
1. Le texte intégral (version la plus connue que cite Sollers)
2. Le texte intégral de l’édition Payot (recommandée pour ses nombreuses notes)
[1] Etienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire ou Contr’un 1574-1576.
- Discours de la servitude volontaire. Présentation et notes par Simone Goyard-Fabre. Paris, GF-Flammarion, 1983.
- Discours de la servitude volontaire. Présentation et notes de Françoise Bayard. Paris, Imprimerie Nationale, 1993.
-
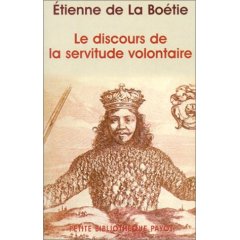 Le discours de la servitude volontaire. Texte établi par Pierre Léonard, suivi de " La Boétie et la question du politique ". Textes Félicité Lamennais, Pierre Leroux, Auguste Vermorel, Gustav Landauer, Simone Weil, Miguel Abensour, Marcel Gauchet, Pierre Clastres, Claude Lefort. Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1993.
Le discours de la servitude volontaire. Texte établi par Pierre Léonard, suivi de " La Boétie et la question du politique ". Textes Félicité Lamennais, Pierre Leroux, Auguste Vermorel, Gustav Landauer, Simone Weil, Miguel Abensour, Marcel Gauchet, Pierre Clastres, Claude Lefort. Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1993.
Discours de la servitude volontaire. Traduction en français moderne et postface de Séverine Auffret Turin, Mille et une Nuits, 1995.
La servitude volontaire. Mis en français moderne et présenté par Claude Pinganaud, Arléa, 2003 (1ère édition), 2007
[2] Vingt et neuf sonnets d’Estienne de la Boëtie.
A Madame de Grammont Contesse de Guissen.
MADAME, je ne vous offre rien du mien, ou par ce qu’il est desja vostre, ou pour ce que je n’y trouve rien digne de vous. Mais j’ay voulu que ces vers en quelque lieu qu’ils se vissent, portassent vostre nom en teste, pour l’honneur que ce leur sera d’avoir pour guide cette grande Corisande d’Andoins. Ce present m’a semblé vous estre propre, d’autant qu’il est peu de dames en France, qui jugent mieux, et se servent plus à propos que vous, de la poësie : et puis qu’il n’en est point qui la puissent rendre vive et animee, comme vous faites par ces beaux et riches accords, dequoy parmy un milion d’autres beautez, nature vous a estrenee : Madame ces vers meritent que vous les cherissiez : car vous serez de mon advis, qu’il n’en est point sorty de Gascongne, qui eussent plus d’invention et de gentillesse, et qui tesmoignent estre sortis d’une plus riche main. Et n’entrez pas en jalousie, dequoy vous n’avez que le reste de ce que pieça j’en ay faict imprimer sous le nom de monsieur de Foix, vostre bon parent : car certes ceux-cy ont je ne sçay quoy de plus vif et de plus bouillant : comme il les fit en sa plus verte jeunesse, et eschauffé d’une belle et noble ardeur que je vous diray, Madame, un jour à l’oreille. Les autres furent faits depuis, comme il estoit à la poursuitte de son mariage, en faveur de sa femme, et sentant desja je ne sçay quelle froideur maritale. Et moy je suis de ceux qui tiennent, que la poësie ne rid point ailleurs, comme elle faict en un subject folatre et desreglé.
Ces vingt neuf sonnetz d’Estienne de la Boëtie qui estoient mis en ce lieu ont esté despuis imprimez avec ses oeuvres.
Montaigne, Essais, Livre I, chap. XXVIII. (Les sonnets ne figurent que dans la 1ère édition des Essais)
[3] L’édit de tolérance, signé par Charles IX en janvier 1562.
[4] Autres transcriptions : "les ignorants", "les ignorants encroûtés".
[5] On peut toujours lire la version de ce texte qu’un nommé Hermès, déguisé en jardinier, cite dans L’étoile des amants (Gallimard, coll. blanche, p. 94, mais vous l’aviez remarquée) :
« Il s’en trouve toujours certains, mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne peuvent se retenir de le secouer, qui ne s’apprivoisent jamais à la sujétion et qui, comme Ulysse cherchait par terre et par mer à revoir la fumée de sa maison, n’ont garde d’oublier leurs droits naturels, leurs origines, leur état premier, et s’empressent de les revendiquer en toute occasion. Ceux-là, ayant l’entendement net et l’esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme les ignorants, de voir ce qui est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni devant. Ils se remémorent les choses passées pour juger le présent et prévoir l’avenir. Ce sont eux qui, ayant d’eux-mêmes la tête-bien faite, l’ont encore affinée par l’étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde, l’imaginent et la sentent en leur esprit, et la savourent. Et la servitude les dégoûte, pour si bien qu’on l’accoutre. »




 Version imprimable
Version imprimable Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



2 Messages
La servitude volontaire, un « doux servage »
Les Déesses (nom générique de toutes les femmes supèrieures et qui n’indiquait alors que les qualités morales inhérentes au sexe féminin) avaient toutes un peuple d’affidés (« a » préfixe, « fides », foi) qui portaient sur eux, à découvert, l’emblème de leur dévouement. Chez les Celtes, les dévoués de la Déesse Néhal-Ennia portaient un anneau, et c’est du nom de la Déesse « Ennia » qu’on fît annulus (anneau).
Dans les pays où la Déesse était une Magicienne faisant des choses merveilleuses (des guérisons, des travaux de « fée ») qu’on désigne par le mot sortilège, l’anneau qui lie à elle s’appelle sortija.
Ceux qui portaient un collier autour du cou, appelé cadena ou catena (chaîne), étaient les Catanes, et ce nom resta longtemps pour désigner celui qui fait partie d’un ordre et en porte le cordon. La chevalerie, qui est le culte primitif, a toujours représenté les chevaliers, initiés à la doctrine, munis d’un cordon qui est l’insigne de l’ordre. Ce cordon représente le lien moral qui attache l’homme à la Divinité, comme le cordon ombilical attache l’enfant à sa mère. Le mot « Europe » le désigne également (Eu, lien ; rope, corde, cordon, lien, ligature). Cette corde a fait cordial, lien du cœur.
Les affiliés de la Déesse Mâ-Bog (qui a donné son nom à la ville de Maubeuge) avaient, imprimée au cou, la marque du collier.
La Déesse Bendis a des serviteurs qui s’appellent Bendès, Bender, ce qui veut dire lier. Dans la langue phénicienne, la discipline se dit « Iaca ». De ce mot dérive Jugum (joug), servitude volontaire, ainsi que l’oriental yogi (religieux), et « jacha huaca », la maison disciplinée de Cusco.
Yago (dont les Catholiques feront Santiago) est un ancien nom donné au joug druidique chez les Callaïques (en Galice). Les initiés portaient le collier de l’ordre, Torques, ce qui est l’origine de la légende populaire qui donne pour disciple au patron de l’Espagne (Santiago de Compostelle) San Torcuato.
Théophile Cailleux, qui voit la source de toute civilisation chez les Celtes, dit dans son livre (Origine celtique de la civilisation) : « Le principe de servitude volontaire ne se borna pas au pays des Celtes ; la discipline druidique se répandit partout, jusque sur le continent américain, jusque dans les îlots les plus reculés de l’Océanie. »
Il était des Déesses, comme Bhâvani aux Indes, dont le culte était continué par une série indéfinie de Prêtresses. Elle était surnommée « Dordji Pa Mou », c’est-à-dire Sainte Mère.
« En considérant la Sainte Mère au Tibet, dit M. Cailleux, il est facile de voir ce que furent, dans les temps druidiques, les Abbesses de nos Monastères. Bhâvani habite un palais tout entouré de chapelles et de couvents ; quand elle sort, on la porte sur un trône ; les thuriféraires la précèdent, une foule pieuse et dévote se prosterne devant elle pour baiser le sceau qui sanctionne ses décrets. Elle possède donc encore dans toute leur plénitude les immortelles prérogatives de la Divinité.
« Ses antiques sœurs des pays occidentaux, au contraire, sont depuis longtemps dépossédées de leur premier état, rentrant peu à peu dans la simple nature humaine. Elles n’étaient plus, dans ces derniers temps, malgré le faste qui les entourait, que de simples mortelles ».
Il est impossible de citer toutes les Déesses qui furent honorées sur cette terre d’Europe, dont le nom est celui d’une femme ; le nombre en est immense, parce que la plupart des femmes prenaient un rôle dans cette jeune activité humaine qui n’était pas encore entravée, et le mot Déesse les désignait toutes comme le mot Fée.
Donc, la religion des Celtes avait un idéal élevé. Les Druidesses qui l’enseignaient avaient un grand prestige ; le peuple les croyait douées d’un pouvoir surnaturel. Leur souvenir se confond avec celui des Fées.
La parure d’un Celte était son collier ; il le portait en ambre ou en or, et ne le quittait jamais. On alla même jusqu’à enterrer les morts avec leurs colliers, et dans les tombes on retrouve encore les aïeux parés de cette marque de noble servitude. Le collier indique que l’on fait partie du parti de l’ordre, c’est pour quoi on disait « collier de l’ordre ».
Les Druides, qui étaient les affidés des Druidesses, portaient un collier d’or, Torques en celte, d’où Torquatus (voir Garciles, Histoire des Incas).
La vie morale était tout dans cette société antique. Le lien qui unissait les hommes à la femme était la base de la domination de soi-même qui élève l’homme.
Le mot serf indiqua d’abord la soumission volontaire des hommes liés à la Déesse. Ce lien, fait d’affection, de tendresse, était si heureux qu’on le désignait par ces mots : « un doux servage ».
Voir en ligne : La servitude volontaire, un « doux servage »
Je surfais récemment sur la vidéo plus ou moins célèbre, et libre de droits, de JF Brient, dénonçant la servitude moderne comme servitude volontaire, renouant avec les thèses de La Boétie, le petit prodige de la philosophie politique du 16° siècle. La vidéo de JF Brient, on doit le reconnaître, manifeste une terrifiante beauté métaphysique, tout en dénonçant avec justesse l’auto-aliénation des masses et plus particulièrement du salariat. Je ne suis pas sûr toutefois qu’elle prolonge suffisamment l’ ?uvre remarquable de La Boétie.
La vidéo, sorte de nouveau Discours de la servitude volontaire mis en image, en reste à une sorte de contemplation morose, et c’est d’ailleurs ce qui fait sa beauté.
Il me semble cependant que dénoncer la servitude volontaire d’aujourd’hui, particulièrement celle du salarié qui vit encore dans des pays vaguement démocratiques, ne sert pas à grand-chose si on ne valorise pas en même temps le nécessaire contrepoids à l’exploitation et à l’oppression des travailleurs qu’est le syndicalisme (il faut relire la Charte d’Amiens à ce sujet). La liberté syndicale ne s’usant que si l’on ne s’en sert pas, c’est encore et toujours de la responsabilité du salarié, s’il laisse se dégrader le syndicalisme en n’y participant pas.
En clair, la syndicalophobie de masse (à ne pas confondre avec l’antisyndicalisme classique des gouvernements et du patronat) constitue la forme la plus achevée, la plus navrante et la plus effrayante aussi de la servitude volontaire. Jamais les salariés n’ont été autant exploités ; jamais comme aujourd’hui, cependant, ils n’ont autant méprisé leur propre outil de revendication : l’organisation syndicale sur le terrain.
En clair, à l’heure actuelle, une philosophie politique qui se contenterait de déplorer les excès du capitalisme libéral sans jamais s’interroger une seule fois sur la nécessité de l’outil syndical, cette philosophie politique, dis-je, resterait abstraite, imprécise et, pour tout dire, sans aucun effet pratique.
LP Roche
Professeur de philosophie
Responsable syndical
Auteur de SYNDICALOPHOBIES, L’horreur syndicalophobe ou les nouveaux visages de la servitude volontaire
En ce qui me concerne, j’ai appliqué le conseil de Philippe Sollers : relire La Boétie. J’ai essayé d’inscrire ma réflexion entre La Boétie et un certain retour au pansyndicalisme.
Voir en ligne : SYNDICALOPHOBIES, L’horreur syndicalophobe ou les nouveaux visages de la servitude volontaire