« En exergue, ce passage d’une lettre de Heidegger à Jaspers, datée du 21 septembre 1949 : « Il me semble essentiel que vous pensiez comme temps axial cette simultanéité, ce parallélisme entre les anciens siècles chinois, indiens et occidentaux. Il s’y cache un axe monde qui pourrait un jour devenir le gond dans lequel tournera la technique-monde moderne. » [...] Heidegger procède souvent par allusions transversales. En général, elles s’expliquent en liaison avec les dates. Ici, nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale, et la Troisième est alors en cours, sous le nom de « guerre froide ». Nous sommes maintenant dans la Quatrième : Technique et Terreur. » (je souligne. A.G.)
Philippe Sollers, Poker, entretien avec Ligne de risque, 2005.
Technique et Terreur : n’est-ce pas exagéré ? Demandez au peuple ukrainien.
Le 18 novembre 1953, Martin Heidegger prononce sa conférence sur La question de la technique où on peut lire cette phrase encore impensée :
« L’essence de la technique n’est absolument rien de technique. »
Faut-il encore citer Heidegger ? 30 octobre 1955 :
« [...] Si l’on réussit à maîtriser l’énergie atomique, et on y réussira, un nouveau développement du monde technique commencera alors. Les techniques du film et de la télévision, celles des transports, en particulier par air, celles de l’information, de l’alimentation, de l’art médical, toutes ces techniques telles que nous les connaissons aujourd’hui ne représentent sans doute que de premiers tâtonnements. Personne ne peut prévoir les bouleversements à venir. Mais les progrès de la technique vont être toujours plus rapides, sans qu’on puisse les arrêter nulle part. Dans tous les domaines de l’existence, l’homme va se trouver de plus en plus étroitement cerné par les forces des appareils techniques et des automates. Il y a longtemps que les puissances qui, en tout lieu et à toute heure, sous quelque forme d’outillage ou d’installation technique que ce soit, accaparent et pressent l’homme, le limitent ou l’entraînent, il y a longtemps, dis-je, que ces puissances ont débordé la volonté et le contrôle de l’homme, parce qu’elles ne procèdent pas de lui.
Mais c’est encore un trait nouveau du monde technique que l’extrême rapidité avec laquelle ses réussites sont connues et publiquement admirées. Ainsi, ce que je suis en train de vous dire au sujet du monde technique, chacun peut le relire aujourd’hui dans un illustré habilement dirigé ou l’entendre à la radio. Mais... c’est une chose que de lire ou d’entendre dire ceci ou cela, c’est-à-dire d’en prendre seulement connaissance ; et c’en est une tout autre que d’en acquérir la connaissance, c’est-à-dire de l’appréhender par la pensée. [...] » (je souligne. A.G.)Martin Heidegger, Gelassenheit, 1955.
Si cela est vrai (et cela est vrai), il faut lire de toute urgence Technopolitique. Comment la technologie fait de nous des soldats. Et défendre, comme son auteure, Asma Mhalla, le « retour du politique » face au péril des démocraties.



Technopolitique
Comment la technologie fait de nous des soldats
Asma Mhalla
Intelligence artificielle, réseaux sociaux, implants cérébraux, satellites, métavers… Le choc technologique sera l’un des enjeux clés du XXIe siècle et les géants américains, les « BigTech », sont à l’avant-garde. Entités hybrides, ils remodèlent la morphologie des États, redéfinissent les jeux de pouvoir et de puissance entre nations, interviennent dans la guerre, tracent les nouvelles frontières de la souveraineté. S’ils sont au cœur de la fabrique de la puissance étatsunienne face à la Chine, ils sont également des agents perturbateurs de la démocratie. De ces liens ambivalents entre BigTech et « BigState » est né un nouveau Léviathan à deux têtes, animé par un désir de puissance hors limites. Mais qui gouverne ces nouveaux acteurs privés de la prolifération technologique ? A cette vertigineuse question, nous n’avons d’autre choix que d’opposer l’innovation politique !
S’attaquant à tous les faux débats qui nous font manquer l’essentiel, Asma Mhalla ose ainsi une thèse forte et perturbante : les technologies de l’hypervitesse, à la fois civiles et militaires, font de chacun d’entre nous, qu’on le veuille ou non, des soldats. Nos cerveaux sont devenus l’ultime champ de bataille. Il est urgent de le penser car ce n’est rien de moins que le nouvel ordre mondial qui est en jeu, mais aussi la démocratie.
 Docteure en études politiques, Asma Mhalla est chercheure au Laboratoire d’Anthropologie Politique de l’Ehess. Politologue spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la Tech et de l’IA, elle conseille gouvernements et institutions dans leur politique publique technologique. Elle a produit et animé, à l’été 2023, l’émission « CyberPouvoirs » sur France Inter qui a été très remarquée.
Docteure en études politiques, Asma Mhalla est chercheure au Laboratoire d’Anthropologie Politique de l’Ehess. Politologue spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la Tech et de l’IA, elle conseille gouvernements et institutions dans leur politique publique technologique. Elle a produit et animé, à l’été 2023, l’émission « CyberPouvoirs » sur France Inter qui a été très remarquée.
Réseaux sociaux et satellites, intelligence artificielle et métavers, implants cérébraux et réalités augmentées… Nos sociétés sont-elles armées pour le monde d’après ? C’est la question vertigineuse posée par l’essai d’Asma Mhalla. Interviews.




J’ai bien étudié comment je pourrais comparer
Avec le monde cette prison où je vis.
William Shakespeare, Richard II

Introduction

Comment comprendre les nouvelles formes de pouvoir qui s’articulent autour de la question technologique et en particulier, autour des BigTech, géants technologiques hybrides et inclassifiables ? Quelles clés de lecture apposer à des jeux de puissance parfois dangereux, cristallisés autour des nouvelles conflictualités cyber et de néo‑guerres augmentées d’intelligence artificielle ? Comment saisir les contours distordus de la souveraineté par cette nouvelle répartition des clés de pouvoir ? Quelles architectures démocratiques inventer, quelles libertés nouvelles imaginer ? Telles sont quelques‑unes des questions que le choc technologique nous enjoint d’investiguer.
Dans Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable, Romain Gary faisait remarquer que « le monde meurt de l’envie de naître. Notre société s’est épuisée à réaliser les rêves du passé […] Le vingtième siècle n’a pas préparé le vingt et unième ». Comme un écho à Gary, Alain Touraine, dans Le Nouveau Siècle politique, nous invitait à enjamber ce dernier, à acter la vétusté de nos logiciels politiques. Mais paradoxalement il m’apparaît que c’est précisément lors des grands bouleversements que les positions acquises se figent, défensives. Si le premier réflexe est le rejet de l’inconnu, nous devrons inéluctablement renoncer à quelques prêts‑à‑penser automatiques, accueillir un réel complexe et perturbant dont on ne détient pas les codes, imaginer une identité politique sur mesure pour de nouveaux acteurs étranges qui émergent (BigTech) ou qui mutent (l’État), proposer de nouveaux repères collectifs pour nos démocraties vacillantes, principal objet de ma réflexion.
Le siècle qui se déploie brutalement est turbulent, chaotique mais aussi intellectuellement stimulant en ce sens qu’il implique la fin des dogmes anciens et par conséquent la fabrication de catégories politiques nouvelles. Il signe le retour en force du politique. Pour décrypter ce qui se joue autour de ces cyber‑puissances, cet essai propose un nouveau champ d’analyse multi‑disciplinaire, la technopolitique.
À partir des années 2010, le terme « technopolitics » apparaît dans la littérature anglo‑saxonne, plus rarement dans les textes francophones. Il est alors employé pour qualifier la prise en main des technologies numériques, réseaux sociaux en tête, à des fins de mobilisations ou de conquête politique par les citoyens, d’empowerment. La technopolitique, telle que je la conçois, se situe quant à elle au niveau de la compréhension des grands systèmes politiques et idéologiques. Elle n’est pas fille de la techno‑critique traditionnelle, ou plutôt pas uniquement. Les terrains de jeu et de réflexion entre technologie et politique sont évidemment nombreux, ce champ conceptuel n’est pas nouveau. Mais le travail est‑il terminé pour autant ? La technopolitique poursuit une partie de ce travail critique, au sens premier de la mise à distance de son objet, sans confondre technocritique et technophobie.
La technopolitique est une multidiscipline au croisement de l’économie et du droit, de la philosophie et de la théorie poli‑ tique, des relations internationales et de l’histoire, du cyber et de la Tech. Aux États‑Unis, on aurait appelé cela des studies.
Il me semble crucial de faire émerger ces studies que je définis comme technopolitiques en tant que champ d’étude propre pour appréhender ces objets hybrides que sont les BigTech, les nouvelles structures de pouvoir qu’ils dictent en lien avec le BigState comme alter ego, les expressions stato‑militaires de la cyberpuissance, les glissements démocratiques qu’ils induisent, l’idéologie qu’ils abritent : le projet de Technologie Totale. Assez simplement, la Technologie Totale est l’idée que la technologie porte un projet politique, idéologique, total par sa volonté de puissance et de contrôle hors limites. On ne peut en attraper les ramifications par un seul bout, à travers un seul prisme, sur d’étroits couloirs d’expertise. La pensée doit se déployer. Autrement, nous passerions à côté de notre époque.
Par les technologies de l’hypervitesse, une ère nouvelle s’ouvre, celle de la symbiose, fusion organique entre des entités ou des notions qui s’adaptent, survivent et co‑évoluent. La symbiose n’est pas un simple croisement, elle est plus radicale et plus dangereuse aussi. La technopolitique tente de s’emparer de ces phénomènes, de mettre à distance les lamentos habituels pour poser un diagnostic possible du recul démocratique, propose quelques pistes de réflexion pour résoudre ces équations (géo) politiques qui s’imposent à nous de façon si urgente.
Pour saisir ces phénomènes symbiotiques, on ne peut figer la pensée alors que le monde, lui, se métamorphose. À une époque où notre « singularité humaine » serait remise en cause par des technologies artificielles de plus en plus puissantes, c’est justement là notre force d’humains. S’il faut penser avec nos figures tutélaires, il ne faut pas non plus oublier de les oublier, sortir des routes balisées, prendre des chemins de traverse, marquer la rupture, penser contre soi, s’aventurer ailleurs. Quitte à se tromper. Cette pensée vivante est une condition de survie. Cela suppose de transformer notre rapport à la connaissance, à sa construction, à sa diffusion, à son partage. Il existe assurément une faim de savoir, un besoin de donner du sens à cette aube encore brumeuse de XXIe siècle. Apaiser, calmer les peurs irrationnelles et les paniques préfabriquées, proposer des clés de décryptage et quelques balises pour ne pas se perdre dans l’épais brouillard qui nous enveloppe, pour raisonner plutôt que d’avoir peur. Ce voyage, entre théorie et pratique, ancré dans l’ultra‑contemporanéité des événements de notre époque n’est pas une réflexion technique d’expert. Ce dont je veux vous parler ici, c’est d’une vision globale, une vision‑système. Une vision politique, forcément la mienne, forcément subjective, qui tente de se confronter à quelques‑uns de nos impensés, coincés entre technologie et politique.
Malgré les doutes et les interrogations, voilà l’intention de Technopolitique. Franchir le nouveau siècle et poursuivre le travail. Avancer et espérer. Défendre le « retour du politique ». Réactiver la promesse de progrès, celui des sciences et de la connaissance, celui de la justice, à la condition expresse de « dépasser sa propagande » disait Paul Virilio. Tel est le projet de Technopolitique.

L’Histoire repart pour un tour :
morcellement du monde et nouvelles rivalités
En 1989, Francis Fukuyama affirmait que nous étions arrivés à la fin de l’Histoire. Une thèse provocante à comprendre dans le contexte de l’époque : la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, la victoire du modèle des démocraties libérales sur un communisme moribond. Au‑delà de la punchline, il fallait comprendre la fin de l’Histoire comme la fin des idéologies, ou plutôt de leur confrontation, « le point final de l’évolution idéologique de l’Humanité », le triomphe du modèle libéral mondialiste, l’hégémonie de « l’hyperpuissance » américaine. L’affaire semblait entendue. Nous aurions dû nous méfier, l’histoire n’est rythmée que de surprises, d’accidents, de contre‑exemples : des puissances émergent, dominent puis s’effondrent, d’autres apparaissent, dans un éternel recommencement, ou presque.
L’Histoire a décidé de se remettre en mouvement. Un nouveau couple s’affronte. Cette fois, ce ne sont plus les États‑Unis contre le bloc soviétique ou l’« axe du mal » post‑11 Septembre, mais face à la Chine. La rivalité alimente abondamment chroniques, auditions, colloques, conférences, dîners, tables rondes, émissions TV, etc., la panique et l’excitation sont de retour. Il se passe de nouveau quelque chose !
Si la rivalité stratégique sino‑américaine dessine la trame de fond, l’Histoire a décidé de s’énoncer aussi autour d’un monde multipolaire aux coalitions fluides, aux interdépendances économiques profondes, aux velléités de désoccidentalisation et de décentrement. Dans le désordre du monde, des axes alternatifs tentent de se structurer avec l’ambition de fédérer une partie du reste du monde, en rupture croissante avec l’Ouest. L’Occident a perdu son monopole, une partie de son influence, mais pas sa puissance. Superpuissances et puissances régionales se provoquent, se testent, se tournent autour. Et une petite musique lancinante, simpliste, dangereuse remonte doucement, celle du « choc des civilisations » que Samuel Huntington livrait en 1996. Au fond, qu’appelle‑t‑on désormais « Occident » dans cette recomposition mondiale en réseau, gigantesque toile d’araignée faite de rivalités, d’intérêts et d’interdépendances ? Le crépuscule d’un monde que l’on avait rêvé sage et lisse force les démocraties occidentales à réinventer leur modèle, à redéfinir leur place. Or la question technologique est au cœur de ces rapports de forces. Les rivalités se cristallisent autour d’une compétition technologique à couteaux tirés entre Chine et États‑Unis. Intelligence artificielle civile, reconquête de l’espace, climate tech, chiffrements quantiques et post‑quantiques, armes autonomes et systèmes d’intelligence artificielle à usages militaires… La compétition se fait à tous les niveaux, à coups de pression, de coercition, de coopération, d’alliances nouvelles, de menaces. En étau entre la Chine et les États‑Unis, l’Europe, l’Inde, la Corée du Sud et d’autres encore aspirent à « en être », se positionnent pour jouer leur partition dans la recomposition du monde.
Diffraction de l’espace-temps et schizophrénie du système
Au cœur de ces jeux de puissance, pour le moment à somme nulle, entre les deux technopuissances américaine et chinoise, le rôle des acteurs technologiques, les BigTech, est nodal. Avec la question climatique et celle des inégalités, les chocs technologiques tricotent le troisième nœud de tension de nos années 1920. Ils façonnent la nature de cette rivalité titanesque, modèlent le futur du monde par la maîtrise technologique et la norme, redéfinissent au passage nos représentations politiques. Étrangement, la singularité des dilemnes technologiques mettent en lumière les deux autres affaires.
En ce qui concerne la question climatique, est apparue cette croyance d’une climate tech qui résoudrait toutes nos difficultés ou à peu près. C’est ainsi que nous procédons : domestiquer nos problèmes par la technique, construire des voies de progrès (a minima celui de la connaissance), par notre volonté de comprendre, de maîtriser. Mais cette recherche du bien commun, d’aucuns diraient de l’intérêt général, et de la connaissance est aujourd’hui privatisée, soumise à des critères de concurrence et de rentabilité rapide. Cela peut accélérer l’innovation de rupture ou au contraire la retarder. Comment concilier technologie et climat en s’évitant le faux raccourci des pensées magiques ? Ce n’est pas le fléchage de subventions publiques ou les fonds de venture capital qui peuvent, à eux seuls, le déterminer. D’autant que les BigTech, à l’image d’Elon Musk, de ses voitures électriques et de ses satellites multiusages, vont compter dans cette nouvelle équation climato‑technologique. Même constat en Chine, la technologie serait là aussi la solution. À l’exception d’un solutionnisme technologique simpliste, les doctrines ne sont pas encore claires à ce sujet.
Plus étonnant encore, persiste une schizophrénie du système qui semble ne plus pouvoir s’arrêter tant que la catastrophe n’a pas lieu. Notre système n’a pas résolu ses contradictions internes : l’innovation pour l’innovation sans autre finalité qu’elle‑même, sans considération réellement sérieuse de ses externalités négatives, que ce soit en matière de ressources qui se raréfient, de métaux rares, en amont de la chaîne de valeur technologique mondiale, ou de production des déchets en aval. Pourtant, le coût énergétique de ces technologies est exponentiel et les études à ce sujet s’accumulent : consommation continue des data centers en électricité et en eau de refroidissement, des supercalculateurs super‑énergivores pour entraîner sans interruption les algorithmes, des interfaces matérielles (PC, smartphones, casques ou lunettes de réalité augmentée, etc.) rendues rapidement obsolètes. L’explosion des usages qui résulte de la démocratisation des IA génératives démultiplie incommensurablement le problème. La géopolitique des ressources et la militarisation des approvisionnements n’arrangent rien – la Chine contrôle par exemple gallium, germanium et graphite nécessaires à l’industrie des semi‑conducteurs.
Toutes ces technologies se valent‑elles ? Sont‑elles toutes si vitales pour nos existences au point que l’on ne puisse envisager de vivre sans elles ? Ne peut‑on faire un tri raisonnable entre technologies primordiales et non essentielles ? Je ne fais ici que partager des questions qui me taraudent sans que cela soit l’objet de cet essai et sans avoir réussi à stabiliser une réponse ferme et définitive. Toujours est‑il que l’impact environnemental est faramineux, au moment même où, dans un univers parallèle, la fin du monde nous est présentée comme imminente. D’un excès à l’autre, où devons‑nous nous situer ?
Quant à la question des inégalités, le coup de projecteur de la technologie devient miroir grossissant. La technologie, comme toujours, fait prendre aux phénomènes des dimensions extraordinaires : elle ne met pas seulement en lumière les inégalités et les discriminations qu’elle peut contribuer à amplifier, c’est plus que cela encore : elle distend l’espace‑temps. Elle fait cohabiter des super‑technologues partis à la conquête de l’avenir et de l’univers et dans le même temps des images d’embarcations de fortune qui coulent dans la Méditerranée ou des scènes de guerre de tranchées semblant sortir d’un autre siècle. La technologie hypermoderne polarise non seulement les individus et les sociétés, mais elle polarise surtout la perception du monde, fragmente le réel. Elle diffracte l’unicité du temps. Elle structure et détache des scènes d’un présent plus proche du Moyen Âge que de notre hyper‑modernité et des images qui semblent, elles, tout droit sorties d’un futur de science‑fiction. Mais entre ces deux points cardinaux, où se trouve notre présent à nous ? Une partie de notre malaise, nos résistances, nos peurs proviennent sans doute de cet éclatement spatio‑temporel. Un espace‑temps fracturé en deux, deux dimensions qui ne se croisent plus. À quel monde, appartenons‑nous ?
BigTech versus BigState
Pour répondre à la question, encore faudrait‑il savoir dire de quoi ce « monde » est fait. Depuis le tournant des années 2010, les géants technologiques, les BigTech, redéfinissent méthodiquement la morphologie d’à peu près toutes nos représentations politiques collectives : « État », « démocratie », « souveraineté ». Ils questionnent radicalement ces dogmes hérités des siècles passés pour en définir une nature nouvelle.
Au sein des démocraties libérales, les BigTech pour la plupart américains appuient là où ça fait mal, sur ces bascules conceptuelles et civilisationnelles. On peut aisément penser ici à Meta (ex‑Facebook), la galaxie Elon Musk (SpaceX, Tesla, Neuralink, X), Amazon, Alphabet (maison mère de Google), Microsoft, Apple, OpenAI dans le champ des intelligences artificielles génératives, mais aussi à la sulfureuse Palantir, leader dans l’intelligence artificielle et le traitement massifié de la donnée, ou encore à la confidentielle mais stratégique Anduril dans le secteur de la défense américain. La très polémique Tiktok, aux origines chinoises, joue, elle aussi, sa partition occidentale.
Dans mon acception du terme « BigTech », il ne s’agit pas tant d’égrener de traditionnels indicateurs financiers ou économiques que d’appréhender, plus qualitativement, la portée de la puissance technologique intrinsèque de ces nouvelles entités, à la fois acteurs économiques mais aussi sociaux, politiques, militaires, géopolitiques. Les BigTech sont avant tout des acteurs‑systèmes, à la fois instables, volatiles et structurels, qui participent « systémiquement » à conditionner les structures de pouvoir contemporaines dont nous peinons encore à prendre la mesure endémique. Le système capitaliste semble être arrivé à son paroxysme : les BigTech ne sont pas des acteurs du système, ils sont à la fois l’infrastructure – la condition du nouveau système économique – et la superstructure, en tant qu’entités idéologiques et politiques. Ils agissent comme les propriétaires de technologies‑systèmes qui bouleversent le monde physique et l’économie – un monde tout sauf virtuel, mais bel et bien hyper‑ industriel comme le soulignait l’économiste Pierre Veltz. Ils structurent aussi et en même temps la sphère immatérielle qu’est le cyberespace comme ultime espace de création de richesse et de conflictualités. En somme une extension du domaine de la guerre, sa cinquième dimension.
En miroir des BigTech, j’aimerais introduire le concept de « BigState », qui m’a été utile pour formaliser ces nouvelles formes de pouvoir qui sont en train de se mettre en place. Le BigState est cet État omnipotent qui irrigue et permet le fonctionnement des technopuissances mondiales (États‑Unis, Chine) ou plus régionales. Le BigState n’est pas un état libéral au sens classique du terme, il n’est pas caractérisé par un repli passif sur son périmètre régalien ou astreint à la simple mission de fluidification du marché. Sans grande surprise désormais, il peut parfaitement être politiquement ultra‑autoritaire et économiquement hyper‑libéral dans le même temps. Le BigState est donc cet État fort qui porte des velléités à la fois de force et de puissance, qui combine le pouvoir (sur) et la puissance (de) car pouvoir n’est pas toujours puissance, la distinction conceptuelle, que je tiens de Raymond Aron, est importante à garder en mémoire. Par exemple, cette ambivalence vis‑à‑vis de la technologie est particulièrement saillante quand on en vient aux penchants technosécuritaires des démocraties occidentales au prix d’une contorsion édifiante de l’État de droit. Dans le champ militaire, mus par les rivalités entre pôles, les BigStates n’hésitent pas à poursuivre le développement d’armes autonomes et d’intelligences artificielles militaires sans réelle réflexion politique ou éthique. Pour le dire simplement, le BigState est l’alter ego public des BigTech en termes d’intention, d’ambition, de projet.
Il structure un système qui s’apparente à une forme de libéralisme autoritaire ou de despotisme doux tocquevillien, selon le point de vue que vous privilégierez. On notera que seuls des BigStates puissants, systémiques (États‑Unis, Chine prioritairement) ont été capables d’engendrer des BigTech, s’irriguant, se nourrissant mutuellement. Je reviendrai plus tard sur la nature de ces liens, basés sur une certaine conception du capitalisme orienté par le politique, des liens que je qualifie d’intimes.
La fin d’une certaine conception de la souveraineté
En lien avec le BigState américain, les BigTech participent activement à la fabrique de la technopuissance étatsusienne et se positionnent désormais comme bras armés technologiques de leur pays à la fois dans le soft et le hard power. Pensez par exemple au rôle de premier plan qu’ont joué Microsoft, Starlink (les satellites en orbite basse d’Elon Musk) ou Amazon dans la guerre en Ukraine, rôle qui laisse entrevoir la naissance possible d’un complexe techno‑militaire américain, structuré autour de ces entités hybrides, à la fois entreprises privées, militaires et géopolitiques. Pourtant, ce continuum est loin d’être sans coutures, il est rythmé de scandales et de couacs. Chaque BigTech aura son appréhension propre de sa participation, ou non, à l’empowerment militaire américain. Sous pression de leurs collaborateurs, Meta ou Google auront plus de difficulté à afficher leur coopération que Musk ou Palantir qui, eux, sont dans les starting‑blocks. L’État fédéral quant à lui oscille entre une régulation parfois nécessaire – notamment dans le champ de l’anti‑trust ou de l’IA – et le besoin d’une innovation technologique débridée comme instrument de domination et de puissance. Mais sur le principe, l’immixtion grandissante des BigTech au cœur du régalien est‑ elle une dérive à corriger ou bien le « sens de l’histoire » ? La lecture de l’actualité immédiate pourrait faire croire à une défaillance grave des États, mais si, sur le temps long, se jouait au contraire quelque chose de bien plus structurel ?
Les géants technologiques diluent, ou plutôt liquéfient, le concept traditionnel de « souveraineté » jusque‑là exclusivement dévolu aux États. J’emprunte à dessein l’idée de liquidité de Zygmunt Bauman car l’image de liquéfaction de la souveraineté, dont on ne sait plus bien où elle commence et où elle se termine, est en train de s’agencer à grande vitesse. Le constat de cette liquéfaction fait l’objet de grandes résistances. Or, nier un problème, c’est renoncer à le résoudre. Il va pourtant bien falloir dompter ces nouvelles formes de pouvoir qui érodent nos conceptions fondatrices.
Vers des démocraties militarisées
Conséquence directe de cette liquidité toute souveraine, la puissance technologique des BigTech est devenue nécessaire à l’État américain dans la compétition stratégique qui l’oppose à la Chine. Par ces mêmes technologies par nature duales, à la fois civiles et militaires, les BigTech agissent comme des agents perturbateurs de la démocratie.
Une première perturbation provient de la privatisation et de la fragmentation marchande de l’espace public autour des réseaux sociaux, aujourd’hui, des métavers demain. Les réseaux sociaux ont glissé vers un fonctionnement antidémocratique. Si l’on prend l’exemple de X/Twitter, le constat est particulièrement vrai : le réseau social est devenu un espace public d’influence, mais propriété privée d’un techno‑tycoon, Elon Musk, portant une vision maximaliste de la liberté d’expression et, au fond, de la liberté tout court au mépris de celle des autres. Dans un autre registre, ces mêmes BigTech accaparent des systèmes d’intelligence artificielle livrés au plus grand nombre sans plus de précaution. On peut penser aux IA génératives de contenus (textes, voix, codes, vidéos, images, etc.) dont les usages ont explosé depuis la mise sur le marché mondial de ChatGPT à la fin de l’année 2022. La sophistication des nouvelles IA, essentiellement en matière d’expérience d’usage et donc d’acceptabilité sociale fulgurante, charrie avec elle d’innombrables problèmes pour les démocraties : massifier l’industrialisation de la désinformation, mettre au point en un temps record des cyberattaques d’envergure ou des armes bactériologiques, être exposé à des savoirs fabriqués, privatisés par des BigTech qui y injectent leur vision du monde. La « bataille culturelle de l’IA » entre Elon Musk et Sam Altman en fut une illustration parfaite, Musk accusant Altman d’avoir construit un outil « woke » qu’il combat.
Enfin, le microciblage et l’hyper‑personnalisation des contenus (l’affaire Cambridge Analytica reste à ce jour le scandale le plus frappant des capacités de manipulation des électeurs sur les réseaux sociaux à des fins idéologiques parfaitement assumées) ; la production industrialisée de fausses informations et d’opérations de désinformation (la Russie est l’un des pays stars de la désinformation, la Chine lui emboîte le pas, les États‑Unis ne sont pas en reste) ; la convergence entre les conspirationnistes « maison » (les QAnon américains par exemple) qui recyclent et s’abreuvent des narratifs et de la propagande étrangère, dopée par des BigTech faisant eux‑mêmes prévaloir arbitrairement leur propre vision du monde parfois extrême (la modération à géométrie variable de Zuckerberg ou l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter qui va vite se traduire par un appel d’air pour les comptes extrémistes séduits par sa vision maximaliste de la liberté d’expression) : tout cela risque de nous précipiter dans un gouffre politique. Chaque citoyen devient une cible potentielle de ces opérations de cyber‑déstabilisation.
Par ces technologies duales, nous n’industrialisons pas que le faux, nous accélérons la fin du système, l’implosion de démocraties par et depuis elles‑mêmes. Sans le percevoir, l’utilisateur citoyen se transforme en guerrier de l’invisible, il peut être utilisé, à bas bruit, comme cheval de Troie, agent radioactif de ces conflictualités hypermodernes qui ne disent pas leur nom. C’est tout le dilemme que posera Tiktok, réseau social extrêmement populaire auprès des jeunes occidentaux mais soupçonné par les États‑Unis d’être un outil de manipulation cognitive au service de Pékin. Les mêmes technologies, les IA génératives par exemple, qui participent à fabriquer de la connaissance peuvent être mises au service d’opérations de manipulations informationnelles et cognitives.
Si les démocraties libérales modernes continuent de se définir par la séparation des pouvoirs civils et militaires, force est de constater que, dans un contexte de permanence des guerres hybrides, la technologie brouille subrepticement cette séparation. En apparence civiles mais en réalité poreuses aux ingérences et aux manipulations personnalisées de masse, à portée de tous, addictives, les technologies civiles deviennent des armes de guerre en puissance, glissées dans votre poche en communication directe avec les failles de votre cerveau, ultime champ de bataille. En bref, la technologie est en train de militariser les démocraties, à notre insu, sans que l’on soit capable de mesurer l’amplitude de la déflagration. Chaque citoyen devient la cible d’une menace multiforme, soldat passif, malgré lui, sans comprendre réellement en quoi il devient un maillon faible, le point de contact de l’ennemi, sa courroie de transmission infra‑étatique. Posé ainsi, le sujet peut paraître sulfureux. Je crois qu’il est pourtant vital de l’énoncer en ces termes directs. Si les cerveaux sont les ultimes champs de bataille, si la démocratie, bastion des libertés, est désormais militarisée, si le vrai et le faux ne sont plus identifiables, indifféremment solubles dans la post-truth politics, si nous partons du principe, comme Hannah Arendt, que la démocratie ne peut fonctionner que si elle est construite sur une perception commune de la réalité, de faits vérifiables et discutables (au sens du débat démocratique), alors comment fait‑on pour éviter la fragmentation du corps social en bulles alternatives, comment éviter l’écroulement civilisationnel des démocraties, le retour à un état Hobbesien de violence primaire, l’arrivée au pouvoir de néofascismes ? Comment repenser la démocratie et ses anticorps dans ce monde symbiotique qui s’énonce désormais au rythme de ces technologies duales ? Dit autrement, si la réalité est une construction, alors comment gouverner des outils qui manipulent du réel pour les aligner sur notre modèle politique ?
Le risque d’un hyper-pouvoir
La dernière inconnue de nos nouvelles équations (géo) politiques tient au paradoxe de l’État pris en tenailles entre des injonctions contradictoires. Les BigTech agissent comme amplificateurs d’une forme de paranoïa d’État technosécuritaire en dotant le BigState d’instruments de pouvoir intérieur (dispositifs de technosurveillance divers, logiciels, notamment biométriques, en nombre, captation massive de données). En parallèle, la paranoïa d’État serait alimentée par la permanence de la menace notamment cyber, le pullulement d’un aréopage d’acteurs étatiques et paraétatiques hostiles, qu’ils soient politiques ou criminels ou les deux à la fois, dans le cyberespace. La militarisation subreptice du monde, de la démocratie et des esprits, la brutalisation des liens – je reprends ici à dessein le concept de brutalisation de George L. Mosse – dans cet entre‑deux qui n’est ni tout à fait la guerre ni tout à fait la paix, ressuscite le fantôme de Thomas Hobbes, la peur et la violence comme sentiments dominants, comme modalité de gouvernance. Ce risque est encouragé par notre désensibilisation à la brutalité. Or en démocratie, comment agir face à des menaces extrêmes sans nier l’esprit de la loi, l’État de droit, comment ne pas balayer nos libertés à coups d’amendements bavards commandés par l’urgence ? C’est au tréfonds de ces tergiversations que réside ce paradoxe existentiel de l’État démocratique qui possède – aussi – les moyens du pire, la tentation d’un hyper‑pouvoir qui risque de faire drastiquement vriller le projet de « liberté politique » vers une logique contre‑insurrectionnelle.
L’État contre son peuple. Et inversement.
Dès lors, le prix à payer de la puissance serait‑il un hyper‑pouvoir antidémocratique ? La technopuissance est‑elle en train d’achever ce qui reste de nos démocraties libérales ou participe‑ t‑elle au contraire à la redéfinir en contre‑modèle possible aux techno‑autoritarismes ? Tout le paradoxe de la puissance du XXIe siècle est là. Cet enchevêtrement d’acteurs, d’intérêts publics et privés peut rapidement devenir destructeur pour les États‑Unis, et par ricochet pour l’Europe qui en dépend technologiquement. Face à cette équation complexe, en tiroirs, à inconnues multiples, nous devons déplacer le regard, changer de grille de lecture pour redéfinir les contours de l’État et de sa souveraineté, pour nous remettre d’accord sur un nouveau récit démocratique. Il ne s’agit rien de moins que de réconcilier le trilemme infernal : pouvoir, puissance et démocratie.
L’urgence est autant politique que militaire car, à moins d’un accident de l’Histoire dont nous ne sommes certes pas à l’abri, États‑Unis et Chine seront à court terme deux technopuissances équivalentes, difficiles à départager autrement que par les récits et les idées, l’idéologie et le politique. Il nous revient donc de réinvestir le champ politique pour réaffirmer notre modèle démocratique « avec » la technologie et non pas « contre » elle.
Méthodiquement, il nous faut construire un cadre d’analyse capable de saisir les complexités et les ambiguïtés du système technopolitique qui se dresse à l’ombre du chaos du monde. Construire le modèle pour désamorcer la menace.



Nos cerveaux sont devenus l’ultime champ de bataille impact du choc technologique sur le nouvel ordre mondial
Signes des temps. Dimanche 3 mars 2024.
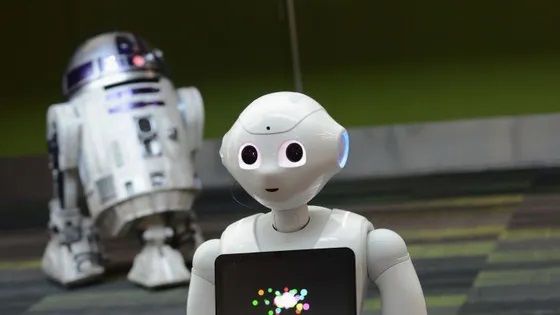
- Pepper, premier robot humanoïde
Silicon Valley ©Getty Albert L. Ortega
A l’occasion de la parution de Technopolitique : comment la technologie fait de nous des soldats aux éditions du Seuil, Marc Weitzmann s’entretient avec la chercheuse Asma Mhalla et questionne l’étroite imbrication entre les "Big Tech" et les enjeux géostratégiques. Serions-nous tous des soldats ?
Avec Asma Mhalla Spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la Tech

Avec la guerre hybride, une guerre qui se livre à la fois sur le terrain et dans le cyberspace, l’invasion de l’Ukraine a fait exploser une tendance de fond depuis le 11 Septembre 2001 : surveillés par des entreprises tentaculaires qui concurrence et collaborent avec les états, nos gestes les plus futiles, nos pensées et bientôt nos rêves aspirés par les nouvelles technologies et mis en algorithmes sont désormais partie prenante d’enjeux géopolitiques qui nous dépassent. Chaque citoyen et citoyenne, dans son individualité propre, est transformé en soldat à son insu. Nous sommes en guerre, une guerre qui ne se dit pas encore, et nos cerveaux en sont les ultimes champs de bataille.
Telle est l’une des thèses défendue par la chercheuse Asma Mhalla dans Technopolitique, son livre qui sort en ce moment et s’affirme, dans la lignée du capitalisme de Surveillance, comme l’ouvrage le plus important aujourd’hui écrit par une française pour comprendre les enjeux du nouveau siècle. A lire d’urgence.
À écouter : Trump et les réseaux sociaux, pouvoir et technologie au XXIe siècle





 Version imprimable
Version imprimable



 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


