« Qu’appelle-t-on penser ? Dans ce cours fameux de Heidegger, sans parler du fait qu’il prend appui sur Nietzsche, qu’est-ce qui vient se dire comme "esprit de vengeance" ? Le fait d’en vouloir au temps. Il y a ainsi une tendance à déprécier le passage, la "passagèreté", tout ce qui passe. Mais le moment le plus étonnant est quand Heidegger nous dit que penser reviendrait à remercier. Je remercie, donc je pense. Denken-danken. Rien n’est plus à contre-courant de l’histoire de la métaphysique elle-même. Comment dépasser le nihilisme qui est à l’œuvre comme falsification du temps ? »
Philippe Sollers, Guerres secrètes, 2007, Folio p. 369.
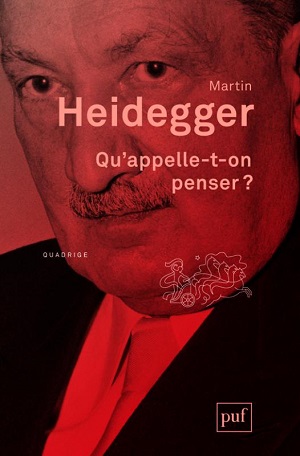 Qu’appelle-t-on penser ? de Martin Heidegger fut publié en 1954 en Allemagne et en 1959 en France, dans une traduction de Gérard Granel et Aloïs Becker.
Qu’appelle-t-on penser ? de Martin Heidegger fut publié en 1954 en Allemagne et en 1959 en France, dans une traduction de Gérard Granel et Aloïs Becker.
« Le présent ouvrage contient, sans qu’on y ait apporté de changement, le texte des deux cours, d’une heure hebdomadaire chacun, qui ont été tenus sous le même titre à l’Université de Fribourg-en-Brisgau le semestre d’hiver 1951-1952 et le semestre d’été de 1952 » écrit Heidegger dans l’Avant-propos.
Dans les leçons V à VIII, prononcées pendant l’hiver 1951-1952, Heidegger médite le mot de Nietzsche « le désert croît » et le « clignement de l’oeil » du « dernier homme » tels que Nietzsche en parle dès le Prologue de Ainsi parla Zarathoustra. Ce dernier homme, c’est l’homme traditionnel, mais aussi l’homme des « Temps modernes ». Il est « celui qui n’est plus capable de regarder au delà de lui-même ».
V
Qu’appelle-t-on penser ? Gardons-nous de l’avidité aveugle qui voudrait arracher une réponse à cette question, sous la forme d’une formule. Demeurons près de la question. Soyons attentifs à la façon dont elle demande : Qu’appelle-t-on penser ?
« Attends ! Je vais t’apprendre ce qu’on appelle obéir », crie la mère à son petit garçon qui ne veut pas rentrer. Est-ce que la mère promet à son fils une définition de l’obéissance ? Non. Mais peut-être lui donne-t-elle une leçon ? Pas non plus, si c’est une véritable mère. Elle lui apporte l’obéissance, ou mieux encore et inversement, elle portera son fils dans l’obéissance, ce qui aura d’autant plus de retentissement qu’elle grondera moins et réussira d’autant plus simplement qu’elle l’y portera plus promptement, c’est-à-dire non d’une façon qui lui permette de prendre son temps, mais d’une façon telle, qu’il ne puisse plus se passer de la volonté d’obéir. Pourquoi plus ? Parce qu’il est devenu obéissant à ce à quoi son être obéit. C’est pourquoi apprendre ne se laisse accomplir à travers aucune remontrance. Et pourtant il faut bien parfois que le maître élève la voix. Il doit même crier et crier, même lorsqu’il s’agit de faire apprendre une chose si silencieuse que la pensée. Nietzsche, qui était l’un des hommes les plus silencieux et les plus craintifs, avait le savoir de cette nécessité. Il endura la souffrance de devoir crier. Dans une décade où le public ne connaissait encore rien des guerres mondiales, où la foi dans le progrès devenait presque la religion des peuples et des États civilisés, Nietzsche a crié au-dehors ceci : « Le Désert croît. » Dans ce cri, il a interrogé les autres, et s’est interrogé avant tout lui-même : « Doit-on leur détruire les oreilles pour qu’ils apprennent à entendre avec les yeux ? Doit-on gronder comme un tambour et comme un prédicateur de carême ? » (Ainsi parlait Zarathoustra, prologue, 5). Mais énigme sur énigme : ce qui était autrefois un cri, « le Désert croît », menace de devenir bavardage. Ce qu’il y a de menaçant dans un tel renversement relève de ce qui nous donne à penser. Ce qu’il y a ici de menaçant consiste en ceci, que ce qui a été le plus pensé risque actuellement, et plus encore dans l’avenir, de se retrouver un beau matin comme simple manière de dire et de se répandre sous cette forme comme un fantôme de pensée. Cette façon de parler s’emploie à donner d’innombrables descriptions de l’état actuel du monde. Celles-ci décrivent ce qui selon son essence est indescriptible. Car cela désirerait seulement être gardé dans la pensée, qui est une sorte d’appel et qui par conséquent doit parfois devenir un cri. Dans les écrits, les cris s’étouffent facilement, et complètement lorsque l’écrire se promène dans le décrire, lorsqu’il vise à occuper l’esprit, à lui fournir toujours en quantité suffisante de la matière. Dans ce qui est fixé par écrit disparaît ce qui est pensé, si l’écrire n’est pas capable de demeurer — même encore dans l’écrit — une marche de la pensée, un chemin. A l’époque où cette parole : « le désert croît », tomba, Nietzsche écrit dans son carnet (G. W. XIV, p. 229, aph. 464 de l’année 1885) : « Un homme pour qui presque tous les livres sont devenus superficiels, qui n’a gardé encore — et cela pour un petit nombre d’hommes du passé — que la croyance qu’ils avaient suffisamment de profondeur pour ne pas écrire ce qu’ils savaient. » Mais Nietzsche devait crier. Et il ne lui restait aucune autre façon de le faire, sinon d’écrire. Ce cri écrit de sa pensée est le livre que Nietzsche intitula Ainsi parlait Zarathoustra. Les trois premières parties ont été écrites et ont paru entre 1883 et 1884. La quatrième partie fut écrite en 1884-1885, mais imprimée seulement pour un petit cercle d’amis. Cette œuvre de Nietzsche pense l’unique pensée de ce penseur : la pensée de l’éternel retour du même. Chaque penseur pense seulement une unique pensée. Cela aussi distingue essentiellement la pensée des sciences. Le chercheur a toujours besoin de nouvelles découvertes et de nouvelles idées, ou bien la science tombe dans la stagnation et la fausseté. Le penseur a besoin seulement d’une unique pensée. Et la difficulté pour le penseur est de retenir cette unique, cette seule pensée, comme ce qui est pour lui la seule chose qu’il faille penser ; c’est de penser cet Unique et ce Même, et de parler de ce Même de façon convenable. Or, nous ne parlons du Même d’une façon décente que si nous disons toujours le Même du Même, et ce de telle sorte que nous soyons nous-mêmes pris dans la requête du Même. C’est pourquoi l’absence de limites du Même est pour la pensée la plus tranchante limitation. Nietzsche le penseur indique cette décence cachée de la pensée par le sous-titre dont il a voulu accompagner son œuvre Ainsi parlait Zarathoustra, et qui déclare :« Un livre pour tous et pour aucun. » « Pour tous », cela ne veut pas dire pour chacun en tant que premier venu. « Pour tous » veut dire : pour chaque homme en tant qu’homme, pour chacun pris en soi-même en tant que dans son être il devient à soi-même mémorable. Et « pour aucun », cela signifie pour aucun de ces hommes qu’on rencontre partout, qui s’enivrent purement et simplement à des passages et des phrases de ce livre, et qui titubent à l’aveuglette de-ci de-là dans son langage, au lieu de se mettre sur le chemin de sa pensée et, avant tout, de devenir ainsi à eux-mêmes problématiques.
« Ainsi parlait Zarathoustra — un livre pour tous et pour aucun. » De quelle étrange façon devait se confirmer ce sous-titre de l’œuvre, dans les soixante-dix années qui ont suivi sa parution, mais confirmation dans une inversion exacte du sens ! Cela devint un livre pour n’importe qui, et personne qui pense ne se montre, qui soit de plain-pied avec les pensées fondamentales de ce livre et avec son obscurité. Dans ce livre, à sa quatrième partie et dernière, Nietzsche écrit cette parole :« Le désert croît. » Il a, dans cette parole, tout mis de ce qu’il savait. Car cette parole est le titre d’un lied que Nietzsche composait quand il était « au plus loin de la nuageuse, humide et mélancolique Vieille-Europe ». Cette parole en son entier déclare : « Le désert croît. Malheur à celui qui protège le désert ! » A qui s’adresse ce « Malheur ! » ? Nietzsche a-t-il ici pensé à lui-même ? Et s’il avait su que ce serait justement sa pensée qui viendrait apporter une désolation, au centre de laquelle d’abord, puis çà et là, s’ouvriraient des oasis et jailliraient des sources ? Et s’il avait su qu’il devait devenir un passage précaire qui montre vers l’avant et vers l’arrière, et qui pour cette raison est ambigu pour tout le monde, jusque dans sa nature même et son sens de passage ? Tout, si l’on réfléchit, parle pour que telle soit la nature de ce passage, comme Nietzsche lui-même le savait et comme il l’a souvent exprimé, en paroles par conséquent énigmatiques. C’est pourquoi également un dialogue de pensée avec lui se situe dans des dimensions qui deviennent toujours autres. C’est pourquoi enfin, confrontées à sa pensée, toutes étiquettes et toutes appellations sont, en un sens particulier, autant d’impossibilités. Ce qui ne signifie absolument pas que la pensée de Nietzsche soit un jeu d’images et de signes qu’on puisse à toute heure considérer comme réversibles. Le pensé de sa pensée est aussi un dans sa signification qu’aucun autre ; mais cette unicité de signification joue dans plusieurs espaces, espaces qui s’ordonnent les uns aux autres. II y a à cela une raison, c’est que dans la pensée de Nietzsche tous les motifs de la pensée occidentale, mais tous transmués, se rassemblent par destin. Cette transmutation est aussi ce qui fait qu’il est impossible à l’histoire de dénombrer ces thèmes et de leur imputer ceci ou cela dans la pensée de Nietzsche. A la pensée de Nietzsche, qui est un passage, ne peut donc répondre qu’un dialogue qui, par son cheminement particulier, prépare un passage. Dans ce second passage cependant la pensée de Nietzsche dans son ensemble doit s’inscrire encore sur l’une des rives, loin de laquelle, sur l’autre rive, ce passage suit son mouvement. Ce n’est pas le lieu de discuter cet autre passage, autre par son ampleur et par sa nature. Cette remarque doit simple ment signifier que ce passage qui se déploie avec plus d’ampleur et qui est d’une autre nature doit, certes, quitter la rive, mais en cela ne doit justement pas passer-outre, au sens où passer-outre signifie négliger. Ce passage est l’appropriation de la pensée de Nietzsche, de toute la pensée de l’Occident, dans sa vérité propre. Cette vérité cependant ne se trouve aucunement à ciel ouvert. En ce qui concerne Nietzsche, bornons-nous à rendre visible l’unique essentiel qui a brillé devant sa pensée, tandis qu’elle allait en pompe son chemin. A partir de là nous pouvons alors saisir de quelle démarche de sa pensée procède la parole : « Le désert croît. Malheur à celui qui protège le désert ! »
Or donc, pour que nous puissions seulement rencontrer la pensée de Nietzsche, il nous faut d’abord la trouver. Ce n’est que lorsque nous aurons réussi à la trouver que nous aurons le droit de chercher à perdre de nouveau ce que cette pensée à pensé. Ceci — la perdre — est plus difficile que cela : la trouver. Car perdre quelque chose ne signifie pas dans un tel cas la « laisser simplement tomber », la laisser derrière soi et l’abandonner. « Perdre » veut dire ici se libérer véritablement de ce que la pensée de Nietzsche pensait. Mais cela ne se produit que d’une façon, c’est-à-dire que si nous mettons en liberté de nous-mêmes, et comme un monument pour notre mémoire, ce que Nietzsche a pensé, si nous lui ouvrons l’espace libre de sa propre richesse essentielle et que par là nous le laissions dans le lieu auquel par lui-même il appartient. Nietzsche avait le savoir de ces rapports entre découvrir, trouver et perdre, un savoir qui devait devenir toujours plus clair durant toute la marche qu’il fit sur son chemin. Car c’est ainsi seulement qu’il faut comprendre qu’à la fin de son chemin il ait pu exprimer ces rapports avec une effrayante clarté. Ce qu’il avait encore à dire de ce point de vue tient sur l’un des billets qu’il dépêchait à ses amis dans les jours qui entourent ce 4 janvier 1889, où il s’écroula dans la rue et sombra dans la folie. On appelle ces billets « billets de la folie ». Selon le mode de représentation médico-scientifique, cette désignation est exacte. Pour la pensée, elle demeure cependant insuffisante. L’un de ces billets est adressé au Danois Georg Brandès qui, l’année 1888 à Copenhague, a tenu les premiers cours publics sur Nietzsche.
Posté de Turin 4-1-89.
A MON AMI GEORG !
Après que tu m’as eu découvert, ce n’était pas un exploit de me trouver : la difficulté est maintenant celle de me perdre...LE CRUCIFIÉ.
Nietzsche savait-il que quelque chose d’inoubliable était venu par lui dans les mots ? Quelque chose d’inoubliable pour la pensée ? Quelque chose d’inoubliable pour la pensée sur quoi la pensée doit toujours faire à nouveau retour, plus elle devient pensante ? Il le savait. Car la phrase décisive, à laquelle nous conduisent les deux points, n’est plus adressée seulement au destinataire du billet. Cette phrase exprime par excellence un rapport lourd de destin : « La difficulté est maintenant celle de me perdre. » Maintenant, et pour tous, et pour l’avenir. C’est pourquoi nous lisons la phrase, et même tout le contenu du fragment, comme si cela nous était adressé. Bien que nous puissions, au moins dans les grandes lignes, dominer du regard les soixante-trois années qui se sont écoulées depuis lors, nous devons pourtant reconnaître que pour nous aussi la difficulté demeure d’abord de trouver Nietzsche, alors même qu’il est découvert, c’est-à-dire alors même qu’il est bien connu qu’il s’est produit une pensée de ce penseur. Nous courons même, à cause de ce « bien connu », un risque plus grand de ne pas trouver Nietzsche, parce que nous croyons être débarrassé d’avoir à la chercher. Ne nous laissons pas prendre à cette opinion illusoire que la pensée de Nietzsche serait trouvée, du fait que la littérature concernant Nietzsche est en crue depuis un demi-siècle. Il paraît que Nietzsche avait aussi prévu cela ; car ce n’est pas en vain qu’il fait dire à son Zarathoustra : « Ils parlent tous de moi, mais personne n’a de pensée pour moi. » Il n’y a de pensée-pour que là où il y a une pensée. Comment pourrions nous avoir une pensée pour la pensée de Nietzsche alors que nous ne pensons pas encore ? La pensée de Nietzsche cependant ne contient pas seulement les vues outrancières d’un homme exceptionnel. Dans cette pensée trouve son langage ce qui est, exactement ce qui est encore à être. Car les « Temps modernes » ne sont aucunement révolus. Ils avancent au contraire à peine dans leur commencement, et leur accomplissement sans doute long. Et la pensée de Nietzsche ? Qu’elle ne soit pas encore trouvée fait partie de ce qui donne à penser. Que nous ne soyons préparés en rien à oublier véritablement ce que nous aurions trouvé, au lieu de passer-outre simplement et de le contourner, cela fait partie de ce qui donne le plus à penser. Cette façon de « contourner » s’accomplit souvent sous une forme candide, c’est-à-dire qu’elle étale une présentation d’ensemble de la philosophie de Nietzsche. Comme s’il y avait une présentation qui ne soit déjà une interprétation jusque dans les recoins les plus intimes. Comme s’il pouvait y avoir une interprétation qui éviterait d’être une prise de position, ou même, à travers le mode d’approche, d’être déjà un refus et une réfutation implicite ? Mais un penseur ne se laisse jamais vaincre par le fait qu’on le réfute et qu’on entasse autour de lui une littérature de réfutation. Le pensé d’un penseur ne se laisse surmonter que lorsque l’impensé dans son pensé est re-situé dans sa vérité initiale. Par là cependant le dialogue de pensée avec le penseur n’est pas rendu plus facile, mais bien au contraire il ne fait d’abord qu’atteindre l’acuité croissante d’une dispute. En attendant, on continue bonnement à réfuter Nietzsche. Dans cette besogne, on en est arrivé bientôt à prêter à ce penseur — comme nous le montrerons tout à l’heure — exactement le contraire de ce qu’il pensait proprement, et dans quoi sa pensée finalement se consumait.
VI
Nietzsche voit, dans le domaine de la pensée essentielle, plus clairement qu’aucun autre avant lui la nécessité d’un passage, et du même coup le danger que l’homme traditionnel ne s’installe avec toujours plus d’obstination à la simple surface et sur la seule façade de son essence traditionnelle, et qu’il n’accorde valeur qu’à ces surfaces aplaties comme à l’unique espace de son séjour sur la terre. Ce danger est d’autant plus grand qu’il menace dans un moment historique que Nietzsche fut le premier à reconnaître nettement et qu’il fut jusqu’ici le seul à penser métaphysiquement jusqu’au bout et dans toute sa portée. C’est le moment où l’homme s’apprête à s’emparer intégralement de la domination de la terre.
Nietzsche est le premier qui pose cette question : l’homme est-il, en tant qu’homme, dans son essence traditionnelle, préparé à cette prise de domination ? S’il ne l’est pas, que doit-il advenir de l’homme traditionnel pour qu’il puisse « soumettre » la terre et accomplir ainsi la parole de l’Ancien Testament ? Nietzsche, dans l’horizon de sa pensée, nomme l’homme traditionnel « le dernier homme ». Ce nom ne signifie pas qu’avec l’homme qui le porte s’achève en général l’être de l’homme. Le dernier homme est bien plutôt celui qui n’est plus capable de regarder au delà de lui-même, et tout d’abord de se transcender lui-même en ce qui concerne son devoir, ni de le prendre en charge comme il faut. L’homme traditionnel n’en est pas capable parce qu’il n’est pas encore entré lui-même dans la plénitude de son être propre. Nietzsche explique : Cet être de l’homme n’est pas encore du tout déterminé, c’est-à-dire qu’il n’est ni trouvé ni fixé. C’est pourquoi Nietzsche dit : « L’homme est la bête non encore déterminée. » La phrase sonne étrangement. Pourtant, elle énonce simplement ce que depuis toujours la pensée occidentale pensait de l’homme. L’homme est l’animal rationale, la bête raisonnable. Par la raison l’homme se hausse au-dessus de la bête, mais de sorte qu’il doit toujours continuer à regarder la bête de haut, à la mettre au-dessous de lui, à en finir avec elle. Si nous nommons ce qui est animal : « sensible », et que nous prenions la raison comme le non-sensible et le supra-sensible, alors l’homme, l’animal rationale, apparaît comme le sensible supra-sensible. Si nous nommons le sensible, selon la tradition, le « physique », alors la raison, le supra-sensible, se montre comme ce qui va au-dessus et au delà du physique. « Au-dessus et au delà » se dit en grec μετα. Mετα τα φυσικα — au-dessus et au delà du physique, du sensible ; le supra-sensible, dans son « au delà et au-dessus » du physique, est le métaphysique. L’homme, en tant qu’il est représenté comme l’animal rationale, est le physique dans le dépassement du physique. Bref, dans l’essence de l’homme comme animal rationale se ramasse l’au-delà du physique vers le non physique et le supra-physique : L’homme est ainsi le Méta-physique même. Mais puisque pour Nietzsche ni le physique, le sensible de l’homme, le corps ; ni le non-sensible, la raison, ne sont encore représentés suffisamment dans leur essence, l’homme demeure, dans la définition qu’on en a donnée jusqu’ici, l’animal non-encore pré-senté, et par là non encore déterminé. L’anthropologie moderne qui, de pair avec la psychanalyse, exploite assidûment les écrits de Nietzsche, s’est foncièrement méprise sur cette phrase, dont elle a complètement méconnu la portée. L’homme est l’animal non encore déterminé ; l’animal rationale n’est pas encore mis dans la plénitude de son être. Mais pour que l’être de l’homme traditionnel puisse tout d’abord être déterminé, il faut que l’homme traditionnel soit mis au-dessus de lui-même. L’homme traditionnel est le dernier homme en ce sens qu’il n’est pas capable — et cela veut dire : qu’il ne veut pas — s’assujettir lui-même à lui-même, ni mépriser ce qu’il y a de méprisable dans la « façon » dont il a été jusqu’ici. C’est pourquoi il faut, pour l’homme traditionnel, que soit recherché le passage au delà de soi-même, que soit trouvé le pont vers cet être qui, devenu celui de l’homme traditionnel, lui permette d’être le vainqueur de ce qu’il y a de « traditionnel », de ce qu’il y a de « dernier » en lui. Nietzsche incarne pour commencer dans la figure de Zarathoustra cette façon d’être, aperçue par lui, de l’homme qui se surpasse. Nietzsche choisit pour cet homme qui se sur-passe, qui ainsi se met au-dessus de soi et ainsi se détermine enfin, un nom qui prête beaucoup trop au malentendu. Nietzsche nomme l’homme qui sur-passe l’homme traditionnel : « le Surhomme ». Par ce terme, Nietzsche n’entend précisément pas un homme traditionnel dont le calibre serait supérieur. Il ne s’agit pas non plus d’une espèce d’homme qui jette l’humain aux orties et pousse l’arbitraire jusqu’à en faire sa loi, ni qui prenne pour règle une frénésie titanique. Le sur-homme est celui qui conduit l’essence de l’homme traditionnel dans sa vérité, et qui se charge de celle-ci. L’homme traditionnel ainsi déterminé dans son être doit par là même être mis en état d’être à l’avenir le maître de la terre, c’est-à-dire de gouverner dans un sens élevé les possibilités de puissance qui proviennent de l’essence de la transformation technique de la terre et de l’agir humain, et qui incombent à l’homme futur. La forme d’être de cet homme, du sur-homme droitement compris, n’est pas le produit d’une fantaisie effrénée, dégénérée et qui se précipite dans le vide. On ne trouvera pas davantage cette forme sur le chemin d’une analyse historique de l’époque moderne - mais : la forme d’être du sur-homme fut révélée à la pensée métaphysique de Nietzsche parce que sa pensée était capable de prendre, pure, sa place dans le destin passé de la pensée occidentale. Dans la pensée de Nietzsche trouve déjà une parole ce qui est, mais qui demeure encore inacessible à la représentation courante. Nous pouvons donc présumer que le sur-homme ici et là, et à vrai dire encore invisible au grand public, existe déjà. Mais nous ne devons jamais chercher la forme d’être du sur-homme dans ces personnages qui, comme hauts-fonctionnaires d’une volonté de puissance superficielle et mal comprise, sont poussés aux postes les plus élevés de son organisation multiforme. Le surhomme n’est pas non plus un sorcier qui doit mener l’humanité vers une félicité paradisiaque sur la terre.
« Le désert croît. Malheur à celui qui protège le désert ! » Qui est celui à qui ce cri de « Malheur ! » s’adresse ? C’est le surhomme. Car celui qui va « au delà » doit être celui qui décline ; le chemin du surhomme commence avec son déclin. Par un tel commencement son chemin se trouve déjà décidé. Il faut de nouveau faire cette remarque : Puisque la phrase sur ce qui donne le plus à penser dans notre temps (que nous ne pensons pas encore) est liée à la parole de Nietzsche sur le désert croissant, puisque dans cette parole c’est bien le surhomme qui est visé, nous devons essayer d’élucider l’être du surhomme aussi loin que notre chemin le demandera.
Nous tenons maintenant à l’écart les confusions, les fausses résonances dont s’accompagne le terme de surhomme dans le jugement commun. Au lieu de cela, prêtons attention à trois aspects simples du terme « surhomme », qui s’imposent comme d’eux mêmes si l’on pense tout uniment le mot : 1) Aller au delà (sur-passer) ; 2) D’où part le passage ? ; 3) Vers où le passage se produit-il ?
Le surhomme va au delà de l’homme tel qu’il a été jusqu’ ici, du dernier homme par conséquent. L’homme, s’il ne s’arrête pas à la façon d’être de l’homme traditionnel, est un passage. Il est un pont. Il est « une corde tendue entre la bête et le sur-homme ». Celui-ci est, strictement pensé, la figure de l’homme vers laquelle va celui qui va au delà. Zarathoustra n’est pas encore le surhomme même, mais seulement le premier qui aille au delà, qui aille vers lui — le surhomme naissant. Nous bornons ici la réflexion, pour diverses raisons, à cette préfiguration du surhomme. Mais d’abord il importe de prêter attention à ce passage. Ce qui ensuite demeure à considérer de plus près, c’est le deuxième point, à savoir : d’où part celui qui va au delà, c’est à-dire ce qu’il en est de l’homme traditionnel, du dernier homme. En troisième lieu, nous avons à considérer « vers où » va celui qui va au delà, c’est-à-dire quelle stature cet homme ira prendre finalement.
Le premier point, le passage, ne deviendra clair pour nous que si nous considérons le deuxième et le troisième, le « à partir d’où » et le « vers où » de l’homme qui va au delà et qui, dans ce passage, devient autre.
L’homme au delà duquel il va et qu’il laisse derrière lui, c’est l’homme traditionnel. Nietzsche le caractérise, quand il veut rappeler ce qui a été jusqu’ici sa détermination essentielle, comme l’animal non encore déterminé. Ce qui implique : Homo est animal rationale. Animal ne signifie pas simplement « être vivant ». La plante aussi est un tel « être vivant ». Mais nous ne pouvons pas dire que l’homme soit une « végétation raisonnable ». Animal signifie la Bête ; animaliter veut dire (par exemple chez saint Augustin également) « bestialement ». L’homme est la bête raisonnable. La raison est la saisie de ce qui est, ce qui veut toujours dire en même temps : de ce qui peut et de ce qui doit être. Le saisir englobe, et englobe par degrés : subir ; recevoir ; entre-prendre ; pénétrer, lequel veut dire « parler complètement ». En latin « parler complètement » se dit reor, c’est-à-dire le grec ρεω (rhétorique), la faculté d’entre-prendre et de pénétrer quelque chose. Reri est la Ratio. L’animal rationale est la bête qui vit tout en saisissant, des différentes façons que nous avons dites. Le saisir régnant dans la raison précise des fins, érige des règles, dispose des moyens, règle tout sur les modalités de l’action. Le saisir de la raison se déploie dans ces diverses « dispositions » qui sont partout et avant tout une pré-sentation. Ainsi pourrait-on dire également : Homo est animal rationale, l’homme est la bête qui pré-sente. La simple bête, un chien par exemple, ne pré-sente jamais une chose. Il ne peut jamais, devant soi, pré-senter quelque chose. Pour cela le chien, la bête, devrait se saisir. Il ne peut pas dire « je ». D’une façon générale, il ne peut pas « dire ». L’homme au contraire est, selon la doctrine de la métaphysique, la bête qui pré-sente, à qui le pouvoir-dire appartient en propre. Sur cette détermination de l’être de l’homme, qui n’a pourtant jamais été pensée jusqu’ au bout ni plus originellement, se construit alors la doctrine de l’homme comme personne, qui dans la suite se laisse exposer théologiquement. Persona signifie le masque du Théâtre, à travers lequel son dire sonne. En tant que l’homme comme saisissant saisit ce qui est, il peut être pensé comme la persona, le masque de l’Être.
Nietzsche caractérise comme le dernier homme cet homme traditionnel qui a fixé pour ainsi dire en lui l’essence traditionnelle de l’homme. C’est pourquoi justement le dernier homme reste le plus éloigné de la possibilité de se sur-passer et ainsi d’être sous-mis à soi-même. C’est pourquoi encore, dans la façon d’être du dernier homme, la raison, la pré-sentation doit succomber d’une manière qui lui soit propre et se décomposer pour ainsi dire en elle-même. Ainsi la représentation ne s’attache-t-elle plus qu’à des choses qui se trouvent lui avoir été adressées, mais qui sont par là même obturées ; à des choses adjacentes. C’est l’exploitation que les hommes en ont fait selon la fantaisie de leur présentation qui a servi de règle à leur obturation, et c’est pour des raisons de compréhensibilité générale et de commodité que celle-ci fut convenue. Tout ce qui est ne parvient à !’apparaître que dans la mesure où il a été obturé par ce qui nous l’adresse comme un objet ou un état, c’est-à-dire par cette représentation tacitement convenue, dans la mesure par conséquent où il a été admis. Le dernier homme, la façon d’être définitive de l’homme traditionnel, se fige elle-même et fige en général tout ce qui est par sa manière particulière de représenter.
Mais écoutons maintenant ce que Nietzsche fait dire à son Zarathoustra du dernier homme. Citons seulement un court passage, tiré de la préface d’Ainsi parlait Zarathoustra (1883, n° 5). Zarathoustra prononce son discours préliminaire sur le marché de la ville, qui fut le premier lieu qu’il rencontra lorsqu’il fut descendu de la montagne. La ville « était située près des forêts ». Un peuple nombreux s’y était rassemblé parce qu’on leur avait promis le spectacle d’un funambule — par conséquent d’un homme qui va au delà.
Un matin, Zarathoustra avait interrompu son séjour de dix ans dans la montagne pour descendre chez les hommes. Nietzsche écrit :
« Et un matin il se leva, c’était l’aurore ; il se mit devant le soleil et lui parla ainsi : 0 grand astre ! Que serait ton bonheur si tu n’avais pas ceux auxquels tu donnes la lumière ? Dix années durant tu es monté ici, jusqu’à ma caverne. Tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin, sans moi, mon aigle et mon serpent. »
Dans ces paroles, qui remontent historiquement jusqu’au centre de la métaphysique de Platon et qui touchent ainsi le noyau de la pensée occidentale, se trouve cachée la clef du livre de Nietzsche Ainsi parlait Zarathoustra. Zarathoustra descendit tout seul de la montagne. Mais lorsqu’il atteignit la forêt, il rencontra un vieil ermite « qui avait quitté sa cabane sainte ». Lorsque Zarathoustra, après le dialogue avec le vieillard, fut de nouveau seul, il parla à son coeur :
« Devait-ce être possible ? Ce saint vieillard dans sa forêt n’a pas encore appris que Dieu est mort ! » (n°2). Quand il fut sur le marché de la ville, il essaya d’enseigner immédiatement au peuple le surhomme comme étant « le sens de la terre ». Mais le peuple ne faisait que rire de Zarathoustra, qui dut reconnaître que l’heure n’était pas encore venue de parler sans préambule des choses les plus hautes, de celles qui sont à venir, et qu’il ne possédait pas encore non plus la bonne façon de le faire. Il dut reconnaître qu’il convient de parler seulement médiatement, et d’abord même seulement du contraire.
« Je vais donc leur parler du plus méprisable : or cela, c’est le dernier homme. » De ces paroles sur le dernier homme, de ces préliminaires aux véritables paroles de Zarathoustra, écoutons simplement quelques phrases, afin de voir en quoi consiste la façon d’être de l’être humain à partir duquel le passage doit se produire.
« Et ainsi parla Zarathoustra au peuple : Malheur ! Le temps vient où l’homme ne lance plus la flèche de son désir au delà de l’homme, et la corde de son arc a désappris de siffler. Malheur ! Le temps vient où l’homme n’accouche plus d’aucune étoile. Malheur ! Le temps vient de l’homme le plus méprisable, qui n’est plus capable de se mépriser soi-même.
« Voyez : Je vous montre le dernier homme. Qu’est-ce qu’amour ? Qu’est-ce que création ? Qu’est-ce que désir ? Qu’est-ce qu’étoile ? Ainsi interroge le dernier homme — et il cligne de l’oeil.
« La terre est alors devenue plus petite, et sur elle saute le dernier homme qui rapetisse tout. Son espèce est indestructible comme la puce ; le dernier homme vit le plus longtemps.
« Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes — et ils clignent de l’oeil. »
VII
Écoutons bien ici :« Le dernier homme vit le plus longtemps. » Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’à l’aube, où nous sommes maintenant, du règne du dernier homme, nous ne marchons précisément pas vers une fin ni vers un temps de la fin ; que plutôt le dernier homme aura un étrange pouvoir de durer. Sur quoi ce pouvoir peut-il se fonder ? Sur quoi d’autre que sur sa façon d’être, qui détermine en même temps toute chose d’après la façon dont elle est et dont chacune vaut en tant qu’étant ?
Cette façon d’être repose pour l’animal rationale dans la manière dont il fige tout ce qui est pour en faire ses objets et ses propres états, dont il les met devant lui et dont il se règle lui-même sur ce qu’il a ainsi posé comme par rapport à des circonstances complètes. Et quelle est maintenant cette façon de présenter dans laquelle se meut le dernier homme ? Nietzsche le dit bien clairement, mais il ne conduit pas davantage ce qu’il dit dans le sens de la question que nous, maintenant, nous posons. Quelle est la façon de présenter dans laquelle les derniers hommes séjournent ? Les derniers hommes clignent de l’oeil. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cligner de l’oeil se rattache à « scintiller », à « briller », à « paraître ». Cligner de l’oeil, c’est-à-dire : jeter, adresser un paraître, une apparence sur laquelle on s’entend comme sur quelque chose de valable, et cela d’une entente réciproque qui n’est même pas expressément formulée et consiste à ne pas suivre jusqu’au bout tout ce qu’on s’adresse ainsi. Cligner de l’oeil, c’est s’adresser par convention, et finalement sans qu’une convention soit encore nécessaire, en toute chose cette surface, cette façade des « états objectifs » comme ce qui seul vaut et ce qui seul compte, d’après quoi l’homme fait tout marcher et évalue tout.
VIII
Le sur-homme est celui qui va au delà, qui quitte l’homme tel qu’il a été jusqu’ ici — mais qui le quitte pour où ? L’homme tel qu’il a été jusqu’ici est le dernier homme. Mais si l’espèce d’être vivant « homme » se distingue des autres vivants de la terre — plantes et animaux — par la rationale, par la ratio ; si d’autre part saisir et calculer c’est au fond présenter, alors la façon d’être particulière du dernier homme doit reposer dans une façon particulière qu’il a de présenter. Nietzsche la nomme « cligner de l’oeil », sans la mettre expressément en rapport avec l’essence de la représentation, sans continuer à interroger la représentation dans son domaine essentiel et avant tout dans son origine essentielle. Pourtant, nous devons laisser tout son poids, d’après le contexte dans lequel il se trouve, au terme employé par Nietzsche pour cette présentation : cligner de l’oeil. Nous ne devons pas identifier « cligner de l’oeil » avec simplement « faire un clin d’oeil » pris dans un sens purement extérieur et insignifiant, par lequel on fait entendre dans certaines circonstances qu’au fond l’on ne prend plus au sérieux ce que l’on a dit, ce que l’on a projeté, et généralement ce qui se produit. Car « faire un clin d’oeil » ainsi ne peut se généraliser que parce que toute la présentation a déjà en soi le caractère d’un clignement de l’oeil. La représentation adresse et présente, en toute chose, seulement le scintillant, le luisant de l’apparence, qui n’est que surface et façade. C’est seulement ce qui est ainsi pré-senté, et chaque fois apprêté ainsi, qui a cours. Cette sorte de présentation ne naît pas du clignement de l’oeil, mais au contraire : le clignement de l’oeil ne vient qu’à la suite de la présentation qui règne déjà primitivement. Quelle présentation est-ce là ? C’est là cette pré-sentation qui constitue le fondement métaphysique de l’époque du monde que l’on appelle l’époque moderne et qui ne va pas maintenant vers sa fin, car elle ne fait précisément que commencer, en ce sens que l’Être qui règne en elle ne se déploie que maintenant dans la totalité de l’étant qu’elle avait prévue. Le fondement métaphysique de l’époque moderne ne se laisse pas exposer en peu de phrases. Je renvoie là-dessus à une conférence que j’ai tenue, de cette chaire, en 1938, et qui est publiée dans les Holzwege, pp. 69-104, sous le titre : « Die Zeit des Welt-bildes » [L’époque des conceptions du monde].
« Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l’oeil. »
Avec le secours de notre sociologie, de notre psychologie, et de notre psychothérapie — et de quelques autres moyens encore — nous allons de tous côtés nous occuper à mettre bientôt tous les hommes de la même façon dans le même état du même bonheur, et d’assurer l’égalité du bien-être de tous. Mais, en dépit de cette invention du bonheur, les hommes sont poussés d’une guerre mondiale dans l’autre. On cligne de l’oeil aux peuples : « La paix est la suppression de la guerre. Pourtant la paix, qui supprime la guerre, ne saurait être assurée que par une guerre. » Mais contre cette paix-de guerre va de nouveau s’ouvrir une offensive-de-paix, dont les attaques se laissent à peine qualifier de pacifiques. La guerre : ce qui assure la paix. Mais la paix : ce qui supprime la guerre. Comment la paix doit-elle être assurée par ce qu’elle supprime ? Il y a là quelque chose de disjoint dans le fond des fondements, ou peut-être quelque chose qui n’a jamais été joint. Mais, en attendant, guerre et paix demeurent comme deux bouts de bois que les sauvages frottent sans cesse l’un contre l’autre pour faire du feu ; en attendant le dernier homme doit se mouvoir dans une présentation à cause de laquelle, sur toute chose, on ne fait et ne peut faire que cligner de l’oeil, suivant un destin sinistre qui empêche l’homme moderne de regarder au-dessus de lui et au-dessus de la façon de présenter qui est la sienne. C’est pourquoi il est contraint de chercher dans la façon de présenter qui est la sienne, dans le clignement de l’oeil, la forme des mesures qui doivent instaurer un ordre du monde. Congrès et conférences, commissions et sous-commissions sont-ils autre chose que l’organisation « clignante de l’oeil » que se donne une convention « clignante de l’oeil », faite de méfiance et d’arrière-pensées ? Toute décision intérieure à cette présentation obéit à son essence en tournant court. En même temps, l’homme ne peut pourtant s’installer dans une absence de décisions, dans un semblant de repos et de sécurité. Mais le fondement de ce déchirement de l’homme demeure voilé dans l’ombre d’un sinistre destin mondial. Ce voilement lui même est couvert encore par la prépondérance de la vie publique, de sorte que la déchirure du déchirement n’atteint pas encore l’homme dans son être, malgré la souffrance indicible, malgré la détresse dont un trop grand nombre souffre. La douleur qui s’élève de la déchirure de ce qui est n’atteint pas encore l’homme dans son être. Comment était-ce donc dit dans la première heure de ce cours ? « Nous sommes hors douleur... »
Serait-il possible, d’après tout ce que nous avons dit, que cette présentation qui cligne de l’oeil ne tienne pas elle-même intrinsèquement à un simple arbitraire, ni même à une simple négligence du côté de l’homme ? Serait-il possible que dans cette présentation règne un rapport particulier à ce qui est, qui passe par-dessus la tête de l’homme ? Serait-il possible que ce rapport soit d’une sorte qui empêche l’homme de laisser être l’Être dans son être ?
Serait-il possible que cette présentation mette certes devant soi chaque fois ce qui est, l’étant, mais en cela cependant se refuse au fond à tout ce qui est et à la façon dont cela est ? Serait-il possible que cette présentation pourchasse dans le fond ce qu’elle se donne pour le rabaisser et le décomposer ? Quelle est la façon de penser qui pré-sente tout de telle sorte qu’elle ne fait au fond que tout pour chasser ? Quel est l’esprit de cette présentation ? Quelle sorte de pensée est-ce que celle dont la réflexion poursuit toute chose de telle façon ? De quelle nature est cette réflexion-poursuite de l’homme traditionnel ?
Nietzsche donne à notre question sur cette présentation une réponse qui, d’avance, décide entièrement du clignement de l’oeil du dernier homme. Elle se trouve dans l’avant-avant-dernier paragraphe de la deuxième partie d’Ainsi parlait Zarathoustra (1883). Ce paragraphe est intitulé : « De la délivrance. » Il y est dit :
« L’esprit de vengeance : Mes amis, c’était la meilleure pensée de l’homme jusqu’ici, et là où il y avait souffrance, là il devait y avoir toujours punition. »
Vengeance, venger, « wreken », « urgere », veut dire : heurter, pousser, poursuivre, pourchasser. Toute pensée de l’homme tel qu’il a été jusqu’ici, sa pré-sentation, est déterminée par la vengeance, par le « pourchasser ». Mais lorsque Nietzsche veut quitter et dépasser l’homme traditionnel et sa présentation vers un autre homme plus élevé, quel est alors le pont qui conduit sur le chemin d’un tel dépassement ? A quoi Nietzsche pense-t-il lorsqu’il cherche le pont pour parvenir, en quittant le dernier homme, à atteindre le surhomme ? Quelle est la chose que ce penseur pensait proprement et uniquement, qu’il pensait même s’il ne l’exprimait pas en toute occasion, ni chaque fois de la même façon ? Nietzsche donne la réponse à notre question dans la même deuxième partie d’Ainsi parlait Zarathoustra, au passage « sur les Tarentules ». Il y fait dire à Zarathoustra :
« Car le fait que l’homme soit délivré de la vengeance, c’est pour moi le pont vers la plus haute espérance et un arc-en-ciel après de longs orages. »
LIRE LA SUITE : Qu’appelle-t-on penser ? et « la délivrance de l’esprit de vengeance » chez Nietzsche.
A propos du Zarathoustra, lire aussi : Dans quelle traduction lisons-nous ?
(8 mars 2017)




 Version imprimable
Version imprimable Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


