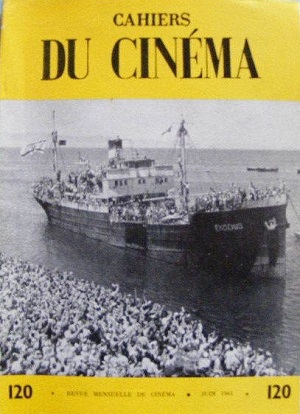Jacques Rivette sur Pileface ? Aucun rapport apparent avec les sujets de ce site. Sinon peut-être celui d’une autre guerre du goût telle qu’elle se mena il y a bien longtemps dans les Cahiers du cinéma, les fameux « Cahiers jaunes ». Guerre du goût dont le Rivette critique de cinéma, avant d’être un réalisateur reconnu, fut l’un des acteurs décisifs. Deux articles en témoignent que je retiendrai. Le premier, Génie de Howard Hawks
 , a été écrit par Rivette en 1953 et est peut-être le véritable acte de naissance de « la politique des auteurs » [1]. D’autres critiques et futurs réalisateurs — Chabrol et Rohmer, puis Truffaut — mettront en avant une autre figure du cinéma américain : Alfred Hitchcock. D’où ce qu’on appellera les « hitchcocko-hawksiens » [2], « tribu » de laquelle, soixante ans après, j’avoue me sentir toujours proche [3].
, a été écrit par Rivette en 1953 et est peut-être le véritable acte de naissance de « la politique des auteurs » [1]. D’autres critiques et futurs réalisateurs — Chabrol et Rohmer, puis Truffaut — mettront en avant une autre figure du cinéma américain : Alfred Hitchcock. D’où ce qu’on appellera les « hitchcocko-hawksiens » [2], « tribu » de laquelle, soixante ans après, j’avoue me sentir toujours proche [3].
Le second article de Rivette qu’on peut considérer comme fondateur sur le plan de la critique cinématographique s’intitule De l’abjection. Il est daté de juin 1961 et porte sur un film controversé de Gillo Pontecorvo, Kapo, plus exactement sur une courte séquence du film, un plan. C’est peut-être cet article qui garde aujourd’hui le plus de pertinence et d’actualité. Il y est question de la possibilité et de la manière de filmer les « camps de concentration » (comme on disait à l’époque), de Nuit et brouillard, de travelling, de « misenscène » et de morale. « L’abjection », c’est à la fois une certaine manière de filmer le réel ou un certain réel lui-même (les camps). Tout « cinéphile » (au sens littéral et historique du terme), du moins s’il est français, même s’il n’a pas vu le film Kapo ni lu l’article de Rivette, en a entendu parler et, consciemment ou inconsciemment, voit désormais tout film à travers la question que pose Rivette. A tel point qu’on en discute encore aujourd’hui. Cette question est celle d’une certaine éthique du cinéma comme Barthes pourra parler plus tard d’une « éthique de la littérature ». Claude Lanzmann s’en est sans doute souvenu pour son oeuvre maîtresse Shoah.
Partir de cet article de Rivette est l’occasion de revenir à travers différents films et différents textes sur les controverses, les analyses et les parti-pris qu’ont suscité, depuis plusieurs décennies, les films, bons ou mauvais, qui ont entrepris de rendre compte de « l’infilmable » ou de « l’irreprésentable ».
Un site présentait il y a quelques années De l’abjection. Je le reproduis avec son appareillage de notes qui sont autant de précieux commentaires.

Cet article de Jacques Rivette constitue en quelque sorte l’aboutissement logique de la "Politique des auteurs" défendue par les Cahiers du cinéma, tout au long des années 1950. Par opposition à la culture intellectuelle dominante à l’époque, de "gauche" (progressiste, anti-américaine), il s’agissait pour les jeunes critiques de définir une approche spécifiquement cinématographique des films, fondée sur la "mise en scène" - en tant qu’elle serait le site essentiel de l’intelligence au cinéma et le mode d’expression par excellence de l’"auteur" de films [4].
Avec ce texte, critique acerbe du « Kapo » (1959) de Gillo Pontecorvo, Rivette applique la "politique des auteurs" au thème extrême de l’après-guerre (à la fois impossible cinématographique et horizon de référence) : les camps de concentration. La gravité du sujet implique la plus grande rigueur ; toute inconséquence de la "mise en scène" condamne le réalisateur au mépris : pour Rivette, Pontecorvo, incarnation du cinéaste drapé dans sa bonne conscience politique mais coupable formellement, trahit son inanité cinématographique.
Fondamentalement, « De l’abjection », en synthétisant l’orthodoxie "moderne" façon Cahiers du cinéma, structure le champs critique. Durablement : Serge Daney, qui doit à ce texte sa "première certitude de futur critique", l’a exprimé clairement : « Au fil des années, en effet, "le travelling de Kapo" fut mon dogme portatif, l’axiome qui ne se discutait pas, le point limite de tout débat. Avec quiconque ne ressentirait pas immédiatement l’abjection du « travelling de Kapo », je n’aurais, définitivement, rien à voir, rien à partager [5]. » La modernité cinématographique se voit définitivement conditionnée à une approche morale (alors qu’on peut se demander s’il en va de même dans les autres champs d’expression artistique).
Comment proposer une représentation "vraie", "juste", des "camps" ? Comment ne pas laisser le spectateur "s’habituer" à l’horreur ? Rivette semble douter à vrai dire de la possibilité même de "traiter" un tel sujet : pour lui, il y a presque immédiatement une transgression à tenter une représentation de cette histoire-là — c’est certainement ce qui explique la violence de son attaque (disproportionnée, au vu des images de Pontecorvo).
C’est ici, face à ces doutes, qu’on saisit pleinement le rôle joué par Alain Resnais dans cette construction de la modernité. La réussite unanimement saluée de « Nuit et Brouillard » (1955), en fournissant un contre-modèle et une référence marquante, prévient l’étape finale de cette "moralisation de la forme" : l’interdit de représentation (ou plus exactement l’interdit d’"image" [6]) qui sera plus tard la position de principe de Claude Lanzmann (concernant la destruction des juifs) [7]. L’oBservatoire.
De l’abjection
par Jacques Rivette
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est difficile, lorsqu’on entreprend un film sur un tel sujet (les camps de concentration [8]), de ne pas se poser certaines questions préalables ; mais tout se passe comme si, par incohérence, sottise ou lâcheté, Pontecorvo avait résolument négligé de se les poser.
Par exemple, celle du réalisme : pour de multiples raisons, faciles à comprendre, le réalisme absolu, ou ce qui peut en tenir lieu au cinéma, est ici impossible ; toute tentative dans cette direction est nécessairement inachevée (« donc immorale »), tout essai de reconstitution ou de maquillage dérisoire et grotesque, toute approche traditionnelle du « spectacle » relève du voyeurisme [9] et de la pornographie [10]. Le metteur en scène est tenu d’affadir, pour que ce qu’il ose présenter comme la « réalité » soit physiquement supportable par le spectateur, qui ne peut ensuite que conclure, peut-être inconsciemment, que, bien sûr, c’était pénible, ces Allemands, quels sauvages, mais somme tout pas intolérable, et qu’en étant bien sage, avec un peu d’astuce ou de patience, on devait pouvoir s’en tirer. En même temps, chacun s’habitue sournoisement à l’horreur, cela rentre peu à peu dans les mœurs, et fera bientôt partie du paysage mental de l’homme moderne ; qui pourra, la prochaine fois, s’étonner ou s’indigner de ce qui aura cessé en effet d’être choquant ?
C’est ici que l’on comprend que la force de Nuit et Brouillard venait moins des documents que du montage, de la science avec laquelle les faits bruts, réels, hélas !, étaient offerts au regard, dans un mouvement qui est justement celui de la conscience lucide et quasi impersonnelle, qui ne peut accepter de comprendre et d’admettre le phénomène. On a pu voir ailleurs des documents plus atroces que ceux retenus par Resnais : mais à quoi l’homme ne peut-il s’habituer ? Or on ne s’habitue pas à Nuit et Brouillard ; c’est que le cinéaste juge ce qu’il montre, et est jugé par la façon dont il le montre.

Autre chose : on a beaucoup cité, à gauche et à droite, et le plus souvent assez sottement, une phrase de Moullet : "la morale est affaire de travellings [11]" (ou la version de Godard : "les travellings sont affaire de morale [12]") ; on a voulu y voir le comble du formalisme, alors qu’on en pourrait plutôt critiquer l’excès "terroriste", pour reprendre la terminologie paulhanienne [13]. Voyez cependant, dans Kapo, le plan où Riva se suicide, en se jetant sur les barbelés électrifiés ; l’homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling-avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final [14], cet homme n’a droit qu’au plus profond mépris. On nous les casse depuis quelques mois avec les faux problèmes de la forme et du fond, du réalisme et de la féerie, du scénario et de la "misenscène", de l’acteur libre ou dominé et autres balançoires ; disons qu’il se pourrait que tous les sujets naissent libres et égaux en droit ; ce qui compte, c’est le ton, ou l’accent, la nuance, comme on voudra l’appeler — c’est-à-dire le point de vue d’un homme, l’auteur, mal nécessaire, et l’attitude que prend cet homme par rapport à ce qu’il filme, et donc par rapport au monde et à toutes choses : ce qui peut s’exprimer par le choix des situations, la construction de l’intrigue, les dialogues, le jeu des acteurs, ou la pure et simple technique, "indifféremment mais autant". Il est des choses qui ne doivent être abordées que dans la crainte et le tremblement ; la mort en est une, sans doute ; et comment, au moment de filmer une chose aussi mystérieuse, ne pas se sentir un imposteur ? Mieux vaudrait en tout cas se poser la question et inclure cette interrogation, de quelque façon, dans ce que l’on filme ; mais le doute est bien ce dont Pontecorvo et ses pareils sont le plus dépourvus.
Faire un film, c’est donc montrer certaines choses, c’est en même temps, et par la même opération, les montrer d’un certain biais ; ces deux actes étant rigoureusement indissociables. De même qu’il ne peut y avoir d’absolu de la mise en scène, car il n’y a pas de mise en scène dans l’absolu, de même le cinéma ne sera jamais un "langage" : les rapports du signe au signifié n’ont aucun cours ici, et n’aboutissent qu’à d’aussi tristes hérésies que la petite Zazie. Toute approche du fait cinématographique qui entreprend de substituer l’addition à la synthèse, l’analyse à l’unité, nous renvoie aussitôt à une rhétorique d’images qui n’a pas plus à voir avec le fait cinématographique que le dessin industriel avec le fait pictural ; pourquoi cette rhétorique reste-t-elle si chère à ceux qui s’intitulent eux-mêmes "critiques de gauche" ? — peut-être, somme toute, ceux-ci sont-ils avant tout d’irréductibles professeurs ; mais si nous avons toujours détesté, par exemple, Poudovkine, De Sica, Wyler, Lizzani, et les anciens combattants de l’Idhec, c’est parce que l’aboutissement logique de ce formalisme s’appelle Pontecorvo. Quoiqu’en pensent les journalistes express, l’histoire du cinéma n’entre pas en révolution tous les huit jours. La mécanique d’un Losey, l’expérimentation new-yorkaise ne l’émeuvent pas plus que les vagues de la grève la paix des profondeurs. Pourquoi ? C’est que les uns ne se posent que des problèmes formels, et que les autres les résolvent tous à l’avance en n’en posant aucun. Mais que disent plutôt ceux qui font vraiment l’histoire, et que l’on appelle aussi « hommes de l’art » ? Resnais avouera que, si tel film de la semaine intéresse en lui le spectateur, c’est cependant devant Antonioni qu’il a le sentiment de n’être qu’un amateur ; ainsi Truffaut parlerait-il sans doute de Renoir, Godard de Rossellini, Demy de Visconti ; et comme Cézanne, contre tous les journalistes et chroniqueurs, fut peu à peu imposé par les peintres, ainsi les cinéastes imposent-ils à l’histoire Murnau ou Mizoguchi.
Jacques Rivette, Cahiers du cinéma, n° 120, juin 1961.
“De l’abjection [Kapo de Gillo Pontecorvo]”, Jacques Rivette - Stéphane Bou
Marcelin Pleynet
En 2007, dans Un homme en résistance, Pleynet écrit :
J’ai rencontré pour la première fois Jean Cayrol en mai 1955. J’avais 22 ans. Et, après avoir publié dans le numéro 2 d’Ecrire, je ne devais pas tarder à travailler pour lui, aux éditions du Seuil, puis à devenir son secrétaire personnel, et à l’accompagner dans divers voyages, en Hollande, en Angleterre, en Ecosse...
Cayrol était déjà occupé par le projet de Nuit et Brouillard, et j’ai suivi toute la réalisation du film par son intermédiaire ; nous en parlions souvent. Nuit et Brouillard est désormais généralement présenté comme "un des grands classiques sur les camps de la mort", cette formule aurait fait frémir Cayrol ! [15]
Quel meilleur commentaire que le silence ? C’est ce à quoi s’oblige et nous oblige Pleynet dans Vita Nova.

J’ai coupé arbitrairement la séquence. Le plan suivant montre la Résurrection, le tableau d’Andrea Mantegna (1457-1459).
Réaction de Claude Lanzmann après la sortie de La liste de Schindler de Spielberg.
« Holocauste, la représentation impossible »
par Claude Lanzmann
Ce que je reproche fondamentalement à Spielberg, c’est de montrer l’Holocauste à travers un Allemand. Même s’il a sauvé des juifs, ça change complètement l’approche de l’Histoire. C’est le monde à l’envers... Shoah interdit beaucoup de choses, Shoah dépossède les gens de beaucoup de choses, Shoah est un film aride et pur. Dans Shoah, il n’y a aucune histoire personnelle. Les survivants juifs de "Shoah" sont des survivants d’une espèce particulière ; ce ne sont pas n’importe quels survivants, mais des gens qui étaient au bout de la chaîne d’extermination et qui ont été les témoins directs de la mort de leur peuple. Shoah est un film sur la mort ; pas du tout sur la survie.
Aucun des survivants de Shoah ne dit "je". Aucun ne raconte son histoire personnelle : le coiffeur ne dit pas comment il s’est échappé à Treblinka après trois mois de camp, ça ne m’intéressait pas et ça ne l’intéressait pas. Il dit "nous", il parle pour les morts, il est leur porte-parole. Quant à moi, je voulais construire une structure, une forme qui vaille pour la généralité du peuple. C’est tout le contraire de Spielberg, pour qui l’extermination est un décor : le noir soleil aveuglant de l’Holocauste n’est pas affronté.
On pleure en voyant La liste de Schindler ? Soit. Mais les larmes sont une façon de jouir, les larmes, c’est une jouissance, une catharsis. Beaucoup de gens m’ont dit : "Je ne peux pas voir votre film, parce que, probablement, voyant Shoah, il n’y a pas possibilité de pleurer."
D’une certaine manière, le film de Spielberg est un mélodrame, un mélodrame kitsch. On est pris par cette histoire d’escroc allemand, rien de plus. En tout cas, bien que passant aux yeux de beaucoup pour sioniste, jamais je n’aurais osé donner des "coups de marteau" pareils à ceux qu’assène Spielberg à la fin de sa Liste de Schindler. Avec cette grande réconciliation, la tombe de Schindler en Israël, avec sa croix et les petits cailloux juifs, avec la couleur qui est arrivée pour insinuer l’hypothèse d’un happy ending... Non, Israël n’est pas la rédemption de l’Holocauste. Ces six millions ne sont pas morts pour qu’Israël existe. La dernière image de Shoah, ce n’est pas ça. C’est un train qui roule, interminablement. Pour dire que l’Holocauste n’a pas de fin.
Le Monde, 3 mars 1994.
Auschwitz le point aveugle ?
Après la publication de ses Histoire(s) du cinéma en 1998, Godard donne un interview aux Inrockuptibles. A la fin de l’interview, il parle de Rivette et de sa conviction à lui, Godard, qu’il y a des images des crimes commis par les « Allemands ». Ambiguïté de Godard (sur) la question juive comme l’écrira plus tard Jean-Luc Douin ?
[...] Auschwitz reste le point aveugle de cette histoire ?
Je pense qu’il faut deux générations. Mon grand-père était collabo, mes parents étaient médecins à la Croix-Rouge suisse et ils ne m’ont rien dit, alors que mon père avait peut-être vu quelque chose des camps. J’ai eu une formation de droite, même sans le savoir. La littérature, après mon adolescence, m’a aidé à en sortir. Mais j’étais beaucoup moins militant que Rivette. Je me souviens qu’une fois, place de l’Alma, des voitures passaient en klaxonnant “Algérie française !” ; et j’ai dit comme ça “Oh, il est beau ce son.” Rivette m’a presque giflé, il m’a drôlement engueulé.
Pourquoi les nazis ont-ils filmé les camps alors qu’ils ont tout fait pour que ça ne se sache pas ?
Parce qu’ils avaient la manie de tout enregistrer. Les Allemands sont comme le criminel malade qui ne peut pas garder pour lui la preuve de son crime, qui ne peut pas s’empêcher de l’envoyer à la police alors qu’il était bien tranquille dans son coin. Regardez ce médecin d’Auschwitz dont les journaux ont parlé, qui ne peut s’empêcher encore aujourd’hui de se vanter de ses crimes. Les archives, on les découvre toujours longtemps après. Regardez le procès Papon, dont on n’aura le droit de voir les débats qu’en 2030, c’est incroyable ! Incroyable qu’on n’ait pas pu suivre les débats sur une chaîne d’histoire ! Je n’ai aucune preuve de ce que j’avance, mais je pense que si je m’y mettais avec un bon journaliste d’investigation, je trouverais les images des chambres à gaz au bout de vingt ans. On verrait entrer les déportés et on verrait dans quel état ils ressortent. Il ne s’agit pas de prononcer des interdictions comme le font Lanzmann ou Adorno, qui exagèrent parce qu’on se retrouve alors à discuter à l’infini sur des formules du style “c’est infilmable” — il ne faut pas empêcher les gens de filmer, il ne faut pas brûler les livres, sinon on ne peut plus les critiquer. Moi, je dis qu’on est passé de “plus jamais ça” à “c’est toujours ça”, et je montre une image de La Passagère de Munk et une image d’un film porno ouest-allemand où on voit un chien qui se bat avec un déporté, c’est tout : le cinéma permet de penser les choses.
L’intégralité de l’entretien dans Les Inrocks, octobre 1998.
La position de Godard fait réagir le psychanalyste Gérard Wajcman dans Le Monde du 3 décembre 1998. Le texte est repris, quelque mois plus tard, dans le n° 65 de la revue L’Infini.
« Saint-Paul » Godard contre « Moïse » Lanzmann ?
par Gérard Wajcman
Pour certains, le temps serait enfin venu d’abattre une ultime Bastille, de se libérer du « dernier tabou » dans ce monde. Ainsi s’exalte Charles Najman dans Libération (19 novembre). Contre quels censeurs ? Le ministère de l’Intérieur ? Le Vatican ? Non : ceux que le film de Benigni ne fait pas rire et pour qui la représentation de la Shoah pose un problème. Se portant en tête de manif, il se place sous l’autorité d’un propos de Jean-Luc Godard qu’il brandit comme le drapeau de la lutte cinématographique finale : « Il ne faut pas empêcher les gens de filmer. » J.-L. G. faisait spécifiquement allusion aux camps et aux chambres à gaz (Les Inrockuptibles, 21 octobre).
Mettons au compte d’une simple dérive langagière ce glissement qui fait passer ceux qui penseraient que « c’est infilmable » pour des « empêcheurs » de filmer. Benigni ou Spielberg semblent avoir été assez peu « empêchés » par Claude Lanzmann ou Adorno, tous deux mariés par J.-L. G. pour l’occasion, et dénoncés comme les empêcheurs en chef ; l’un est l’auteur du film Shoah, l’autre, philosophe, mort en 1969, s’était interrogé sur la possibilité de la poésie après Auschwitz.
Si on s’en tient là, si on place la question sur le terrain des droits — on a bien le droit de filmer ce qu’on veut ! —, si on ne voit là qu’une enivrante montée au front contre l’oppression, tout est simple : on a toujours raison. Qui ne se rangera derrière une banderole « À bas la censure ! » ? Quelle censure ? Et est-ce bien la liberté de création qui préoccupe J.-L. G. au sujet de la Shoah ? J’ai la sensation qu’il fait mine de s’en prendre à une supposée politique des images pour faire passer une autre camelote, une vraie théologie. Une théologie de l’image. Ni nette ni neuve.
Juste une phrase de Godard dans cet entretien récent : « […] Je pense que si je m’y mettais avec un bon journaliste d’investigation, je trouverais des images des chambres à gaz au bout de vingt ans. » Sous ses dehors lisses et sans malice, cette idée empoisonne. Je ne l’aime pas. Pour tout dire, elle m’inquiète. Une phrase pas juste.
Évidemment, je ne discute pas la question de savoir s’il y a ou non des images des chambres à gaz. Je n’en sais rien. Et, même s’il y a de puissantes raisons de penser que non (parce que, malgré ce que J.-L. G. suggère de « leur manie de tout enregistrer », les nazis se sont préoccupés de ne laisser aucune trace et avaient soigneusement interdit toute image ; parce qu’il n’y avait pas de lumière dans les chambres à gaz ; parce que, cinquante ans après, on aurait retrouvé déjà un petit bout de quelque chose, etc.), on est parfaitement en droit d’en faire l’hypothèse. Seulement voilà : supposons qu’on mette la main dessus, qu’est-ce que ça changerait ?
Ce qui me soucie ? Pourquoi J.-L. G. paraît-il, lui, si convaincu que de telles images existent ? Pourquoi lui semble-t-il presque nécessaire qu’il y en ait ? Et puis, si de telles images existent, est-ce qu’elles montreraient ce que fut, réellement, la « solution finale » ? Est-ce qu’il est du pouvoir d’une image de nous faire voir, vraiment, l’horreur ? Tout simplement, qu’est-ce que ça prouverait de plus ?
Parce qu’il faut prouver ?
C’est pourtant dans une logique de la preuve que se tient J.-L. G. Déjà, en 1985 : « Les camps, ça a été filmé sûrement en long et en large par les Allemands, donc les archives doivent exister quelque part, ça a été filmé par les Américains, par les Français, mais ça n’est pas montré, parce que si c’était montré, ça changerait quelque chose. Et il ne faut pas que ça change. On préfère dire : Plus jamais ça » (L’Autre Journal, n° 12, janvier 1985).
Ce que ça changerait, selon J.-L. G. (laissons là l’aspect légèrement X-Files des puissances qui nous cachent un lourd secret) ? Il donne une réponse dans ce même entretien : on montre une seule image des camps, et « Vergès, il n’existe plus après ». Je tiens J.-L. G. pour un grand artiste, donc un profond penseur, mais l’avocat Jacques Vergès désintégré par l’exhibition d’une photo des chambres à gaz, confondu par une preuve visible… Disons que tant d’innocence ou d’aveuglement désarme. On supposera ainsi que si Vergès a été l’avocat de Carlos, c’est qu’il n’y eut jamais aucune image des massacres terroristes, de Munich ou d’ailleurs, que s’il avait vu des photos de Jean Moulin ou des enfants d’Izieu, il n’aurait jamais accepté de défendre Barbie, etc.
Les opticiens-lunetiers avaient leur slogan : « La vue, c’est la vie ». Jean-Luc Godard a le sien : L’Image, c’est le Vrai. Le Souverain Vrai..
Les chambres à gaz ont existé. Je le sais. Pourtant, je ne les ai jamais vues. je ne les ai pas vu fonctionner. J’ai vu les traces, j’ai vu des lieux, j’ai vu des images des crématoires ouverts, j’ai vu des reconstitutions des chambres à gaz, mais les hommes, les enfants, les femmes courant nus dans les couloirs, poussés dans les douches, mourant asphyxiés en grimpant les uns sur les autres, je ne les ai jamais vus. Pourtant, je sais que cela a eu lieu. Je le sais comme tout le monde le sait – hors ceux qui ne veulent pas le savoir, comme nous savons qu’il y a des milliards de galaxies dans un univers infini sans les avoir jamais vues.
Je sais que les chambres à gaz ont eu lieu parce qu’il y a des témoins, des preuves aussi. Pas d’images, mais une infinité de paroles accumulées, privées ou publiques, des victimes ou des bourreaux.
Comment sait-il, lui, J.-L. G., qui pas plus que moi n’a vu ces images, comment sait-il, aujourd’hui, que les chambres à gaz ont eu lieu ? Sa certitude ne repose-t-elle que sur cette conviction qu’il ne peut pas ne pas y avoir d’images ? Parce que si c’est ainsi, alors on va droit à cette conclusion : et si — simple supposition — il n’y avait vraiment pas d’images, est-ce que la conviction sur les camps pourrait en être changée ? Avec ce credo qu’il y a quelque part des images, J.-L. G. ouvre — j’ose le croire, malgré lui, contre lui — la possibilité d’un raisonnement délétère : si, après vingt ans, vingt siècles de recherches, on constate qu’il n’y a décidément aucune image de ce qui doit forcément avoir une image, est-ce que cela ne suffit pas pour faire droit, raisonnablement, au soupçon qu’après tout cela pourrait bien ne pas avoir existé ?
J.-L. G. professe une étrange religion de l’image dont le cinéma serait le lieu de culte.
Une autre idée se répète chez lui : celle d’un péché originel du cinéma qui aurait annoncé les camps (il cite alors, assez obscurément, La Règle du jeu et Le Dictateur), mais qui ne les a pas montrés. Les « Allemands », les « Américains », les « Français » les ont filmés, mais le Cinéma pas ; il a « manqué à son devoir », il a « failli » — les mots sont de lui. D’un côté, un pouvoir coupable de cacher des images, de l’autre le Cinéma coupable de n’en avoir aucune. [...]
Selon la doctrine de l’Église de la Sainte-Image, ce serait La Liste de Schindler contre Shoah, pour Spielberg contre Lanzmann. [...]
J.-L. G. accuse Lanzmann de ne rien montrer, de ne rien vouloir montrer, et, sans doute, de servir ainsi les intérêts de ceux qui ne veulent rien changer.[...]
Ne rien représenter de la Shoah n’est pas un choix libre mais forcé. Il n’est pas question d’interdit — au nom de quoi ? C’est simplement qu’il y a des choses impossibles à voir. Au regard de l’horreur, Shoah réalise une proposition qui paraphrase Wittgenstein : « Il y a des choses qu’on ne peut voir. Et ce qu’on ne peut voir, il faut le montrer. » En cela, chez Lanzmann, l’art du cinéma noue intimement l’esthétique et l’éthique. Avec une seule volonté : regarder l’horreur en face. Sans image, parce qu’il y a quelque chose que l’image ne peut transmettre, qui l’excède, quelque chose de réel. C’est le cœur de l’affaire. Si on tient cela, alors toute tentation de représenter ne peut qu’être mesurée à cette aune : quelle que soit la qualité des intentions, fabriquer des images de la Shoah reviendra toujours peu ou prou à amadouer, à trivialiser le crime qui, dans sa monstruosité, ne peut avoir d’image. Qu’on le veuille ou non, toute image de l’horreur amène au fond une certaine humanisation de l’horreur, une distance (les films dits d’horreur sont fondés là-dessus), une certaine consolation aussi. C’est pourquoi Lanzmann ne peut que montrer cela, sans image. Parce que ce crime est aussi sans rémission.
Est-ce que J.-L. G. se figure Lanzmann en Moïse descendant à nouveau du Sinaï pour apporter dans le XXe siècle, adorateur de veaux d’or électroniques, la loi de l’interdit de la représentation ?
Au regard de cela, J.-L. G. le protestant serait-il, lui, saint Paul. Saint Paul contre Moïse, tel est le match qui semble l’occuper. Le match du siècle ?
Lanzmann n’est pas Moïse, mais un artiste, qui fait ce qu’il doit. Mais pour J.-L. G., c’est comme si Shoah, par sa seule présence, « regardait » tout le cinéma, une sorte d’œil hugolien dans le tombeau d’un cinéma coupable depuis cinquante ans d’être traître au réel – c’est lui qui le dit. On comprendrait alors que J.-L. G. ne puisse regarder en face le film qui regarde le siècle en face. Parce que, s’il y a Shoah, alors il n’y a pas d’image à venir, pas de salut. Alors, adieu saint Paul, l’annonciateur de l’image, adieu saint Jean, le précurseur de l’Esprit visible, adieu saint Luc, portraitiste de la Vierge. Adieu saint Jean-Luc. Adieu l’artiste ?
Le Monde, 3 décembre 1998. L’Infini n° 65, printemps 1999 (version modifiée).
Rancière revient sur l’article de Wajcman et la polémique Godard-Lanzmann. Pour lui, ce sont deux théologies de l’image qui s’affrontent.
La faute au cinéma ?
par Jacques Rancière
 La sortie du film de Roberto Benigni La vie est belle a relancé l’affrontement sur ce que le cinéma — et l’art, plus généralement — peut ou ne peut pas montrer de l’extermination nazie. La donnée fictionnelle du film — un père juif qui réussit à faire croire à son fils que leur séjour forcé dans un camp est un jeu — mime évidemment d’une façon troublante l’argument négationniste selon lequel les faits peuvent toujours être interprétés autrement. Aussi a-t-il ravivé la polémique de ceux qui tiennent que l’horreur de l’extermination ne peut être représentée. Et cette affirmation de l’irreprésentable a suscité la réaction de ceux qui refusent la « censure » ainsi exercée à l’égard de l’image. Parmi ces derniers, Jean-Luc Godard proclamait récemment que l’on n’a pas le droit « d’empêcher les gens de filmer », quitte à provoquer à son tour le soupçon. Dans un article du Monde, Gérard Wajcman, psychanalyste et auteur d’un ouvrage au titre significatif, L’Objet du siècle, s’interrogeait sur le culte de l’image sous-jacent à cette revendication et réaffirmait la position illustrée par les œuvres et les déclarations de Claude Lanzmann : à l’horreur de l’extermination aucune image ne peut être adéquate [16]. Car toujours l’image banalise l’extrême et donne au crime un visage humain.
La sortie du film de Roberto Benigni La vie est belle a relancé l’affrontement sur ce que le cinéma — et l’art, plus généralement — peut ou ne peut pas montrer de l’extermination nazie. La donnée fictionnelle du film — un père juif qui réussit à faire croire à son fils que leur séjour forcé dans un camp est un jeu — mime évidemment d’une façon troublante l’argument négationniste selon lequel les faits peuvent toujours être interprétés autrement. Aussi a-t-il ravivé la polémique de ceux qui tiennent que l’horreur de l’extermination ne peut être représentée. Et cette affirmation de l’irreprésentable a suscité la réaction de ceux qui refusent la « censure » ainsi exercée à l’égard de l’image. Parmi ces derniers, Jean-Luc Godard proclamait récemment que l’on n’a pas le droit « d’empêcher les gens de filmer », quitte à provoquer à son tour le soupçon. Dans un article du Monde, Gérard Wajcman, psychanalyste et auteur d’un ouvrage au titre significatif, L’Objet du siècle, s’interrogeait sur le culte de l’image sous-jacent à cette revendication et réaffirmait la position illustrée par les œuvres et les déclarations de Claude Lanzmann : à l’horreur de l’extermination aucune image ne peut être adéquate [16]. Car toujours l’image banalise l’extrême et donne au crime un visage humain.
Sous son apparente clarté, la formulation du débat pose bien des questions et laisse subsister bien des obscurités. Une formule trop vite énoncée et trop longuement glosée d’Adorno déclarait l’art impossible après Auschwitz. On voit aujourd’hui comment cette culpabilisation de l’art au regard de l’horreur se laisse interpréter de deux manières opposées. Selon Lanzmann, le cinéma est coupable quand il veut donner des images de la Shoah et participe ainsi à sa banalisation. Selon Godard, il est coupable de ne pas avoir filmé ces images, d’avoir ignoré les camps, négligé d’en chercher les images, et méconnu que, dans ses fictions propres, il avait annoncé l’œuvre de mort. Selon l’un, le cinéma manque par l’image à la considération de l’horreur ; selon l’autre, il lui a manqué en en manquant les images. Clairement, ces deux versions contradictoires de la culpabilité sont deux idées différentes du rapport entre l’art et l’image, deux idées de l’art qui se fondent, en dernier ressort, sur deux théologies de l’image.
On peut assurément l’accorder à Gérard Wajcman : la position de Godard relève de tout autre chose que de la défense du droit à la liberté des images. Elle relève d’une conception proprement iconique du cinéma que les Histoire(s) du cinéma illustrent longuement. Le cinéma, y dit Godard, n’est pas un art ni une technique, c’est un mystère. Ce « mystère » n’est pas autre chose que celui de l’incarnation. Le cinéma n’est pas un art de la fiction, l’image cinématographique n’est pas une copie, pas un simulacre. C’est l’empreinte du vrai, semblable à l’image du Christ sur le linge de Véronique. L’image est attestation de vérité parce qu ’elle est la marque même d’une présence. Puisqu’il y a eu des camps, il y en a des images. Le cinéma a été coupable en les manquant. Et ceux qui veulent proscrire les images de l’horreur en refusent en même temps le témoignage. Cet argument peut se lire à l’envers : il faut qu’il y ait des images des camps pour que s’atteste la vérité de l’image et que l’art cinématographique soit voué à son culte.
La dénonciation de ce culte de l’image est-elle pour autant parfaitement claire ? Elle revendique l’unité d’un point de vue éthique et d’un point de vue esthétique : qui veut faire des images de l’horreur irreprésentable en est puni par la médiocrité esthétique de son produit. Mais que veut dire au juste « faire des images » ? Lanzmann dans Shoah et Benigni dans La vie est belle font, l’un et l’autre, des images en mouvement. Ce qui diffère, c’est la fonction de ces images, la fin qu’elles poursuivent et la manière dont le cinéaste les compose pour les ordonner à cette fin. Lanzmann se propose d’attester la réalité d’un processus à partir même de l’effacement programmé de ses traces. L’image ne peut donc reproduire ce qui a disparu. Elle doit faire autre chose, deux choses en même temps : elle montre l’effacement des traces et elle donne lieu à la parole des témoins et historiens qui reconstituent avec des mots la logique de la disparition réalisée sur le terrain, la logique de l’extermination et de sa dissimulation. En subordonnant, selon cette fin, l’image aux mots qui la font parler, Lanzmann retrouve le paradoxe qu’avait énoncé Burke il y a plus de deux siècles, en comparant les pouvoirs de la poésie et ceux de la peinture : les mots sont toujours plus propres que les images à traduire toute grandeur, de sublimité comme d’horreur, qui passe la mesure. Plus propres précisément parce qu’ils nous dispensent de voir ce qu’ils nous décrivent. Pour « montrer » l’horreur du dernier voyage vers la mort, l’analyse des ordres de route et la froide explication du mécanisme des « réductions de groupe » consenties par la Reichsbahn seront toujours supérieures à toute reconstitution de « troupeau humain » conduit à l’abattoir, pour deux raisons qui ne sont qu’en apparence contradictoires : parce qu’ils nous donnent une représentation plus exacte de la machine de mort, en nous laissant moins à voir et à imaginer de la souffrance de ses victimes.
En bref, le dessein de Lanzmann commande un certain type d’art, un certain type de « fiction », c’est-à-dire d’agencement des mots et des images. Clairement, le dessein de Benigni est tout autre. Il n’a, à l’égard de l’extermination, aucun souci d’attestation ni de négation. Il la prend comme une situation propre à porter à son paroxysme la logique constitutive de son personnage. Tout le film est en effet construit sur une seule donnée : la capacité d’un personnage au miracle permanent et à la transfiguration de toute réalité. Aussi est-il tout aussi incapable de nier la réalité des camps que d’en dire quelque chose. La médiocrité du film ne vient pas de l’indignité éthique qu’il y aurait à fictionner l’horreur nazie et à en faire rire. Elle vient de ce que Benigni n’a rien fictionné du tout. Auteur-acteur comme Benigni, Chaplin avait, dans Le Dictateur, pris le risque et gagné le pari de faire rire de Hitler. Mais, pour mettre en fiction la personne de Hitler, il avait payé le prix le plus fort : il avait consenti à casser l’unité de la forme Charlot, à jouer les rôles inverses du dictateur et de sa victime et à les dépouiller l’un et l’autre pour parler en son propre nom. Il avait ainsi mis en scène le déplacement de son personnage sur l’estrade du Führer [17]. Le metteur en scène Benigni, lui, est incapable d’inventer le déplacement de l’acteur Benigni. Incapable de rien fictionner, capable seulement de répéter à l’infini la gesticulation de l’illusionniste. Les scènes du camp ne sont pas mauvaises parce qu’elles donnent des images de ce qui ne peut pas ou ne doit pas être imagé. Elles sont mauvaises parce qu’elles n’ont ni plus ni moins de raison d’être que les précédentes.
La question porte donc sur la capacité fictionnelle de la mise en scène et non pas sur la dignité ou l’indignité de l’image. Pas non plus sur ce que l’image en elle même peut ou ne peut pas. L’argument de la « banalisation » par l’image est lui même équivoque, s’il se pose en termes d’efficacité. Car l’attestation de l’événement exceptionnel est soumise à un double risque. Le soustraire, au nom de son exceptionnalité, aux conditions ordinaires de la représentation des événements est aussi dangereux que de le banaliser en le représentant selon les mêmes règles que tout autre. Il faut alors penser que les ennemis de l’image comme ses dévots mettent dans l’affaire un autre enjeu. En critiquant la valeur salvatrice que Godard, en disciple de saint Paul, donne à l’image, Gérard Wajcman se défend de vouloir faire jouer une autre théologie de l’image : l’interdit mosaïque de la représentation. Mais si ce n’est point la sacralité de la loi qui est en jeu ici, ce pourrait bien en être une autre, celle de l’art. L’argument de l’irreprésentable veut assurer l’équivalence entre un destin moderne de l’art et une mission historique. Selon cette logique, le Carré blanc sur fond blanc de Malevitch, en ruinant le principe figuratif, donnerait à l’art moderne son vrai sujet : l’absence. Pour prouver la vérité de l’image, Godard devait voir dans le camp du Dictateur, ou dans la chasse aux lapins et la danse des morts de La Règle du jeu, des prophéties de l’extermination à venir. Pour attester la mission de l’art, son critique doit mettre en œuvre une même logique, voir dans les manifestes antireprésentatifs des années 1910 l’anticipation prophétique par l’art moderne de sa vocation : rendre compte de l’« objet du siècle », l’extermination. C’est alors une théologie de la modernité artistique qui s’oppose à une théologie de l’image salvatrice. Il n’est pas sûr que ce combat rende justice à ce que font les films, bons ou mauvais.
Jacques Rancière, mai 1999.
Suite et fin ? Suite oui ; fin, certainement pas. Vous pouvez lire Pas un dîner de Gala (Troisième épisode, 1999). Les documents inédits d’un projet de film sur la Shoah avec Claude Lanzmann, Jean-Luc Godard et Bernard-Henri Lévy.
Le projet n’aboutira pas.
Claude Lanzmann, Porte-parole de la Shoah
un film d’Adam Benzine, 2015
Le cinéaste Claude Lanzmann raconte la genèse de "Shoah", oeuvre monumentale sur l’extermination des juifs d’Europe, dans un documentaire émouvant diffusé le jour du 71e anniversaire de la libération d’Auschwitz.
Oeuvre de commande, à l’origine, du ministère des Affaires étrangères israélien, Shoah a happé douze ans de la vie de son auteur. Dans un entretien au long cours, Claude Lanzmann retrace les jalons de cette entreprise éreintante et essentielle, menée dans une alliance “d’urgence totale et d’extrême patience”. Pour révéler l’ampleur et les rouages du “crime parfait” commis par les nazis, le cinéaste a arpenté quatorze pays, pistant les témoins à même de raconter la mort dans les chambres à gaz : rescapés des sonderkommandos, habitants des villages limitrophes des camps d’extermination et bourreaux. Claude Lanzmann explique ainsi comment il a remué ciel et terre pour retrouver, dans un salon de coiffure du Bronx, Abraham Bomba, qui coupait les cheveux des femmes à Treblinka, et comment, en filmant la course de ses ciseaux et en réclamant toujours plus de détails, il a réveillé la mémoire de ce témoin exceptionnel. Il évoque par ailleurs — non sans résistance — la dangereuse traque des criminels nazis, qu’il a fallu payer, berner et flatter pour qu’ils parlent, filmés à leur insu à l’aide d’une paluche. Mais aussi le casse-tête du montage, cinq années traversées de découragements, et la fierté sans joie ressentie au terme de cette aventure radicale.
Bribes de vie
Présentant des rushs inédits de Shoah, ce documentaire éclaire la création de ce chef-d’œuvre et son influence à la fois historique et cinématographique, saluée notamment par Marcel Ophüls. L’occasion également d’effleurer certains aspects de la vie de son auteur : sa jeunesse résistante, son histoire d’amour avec Simone de Beauvoir, son affection pour Sartre, son rapport à la mort et sa vision de l’avenir.
[1] Un an avant le texte retentissant de François Truffaut Une certaine tendance du cinéma français qui « fustige le réalisme psychologique de la "Qualité française" (Autant-Lara, Delannoy, Allégret), au profit d’un cinéma d’auteurs incarné par Renoir, Bresson ou Cocteau ».
[2] Cf. André Bazin, Comment peut-on être hitchcocko-hawksien ?, Cahiers du cinéma n°44, février 1955.
[3] Le fait d’avoir revu récemment à la télévision Psychose d’Hitchcock et, tout dernièrement, dans une salle parisienne que j’ai beaucoup fréquentée dans ma jeunesse, le très beau film de Hawks, Seuls les anges ont des ailes, m’en a convaincu. A noter, d’ailleurs, que Hawks, puis Hitchcock ont sans doute donné à Cary Grant, de 1938 à 1958, plusieurs de ses meilleurs rôles : qu’on se souvienne du désopilant Bringing up Baby (L’impossible Mr. Bébé) et du bouleversant Only Angels Have Wings (Seuls les anges ont des ailes) de Hawks, ou de Notorious (Les enchaînés) et de North by Northwest (La mort aux trousses) de Hitchcock, tous indubitables chefs-d’oeuvre (où, entre parenthèse, les femmes jouent un rôle capital comme dans tous les films de Hawks et de Hitchcock).
[4] Voir Antoine de Baecque, La Cinéphilie. Invention d’un regard, histoire d’une culture 1944-1968, Paris, Hachette, 2005 ; par exemple, p. 19.
[5] Le texte de Daney vaut d’être cité plus longuement : « Au nombre des films que je n’ai jamais vus, il n’y a pas seulement Octobre, Le Jour se lève ou Bambi, il y a l’obscur Kapo, film sur les camps de concentration, tourné en 1960 par l’italien de gauche Gillo Pontecorvo. Kapo ne fit pas date dans l’histoire du cinéma. Suis-je le seul, ne l’ayant jamais vu, à ne l’avoir jamais oublié ? Car je n’ai pas vu Kapo et en même temps je l’ai vu. Je l’ai vu parce que quelqu’un, avec des mots, me l’a montré. Ce film, dont le titre, tel un mot de passe, accompagna ma vie de cinéma, je ne le connais qu’à travers un court texte : la critique qu’en fit Jacques Rivette en juin 1961 dans Les Cahiers du cinéma. C’était le numéro 120, l’article s’appelait « De l’abjection », Rivette avait 33 ans et moi 17. Je ne devais jamais avoir prononcé le mot « abjection » de ma vie. Dans son article, Rivette ne racontait pas le film, il se contentait, en une phrase, de décrire un plan. La phrase, qui se grava dans ma mémoire, disait ceci : « Voyez cependant, dans Kapo, le plan où Riva se suicide en se jetant sur les barbelés électrifiés : l’homme qui décide à ce moment de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n’a droit qu’au plus profond mépris ». Ainsi, un simple mouvement de caméra pouvait-il être le mouvement à ne pas faire. Celui qu’il fallait – à l’évidence — être abject pour faire. A peine eus-je lu ces lignes que je sus que leur auteur avait absolument raison. Abrupt et lumineux, le texte de Rivette me permettait de mettre des mots sur ce visage de l’abjection. Ma révolte avait trouvé des mots pour se dire. Mais il y avait plus. Il y avait que la révolte s’accompagnait d’un sentiment moins clair et sans doute moins pur : la reconnaissance soulagée d’acquérir ma première certitude de futur critique. Au fil des années, en effet, "le travelling de Kapo" fut mon dogme portatif, l’axiome qui ne se discutait pas, le point limite de tout débat. Avec quiconque ne ressentirait pas immédiatement l’abjection du "travelling de Kapo", je n’aurais, définitivement, rien à voir, rien à partager. Ce genre de refus était d’ailleurs dans l’air du temps. Au vu du style rageur et excédé de l’article de Rivette, je sentais que de furieux débats avaient déjà eu lieu et il me paraissait logique que le cinéma soit la caisse de résonance privilégiée de toute polémique. La guerre d’Algérie finissait qui, faute d’avoir été filmée, avait soupçonné par avance toute représentation de l’Histoire. N’importe qui semblait comprendre qu’il puisse y avoir – même et surtout au cinéma — des figures taboues, des facilités criminelles et des montages interdits. La formule célèbre de Godard voyant dans les travellings « une affaire de morale » était à mes yeux un de ces truismes sur lesquels on ne reviendrait pas. Pas moi, en tout cas. » Serge Daney, « Le travelling de Kapo » pdf
 , Trafic, n°4, automne 1992. Repris dans Persévérance. Entretien avec Serge Toubiana, Paris, POL, 1994, pp. 13-39.
, Trafic, n°4, automne 1992. Repris dans Persévérance. Entretien avec Serge Toubiana, Paris, POL, 1994, pp. 13-39.
[6] Sur la réfutation de la thèse de l’Inimaginable appliquée aux camps d’extermination et comprise comme nouvel iconoclasme, voir Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Paris, Minuit, 2003, notamment p. 38 et s., p. 83 et s. Portée heuristique des cas limites (l’horreur des camps), c’est, pour Didi-huberman comme pour Rivette, l’occasion de réexposer l’ensemble de leur conception "imaginaire", l’occasion de tout revoir — éprouver et ressaisir —, à la lumière la plus exigeante.
[7] Voir Claude Lanzmann, "Holocauste, la représentation impossible", Le Monde, 3 mars 1994, p. I et VII.
[8] Georges Didi-Huberman rappelle que "la distinction entre camps d’extermination (Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka – NdE.) et camps de concentration n’était pas encore d’usage courant dans l’historiographie des années cinquantes". C’est l’une des critiques (G. Bensoussan, 1998 ; A. Wieviorka, 1992) faites à Nuit et Brouillard d’Alain Resnais, de mal opérer cette distinction capitale. Didi-Huberman, op. cit., p. 164.
[9] Alain Resnais, en 2000, est sur la même ligne : « Q. : Votre réaction scandalisée par rapport au spectaculaire fait autour des images des camps me rappelle la réaction de Rivette au film de Pontecorvo, Kapo, et son texte « De l’abjection » dans les Cahiers du cinéma, en 1961. Vous connaissez ce texte ? Resnais : Je le connais. Je m’en sens proche. Je ne l’ai pas lu à l’époque, mais après. Je vois très bien le mouvement de caméra de Kapo sur la main d’Emmanuelle Riva. On ne peut pas faire de mise en scène avec ces images. On ne peut pas non plus en faire des reconstitutions par la fiction. Des films romanesques sur les camps de concentration, cela me paraît consternant. Il y a une exception, Ghetto Terezin (d’Alfred Radok, 1950). Je n’ai pas pu me décider à aller voir La Vie est belle (De Roberto Begnini, 1997) par exemple. » Alain Resnais, « Les photos jaunies ne m’émeuvent pas », propos recueillis par Antoine De Baecque et Claire Vassé, Cahiers du cinéma, hors-série « Le Siècle du cinéma », novembre 2000, pp. 70-75, ici p. 74. (NdE.)
[10] Rivette reprend le terme à Jean-Luc Godard qui l’a utilisé lors de la "Table ronde" (juillet 1959) consacrée à Hiroshima, mon amour d’Alain Resnais (1959). Je cite in extenso les remarques importantes de Godard (notamment sur la question qui nous occupe, à savoir les relations entre morale et modernité, et la place particulière de Resnais) ; la réponse de Rivette est intéressante puisqu’il attribue à Resnais les qualités qui précisément manquent à Pontecorvo (le fait de questionner sa mise en scène et surtout la capacité à intégrer ces questions au film lui-même) :
Godard : Il y a une chose qui me gêne un peu dans Hiroshima, et qui m’avait également gêné dans Nuit et Brouillard, c’est qu’il y a une certaine facilité à montrer des scènes d’horreur, car on est vite au-delà de l’esthétique. Je veux dire que bien ou mal filmées, peu importe, de telles scènes font de toute façon une impression terrible sur le spectateur. Si un film sur les camps de concentration, ou sur la torture, est signé Couzinet, ou signé Visconti, pour moi, je trouve que c’est presque la même chose. Avant Au Seuil de la vie, il y avait un documentaire produit par l’Unesco qui montrait dans un montage sur musique tous les gens qui souffraient sur la terre, les estropiés, les aveugles, les infirmes, ceux qui avaient faim, les vieux, les jeunes, etc. J’ai oublié le titre. Ça devait être L’Homme, ou quelque chose dans ce genre. Eh bien, ce film était immonde. Aucune comparaison avec Nuit et Brouillard, mais c’était quand même un film qui faisait de l’impression sur les gens, tout comme récemment Le Procès de Nuremberg. L’ennui donc, en montrant des scènes d’horreur, c’est que l’on est automatiquement dépassé par son propos, et que l’on est choqué par ces images un peu comme par des images pornographiques. Dans le fond, ce qui me choque dans Hiroshima, c’est que, réciproquement, les images du couple faisant l’amour dans les premiers plans me font peur au même titre que celles des plaies, également en gros plans, occasionnées par la bombe atomique. Il y a quelque chose non pas d’immoral, mais d’amoral, à montrer ainsi l’amour ou l’horreur avec les mêmes gros plans. C’est peut-être par là que Resnais est véritablement moderne par rapport à, mettons, Rossellini. Mais je trouve alors que c’est une régression, car dans Voyage en Italie, quand George Sanders et Ingrid Bergman regardent le couple calciné de Pompéi, on avait le même sentiment d’angoisse et de beauté, mais avec quelque chose en plus.
Rivette : Ce qui fait que Resnais peut se permettre certaines choses, et non les autres cinéastes, c’est qu’il sait d’avance toutes les objections de principe qu’on pourra lui faire. Davantage, ces questions de justification morale ou esthétique, Resnais, non seulement se les pose, mais il les inclut dans le mouvement même du film. Dans Hiroshima, le commentaire et les réactions d’Emmanuelle Riva jouent ce rôle de la réflexion sur le document. Et c’est pourquoi Resnais réussit à dépasser ce stade premier de la facilité qu’il y a à utiliser des documents. Le sujet même des films de Resnais, c’est l’effort qu’il doit faire pour résoudre ces contradictions.
Doniol-Valcroze : Resnais a souvent le mot de douceur terrible. Pour lui, c’est caractéristique de cet effort. »
Jean Domarchi, Jacques Doniol-Valcroze, Jean-Luc Godard, Pierre Kast, Jacques Rivette, Eric Rohmer, « Table ronde sur Hiroshima, mon amour d’Alain Resnais », Cahiers du cinéma, n° 97, juillet 1959. Repris dans Antoine De Baecque, Charles Tesson (edit.), La Nouvelle Vague, coll. "Petite Bibliothèque des Cahiers du cinéma", Paris, Cahiers du cinéma, 1999, pp. 36-62. Ici, pp. 51-53. (NdE.)
[11] Voir Luc Moullet, "Sur les brisées de Marlowe", Cahiers du cinéma, n° 93, mars 1959. (NdE.)
[12] Voir Jean-Luc Godard, "Table ronde sur Hiroshima...", op. cit. Repris dans Antoine De Baecque, Charles Tesson (edit.), La Nouvelle Vague, op. cit., p. 43. (NdE.)
[13] Dans la réflexion de Jean Paulhan, la Terreur — qui impose l’invention d’un langage neuf — s’oppose à la rhétorique. Philippe Roussin et Eric Trudel expliquent : « Il nomme Terreur la volonté de la littérature de faire oublier qu’elle est littérature (...). La Terreur est la récusation littéraire de la rhétorique depuis le romantisme : le choix de l-originalité et de la différence. » « Dès le moment où elle se nie comme discours parmi les autres discours et s’identifie comme une rupture avec les langages de l’ordinaire, la littérature s’affirme en fait comme un régime d’exceptionnalité. Elle s’identifie moins à ce qui serait révolutionnaire parce qu’entièrement libre du rhétorique qu’elle ne dit, en fait, un pouvoir et un fantasme de puissance. Aux poétiques terroristes, Paulhan répond par le rapatriement du poétique dans la rhétorique et, à "la poussière de rhétoriques individuelles, qu’appelle la Terreur", il propose de substituer "une rhétorique commune" (N.R.F., juillet 1936). » Les auteurs précisent que Paulhan « n’invente pas le terme de Terreur. Il le trouve, on le sait, dans le surréalisme, du côté de "l’appareil mental de la Grande Terreur", des insultes du Traité du style d’Aragon, des Pas perdus de Breton ou des appels de Desnos dans La Révolution surréaliste. La Terreur est, ici, la confusion de la liberté d’expression et de la liberté absolue. » Paulhan « travaille à son livre sur la rhétorique et la terreur depuis le milieu des années vingt », mais ce n’est qu’en juin 1936 qu’il « en livre les premiers états dans la N.R.F. (...) Entre les premiers articles publiés (...) et la parution des Fleurs de Tarbes en 1941, ses recherches vont s’infléchir pour s’attacher aux figures de la nouvelle rhétorique autoritaire, aux grands mots et aux slogans. Comme la Terreur, la nouvelle rhétorique politique et autoritaire déclare qu’elle veut bannir le formalisme bourgeois et le verbalisme démocratique mais elle finit par accoucher du mot d’ordre. » (Je souligne.) Voir Philippe Roussin et Eric Trudel (2007), sur Fabula. (NdE.)
[14] La description du travelling par Rivette n’est pas très exacte : pas de main dans l’angle. Cette séquence — la dernière de Kapo : le mouvement d’appareil est d’ailleurs, surtout, une manière convenue de terminer le film — sert au critique à synthétiser une opposition d’ordre beaucoup plus général, évoquée par ailleurs dans le texte : certains sujets ne se laissent pas "moralement" reconstituer, "mettre en scène" (la mort, les camps). Il y a donc un argument rhétorique chez Rivette : la focalisation sur un geste coupable — un travelling (manière de s’inscrire dans le sillon Moullet-Godard) —, supposé exemplaire et décisif, alors que c’est en réalité toute une posture qui est condamnée. Ce raccourci critique, pour lumineux qu’il soit, trahit surtout l’interdit "général" de représentation qui règne dans les esprits.
[16] Gérard Wajcman, « "Saint Paul" Godard contre "Moïse" Lanzmann ? », Le Monde, 3 décembre 1998.
[17] Cf. L’analyse du Dictateur. A.G.




 Version imprimable
Version imprimable