
 17/01/2021 : Ajout « Julia Kristeva, "au sujet du voyage philosophique" sur Radio J »
17/01/2021 : Ajout « Julia Kristeva, "au sujet du voyage philosophique" sur Radio J »
Mon alphabet ou comment je suis une lettre
« Azbouka »
Aujourd’hui, 24 mai, c’est la Fête de l’écriture, à Sofia. Ma première Fête de l’Alphabet. J’ai six, sept ans peut-être ? Je sais en tout cas déjà lire et écrire, cela me plaît et je progresse vite. Les Bulgares sont le seul peuple au monde à célébrer un jour pareil : celui des frères Cyrille et Méthode, créateurs de l’alphabet slave. Derrière l’immense effigie de ces deux moines, le pays défile sur les grands boulevards : les écoliers, les professeurs en tout genre - de la maternelle aux académies des sciences -, les écrivains, les artistes, les amateurs de littérature, les parents... Tout le monde arbore sur son plastron une grande lettre cyrillique.
Les bras chargés de roses et de pivoines, enivrée par leur beauté épanouie et leur fragrance qui trouble ma vue jusqu’à brouiller mes propres contours, je suis moi aussi une lettre. Une trace parmi d’autres, une volute du langage, une hélice du sens. Insérée dans une « règle qui guérit de tout » - comme, je l’apprendrais plus tard, écrivait Colette qui cultivait son alphabet dans la chair du monde - même du communisme. Et disséminée parmi tous ces jeunes corps que le printemps a légèrement vêtus, entrelacée à ces voix offertes aux chants antiques, à la soie des chemises et des cheveux et à ce vent ocre qui, à Byzance ou dans ce qu’il en reste, s’alourdit d’un obstiné parfum de fleurs. Imprimé en moi, l’alphabet a raison de moi ; tout autour de moi est alphabet, pourtant il n’y a ni tout ni alphabet : rien qu’une mémoire en liesse, un appel à écrire qui n’est d’aucune littérature. Une sorte de vie en plus, « fraîchissante et rose », aurait dit Marcel Proust. Je n’oublierai jamais ce premier 24 mai où je suis devenue une lettre.
« Alphabet » se dit « Azbouka » en bulgare.
« Pourquoi Azbouka, papa ? C’est étrange... “Az” (qui en bulgare veut dire “je”), je comprends : c’est moi. Mais “bouk”, serait-ce “the book”, le livre ? »
Après avoir terminé ma maternelle française chez les dominicaines, et tout en continuant le français à l’Alliance française, je viens de commencer l’anglais.
« Mais non, voyons... Mais si, enfin... C’est du slavon, tu sais bien, du vieux slave. Az Bouki Vedi Glagoli... :A, B, V, G, ... », me répond-il.
Croyant orthodoxe et féru de lettres, mon père m’accompagne jusqu’au cortège de l’école, en m’expliquant l’étymologie du mot bulgare pour « alphabet » : AZBOUKA. À chaque lettre nous attribuons un nom, qui n’est pas simple reprise phonétique des lettres grecques avec leur sens renvoyant à leur invention instrumentale : ni un mot de la vie quotidienne, comme les noms des lettres hébraïques : « Mais une leçon de vie, prophétise papa. Une foi, si tu préfères ».
Bien entendu, je ne préfère pas. Mon père le sait, et subit déjà tristement mon attitude de garçon manqué et révolté qui ne rate pas l’occasion de railler ses enseignements et convictions religieuses. Mais aujourd’hui, c’est fête : je me tais, j’écoute. Attentivement. Car c’est ma curiosité qui nourrit ma révolte.![]() « “Az”, dans “azbouka” désigne la première lettre, le A et, comme tu l’as dit, c’est évidemment “je”, en l’occurrence “toi”. “Bouki”, , qui équivaut à la lettre B, signifie en vieux slave “les lettres”. “Vedi”, ou V, notre troisième lettre, veut dire “je connais”. “Glagoli”, , pour le G, c’est “le Verbe” ; “Dobro”, , pour le D, c’est, tout comme en bulgare moderne, “le bien” ; “Est” pour la lettre E, n’est rien d’autre que le verbe “être”... »
« “Az”, dans “azbouka” désigne la première lettre, le A et, comme tu l’as dit, c’est évidemment “je”, en l’occurrence “toi”. “Bouki”, , qui équivaut à la lettre B, signifie en vieux slave “les lettres”. “Vedi”, ou V, notre troisième lettre, veut dire “je connais”. “Glagoli”, , pour le G, c’est “le Verbe” ; “Dobro”, , pour le D, c’est, tout comme en bulgare moderne, “le bien” ; “Est” pour la lettre E, n’est rien d’autre que le verbe “être”... »
Lorsque mon père se mettait en tête de m’instruire, ses leçons pouvaient être interminables. J’ai oublié la suite des 30 lettres de l’alphabet cyrillique ainsi que leurs noms si édifiants. Les ai-je même jamais sues ? Mais depuis ce jour, et à chaque fête de l’Azbouka que j’ai célébrée depuis mon enfance jusqu’à mon départ pour Paris en 1965, me revenaient ces mots : « Az bouki vedi glagoli dobro est. » J’épinglais une grande lettre à mon chemisier de soie blanche et je rejoignais le défilé en répétant cette formule magique. Je la tournais dans tous les sens, décomposant, recomposant les sons, les syllabes, les mots, les vers, les lettres, la lettre que j’étais, gravée, me mêlant aux chants, aux roses, aux géraniums parfumés, aux drapeaux, aux slogans, au vent, à la lumière de mai, à tout, à rien.
« Az bouki vedi glagoli dobro est » : « Je / lettres / comprends / le verbe / le bien / est. » « Je comprends les lettres, le verbe, donc le bien existe, il est » ; et à rebours, la ritournelle :« le bien est je, moi je, comprenant la lettre, le verbe et le bien. » C’est-à-dire : « Je suis les lettres, je comprends le verbe, donc le bien existe. » Ou encore : « En étant la lettre, je comprends le verbe qui est le bien. » Mais aussi : « Je suis la lettre, le verbe, le bien. » Et même : « Je suis l’écriture. » Mieux : « Je est une écriture », car « Écrire le bien c’est être », en clair : « Le Verbe ne fait que s’écrire en moi pour que le bien soit. » Et cetera.Az bouki vedi gragoli dobro est.
Les dessins des lettres, les syllabes et les mots ne tenaient plus en place, se mettaient à danser et m’emportaient en un tourbillon halluciné et lucide. Je retournais les courbes et les jambages, les sons et les leçons du slavon perdu renaissaient dans ma bouche, sous ma langue, sur ma poitrine, dans mes doigts. J’en pressais l’antique mélodie à l’aide du bulgare actuel, je retraçais la graphie et j’en volais le sens, je l’incorporais, le recréais. L’alphabet revivait en moi, pour moi, je pouvais être toutes les lettres. Pour cette première fête, je suis la lettre A, , az, moi. L’année suivante je choisirai peut-être G, , glagoli, verbe. Ou pourquoi pas Z, , zemlja, la terre ? Ou encore P, , pokoi, la paix. L’Azbouka renaît en moi en un présent infini, je est une lettre, je est les lettres. Et voilà que nous nous rassemblons à quatre, cinq, dix, vingt, trente corps de filles et de garçons, de femmes et d’hommes, pour former un mot, une phrase, un vers, une idée, un projet... L’alphabet est devenu mon organe pour jouir du temps hors du temps.
Cette histoire culmine pour moi dans laPrière de l’Alphabetde Constantin de Preslav, un autre disciple des deux frères, et qu’adorait mon père. J’avais un père qui priait pour l’Alphabet. Plus tard, en me rendant visite à Paris, papa allait dire saPrière de l’Alphabetà Notre-Dame. Elle était composée de trente-neuf vers, commençant chacun par une lettre de l’alphabet, selon leur ordre d’apparition dans notre Azbouka. Je ne comprenais pas tous les mots du slavon d’église qui tissaient cette prière, mais j’entendais, vers par vers, s’égrener la mélodie des lettres de l’alphabet et je restituais leurs noms tels que je les avais entendus ce premier jour de 24 mai où je suis devenue une lettre de l’alphabet : « Az bouki vedi glagoli dobro est », « Je suis la lettre qui connaît le bonheur de la parole écrite. »
De l’écrivain comme traducteur
De ce flou qu’est mon immersion dans l’Être, qu’aucune parole ne résume d’emblée, que le vocable de « joie » banalise quand celui d’ « extase » l’embaume, un tremblement imperceptible cherche aujourd’hui la langue française. C’est elle qui traduit ce flux : toute une batterie de lectures et de conversations françaises fait descendre un tissu lumineux qui se laisse choisir par le senti pour faire exister le sens. Alchimie de la nomination où je suis seule avec le français. Et là, dans cet exil que mon imagination essaie de vivre en français, la souffrance me revient, Bulgarie, ma souffrance [1].
On me signale le texte célèbre de Thomas Mann, le journal de l’exilé qu’il fut pendant le nazisme, et qui porte le titre Allemagne, ma souffrance [2]• L’ écrivain vit la tragédie de son pays du dedans et du dehors, et s’il condamne la honte de l’hitlérisme, il n’en est pas moins averti de la complicité sournoise que la majorité des Allemands nourrit envers celui qu’ils n’hésitent pas à nommer leur« frère Hitler ». La violente barbarie du Troisième Reich n’a cependant rien à voir avec l’effondrement de la politique et de la morale dans l’ancien empire communiste, effondrement que n’ignorent d’ailleurs pas réellement les démocraties occidentales. Aucun lien direct, par conséquent, entre le journal de Thomas Mann et mes interrogations intimes, trop intimes, si ce n’est cette position dehors-et-dedans et cette inquiétude devant un bouleversement dont les méfaits nous atteignent de plein fouet, mais aux suites aujourd’hui imprévisibles.
En définitive, et malgré tout, je m’accroche au français - « autre langue » pour moi - parce qu’un des plus grands écrivains français, peut-être le plus grand du XXe siècle, était un traducteur. Je pense naturellement à Proust : « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère [3] » ; « Le seul livre vrai, un grand écrivain n’a pas à l’inventer puisqu’il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d’un écrivain sont ceux d’un traducteur [4]. »
De l’étranger que je définis comme un traducteur, à l’écrivain traduisant l’univers sensible de sa singularité : sommes nous tous des étrangers ?
Je sais combien ce cri pathétique des consciences humanistes, soucieuses de lutter contre l ’« exclusion », peut paraître démagogique et agaçant. Nous ne sommes pas tous des étrangers, et tant d’écrivains ont pu être non seulement des idéologues fervents de l’identité nationale, nationalistes, voire fascistes ! Mais, très sincèrement, hors de ces dérapages, se considérer comme indissolublement retenus par le cordon ombilical qu’est la langue nationale et ses codes traditionnels, oui !
Beaucoup ne soupçonnent même pas que le mot « étranger à la langue [5] »,que Mallarmé souhaitait écrire, et la « traduction du sensible », que Proust visionnait, loin d’être des exceptions extravagantes, sont au cœur même de l’acte créateur.
Je voudrais insister ici sur cette parenté intrinsèque et souvent insoupçonnable entre l’étranger et l’ écrivain pour les réunir tous deux dans une commune et cependant toujours singulière expérience de traduction.
J’irai même plus loin. Si nous n’étions pas tous des traducteurs, si nous ne mettions pas sans cesse à vif l’étrangeté de notre vie intime - ses dérogations aux codes stéréotypés qu’on appelle des langues nationales - pour la transposer à nouveau dans d’autres signes, aurions-nous une vie psychique, serions nous des êtres vivants ? « S’estranger » à soi-même et se faire le passeur de cette étrangeté continûment retrouvée : n’est-ce pas ainsi que nous combattons nos psychoses latentes, et réussissons là où le psychotique ou l’autiste échouent, c’est-à-dire à nommer le temps sensible ? C’est dire qu’à mon avis parler une autre langue est tout simplement la condition minimale et première pour être en vie. Pour retrouver l’alphabet, le sens de la lettre, et les traduire et retraduire au-delà d’incroyables renaissances.
Une version de ce texte a paru dans La Nouvelle Revue française, n° 601, juin 2012.

D’Antigone à Benoît XVI ? : portrait chinois de Julia Kristeva, philosophe, psychanalyste, sémioticienne, écrivaine.

Pulsions du temps, de Julia Kristeva. Éditions Fayard, 2003 - 799 pages, 28 euros.
Le lecteur pourra trouver autant d’invitations à la lecture des jalons de l’œuvre de Julia Kristeva dans cette recension de conférences, hommages, articles de revues, tribunes de presse prononcés ou publiés de 1986 à 2012. Pulsions du temps se lit aussi comme le recueil d’une pensée protéiforme, fertilisée par le croisement de la psychanalyse avec la philosophie, la sémiotique et de grands enjeux du siècle. L’ouvrage est encore le portrait chinois d’une « femme d’origine bulgare, de nationalité française, citoyenne européenne et d’adoption américaine » qui définit ainsi sa « place » au monde. [...]
Michel Guilloux,
L’Humanité, 02/05/2013Quatrième de couverture
« Où est le temps, existe-t-il encore ?
Je vous propose d’ouvrir la question du TEMPS.
Jamais le temps n’a été aussi compact, uniformisé, fermé comme il l’est désormais à la surface globalisée de l’hyperconnexion. Mais jamais non plus il n’a été aussi ouvert et multiple : incessant battement d’avènements, amorces, émergences, éclosions perpétuelles.Je retrouve ici des expériences singulières : dans l’érotisme maternel et dans celui de la foi religieuse, j’ose parier sur la culture européenne et sur l’humanisme à refonder, je découvre un destin de la psychanalyse en terre d’Islam et en Chine.
Je n’ai pas de réponses toutes faites et n’en donne pas une fois pour toutes. Je déplie des vérités hic et nunc telles que je les vis et les pense.Je vous présente mes compagnons de route : Antigone et Philippe Sollers, Jean-Jacques Rousseau et Jacques Lacan, Jackson Pollock et Emile Benveniste ; Simone de Beauvoir et Thérèse d’Avila.
Un livre sur la Vérité découverte par le Temps ? Plutôt une expérience du temps scandée par des événements, des étonnements, rebonds de surprises et de renaissances. »

Julia Kristeva, oser l’humanisme aujourd’hui !
Le Point.fr - Publié le 10/06/2013
Dans son dernier ouvrage "Pulsions du temps", la linguiste et psychanalyste offre une réflexion magistrale sur notre relation au présent.
Par DANIEL SALVATORE SCHIFFER & GUERRIC PONCET
Julia Kristeva, linguiste et psychanalyste, docteur honoris causa de nombreuses universités, est un nom qui compte au sein de l’intelligentsia française et internationale. Ses prestigieuses récompenses en témoignent : prix Holberg (2004) pour les sciences humaines ; prix Hannah Arendt (2006) pour la pensée politique ; prix Vaclav Havel(2008) pour la culture européenne. Preuve en est, également, son dernier livre, Pulsions du temps : une réflexion magistrale, d’une brûlante actualité, sur notre relation au présent !
Daniel Salvatore Schiffer : Vous vous penchez, dans votre dernier essai intitulé Pulsions du temps, sur la question du temps. Qu’est-ce à dire ?
Julia Kristeva : Nous vivons aujourd’hui, à travers l’hyperconnexion planétaire, qu’elle soit due à Internet, aux réseaux sociaux ou aux médias, dans un monde de plus en plus globalisé. Ce fait a pour conséquences principalement deux choses, qui s’avèrent à la fois - le paradoxe n’est qu’apparent - contradictoires et complémentaires. D’une part, le temps ne nous est jamais apparu aussi uniforme, compact, fermé, répétitif, comme replié sur lui-même, sans réelles perspectives. D’autre part, jamais il ne s’est révélé aussi ouvert, multiple, diversifié, inconnu, changeant, riche de potentialités les plus variées. Le temps, aujourd’hui, ne s’est pas seulement accéléré. Il engendre également, et peut-être surtout, une invraisemblable quantité d’événements, mais dont le sens réel et profond, cependant, se révèle souvent difficile, dans l’immédiat, à comprendre, à interpréter à sa juste valeur. D’où, ainsi que mon livre nous y engage, la nécessité de pouvoir le décrypter.
Un ouvrage à l’usage de vos contemporains, en somme !
C’est là, en tout cas, son ambition. Ce livre questionne notre relation au présent et, donc, au monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. C’est la teneur de ce rapport, précisément, que j’interroge. Telle est la raison pour laquelle je parle, dans cesPulsions du temps, de "reliance" : concept censé expliquer le lien existant entre la formation de la conscience, qu’elle soit individuelle ou collective, et le temps.
N’est-ce pas là une manière de reprendre, en l’actualisant, ce que Montaigne nomme dans sesEssaisla "contexture" de notre relation au temps et, de manière plus spécifique, à notre présent justement ?
Absolument ! Mais, plus concrètement encore, je pense, pour ma part, que le présent, fort des leçons qu’il peut lucidement tirer de son passé, y compris dans ce qu’il a eu de plus tragique, peut aider les jeunes générations d’aujourd’hui, et même celles à venir, à sortir de ce délitement social et individuel dans lequel elles sont actuellement enferrées, ainsi qu’en témoigne, par exemple, la violence de certaines banlieues, dites pudiquement "sensibles".
Lorsque vous évoquez les tragédies du passé, auxquelles faites-vous plus précisément allusion ?
Je me réfère là, bien évidemment, à ces deux immenses tragédies que furent, au XXe siècle, le stalinisme, avec le goulag et ses millions de morts, et le nazisme, avec ses camps de concentration et son génocide à l’encontre des juifs, ou d’autres minorités, tels les tziganes ou les homosexuels. L’enseignement qu’en a tiré la grande philosophe Hannah Arendt dans son étude sur les origines du totalitarisme, avec notamment cette notion qu’elle appelle la "banalisation du mal", est, de ce point de vue-là, très précieux, par-delà son aspect certes dramatique, lequel n’a par ailleurs pas manqué de susciter un vif débat au sein des élites intellectuelles. Ce qu’il faut retrouver impérativement, à l’instar de cet "impératif catégorique" dont parlait, quoique en un autre contexte, Emmanuel Kant, c’est le sens de l’humain, sans lequel il n’est point, c’est une évidence, d’humanité qui vaille ni ne tienne.
La cinquième section de votre livre, lequel se subdivise en sept parties, a pour très emblématique titre, précisément, "Humanisme" !
Oui. Si on considère l’histoire de la civilisation occidentale, on constate que notre modernité se caractérise par un prodigieux désir de savoir, lequel s’avère certes extrêmement positif, mais peut engendrer également de nombreux effets pervers. Ce que je m’efforce donc de comprendre, dans cette partie de mon livre, c’est la continuité pouvant exister entre le progrès scientifique et technologique de nos sociétés contemporaines et le projet intellectuel des grands humanistes du passé, depuis un penseur tel qu’Érasme de Rotterdam, par exemple, jusqu’aux Lumières, Jean-Jacques Rousseau en particulier, en passant, bien sûr, par la Renaissance. En d’autres termes, j’essaie de mettre au jour, sur le plan historique, les motivations, conscientes ou inconscientes, de ce désir de savoir.
Vous y considérez la découverte de l’inconscient et donc, à travers le travail de Freud lui-même, l’émergence de la psychanalyse comme un nouvel humanisme. C’est d’ailleurs là le sujet de la deuxième partie, intitulée "Psychanalyse", de vosPulsions du temps !
Exactement ! Je crois la modernité analytique essentielle pour comprendre, en profondeur, les grandes mutations culturelles de notre monde, ses bouleversements politiques, dont l’évolution du concept de démocratie, fondamental pour le progrès de l’humanité. Je suis convaincue que l’expérience analytique peut être une réponse, à condition que, comme le soulignait Freud, elle se réinvente continuellement. C’est là ce que je soutiens dans le chapitre ayant pour titre "Freud : le fond du débat".
Cette importance que vous accordez, à juste titre, à la psychanalyse, dans ce très complet et pertinent diagnostic critique, au sens noble du terme, que vous posez sur le monde contemporain, se base elle-même sur les acquis, tout aussi fondamentaux, de la linguistique moderne, depuis Ferdinand de Saussure. C’était d’ailleurs Lacan lui-même, pour s’en référer à l’un des maîtres de la psychanalyse contemporaine, qui affirmait - c’est là l’une des formules les plus célèbres au sein de ce courant philosophique que l’on appelait le "structuralisme" - que "l’inconscient est structuré comme un langage" !
Oui. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard, pour la femme d’origine bulgare que je suis, si mon livre s’ouvre, précisément, sur un chapitre intitulé "Mon alphabet, ou comment je suis une lettre". Mais, afin d’élargir davantage encore cet important débat, et de l’asseoir sur un socle plus ferme encore, il est évident que c’est cette intime relation entre la psychanalyse et la linguistique qui permet de penser aujourd’hui, en grande partie, les apports réciproques entre plusieurs continents, dont ceux existant, par exemple, entre l’Europe et la Chine, ou l’Europe et l’Islam. Ainsi, en ce qui concerne l’Europe, je crois que la France, pays où je vis principalement, peut jouer un rôle capital, grâce à sa diversité culturelle, dans ce dialogue interculturel. Mais à une condition, toutefois : il faut que la France retrouve le sens de cet humanisme qui l’a portée pendant des siècles.
Mais ne pensez-vous pas que, au-delà même d’une nation comme la France, ce soit une entité telle que l’Union européenne, dont la France est un des six pays fondateurs, qui porte, aujourd’hui, ce projet humaniste ?
Certainement ! Je pense cependant que le projet européen, malgré ses bonnes intentions de départ, s’avère aujourd’hui encore très imparfait, malheureusement. Je vois donc à ce projet humaniste une autre alternative : celle de la francophonie, injustement négligée et pourtant véritablement porteuse, quant à elle, de cette magnifique ambition culturelle.
Cet ouvrage,Pulsions du temps, se présente donc comme une synthèse magistrale, tout en restant accessible à un large public, de votre oeuvre. La première partie de ce livre s’intitule "Singulières libertés". Qu’entendez-vous par là ?
L’universel, l’un des principaux idéaux de tout humaniste digne de ce nom se conjugue toujours et nécessairement, afin d’éviter l’écueil du totalitarisme idéologique, au singulier. Le paradoxe, là aussi, n’est qu’apparent ! Dans ces "singulières libertés", je parle donc, avant tout, de l’expérience individuelle en tant que centre d’un réseau de relations, notamment à travers la langue, à l’autre, au sens où un philosophe tel que Levinas l’entendait. Mais pas seulement, car il y a différents types de langage : parlé et écrit, bien sûr, mais aussi pictural, sculptural, poétique, musical... bref, artistique. Ainsi verra-t-on apparaître successivement, en cette partie de mon livre, des écrivains et théoriciens du langage tels Philippe Sollers, Roland Barthes ou Émile Benveniste, mais aussi des artistes plasticiens tels Jackson Pollock et Louise Bourgeois, des critiques littéraires ou des universitaires, tels Marcelin Pleynet et Jacqueline Risset.
[...]
Après "l’ère du soupçon", qu’incarnèrent, à la charnière des XIXe et XXe siècles, Marx, Nietzsche et Freud, quant à leur conception de la raison, voici venir donc, au XXIe siècle, "l’ère du pari", quant à cette nouvelle définition de l’humanisme, selon Julia Kristeva ? C’est d’ailleurs là ce que donne à penser le discours, intitulé "Dix principes pour l’humanisme du XXIe siècle", que vous avez prononcé à l’université de Rome III, le 26 octobre 2011, puis, le lendemain, en présence du pape Benoît XVI, à la cathédrale d’Assise !
J’aimerais, en tout cas, le penser ! L’ère du soupçon ne suffit plus. L’homme ne fait peut-être pas l’Histoire, mais il n’empêche que l’Histoire c’est l’homme. Davantage : c’est nous ! Voici donc venu en effet, face à la grave crise que nous vivons actuellement, à tous les niveaux (spirituel, matériel, culturel, philosophique, moral, religieux, économique, financier, social, politique...), l’ère du pari : parier sur le renouvellement continu des capacités des hommes et des femmes à croire ou, mieux, à savoir ensemble. Tel est ce nouvel humanisme - qui n’est pas une utopie, mais bien un processus de refondation permanente - que j’appelle de mes voeux : lui seul pourra sauver l’humanité de ses vieux et nouveaux démons !
Comment toutefois définir, de manière plus précise et concrète, plus pragmatique et moins théorique, l’humanisme ?
L’humanisme est, comme j’ai l’habitude de le dire, un grand point d’interrogation à l’endroit du plus grand sérieux. C’est au sein de la tradition européenne en ce qu’elle a de plus élevé - extraordinaire synthèse des civilisations grecque, juive et chrétienne - qu’il convient de le rechercher. Cet essai, Pulsions du temps, se veut donc aussi, et peut-être surtout, un pari sur le temps de ce que je nomme le corpus mysticum.J’ose parier là, en effet, sur la culture européenne, la seule apte, peut-être, à refonder, tout en lui redonnant ses lettres de noblesse, l’humanisme, présent et à venir !
(*) Publié chez Fayard (Paris).
N.B. : Le titre de cet entretien,Oser l’humanisme aujourd’hui !, est aussi celui de la conférence que Julia Kristeva prononcera, le 17 septembre 2013, lors de la remise, à l’Académie royale des Beaux-Arts de Liège (Belgique), du "prix littéraire Paris-Liège", récompensant, chaque année, un essai, écrit en français, en sciences humaines

« L’Europe est le seul endroit au monde où l’identité n’est pas un culte mais une question »
Libération, 27 juin 2013
Par Julia Kristeva Psychanalyste etécrivaine.
Recueilli par Catherine Calvet et Cécile Daumas
Elle le dit elle-même, elle n’entre pas dans les cases. Psychanalyste, sémiologue, écrivaine, Julia Kristeva fait partie de ces rares intellectuels qui déploient une pensée « globale ». A l’occasion de la sortie de son livre, Pulsions du temps (Fayard), elle repense, à l’aune de la philosophie, de la littérature ou de la théorie freudienne, tout ce qui secoue la société : les identités, la laïcité, l’universel et le rapport au singulier. Donnant des conférences à Oxford comme à la New School for Social Research de NewYork, elle croit pleinement que « le multilinguisme européen » peut lever les crispations identitaires. Constatant les limites du « tout-politique », elle estime nécessaire de refonder un humanisme, quitte à faire débat en rebattant les frontières entre politique et religieux. En bonne psychanalyste, ne rappelle-t-elle pas que le besoin de croire, chez l’homme, précède le religieux et finalement le désir de savoir.
Dans votre dernier livre, vous vous présentez comme citoyenne européenne, de nationalité française, d’origine bulgare, d’adoption américaine...
Et je suis presque prête à croire les étrangers qui voient en moi une intellectuelle et écrivaine française ! Depuis presque cinqdécennies je vis en exil. Une étrangère. Une « fille qui vient d’ailleurs » ; « I don’t fit », écrit Hannah Arendt. Je dis pour ma part : « Nulle part on n’est plus étranger qu’en France, nulle part on n’est mieux étranger qu’en France. » Je n’appartiens ni aux collèges ni aux académies, je suis en transit à l’université, atypique chez les psychanalystes. Je ne corresponds pas, je ne m’adapte pas. « Etre ou ne pas être » se dit en français « En être ou ne pas en être », ironise Marcel Proust : pas de salut sans appartenance. Mais nous avons développé une forme de pensée spécifiquement européenne qui consiste à problématiser les identités et les appartenances. Je ne suis pas « dedans », je me tiens à la frontière. Dès lors, l’étrangeté - qui est aussi souffrance - devient une chance.
Cette position d’entre-deux a-t-elle influencé votre mode de pensée ?
Impossible d’interroger sans distance. Depuis Platon, et jusqu’à la phénoménologie et la psychanalyse, la vie de l’esprit est une vie « étrangère » qui ne peut éclairer son objet de réflexion qu’en étant autre et extérieure à lui. Dans la Bulgarie totalitaire de mon adolescence, cette position me paraissait évidente : impossible de penser sans être « étranger dans cet étrange pays qu’est mon pays lui-même ». Ma mère, qui avait fait des études de biologie, était agnostique ; mon père était croyant, assassiné dans un hôpital où l’on faisait des expériences sur les vieillards, quelques mois avant la chute du mur de Berlin ; et moi, j’étais aux Jeunesses communistes, comme tous les écoliers. Je me suis éveillée dans la période de « dégel » (qui deviendra plus tard une « perestroïka »), de remise en question du marxisme. Nous avons repris la protestation des formalistes et postformalistes russes, ancêtres du structuralisme : l’humain n’est pas seulement déterminé par l’économie et la lutte des classes. Il est un être parlant qui délire, questionne, crée un carnaval de sens et de non-sens, mieux, un kaléidoscope, une polyphonie.
A mon arrivée à Paris, grâce à l’expérience littéraire de Tel Quel avec Philippe Sollers et les séminaires de Barthes et de Lacan, la découverte freudienne s’est imposée à moi. Le mal-être sur fond d’inconscient, le malaise dans la civilisation ne sont pas solubles dans une « solution ». La crise endémique actuelle le confirme. Il n’y a pas de solution, mais il est possible de questionner chaque « valeur », « norme » ou « pouvoir », chaque « identité » sexuelle, nationale ou linguistique. C’est à partir de cette réévaluation des désirs, des souffrances, des amours et des haines qu’une reconstruction s’amorce et que des identités provisoires tissent de nouveaux liens. L’homme et la femme en analyse sont des révoltés. « Analyse » signifie une expérience intérieure de décomposition-déstructuration et de recommencement, de renaissance.
Mais l’identité doit aussi être un repère fixe...
L’identité est notre antidépresseur, ellenous est indispensable. « Qui suis-je ? » étant la vraie question, une réponse, forcément provisoire, est nécessaire. La personne qui vient en analyse ne sait pas qui elle est. Blessée, disloquée ou défaite, j’essaie d’entendre sa déshérence sous la revendication d’une identité qui se déclare féminine, masculine, juive, musulmane, catholique, homosexuelle, hétérosexuelle. Cette acceptation de la blessure et du désir indicibles conforte et répare le narcissisme, et permet d’aller plus loin, jusqu’à remettre en question, dans un second temps, les certitudes identitaires elles-mêmes. L’identité est donc un moment incontournable de la constitution de l’humain, mais elle risque de s’ériger en absolu, en dogme. Et, alors, les conflits identitaires dégénèrent en crispations communautaires et guerres de religions.
L’Europe peut-elle répondre à ces crispations ?
L’Europe est le seul endroit au monde où l’identité n’est pas un culte mais une question, non seulement grâce à la pluralité des langues et des cultures, mais aussi à la spécificité de notre héritage grec, juif et chrétien. La culture est le grand atout de l’Europe, pourtant elle ne figure pas dans le traité de Rome : est-elle à ce point une évidence, ou bien l’Europe, sortant en lambeaux de la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle eu honte de ses plaies ? Depuis, on multiplie les « programmes » pour le « patrimoine culturel ». Mais existe-t-il une culture européenne ? Laquelle ? Après avoir succombé aux dogmes identitaires jusqu’aux crimes, et peut-être aussi parce qu’il a succombé et en a fait l’analyse mieux que tant d’autres, un « nous » européen est en train d’émerger, pour lequel l’identité est une inquiétude questionnante : à contre-courant des certitudes identitaires qui préparent toujours et encore de nouvelles guerres.
Mais les politiques, soumis à l’économie et à la finance, ont perdu de vue la question de la civilisation. Ils ont peur de parler d’Europe dans les campagnes électorales. Les intellectuels, dont certains sont encore prompts à s’engager, se font rares sur le chantier culturel européen. Ils portent une grande responsabilité dans la crise européenne actuelle. En revanche, je soutiens que les peuples européens, les Grecs, les Polonais, et même les Français, bien que tous choqués par la crise qu’ils identifient avec l’Europe, se sentent fiers d’appartenir à sa culture prestigieuse. Un trésor flou et peu rentable qu’ils ne sauraient définir mais qui les définit et fascine aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières. Un désir d’Europe existe en dehors de notre continent, je le constate en Amérique latine, en Chine... [6]
Mais peut-on concrètement construire une identité européenne ?
J’admire mes étudiants européens, une nouvelle espèce d’individus kaléidoscopiques. Par exemple, un jeune Norvégien, en cycle Erasmus, parle anglais couramment, apprend le chinois et prend des cours en français sur le génie féminin. Le multilinguisme n’est plus seulement une utopie, c’est une réalité. Il pourrait être un trait significatif de l’identité européenne en train de se construire.
[...]
Il faudrait donc tenir compte des particularités, individuelles ou nationales ?
Oui, mais sans concession. En sachant traduire nos valeurs dans les langues de nos partenaires. A condition de connaître leur culture et leurs valeurs, et de ne pas exporter mais transposer, dans un dialogue permanent. J’ai ardemment défendu une psychanalyste syrienne qui avait étudié la psychologie à Paris-VII : Rafah Nached. Accueillie par des jésuites français et hollandais, elle organisait des thérapies de groupe contre la peur et, en quittant la Syrie pour Paris, elle fut emprisonnée, suspectée d’agir contre le gouvernement. Cette chercheure avait noté que les traductions de Freud déformaient sa pensée car elles utilisaient une langue arabe exprimant la sexualité en métaphores empruntées à la mort. Ses lectures de Corbin et Massignon, Bataille et Lacan lui ont permis de découvrir la mystique arabe du XIIesiècle, qui décrit le lien à Dieu dans un langage amoureux et sensible. Elle a alors décidé de créer un groupe de psychanalystes arabes pour retraduire Freud avec les mots du mystique Hallâj. Voici le formidable exemple d’une double culture et d’un dialogue entre la modernité européenne et un monde arabe rendu à sa complexité souvent censurée. Ou comment être psychanalyste et musulmane. Sans reniement. Où est alors passé l’universel ? Il s’est pluralisé, appelons le « multiversel ». C’est un emprunt métaphorique aux cosmologies des astrophysiciens modernes, qui découvrent des galaxies où l’espace n’est pas en trois dimensions et où les lois universelles se déclinent différemment. L’univers ne serait pas « un », mais multivers. Je risque une image : ou bien nous laissons la globalisation uniformiser, ou bien l’universalité des droits de l’homme s’invente autrement. La pensée européenne favorise cette multiversalité. « Traduisons-nous » !
Mais cette séduisante et complexe idée d’universel pluralisé peut-elle devenir un projet politique...
Vous touchez là à l’une des raisons majeures de la crise politique actuelle : la politique gère les situations mais ne résout pas les problèmes. On l’a vu avec la loi sur le mariage pour tous. Elle a ouvert des chantiers immenses : le sens de la famille varie dans l’histoire des sociétés humaines ; la différence sexuelle demeure un problème majeur du pacte social ; la procréation est au zénith de la jouissance sexuelle ; la filiation impacte la capacité de faire sens,etc. La politique peut-elle y répondre ? Nous apercevons ici les limites de ce qu’il faut bien appeler la « religion politique », issue d’une certaine interprétation de la philosophie des Lumières.
Laquelle ?
Je pense à la séparation du politique et du religieux qui structure les Etats démocratiques et les institutions internationales : elle est salutaire et irréversible, elle évite aux démocraties avancées tant d’abus obscurantistes. Mais la ferveur politique, qui a cru résorber le religieux, a explosé au XXesiècle sous la forme du totalitarisme, et se réduit au XXIe à un moralisme compréhensif de la crise économique et financière. En divorçant de la théologie, le politique semble oublier que la dimension éthique hérite, en dernière instance, du Dieu de Spinoza « s’aimant lui-même d’un amour infini », et du « Corpus mysticum » de Kant, où le libre arbitre cherche à « s’unir avec soi-même et avec le tout autre ».
Pour cette raison, vous insistez sur la nécessité de refonder l’humanisme...
Balzac écrivait que « rien n’est plus calomnié dans ce bas monde que Dieu et leXVIIIesiècle ». Aujourd’hui, je souhaite ajouter : et l’humanisme. On le brocarde, on le réduit à une survivance métaphysique quand on ne le confond pas avec la corruption qui fleurit dans le « droit-de-l’hommisme » ou avec les « systèmes » de « radicalisme sécularisé » (Auguste Comte) ou autre « moraline » (dont parle Nietzsche). De fait, l’humanisme n’existe qu’en tant que processus de refondation permanente de l’éthique, ne se développant qu’à condition de ruptures et d’innovations . La mémoire n’est pas du passé : la Bible, les Evangiles, le Coran, le Rigveda, le Tao nous habitent au présent. Pour que l’humanisme puisse se développer et se refonder, le moment est venu de revenir aux codes moraux construits au cours de l’histoire : pour les problématiser en les rénovant au regard des nouvelles singularités. L’Homme majuscule n’existe pas, il n’est ni La « valeur » ni La « fin » suprême. Les hommes ne font pas l’histoire, mais l’Histoire, c’est nous. Et, puisque nous sommes les seuls législateurs, c’est la mise en question de notre situation personnelle, historique et sociale qui nous permet de décider de la société et de l’histoire.
Mais n’est-il pas risqué de repenser la laïcité en regard de l’héritage religieux ?
Un événement s’est produit en Europe au XVIIIesiècle et plus particulièrement en France : la sécularisation. Le fil de la tradition, comme disent Tocqueville et Hannah Arendt, a été coupé. Faut-il rappeler qu’il n’a eu lieu qu’en Europe ? C’est un sommet de l’histoire de l’humanité qui a permis de libérer les esprits et les corps. De là viennent la philosophie de la révolte, les mouvements de libération des classes opprimées, la libération des femmes, l’essor des sciences... Ni Dieu ni maître, et une éthique à refonder sans fin, face aux abus des intégrismes et aux risques de la liberté. Ne réduisons pas ce mouvement, de cette alchimie qu’est la philosophie des Lumières, à une feuille de route pour tous.
Nous devons nous approprier la mémoire des cultures, religions comprises, qui nous précèdent et qui imprègnent les comportements, les mœurs, les discours, les arts et les lettres. Pour éclairer et réévaluer les codes anciens, désamorcer les dogmes intégristes, esquisser des passerelles entre les diversités émergentes, et ainsi seulement amorcer des éthiques partageables. Si l’enseignement de la morale laïque à l’école devait se résumer à une liste de règles à respecter, il trahirait l’esprit d’invention et de créativité que revendique la laïcité, et serait de surcroît un projet pédagogique irréalisable, voué à l’échec. Car il n’y a pas une morale, mais une histoire des morales, de la Grèce antique à la Chine en passant par l’islam, le christianisme, le judaïsme. C’est tout cela que nous ne connaissons plus. Si la laïcité est héritière de Spinoza ou des Lumières, on se doit d’intégrer cette historicité pour se refonder.
[...]
Crédit Libération

Une conversation avec Julia Kristeva
Dans le cadre des séminaires de la revue La Règle du Jeu, c’était le dimanche 28 avril 2013, à l’occasion de la parution de son dernier livre Pulsions du temps (Fayard, 2013, 780 pages). Une rencontre animée par Alexis Lacroix.
Radio J. Julia Kristeva au sujet du voyage philosophique
L’émission Philosophies de Blandine Kriegel.

Invitée : Julia Kristeva au sujet du voyage philosophique. Chroniqueurs : le Dr Marielle David, pédopsychiatre ; le doyen François Guéry, philosophe ; l’historien Alexandre Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix.
Radio J, 7 janvier 2021
[1] Cf. ici même, « Diversité, c’est ma devise », p. 601.
[2] Cf. Thomas Mann, Allemagne ma souffrance, in Les Exigences du jour, Grasset, 1976.
[3] Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1971, p. 305.
[4] Idem, Le Temps retrouvé, in À la recherche du temps perdu, Œuvres complètes, op. cit., t. IV, p. 469.
[5] Cf. Stéphane Mallarmé, Variations sur un sujet, Crise de vers, in Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1945, p. 368.
[6] un désir d’Europe qui existe aussi sur notre continent, en témoignent dans l’actualité, la Croatie qui devient le 28ème Etat européen, les républiques russes qui frappent à la porte, la réouverture des négociations avec la Turquie. (note pileface)



 suivi de Entretien sur Radio J : "Au sujet du voyage philosophique"
suivi de Entretien sur Radio J : "Au sujet du voyage philosophique"
 Version imprimable
Version imprimable

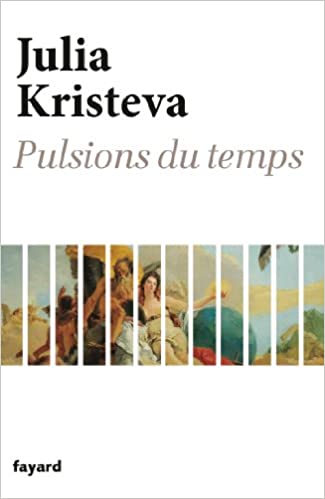
 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



1 Messages
La première écriture, la proto-graphie, fut universelle comme la première langue fut universelle.
Tous les vestiges archaïques se ressemblent.
L’écriture fut d’abord formée de signes idéographiques.
Il est si naturel que l’écriture ait été, au début, la représentation d’une idée par un dessin, d’un objet par l’image de l’objet, qu’on ne conçoit même pas que cela ait pu commencer autrement.
D’autant plus que ce système d’écriture existe encore dans certains pays, notamment en Chine.
Mais il restait à savoir comment l’écriture idéographique est devenue alphabétique.
Une des choses qui ont le plus frappé les premiers humains, c’est la différence des sexes. Il est bien certain qu’ils ont représenté le garçon par le signe « I » et la fille par le signe « O » ; et ces deux signes primordiaux qui ont servi à désigner le masculin et le féminin sont l’origine des lettres ; ils sont arrivés, en se modifiant de différentes manières, à former l’alphabet. Les lettres sont faites de « I » et de « O » combinés.
Aujourd’hui encore, nous trouvons ces deux lettres dans le « symbole power » (On/Off), cette icone qui permet de changer l’état d’un appareil électronique.
Le système d’écriture ionien, en les combinant de 25 manières, en forma un alphabet, le même dont nous nous servons.
Quand la pudeur sera née, beaucoup plus tard, on dira que ces deux signes représentent une baguette et une bague.
On les retrouve partout sous cette idée nouvelle et ils deviennent des symboles.
Le système du symbole féminin (la bague) se développe puissamment en Europe.
Annules (anneau) est un mot dérivé du nom d’une grande Déesse : Ennia.
Sortija (en espagnol) signifie sortilège des magiciennes. Ring (en anglais) vient de Rhénus, le pays où naquit la civilisation gynécocratique.
La bague servira à sceller les décrets.
Dans certaines langues, comme l’hébreu, le « I », devenu le « Y o d », servira à représenter le sexe masculin.
C’est cette lettre « I » qui sera représentée plus tard par les Obélisques, alors que le « O » sera représenté par les arcs de triomphe.
« Oros », la lumière en hébreu, « Horus » en égyptien, le fils d’Isis, dans le Tarot les « or » sont les symboles de l’Esprit féminin.
En Asie, on relia ces deux signes « I » et « O » par un trait, un lien, mettant d’un côté la pointe de « I », de l’autre l’anneau. Ainsi rattachés, cela forma une flèche effilée par un bout, et arrondie par l’autre en forme d’anneau.
Ces flèches se disaient en saxon « Log », d’où dérive le mot pélasgique « Logos ».
Le système d’écriture assyrienne se fonda sur ces signes.
Quoi d’étonnant que la différenciation sexuelle ait été la grande préoccupation de ces primitifs, et que toute la symbolique s’y soit rapportée ?
Les lettres carrées semblent dérivées aussi des signes par lesquels les Orientaux désignaient les sexes.
Le triangle la pointe en bas y représente le sexe féminin, c’est le pubis, et la pointe en haut le sexe masculin. Puis on les réunit, ce qui déjà devient un signe plus compliqué.
Les deux natures masculine et féminine sont représentées unies dans un signe « N » formé de deux branches unies par un trait qui va de haut en bas, de l’esprit au sexe. C’est la lettre Aleph, « א » des Hébreux. C’est cette même lettre qui deviendra le « H » quand la ligne qui unit les deux branches sera mise horizontalement (dans le régime de l’égalité des sexes).
Dans notre alphabet européen, nous la retrouvons dans le « A » majuscule formé de deux branches reliées par un trait.
Dans l’alphabet samaritain, le daleth (D) représente le vagin.
Les premiers signes idéographiques « I » et « O » sont restés longtemps dans les usages pour désigner les sexes.
On les retrouve dans les glyphes du tarot. Le masculin est représenté par « I » (une épée qui pénètre) et, comme conséquence physiologique, la force symbolisée par une massue (la massue d’Hercule), qui devient un bâton dans les cartes modernes.
Le sexe féminin est symbolisé par une coupe et, comme conséquence, l’or.
Il s’agit du primitif jeu de cartes égyptien, encore en usage en Espagne. Le jeu français a fait de l’épée le pique et de la massue le trèfle, de la coupe le cœur et de l’or le carreau.
Voir en ligne : FAITS ET TEMPS OUBLIÉS