Martin Heidegger
Le commencement de la philosophie occidentale
Interprétation d’Anaximandre et de Parménide
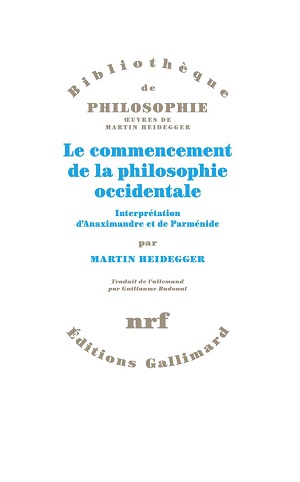 Trad. de l’allemand par Guillaume Badoual.
Trad. de l’allemand par Guillaume Badoual.
Collection Bibliothèque de Philosophie
Série Œuvres de Martin Heidegger
Gallimard Parution : 23-11-2017.
On sait l’importance de la réflexion sur les penseurs présocratiques dans la philosophie de Heidegger. Le cours traduit ici, datant de 1932, s’il n’est pas le premier à en faire mention, est le premier, en revanche, à les aborder sous l’angle du commencement qui s’y joue. C’est ce motif du commencement qui oriente la lecture que Heidegger entreprend de la très courte et dense « parole d’Anaximandre » et des fragments qui nous sont parvenus du Poème de Parménide d’Élée. Cette explication avec le commencement de la philosophie occidentale ne cessera plus, dès lors, d’accompagner le cheminement de la pensée de Heidegger. Elle constituera un second foyer de l’œuvre heideggerienne, après Être et temps : la recherche d’un autre commencement.
AVANT-PROPOS DU TRADUCTEUR
Le cours ici traduit, Le commencement de la philosophie occidentale. Interprétation d’Anaximandre et de Parménide, n’est pas le premier que Heidegger ait consacré aux penseurs présocratiques. En tant que jeune Privat-dozent, il inaugure son enseignement à Fribourg-en-Brisgau, lors du semestre d’hiver 1915-1916, par une leçon sur Parménide, qu’on retrouve dans un cours professé à Marbourg en 1922, au fil d’une explication des concepts aristotéliciens. Mais, en 1932, pour la première fois, comme l’indique expressément le titre annoncé, le motif du commencement oriente explicitement la lecture que Heidegger entreprend de la très courte et dense « parole d’Anaximandre » et des fragments qui nous sont parvenus du Poème de Parménide d’Élée.
Cette explication avec le commencement de la philosophie occidentale ne cesse dès lors d’accompagner le cheminement de la pensée de Heidegger. Citons, entre autres jalons : le cours de 1935, Introduction en la métaphysique, le grand cours consacré à Parménide en 1942-1943, enfin la lecture extrêmement attentive et méditée du début du fragment VI du Poème dans le cours non prononcé de 1951-1952, Was heißt denken ? (Qu’est-ce qui s’appelle penser ?). Quant à la sentence d’Anaximandre, on la retrouve dans la seconde partie d’un cours de 1941 intitulé Grundbegriffe (tome 51 de l’édition intégrale aux Éditions Klostermann, Concepts fondamentaux) ; surtout, son interprétation occupe la suite très dense de réflexions qui, au début des années 1940, ouvre le tome 71, Das Ereignis (De l’avenance), et se prolonge en 1946 dans le tome 78, intitulé La parole d’Anaximandre. Enfin, sous ce dernier titre, l’essai qui clôt les Chemins qui ne mènent nulle part est consacré à la lecture d’Anaximandre que Heidegger livre au public en 1950.
L’interprétation du commencement grec ne peut donc être considérée à part de la suite des traités tenus en réserve et non publiés, qui s’ouvre avec les Beiträge (Apports à la philosophie). Ces écrits sont apparus, au fur et à mesure de leur publication dans l’édition intégrale, comme le second foyer de l’œuvre de Heidegger après Être et temps ; ou, pour être plus exact, comme le même foyer autrement pensé, se découvrant révolutionnairement ouvert sur une pensée tout autre — un autre commencement.
À mi-chemin entre ces deux foyers, sous l’apparence académique d’une leçon sur Anaximandre et Parménide, le cours de 1932 fait voir clairement comment l’interprétation du commencement grec est indissociable de l’effort renouvelé de mesurer ce qu’exige de nous ce commencement, dès lors que nous lui faisons vraiment face. Cet effort est d’abord celui d’abandonner la sécurité de mauvais aloi du regard historisant, qui ramène aux fausses évidences des concepts de « nature », de « science » de « raison », ces premières paroles du matin grec, de sorte que plus rien ne peut nous atteindre de leur originalité radicale, ni de la manière dont en elle se met en marche une histoire — la nôtre — où l’être humain s’est reconnu comme celui qui fait face à l’étant dans son entier. Mais cela demande, plus essentiellement encore, que nous-mêmes nous demandions sérieusement qui nous sommes pour qu’une telle histoire nous concerne. En ce sens, la « considération intermédiaire » qui fait dans ce cours la transition entre l’interprétation d’Anaximandre et celle du Poème de Parménide en constitue le véritable centre de gravité. S’y retrouve l’accent très reconnaissable mis sur ce « nous » (voir le titre du § 9-a : « Qui s’enquiert du commencement ? Pour arriver à déterminer le “nous” »), qui, dans les leçons qui précèdent, accompagnent et suivent Être et temps, est tout autre chose qu’une simple convention rhétorique et académique. C’est en effet, au-delà même de la communauté de savoir effective du professeur Heidegger et de ses étudiants, chacun d’entre nous qui, à la lecture de ces interprétations, est sans cesse appelé, avec un souci pédagogique inlassable, à reconnaître ce qui est essentiellement en jeu dans le fait de faire de la philosophie. « Étudier la philosophie » n’a de sens qu’à condition de se comprendre vraiment soi-même dans la possibilité du questionnement philosophique et de saisir comment vient expressément y jouer ce qui fait le fond de notre être : cette entente d’être par laquelle notre être est pour soi-même en question. En revenant à sa manière à l’entente d’être qui est au cœur de l’œuvre de 1927, la « considération intermédiaire » fait entrer en résonance ce qui chez Anaximandre et Parménide est le lieu le plus profond, mais aussi le plus dérobé, du commencement : le rapport de l’être au temps.
Nous ne pouvons commencer avec le commencement — ouvrir un espace d’intelligence possible du commencement — que là où nous-mêmes nous employons sans cesse à laisser librement jouer en notre existence la dimension de ce là, où être nous atteint et devient question. Alors seulement, pour reprendre une image dont use Heidegger dans ce cours, la source nous redevient proche, et nous pouvons comprendre en quel sens ce qui parle dans ces paroles très anciennes — paroles qui disent, selon la formule de Jean Beaufret, les choses « au foyer de leur apparition » — peut véritablement être présent.
Les références bibliographiques entre crochets qui apparaissent au cours du texte sont établies par l’éditeur allemand.
Toute ma gratitude va à François Fédier : au-delà même du suivi très attentif, des suggestions et des conseils sans lesquels cette traduction n’aurait pas été possible, j’ai commencé à comprendre auprès de lui ce que signifie traduire. Qu’il soit remercié de m’avoir permis de me confronter à cette tâche, passionnante et difficile.
Mes remerciements vont également à Albain Duthoit, pour m’avoir aidé avec attention et amitié dans la relecture de la traduction.
Guillaume Badoual

LA RECENSION D’ÉTIENNE PINAT
Première partie pdf

Deuxième partie pdf

LIRE AUSSI : LE DIRE INITIAL DE L’ÊTRE DANS LA PAROLE D’ANAXIMANDRE




 Version imprimable
Version imprimable


